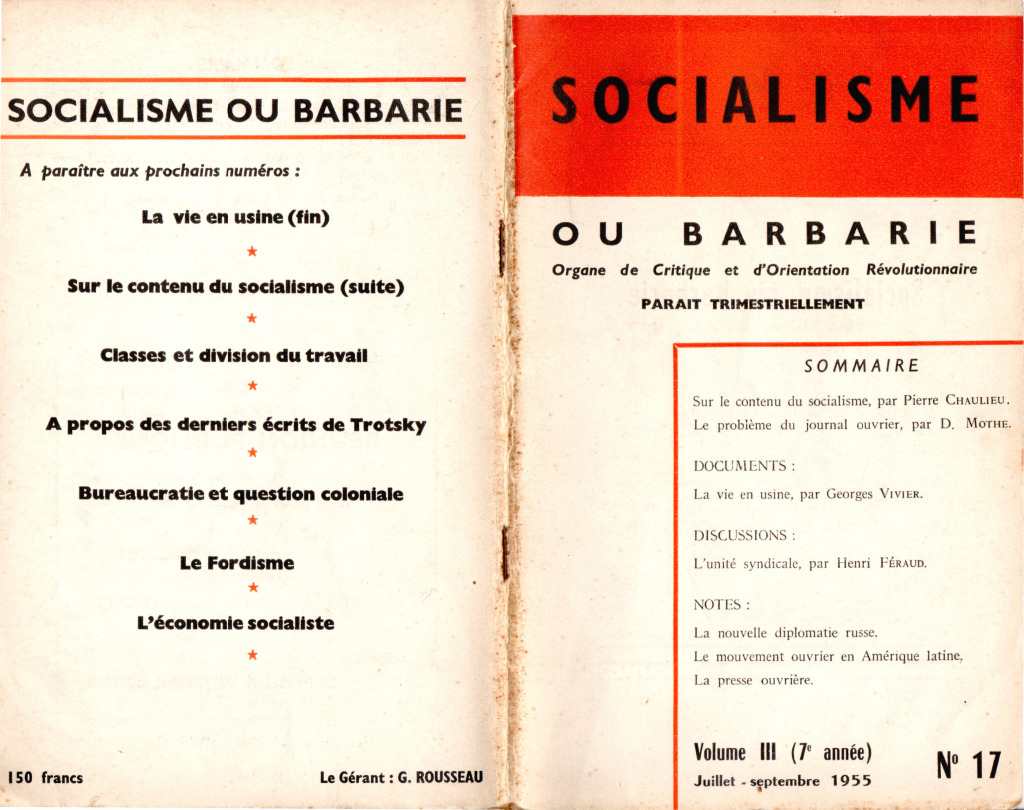CHAULIEU, Pierre: Sur le contenu du socialisme (I) 17:1-25 = FR1955A*
MOTHÉ, D.: Le problème d'un journal ouvrier 17:26-48
DOCUMENTS:
VIVIER, G.: La vie en usine (V) 17:49-60
DISCUSSIONS:
FERAUD, Henri: L'unité syndicale 17:61-65
NOTES:
MONTAL, Claude: La nouvelle diplomatie russe 17:66-71
LES LIVRES:
LABORDE, François: Le mouvement ouvrier en Amérique Latine de Victor Alba 17:72-77
La réunion des lecteurs de Socialisme ou Barbarie 17:78-80 = FR1955B
Lettre d'un camarade 17:80-82
La presse ouvrière (extraits de Correspondence et Tribune Ouvrière) 17:83-96
ANNONCE: Réunion publique 17:[97]
À PARAÎTRE AUX PROCHAINS NUMÉROS
Socialisme ou Barbarie - NO. 17 (JUILLET-SEPTEMBRE 1955)
Table des matières
Socialisme ou Barbarie
Paraît tous les trois mois
9, rue de Savoie, Paris-Vle
C. C. P. : Paris 11987-19
Comité de Rédaction :
P. CHAULIEU CI. MONTAL
Ph. GUILLAUME D. MOTHE A. VEGA
Gérant : G. ROUSSEAU
LE NUMERO
150 francs
ABONNEMENT UN AN (4 numéros)
500 francs
SOCIALISME OU BARBARIE
Sur le contenu du socialisme
Ce texte ouvre une discussion sur les problèmes programma-
tiques qui sera poursuivie dans les prochains numéros de Socia-
cialisme ou Barbárie.
1. De la critique de la bureaucratie à l'idée de l'autonomie
du prolétariat
Les idées exposées dans ce texte seront peut-être comprises
plus aisément si on retrace le chemin qui nous y a conduits.
En effet, nous sommes partis de positions où se situe nécessai-
rement un militant ouvrier ou un marxiste à une étape donnée
de son développement, donc que tous ceux à qui nous nous
adressons ont partagé à un moment ou un autre ; et si les concep-
tions exposées ici ont une valeur quelconque, leur développement
ne peut pas être le fait du hasard et de traits personneis, mais
doit incarner une logique objective à l'auvre. Décrire ce déve-
loppement ne peut donc qu'accroître la clarté et faciliter le
contrôle du résultat final. (1)
Comme une foule de militants d'avant-garde, nous avons com-
mencé par constater que les grandes organisations « ouvrières »
traditionnelles n'ont plus une politique marxiste révolutionnaire
ou ne représentent plus les intérêts prolétariens. Le marxiste
arrive à cette conclusion en confrontant l'action de ces organi-
sations (« socialistes » réformistes ou « communistes » stali-
niennes) avec la théorie qui est la sienne. Il voit les partis dits
* socialistes » participer aux gouvernements bourgeois, exercer
activement la répression des grèves ou des mouvements des peu-
ples coloniaux, être champions de la défense de la patrie capita-
(1) Dans la mesure où cette introduction reprend brièvement
l'analyse de divers problèmes déjà traités dans cette revue, nous
nous sommes permis de renvoyer le lecteur aux textes correspondants
publiés dans Socialisme ou Barbarie.
1
liste, oublier même jusqu'à la référence à un régime socialiste.
Il voit les partis « communistes » staliniens appliquer tantôt
cette même politique opportuniste de collaboration avec la bour-
geoisie, tantôt une politique « extrémiste », un aventurisme vio-
lent sans rapport avec une stratégie révolutionnaire conséquente.
L'ouvrier conscient fait les mêmes constatations sur le plan de
son expérience de classe ; il voit les socialistes prodiguer leur
effort pour modérer les revendications de sa classe et pour
rendre impossible toute action efficace visant à les satisfaire,
pour substituer à la grève des palabres avec le patronat ou
l'Etat ; il voit les staliniens tantôt interdire rigoureusement les
grèves (comme de 1945 à 1947) et essayer de les réduire même
par la violence (2) ou les faire insidieusement avorter (3) ;
tantôt vouloir imposer à la cravache la grève aux ouvriers qui
n'en veulent pas parce qu'ils la perçoivent comme étrangère à
leurs intérêts (comme en 1951-1952, avec les grèves « anti-amé-
ricaines »). Hors de l'usine, il voit lui aussi les socialistes et
les communistes participer au gouvernement capitaliste, sans
qu'il s'ensuive une modification quelconque dans sa condition :
et il les voit s'associer, aussi bien en 1936 qu'en 1945, lorsque
sa classe veut agir et le régime est aux abois, pour arrêter le
mo!ivement et sauver ce régime, en proclamant qu'il faut
« savoir terminer une grève », qu'il faut « produire d'abord et
revendiquer ensuite ».
Aussi bien le marxiste que l'ouvrier conscient, constatant cette
opposition radicale entre l'attitude des organisations tradition-
nelles et une politique marxiste révolutionnaire exprimant les
intérêts immédiats et historiques du proletariat, pourront alors
penser que ces organisations « se trompent » ou qu'elles « trahis-
sent ». Mais, dans la mesure où ils réfléchissent, où ils appren-
nent, où ils constatent que réformistes et staliniens se comportent
de la même manière jour après jour, qu'ils se sont comportés
ainsi toujours et partout, autrefois, maintenant, ici et ailleurs,
ils voient que parler de « trahison » et d'« erreurs » n'a pas
de sens. Il ne pourrait s'agir d'« erreurs » que si ces partis
poursuivaient les buts de la révolution prolétarienne avec des
moyens inadéquats ; mais ces moyens, 'appliqués d'une façon
cohérente et systématique depuis plusieurs dizaines d'années,
montrent simplement que les buts de ces organisations ne sont
(2) La grève d'avril 1947 chez Renault, la première grande explo
sion ouvrière d'après-guerre en France, n'a pu avoir lieu qu'après une
lutte physique des ouvriers avec les responsables staliniens.
(3) Voir dans le n° 13 de Socialisme ou Barbarie (pp. 34 à 46), la
description détaillée de la manière dont les staliniens, en août 1953,
chez Renault, ont pu « couler » la grève, sans s'y opposer ouver-
tement.
2
pas les nôtres, qu'elles expriment des intérêts autres que ceux
du proletariat. Dire, du moment où l'on a compris cela, qu'elles
« trahissent » n'a pas de sens. Si un commerçant, pour me vendre
sa camelote, me raconte des histoires et essaie de me persuader
que mon intérêt est de l'acheter, je peux dire qu'il me trompe,
non pas qu'il me trahit. De même, le parti socialiste ou stalinien,
en essayant de persuader le proletariat qu'ils représentent ses
intérêts, le trompent, mais ne le trahissent pas : ils l'ont trahi
une fois pour toutes, il y a longtemps, et depuis, ce ne sont
pas des traîtres à la classe ouvrière, mais des serviteurs consé-
quents et fidèles d'autres intérêts, qu'il s'agit de déterminer.
D'ailleurs, cette politique n'apparaît pas simplement cons-
tante dans ses moyens et dans ses résultats. Elle est incarnée
dans la couche dirigeante de ces organisations ou syndicats ; le
militant s'aperçoit rapidement et à ses dépens que cette couche
est inamovible, qu'elle survit à tous les échecs et qu'elle se per-
pétue par cooptation. Que le régime intérieur de l'organisation
soit « démocratique », comme chez les réformistes, ou dictatorial,
comme chez les staliniens, la masse des militants ne peut absolu-
ment pas influer sur leur orientation, déterminée sans appel par
une bureaucratie dont la stabilité n'est jamais mise en question ;
car même lorsque le noyau dirigeant arrive à être remplacé,
il l'est au profit d'un autre non moins bureaucratique.
A ce moment, le marxiste et l'ouvrier conscient se rencontrent
presque fatalement avec le trotskisme (4). Le trotskisme offre
en effet une critique permanente, pas après pas, de la politique
réformiste et stalinienne, depuis un quart de siècle, montrant
que les défaites du mouvement ouvrier Allemagne 1923,
Chine 1925-1927, Angleterre 1926, Allemagne 1933, Autriche
1934, France 1936, Espagne 1936-1938, France et Italie 1945-47,
etc... sont dues à la politique des organisations tradition-
nelles, et que cette politique a été en rupture constante avec le
marxisme. En même temps, le trotskisme (5) offre une explica-
tion de la politique de ces partis à partir d'une analyse sociolo-
gique. Pour ce qui est du réformisme, il reprend l'interprétation
qu'en avait donnée Lénine : le réformisme des socialistes exprime
les intérêts d'une aristocratie ouvrière (que les sur-profits de l'im-
périalisme permettent à celui-ci de « corrompre » par des salaires
plus élevés) et d'une bureaucratie syndicale et politique. Pour
(4) Ou avec d'autres courants d'essence analogue (bordiguisme
par exemple).
(5) Chez ses représentants sérieux, qui se réduisent à peu près
à Léon Trotsky lui-même. Les trotskistes actuels, malmenés par la
réalité comme jamais courant idéologique ne le fut, en sont à un
degré tel de décomposition politique et organisationnelle qu'on ne
peut rien en dire de concis.
3
ce qui est du stalinisme, sa politique est au service de la bureau-
cratie russe, de cette couche parasitaire et privilégiée qui a usurpé
le pouvoir dans le premier Etat ouvrier grâce au caractère arriéré
du pays et au recul de la révolution mondiale après 1923.
C'est sur ce problème de la bureaucratie stalinienne que nous
avons commencé, au sein même du trotskisme, notre travail
de critique. Pourquoi sur celui-là en particulier n'a pas besoin
de longues explications. Tandis que le problème du réformisme
paraissait réglé par l'histoire au moins sur le plan théorique,
le réformisme devenant de plus en plus un défenseur ouvert
du système capitaliste (6), sur le problème crucial entre tous,
celui du stalinisme qui est le problème contemporain par
excellence et qui pèse dans la pratique d'un poids beaucoup
plus grand que le premier
l'histoire de notre époque appor-
tait démenti après démenti à la conception trotskiste et aux
perspectives qui en découlaient. La politique stalinienne s'ex-
pliquait pour Trotsky par les intérêts de la bureaucratie russe,
produit de la dégénérescence de la révolution d'octobre. Cette
bureaucratie n'avait aucune « réalité propre », historiquement
parlant ; elle n'était qu'un « accident », le produit de l'équi-
libre constamment rompu des deux forces fondamentales de
la société moderne, le capitalisme et le prolétariat. Elle s'ap-
puyait en Russie même sur les « conquêtes d'octobre » qui
avaient donné des bases socialistes à l'économie du pays (natio-
nalisation, planification, monopole du commerce extérieur, etc...)
et sur le maintien du capitalisme dans le reste du monde ;
car la restauration de la propriété privée en Russie signifie-
rait le renversement de la bureaucratie au profit d'un retour
des capitalistes, tandis que l'extension mondiale de la révolu-
tion détruirait cet isolement de la Russie dont la bureaucra-
tie était le résultat à la fois économique et politique et déter-
minerait une nouvelle explosion révolutionnaire du proléta-
riat russe, qui chasserait les usurpateurs. De là le caractère néces-
sairement empirique de la politique stalinienne, obligée de lou-
voyer entre les deux adversaires et se donnant comme objec-
tif le maintien utopique du statu quo ; par là même, obligée de
saboter- tout mouvement prolétarien dès que celui-ci mettait en
danger le régime capitaliste et aussi de sur-compenser les résultats
de ce sabotage par une violence extrême chaque fois que la
réaction encouragée par la démoralisation du prolétariat ten-
tait d'instaurer une dictature et de préparer une croisade capi-
taliste contre « les restes des conquêtes d'octobre ». Ainsi, les
>
(6) En fin de compte, notre conception finale de la bureau-
cratie ouvrière amène aussi à réviser la conception iéniniste tradi-
tionnelle sur le réformisme. Mais nous ne pouvons pas nous étendre
ici sur cette question.
partis staliniens étaient condamnés à une alternance d'aventu-
risme « extrémiste » et d'opportunisme.
Mais ni ces partis, ni la bureaucratie russe ne pouvaient
rester ainsi indéfiniment suspendus en l'air ; en l'absence d'une
révolution, disait Trotsky, les partis staliniens seraient de plus
en plus assimilés aux partis réformistes et attachés à l'ordre
bourgeois, tandis que la bureaucratie russe serait renversée, avec
ou sans intervention militaire étrangère, au profit d'une restau-
ration du capitalisme.
Trotsky avait lié ce pronostic à l'issue de la deuxième
guerre mondiale, qui, comme on sait, y a apporté un démenti
éclatant. Les dirigeants trotskistes se sont donnés le ridicule
d'affirmer que sa réalisation était une affaire de temps. Mais
pour nous, ce qui est devenu tout de suite apparent déjà
pendant la guerre - c'est qu'il ne s'agissait pas et ne pouvait
pas s'agir d'une question de délais, mais du sens de l'évolution
historique, et que toute la construction de Trotsky était, dans
ses fondements, mythologique.
La bureaucratie russe a soutenu l'épreuve cruciale de la
guerre en montrant autant de solidité que n'importe quelle
autre classe dominante. Si le régime russe comportait des
contradictions, il présentait aussi une stabilité non moindre
que le régime américain ou allemand. Les partis staliniens ne
sont pas passés du côté de l'ordre bourgeois, mais ont continué
à suivre fidèlement (à part, certes, des défections individuelles
comme il y en a dans tous les partis) la politique russe : par-
tisans de la défense nationale dans les pays alliés de l’U.R.S.S.,
adversaire de cette défense dans les pays ennemis de l’U.R.S.S.
(y compris les tournants successifs du P.C. français en 1939,
1941 et 1947). Enfin, chose la plus importante et la plus extra-
ordinaire, la bureaucratie stalinienne étendait son pouvoir dans
d'autres pays ; soit en imposant son pouvoir à la faveur de
la présence de l'Armée russe, comme dans la plupart des pays
satellites d'Europe centrale et des Balkans, soit en dominant
entièrement un mouvement confus des masses, comme en Yougo-
slavie (ou plus tard en Chine et au Vietnam), elle instaurait
dans ces pays des régimes, en tous points analogues au régime
russe (compte tenu bien entendu des conditions locales), que de
toute évidence il était ridicule de qualifier d'états ouvriers dégé-
nérés (7)
On était donc dès ce moment obligés de chercher ce qui
donnait à la bureaucratie stalinienne, en Russie aussi bien qu'ail-
leurs, cette stabilité et ces possibilités d'expansion. Pour le
(7) Voir la « Lettre ouverte aux militants du P.C.I. », dans le n 1
de Socialisme ou Barbarie (pp. 90 à 101).
5
faire, il a fallu réprendre l'analyse du régime économique et
social de la Russie. Une fois débarrassés de l'optique trotskiste,
il était facile de voir en utilisant les catégories marxistes fonda-
mentales, que la société russe est une société divisée en classes,
parmi lesquelles les deux fondamentales sont la bureaucratie et
le prolétariat. La bureaucratie y joue le rôle de classe domi-
nante et exploiteuse au sens plein du terme. Ce n'est pas sim-
plement qu'elle est classe privilégiée, et que sa consommation
improductive absorbe une part du produit social comparable
(probablement supérieure) à celle qu'absorbe la consommation
improductive de la bourgeoisie dans les pays de capitalisme
privé. C'est qu'elle commande souverainement l'utilisation du
produit social total, d'abord en en déterminant la répartition
en salaires et plus value (en même temps qu'elle essaie d'impo-
ser aux ouvriers les salaires les plus bas possibles et d'en extraire
le plus de travail possible), ensuite en déterminant la répar-
tition de cette plus value entre sa propre consommation impro-
ductive et les investissements nouveaux, enfin en déterminant
la répartition de ces investissements entre les divers secteurs de
production.
Mais la bureaucratie ne peut commander l'utilisation du
produit social que parce qu'elle en commande la production.
C'est parce qu'elle gère la production au niveau de l'usine
qu'elle peut constamment obliger les ouvriers à produire davan-
tage pour le même salaire ; c'est parce qu'elle gère la produc-
tion au niveau de la société qu'elle peut décider la fabrication
de canons et de soieries plutôt que de logements et de coton-
nades. On constate donc que l'essence, le fondement de la
domination de la bureaucratie sur la société russe, c'est le fait
qu'elle domine au sein des rapports de production ; en même
temps, on constate que cette même fonction a été de tout
temps la base de la domination d'une classe sur la société.
Autrement dit, à tout instant l'essence actuelle des rapports
de classe dans la production, est la division antagonique des
participants à la production en deux catégories fixes et stables,
dirigeants et exécutants. Le reste concerne les mécanismes socio-
logiques et juridiques qui garantissent la stabilité de la couche
dirigeante ; tels sont la propriété féodale de la terre, la pro-
priété privée capitaliste ou cette étrange forme de propriété
privée non personnelle qui caractérise le capitalisme actuel ;
tels sont en Russie la dictature totalitaire de l'organisme qui
exprime les intérêts généraux de la bureaucratie, le parti « com-
muniste», et le fait que le recrutement des membres de la classe
6
dominante se fait par une cooptation étendue à l'échelle de la
société globale. (8)
Il en résulte que la nationalisation des moyens de produc-
tion et la planification ne résolvent nullement le problème du
caractère de classe de l'économie, ne signifient d'aucune façon
la suppression de l'exploitation ; elles entraînent certes la sup-
pression des anciennes classes dominantes, mais ne répondent
pas au problème fondamental : qui dirigera maintenant la pro-
duction, et comment ? Si une nouvelle couche d'individus s'em-
pare de cette direction, l' « ancien fatras » dont parlait Marx
réapparaîtra rapidement ; car cette couche utilisera sa position
dirigeante pour se créer des privilèges, et pour augmenter et
consolider ces privilèges, elle renforcera son monopole des fonc-
tions de direction, tendant à rendre sa domination plus totale
et plus difficile à mettre en question ; elle tendra à assurer la
transmission de ces privilèges à ses descendants, etc. (9)
Qu'il ne s'agit pas là d'un problème particulier à la Russie ou
aux années 1920, c'est facile de s'en apercevoir. Car le problème
est posé à l'ensemble de la société moderne, indépendamment
même de la révolution prolétarienne ; il n'est qu'une autre
expression du processus de concentration des forces productives.
Qu'est-ce qui crée, en effet, la possibilité objective d'une dégéné-
rescence bureaucratique de la révolution ? C'est le mouvement
inexorable de l'économie moderne, sous la pression de la tech-
nique, vers une concentration de plus en plus poussée du capital
et du pouvoir, l'incompatibilité du degré de développement
actuel des forces productives avec la propriété privée et le
marché comme mode d'intégration des entreprises. Ce mouve-
(8) Voir « Les rapports de production en Russie », dans le n° 2
de Socialisme ou Barbarie (pp. 1 à 66).
(9) Relativement à l'argumentation de Trotsky, pour qui la
bureaucratie n'est pas classe dominante puisque les privilèges bureau-
cratiques ne sont pas transmissibles héréditairement, il suffit de rap-
peler: 1° que la transmission héréditaire n'est nullement un élé-
ment nécessaire de la catégorie classe dominante ; 2° qu'eii fait, le
caractère héréditaire de membre de la bureaucratie (non pas certes,
de telle ou telle situation bureaucratique particulière) en Russie est
évident ; il suffit d'une mesure comme la non-gratuité de l'ensei-
gnement secondaire (établie en 1936) pour instaurer un mécanisme
sociologique inexorable assurant que seuls des fils de bureaucrates
pourront entrer dans la carrière bureaucratique. Qu'au surplus la
bureaucratie veuille essayer (par des bourses d'études ou des sélections
« au mérite absolu ») d'attirer à elle les talents qui naissent au sein
du prolétariat ou de la paysannerie, non seulement ne contredit mais ,
plutôt confirme son caractère de classe exploiteuse ; des mécanismes
analogues existent depuis toujours dans les pays capitalistes et leur
fonction sociale est de révigorer par du sang nouveau la couche
dominante, d'amender en partie les irrationalités résultant du carac-
tère héréditaire des fonctions dirigeantes et d'émasculer les ciasses
exploitées en en corrompant les éléments les plus doués.
ment se traduit par une foule de transformations structurelles
chez les pays capitalistes occidentaux, sur lesquelles nous ne pou-
vons nous étendre ici. Il suffit de rappeler qu'elles s'incarnent
socialement dans une nouvelle bureaucratie, bureaucratie écono-
mique aussi bien que bureaucratie du travail. Or, en faisant
table rase de la propriété privée, du marché, etc..., la révolution
peut si elle s'arrête à cela faciliter la voie de la concen-
tration bureaucratique totale On voit donc que, loin d'être privée
de réalité propre, la bureaucratie personnifie la dernière phase
du développement du capitalisme.
Il devenait dès lors évident que le programme de la révolu-
tion socialiste, et l'objectif du prolétariat ne pouvait plus être
simplement la suppression de la propriété privée, la nationali-
sation des moyens de production et la planification, mais la
gestion ouvrière de l'économie et du pouvoir. Faisant un retour
sur la dégénérescence de la révolution russe, nous constations
que le parti bolchévik avait sur le plan économique comme
programme non pas la gestion ouvrière, mais le contrôle ouvrier.
Ceci parce que le parti, qui ne pensait pas que la révolution
pouvait être immédiatement une révolution socialiste, ne se
posait même pas comme tâche l'expropriation des capitalistes,
considérait donc que ceux-ci garderaient la direction des entre-
prises ; dans ces conditions, le contrôle ouvrier aurait comme
fonction à la fois d'empêcher les capitalistes d'organiser le sabo-
tage de la production, de contrôler leurs profits et la disposition
du produit des entreprises, et de constituer une « école » de
direction pour les ouvriers. Mais cette monstruosité sociologique
d'un pays où le prolétariat exerce sa dictature par l'instrument
des Soviets et du parti bolchévik et où les capitalistes gardent
la propriété et la direction des entreprises, ne pouvait pas durer ;
là où les capitalistes n'ont pas pris la fuite, ils ont été expulsés
par les ouvriers qui se sont emparés en même temps de la gestion
des entreprises.
Cette première expérience de gestion ouvrière n'a duré que
peu ; nous ne pouvons pas entrer ici dans l'analyse de cette
période (fort obscure et sur laquelle peu de sources existent)
de la révolution russe, ni des facteurs qui ont déterminé le pas-
sage rapide du pouvoir dans les usines entre les mains d'une
nouvelle couche dirigeante : état arriéré du pays, faiblesse numé-
rique et culturelle du prolétariat, délabrement de l'appareil pro-
ductif, longue guerre civile d'une violence sans précédent, isole-
ment international de la révolution. Il y a un seul facteur dont
nous voulons souligner l'action pendant cette période : la poli-
tique systématique du parti bolchévik a été dans les faits
opposée à la gestion ouvrière et a tendu dès le départ à instaurer
8
un appareil propre de direction de la production, responsable
uniquement vis-à-vis du pouvoir central, c'est-à-dire en fin de
compte du Parti: Ceci au nom de l'efficacité et des nécessités
impérieuses de la guerre civile. Si cette politique était la plus
efficace même à court terme reste à voir ; en tout cas, à long
ternie, elle posait les fondements de la bureaucratie.
Si la direction de l'économie échappait ainsi au proletariat,
Lénine pensait que l'essentiel était que la direction de l'Etat lui
fût conservée, par le pouvoir soviétique ; que, d'un autre côté,
la classe ouvrière participant à la direction de l'économie par le
contrôle ouvrier, les syndicats, etc..., « apprendrait » graduelle-
ment à gérer. Cependant, une évolution impossible à retracer 'ici
mais ineluctable, a rapidement rendu inamovible la domina-
tion du parti bolchevik dans les Soviets. Dès ce moment, le
caractère prolétarien de tout le système était suspendu au carac-
tère proletarien du parti bolchévik. On pourrait facilement mon-
trer que dans ces conditions, le parti, minorité strictement cen-
tralisée et monopolisant l'exercice du pouvoir, ne pouvait même
plus garder un caractère prolétarien au sens fort de ce terme, et
devait forcément se séparer de la classe dont il était sorti. Mais
point n'est besoin d'aller jusque-là. En 1923, « le parti comptait
sur 350.000 membres : 50.000 ouvriers et 300.000 fonction-
naires. Ce n'était plus un parti ouvrier, mais un parti d'ouvriers
devenus fonctionnaires » (10). Réunissant l'« élite » du 'prolé-
tariat, le parti avait été amené à l'installer aux postes de com-
mande de l'économie et de l'Etat ; et de là, elle ne devait
rendre des comptes qu'au parti, c'est-à-dire à elle-même. L'« ap-
prentissage » de la gestion par la classe ouvrière signifiait sim-
plement qu'un certain nombre d'ouvriers, apprenant les tech-
niques de direction, sortaient du rang et passaient du côté de la
nouvelle bureaucratie. L'existence sociale des hommes déter-
minant leur conscience, les membres du parti allaient désormais
agir non pas d'après le programme bolchévik, mais en fonction
de leur situation concrète de dirigeants privilégiés de l'écono-
mie et de l'Etat. Le tour était joué, la révolution était morte, et
s'il y a quelque chose d'étonnant, c'est plutôt la lenteur subsé-
quente de la consolidation de la bureaucratie au pouvoir. (11)
Les conclusions qui résultent de cette brève analyse sont
claires : le programme de la révolution socialiste ne peut être
autre que la gestion ouvrière. Gestion ouvrière du pouvoir, c'est-
à-dire pouvoir des organismes autonomes des masses (Soviets
ou Conseils) ; gestion ouvrière de l'économie, c'est-à-dire direc-
tion de la production par les producteurs, organisés aussi dans
(10) Victor Serge, Destin d'une révolution (Paris 1937), p. 174.
(11) Voir l'éditorial du n° 1 de Socialisme ou Barbarie, pp. 27 et ss.
9
g
des organismes de type soviétique. L'objectif du prolétariat ne
peut pas être la nationalisation et la planification sans plus, parce
que cela signifie remettre la domination de la société à une
nouvelle couche de dominateurs et d'exploiteurs ; il ne peut
pas être réalisé en remettant le pouvoir à un parti, aussi révo-
lutionnaire et aussi prolétarien ce parti soit-il au départ, parce
que ce parti tendra fatalement à l'exercer pour son propre
compte et servira de noyau à la cristallisation d'une nouvelle
couche dominante. Le problème de la division de la société en
classes apparaît en effet à notre époque de plus en plus sous
sa forme la plus directe et la plus nue, dépouillé de tous les
masques juridiques, comme le problème de la division de la
société en dirigeants et exécutants. La révolution prolétarienne
ne réalise son programme historique que dans la mesure où eile
tend dès le départ à supprimer cette division, en résorbant toute
couche dirigeante particulière et en collectivisant, plus exacte-
ment en socialisant intégralement les fonctions de direction. Le
problème de la capacité historique du prolétariat de réaliser la
société sans classes n'est pas celui de sa capacité de renverser
physiquement les exploiteurs au pouvoir (qui ne fait pas de
doute), mais d'organiser positivement une gestion collective,
socialisée, de la production et du pouvoir. Il devient dès lors
évident que la réalisation du socialisme pour le compte du
prolétariat par un parti ou une bureaucratie quelconque est une
absurdité, une contradiction dans les termes, un cercle carré,
un oiseau Sous-marin ; le socialisme n'est rien d'autre que
l'activité gestionnaire consciente et perpétuelle des masses. Il
devient également évident que le socialisme ne peut pas être
« objectivement » inscrit, même pas à 50 %, dans une loi ou
une constitution quelconque, dans la nationalisation des moyens
de production ou la planification, ni même dans une « loi »
instaurant la gestion ouvrière : si la classe ouvrière ne peut pas
gérer, aucune loi ne peut faire qu'elle le puisse, et si elle gère, la
« loi » ne fera que constater cet état de fait
Ainsi, partis de la critique de la bureaucratie, nous sommes
parvenus à formuler une conception positive du contenu du socia-
lisme ; brièvement parlant, « le socialisme sous tous ses aspects
ne signifie pas autre chose que gestion ouvrière de la société ».
et « la classe ne peut se libérer qu'en réalisant son propre pou-
voir ». Le prolétariat ne peut réaliser la révolution socialiste que
s'il agit d'une façon autonome, c'est-à-dire s'il trouve en lui-
même à la fois la volonté et la conscience de la transformation
nécessaire de la société. Le socialisme ne peut être ni le résultat
fatal du développement historique, ni un viol de l'histoire par un
parti de surhommes, ni l'application d'un programme découlant
10
d'une théorie vraie en soi --- mais le déclenchement de l'activite
créatrice libre des masses oppriinées, déclenchement que le déve-
loppement historique rend possible, et que l'action d'un parti
basé sur cette théorie peut énormément faciliter.
Il est dès lors indispensable de développer sur tous les plans
les conséquences de cette idée.
II. --- L'idée de l'autonomie du prolélariat et ie marxisme.
Il faut dire tout de suite que cette conception n'a rien d'essen-
tiellement nouveau. Son contenu est le même que celui de la
célèbre formulation de Marx « l'émancipation des travailleurs
sera l'æuvre des travailleurs eux-mêmes » ; il a été également
exprimé par Trotsky lorsque celui-ci disait « le socialisme, à
l'opposé du capitalisme, s'édifie consciemment ». Il ne serait que
trop facile de multiplier les citations de ce genre.
Ce qu'il y a de nouveau, c'est de vouloir et de pouvoir
prendre cette idée totalement au sérieux, en tirer les implications
à la fois théoriques et pratiques. Ceci n'a pas pu être fait jus-
qu'ici, ni par nous, ni par les grands fondateurs du marxisme.
C'est que d'un côté, l'expérience historique nécessaire manquait ;
l'analyse qui précède montre l'importance énorme que la dégé-
nérescence de la révolution russe possède pour la clarification
du problème du pouvoir ouvrier. C'est, d'un autre côté et à un
niveau plus profond, que la théorie et la pratique révolution-
naires dans la société d'exploitation sont sujettes à une contra-
diction cruciale, résultant du fait qu'elles participent de cette
société qu'elles veulent abolir et se traduisant sous une infinité
d'aspect.
Un seul de ces aspects nous intéresse ici. Etre révolutionnaire,
signifie à la fois penser que seules les masses en lutte peuvent
résoudre le problème du socialisme et ne pas se croiser les bras
pour autant ; penser que le contenu essentiel de la révolution
sera donné par l'activité créatrice, originale et imprévisible des
masses, et agir soi-même à partir d'une analyse rationnelle du
présent et d'une perspective anticipant sur l'avenir (12). En fin
de compte : postuler que la révolution signifiera un bouleverse-
ment et un élargissement énorme de ce qu'est notre rationalité,
et utiliser cette même rationalité pour anticiper le contenu de
cette révolution.
Comment cette contradiction est relativement résolue et rela-
tivement posée à nouveau à chaque étape du mouvement ouvrier
jusqu'à la victoire finale de la révolution, ne peut pas nous
retenir ici ; c'est tout le problème de la dialectique concrète du
(12) Voir « La direction prolétarienne », dans le n° 10 de Socia-
lisme ou Barbarie, (pp. 10 et ss.).
11
du prolétariat, tendent non se
développement historique de l'action révolutionnaire du prolé-
tariat et de la théorie révolutionnaire. Il suffit en ce moment de
constater qu'il y a une difficulté intrinsèque au développement
d'une théorie et d'une pratique révolutionnaire dans la société
d'exploitation, et que, dans la mesure où il veut dépasser cette
difficulté, le théoricien - de même d'ailleurs que le militant
risque de retomber inconsciemment sur le terrain de la pensée
bourgeoise, plus généralement sur le terrain de ce type de pensée
qui procède d'une société aliénée et qui a dominé l'humanité
pendant des millénaires. C'est ainsi que, face aux problemes
que pose la situation historique nouvelle, le théoricien sera sou- .
vent amené à « réduire l'inconnu au connu », car c'est en ceci
que consiste l'activité théorique courante. Il peut ainsi soit ne
pas voir qu'il s'agit d'un type de problème nouveau, soit, inéme
s'il le voit, lui appliquer les types de solution hérités. Cependant,
les facteurs dont il vient de reconnaître ou même de découvrir
l'importance révolutionnaire, la technique moderne et l'activité
types de solution, mais à détruire les termes mêmes dans lesquels
se posaient antérieurement les problèmes. Les solutions de type
traditionnel que donnera dès lors le théoricien ne seront pas
simplement inadéquates ; dans la mesure où elles seront adop-
tées - ce qui implique que le proletariat reste lui aussi sous
l'emprise des idées reçues --- elles seront objectivement l'instru-
ment du maintien du prolétariat dans le cadre de l'exploitation,
bien que peut-être sous une autre forme.
Marx était bien conscient de ce problème : son refus du socia-
lisme « utopique » et sa phrase « un pas pratique en avant vaut
mieux qu'une douzaine de programmes » traduisaient précisément
sa méfiance des solutions « livresques » toujours écartées par
le développement vivant de l'histoire. Cependant, il reste dans
le marxisme une part importante (qui est allée en croissant
chez les marxistes des générations suivantes) d'héritage idéo-
logique bourgeois ou « traditionnel ». Dans cette mesure, il y
a une ambivalence du marxisme théorique, ambivalence qui a
joué un rôle historique important ; par son truchement, l'in-
fluence de la société d'exploitation a pu s'exercer de l'intérieur
sur le mouvement prolétarien. Le cas, analysé plus haut de
l'application par le parti bolchevik en Russie des solutions
efficaces traditionnelles au problème de la direction de la pro-
duction, en offre une illustration dramatique ; les solutions
traditionnelles ont été efficaces en ce sens qu'elles ont efficace-
ment ramené l'état traditionnel des choses et conduit à la res-
tauration de l'exploitation sous de nouvelles formes. Nous ren-
contrerons plus loin d'autres cas importants de survivance d'idées
bourgeoises dans le marxisme. Il est cependant utile d'en discu-
- 12
ter dès maintenant un exemple sur lequel ce que nous voulons
dire apparaitrå clairement.
Comment sera rémunéré le travail dans une économie socia-
liste ? On sait que Marx, dans la « Critique du programme de
Gotha », distinguant cette forme d'organisation de la société
après la révolution (« phase inférieure du communisme ») du
communisme lui-même (où régnerait le principe « de chacun
selon ses capacités, à chacun selon ses besoins »), a parlé du
« droit bourgeois » qui prévaudrait pendant cette phase, enten-
dant par là une rémunération égale pour la même quantité et
qualité de travail - ce qui peut signifier une rémunération
inégale pour les différents individus (13).
Comment justifie-t-on ce principe ? On part des caracté-
ristiques fondamentales de l'économie socialiste : à savoir que,
d'un côté l'économie est encore une économie de pénurie, où il
est par conséquent essentiel que l'effort de production des mem-
bres de la société soit poussé au maximum ; d'un autre côté
que les hommes sont encore dominés par la mentalité « égoïste »
héritée de la société précédente et maintenue précisément par
cette pénurie. Il y a donc besoin d'un effort productif le plus
grand possible, en même temps que besoin de lutte contre la
tendance « naturelle » encore à ce stade de se dérober au travail,
On dira donc qu'il faut, si l'on veut éviter la pagaille et la
famine, proportionner la rémunération du travail à la qualité
et la quantité du travail fourni, mesurées par exemple par le
nombre de pièces fabriquées, les heures de présence, etc., ce qui
conduit naturellement à une rémunération nulle pour un travail
nul et règle du même coup le problème de l'obligation à tra-
vailler. On aboutit en somme à une sorte de « salaire au rende-
ment » (14), et, selon que l'on est plus ou moins astucieux on
conciliera plus ou moins bien cette conclusion avec la critique
acerbe de cette forme de salaire dans le cadre du capitalisme.
Ce faisant, on aura oublié purement et simplement que le
problème ne peut plus se poser dans ces termes : à la fois la
technique moderne et les formes d'association des ouvriers
qu'implique le socialisme le rendent caduque. Qu'il s'agisse du
travail sur une chaîne de montage ou de fabrication de pièces
sur des machines « individuelles », le rythme de travail du
travailleur individuel est dicté par le rythme de travail de
l'ensemble auquel il appartient automatiquement et « physi-
(13) Nous avons montré d'ailleurs que cette inégalité serait extrê-
mement limitée. Voir « Sur la dynamique du capitalisme », n" 13
de cette revue (pp. 66 à 69).
(14) Le terme n'est évidemment pas utilisé ici avec le sens tech-
nique précis qu'il a actuellement.
13
quement » dans le cas du travail à la chaîne, indirectement et
< socialement » dans la fabrication de pièces sur une machine,
mais toujours d'une manière qui s'impose à lui. Il n'y a plus
par conséquent de problème de rendement individuel (15). Il y
a un problème du rythme de travail d'un ensemble donné
d'ouvriers qui est en fin de compte l'ensemble d'une usine
et ce rythme ne peut être déterminé que par cet ensemble
d'ouvriers lui-même. Le problème de la rémunération arrive
donc à être un problème de gestion, car une fois établi un
salaire général, le taux de rémunération concret (rapport salaire-
rendement) sera déterminé à travers la détermination du rythme
de travail ; celle-ci à son tour nous conduit au cæur du pro-
blème de la gestion comme problème concernant sous une forme
concrète la totalité des producteurs (qui auront sous une forme
ou une autre à définir que tel rythme de production sur une
chaîne de nature donnée équivaut comme dépense de travail à
tel rythme de production sur une chaîne d'une autre nature,
et ceci entre les divers ateliers de la même usine comme aussi
entre les diverses usines, etc.). Rappelons, s'il le faut, que ceci
ne signifie nullement que le problème en devient nécessairement
plus facile dans sa solution, peut-être même le contraire ; mais
il est enfin correctement posé. Des erreurs dans sa solution
pourraient être fécondes pour le développement du socialisme,
leur élimination successive permettant d'arriver à la solution ;
tandis qu'aussi longtemps qu'on le pose sous la forme ciu
< salaire au rendement » ou du « droit bourgeois »; on reste
placé d'emblée sur le terrain d'une société d'exploitation (16).
Mais il importe d'analyser le mécanisme de l'erreur. Face
à un problème légué par l'ère bourgeoise on raisonne comnie
des bourgeois. En ceci d'abord, qu'on pose une règle universelle
et abstraite --- seule forme de solution des problèmes pour une
société aliénée --- en oubliant que la loi est comme un
homme ignorant et grossier qui répète toujours la même
chose » (17), et qu'une solution socialiste ne peut être socialiste
que si elle est une solution concrète impliquant la participation
permanente de l'ensemble organisé des travailleurs à sa déter-
mination ; qu'une société aliénée est obligée de recourir à des
règles universelles abstraites, parcequ'autrement elle ne pourrait
(15) Cf. les extraits de Tribune Ouvrière publiés dans ce numéro.
(16) Certes, le problème sous sa forme traditionnelle peut sub-
sister pour les « secteurs arriérés » ce qui ne veut pas dire qu'il y
faudra nécessairement lui donner une solution « arriérée », Mais,
quelle que soit la solution dans ce cas, ce que nous voulons dire
est que le développement historique tend à changer à la fois la forme
et le contenu du problème.
(17) Platon : Le Politique 294 b-c.
14
pas être stable, et parce qu'elle est incapable de prendre en
considération les cas concrets pour eux-mêmes, n'ayant ni les
institutions ni l'optique nécessaires pour cela, tandis qu'une
société socialiste qui crée précisément les organes qui peuvent
prendre en considération tous les cas concrets, ne peut avoir
comme loi que l'activité déterminante perpétuelle de ces
organes.
On raisonne encore comme des bourgeois en ceci qu'on
accepte l'idée bourgeoise (et reflétant justement la situation dans
la société bourgeoise) de l'intérêt individuel comme motif
suprême de l'acivité humaine. C'est ainsi que pour la mentalité
bourgeoise des « néo-socialistes » anglais, l'homme dans la
société socialiste continue à être, avant tout autre chose, un
« homme économique », la société devrait donc être réglementée
à partir de cette idée. Transposant ainsi à la fois les problèmes
du capitalisme et le comportement du bourgeois à la société
nouvelle, ils sont essentiellement préoccupés par le problème
des « incentives » (des gains incitant à travailler) et oublient
que déjà dans la société capitaliste ce qui fait travailler l'ou-
vrier ne sont pas les « incentives », mais le contrôle de son
travail par d'autres hommes et par les machines elles-mêmes.
L'idée de l'« homme économique » a été créée par la société
bourgeoise à son image ; très exactement à l'image du bourgeois
et certainement pas à l'image de l'ouvrier. Les ouvriers n'agis-
sent comme des « hommes économiques » que là où ils sont
obligés de le faire, c'est-à-dire vis-à-vis des bourgeois (qui per-
çoivent ainsi la monnaie de leur pièce) mais certainement pas
entre eux (comme on peut le voir pendant les grèves, et aussi
dans leur attitude vis-à-vis de leurs familles ; autrement il y
a belle lurette qu'il n'y aurait plus d'ouvriers). Qu'on dise qu'ils
agissent ainsi envers ce qui leur « appartient » (famille, ,
classe, etc.) ce sera parfait, car nous disons précisément qu'ils
agiront ainsi : envers tout lorsque tout leur « appartiendra ».
Et prétendre que la famille est là, visible, tandis que le « tout »
est une abstraction serait encore un malentendu car le tout
ciont nous parlons est concret, commence avec les autres ouvriers
de l'atelier, de l'usine, etc.
C
III. La gestion ouvrière de la production.
Une société sans exploitation n'est concevable, on l'a vu,
que si la gestion de la production n'est plus localisée dans une
catégorie sociale, autrement dit si la division structurelle de la
société en dirigeants et exécutants est abolie. On a également
vu que la solution du problème ainsi posé ne peut être donnée
que par le prolétariat lui-même. Ce n'est pas seulement qu'au-
15
cune solution'n'aurait de valeur, ne pourrait même simplement
être réalisée, si elle n'était réinventée par les masses d'une
manière autonome ; ni que le problème posé l'est à une échelle
qui rend la coopération active de millions d'individus indispen-
sable à sa solution. C'est que par sa nature même, la solution
du problème de la gestion ouvrière ne peut tenir dans une for-
mule, ou, comme nous l'avons déjà dit, que la seule loi véritable
que connaisse la société socialiste est l'activité déterminante
perpétuelle des organismes gestionnaires des masses.
Les considérations qui suivent ne visent donc pas à « ré-
soudre ». théoriquement le problème de la gestion ouvrière
ce qui serait encore une fois une contradiction dans les termes
mais d'en clarifier les données. Nous visons seulement à dis-
siper des malentendus et des préjugés largement répandus, en
montrant comment le problème de la gestion ne se pose pas,
et comment il se pose.
Si l'on pense que la tâche essentielle de la révolution est une
tâche négative, l'abolition de la propriété privée qui peut
être effectivement réalisée par décret - on peut penser la
révolution comme centrée sur la « prise du pouvoir », donc
comme un moment (qui peut durer quelques jours et être à
la rigueur suivi de quelques mois ou années de guerre civile),
où les ouvriers, s'emparant du pouvoir, exproprient en droit et
en fait les propriétaires des usines. Et dans ce cas, on sera effec-
tivement amené à accorder une importance capitale à la « prise
du pouvoir » et à un organisme construit exclusivement en vue
de cette fin.
C'est ainsi, en fait, que les choses se passent pendant la
révolution bourgeoise. La société nouvelle est toute préparée
au sein de l'ancienne ; les manufactures concentrent patrons et
ouvriers, la redevance que payent les paysans aux propriétaires
fonciers est dénuée de toute fonction économique comme ces
propriétaires le sont de toute fonction sociale. Sur cette société
en fait bourgeoise ne subsiste qu'un squame féodal. Une Bastille
abattue, quelques têtes coupées, une nuit d'août, des élus (dont
beaucoup d'avocats) rédigeant des Constitutions. des lois et
des décrets — et le tour est joué. La révolution est faite, une
période historique est close, une autre s'ouvre. Il est vrai qu'une
guerre civile peut suivre : la rédaction des nouveaux Codes
prendra quelques années, la structure de l'Administration comme
celle de l'Armée subiront des changements importants. Mais
l'essentiel de la révolution est fait avant la révolution.
C'est qu'en effet la révolution bourgeoise n'est que pure
négation pour ce qui est du domaine économique. Elle se base
sur ce qui est déjà là, elle se borne à élever à la légalité un
16
état de fait en supprimant une superstructure déjà irréelle en
elle-même. Ses constructions limitées n'affectent que cette super-
structure elle-même ; la base économique prend soin d'elle-
même. Que ce soit avant ou après la révolution bourgeoise, le
capitalisme, une fois établi dans un secteur de l'économie, se
propage par la propre force de ses lois sur le terrain de la
simple produetion marchande qu'il trouve devant lui.
Il n'y a aucun rapport entre ce processus et celui de la
révolution socialiste. Celle-ci n'est pas une simple négation de
certains aspects de l'ordre qui l'a précédée ; elle est essentielle-
ment positive. Elle doit construire son régime
non pas
construire des usines, mais construire des nouveaux rapports
de production, dont le développement du capitalisme ne fournit
que les présuppositions. On s'en apercevra mieux en relisant le
passage où Marx décrit la « Tendance historique de l'accumu-
lation capitaliste ». On nous excusera d'en citer un large extrait *:
... Dès que le mode de production capitaliste se suffit à
lui-même, la socialisation progressive du travail et la transfor-
mation consécutive de la terre et des autres moyens de pro-
duction en moyens de production communs, parce que sociale-
ment exploités, et par suite l'expropriation des propriétaires pri-
vés prennent une forme nouvelle. Cette expropriation s'opère par
le jeu des lois immanentes de la production capitaliste elle-même,
par la centralisation des capitaux, Chaque capitaliste en tue
beaucoup d'autres. Concurremment avec cette centralisation, ou
l'expropriation de beaucoup de capitalistes par quelques-uns, se
développent la forme coopérative sur une échelle de plus en plus
grande, du procès de travail, l'application raisonnée de la sience
à la technique, l'exploitation systématique du sol, la transforma-
tion des moyens particuliers de travail en moyens ne pouvant
être utilisés qu'en commun, l'économie de tous les moyens de pro-
duction par leur utilisation comme moyens de production d'un
travail social combiné, l'entrée de tous les peuples dans le
réseau du marché mondial, et par conséquent le caractère inter-
national du régime capitaliste. A mesure que diminue le nombre
des grands capitalistes, qui accaparent et monopolisent tous les
avantages de ce procès de transformation, on voit augmenter
la misère, l'oppression, l'esclavage, la dégénérescence, l'exploi-
tation, mais également la révolte de la classe ouvrière qui gros-
sit sans cesse et qui a été dressée, unie, organisée par le méca-
nisme même du procès de production capitaliste. Le monopole
du capital devient l'entrave du mode de production qui s'est
développé avec lui et par lui. La centralisation des moyens de
production et la socialisation du travail arrivent à un point
où elles ne s'accommodent plus de leur enveloppe capitaliste et
17
Qu'e
une
ou
un
la font éclater. La dernière heure de la propriété privée capi-
taliste a sonné. Les expropriateurs sont expropriés à leur
tour. »(1)
'existe-t-il donc, en fait, de la nouvelle société, au moment
ou l' « enveloppe capitaliste éclate » ? Toutes les prémisses, il
est vrai ; une société formée presqu'entièrement de prolétaires,
ľ' « application rationnelle de la science dans l'industrie », et
aussi, étant donné le degré de concentration des entreprises sup-
posé dans ce passage, la séparation de la propriété et des fonc-
tions effectives de direction de la production. Mais où sont les
rapports de production socialiste déjà réalisés au sein de cette
société, comme les rapports de production bourgeois l'étaient
dans la société « féodale » ?
Car il est évident que ces nouveaux rapports ne peuvent
pas être simplement ceux réalisés dans la « socialisation du
processus du travail », la coopération de milliers d'individus
au sein des grandes unités industrielles ; ce sont là les rapports
de production typiques du capitalisme hautement développé.
La « socialisation du processus de travail » telle qu'elle a
lieu dans l'économie capitaliste est la prémisse du socialisme
en tant qu'elle supprime l'anarchie, l'isolement, la dispersion, etc.
Mais elle n'est nulement « préfiguration »
« embryon » de socialisme, en tant qu'elle est socialisation
antagonique, c'est-à-dire qu'elle reproduit et approfondit la
division de la masse des exécutants et d'une couche de dirigeants.
En même temps que les producteurs sont soumis à une discipline
collective, .que les conditions de production sont unifiées entre
secteurs et localités, que les tâches productives deviennent inter-
changeables, on observe à l'autre pôle non pas seulement un
nombre décroissant de capitalistes à rôle de plus en plus para-
sitaire, mais la constitution d'un appareil séparé de direction
de la production. Or, les rapports de production socialistes sont
ceux qui excluent l'existence séparée d'une couche fixe et stable.
de dirigeants de la production. On voit donc que le point de
départ de leur réalisation ne peut être que la destruction du
pouvoir de la bourgeoisie ou de la bureaucratie. La transfor-
mation capitaliste de la société s'achève avec la révolution bour-
geoise, la transformation socialiste commence avec la révolution
prolétarienne.
L'évolution moderne a d'elle-mêine supprimé des aspects
du problème de la gestion considérés autrefois comme déter-
minants. D'un côté, le travail de direction est devenu lui-même
un travail salarié, comme l'indiquait déjà Engels ; d'un autre
(1) Le Capital, tome IV (trad. Molitor), p. 273-4.
18
côté, il est devenu lui-même un travail collectif d'exécution (2) ;
les « tâches » d'organisation du travail qui autrefois incom-
baient au patron assisté de quelques ingénieurs, sont maintenant
exécutées par des bureaux groupant des centaines ou des mil-
liers de personnes, elles-mêmes exécutants salariés et parcellaires.
L'autre groupe de tâches traditionnelles de direction, en somme
l'intégration de l'entreprise dans l'ensemble de l'économie et
en particulier l' « étude » ou le « flair » du marché (nature,
qualité, prix des fabrications demandées, modifications de
l'échelle de production, etc.), s'était déjà transformé dans sa
nature avec les monopoles ; il s'est aussi transformé dans son
mode d'accomplissement, puisque l'essentiel y est désormais
exécuté par un appareil' collectif de prospection des marchés,
d'étude des goûts des consommateurs, de vente du produit, etc.
Ceci dans le cas du capitalisme de monopole. Lorsque la pro-
priété privée laisse la place à la propriété étatique, comme
dans le capitalisme bureaucratique, un appareil central de coor-
dination du fonctionnement des entreprises prend la place à la
fois du marché comme « régulateur » et des appareils propres
à chaque entreprise ; c'est la bureaucratie planificatrice centrale,
dont la « nécessité » économique découlerait, d'après ses défen-
seurs, précisément de ces fonctions de coordination.
Il est inutile de discuter ce sophisme (3) car -- et c'est là
ce qui nous intéresse - le problème de la coordination de
l'activité des entreprises et des secteurs productifs après la sup-
pression du marché, autrement dit le problème de la planifi-
cation, est virtuellement déjà supprimé par la technique
moderne. La méthode de Léontieff (4) mėme dans son état
actuel (5), enlève toute signification « politique » ou « écono-
mique » au problème de la coordination des divers secteurs ou
des diverses entreprises. Car elle permet, si le volume de pro-
duction désirée d'objets d'utilisation finale est fixé, d'en déter-
miner les conséquences pour l'ensemble des secteurs, des régions
et des entreprises, sous forme d'objectifs de production à réa-
(2) Voir l'article de Ph. Guillaume, Machinisme et Proleta-
riat, dans le n“ 7 de cette révue (en particulier pp. 59 et suiv.).
(3) Notons simplement en passant que les avocats de la bureau-
cratie démontrent, dans un premier mouvement, que l'on peut se
passer des patrons puisqu'on peut faire fonctionner l'économie d'après
un plan et, dans un deuxième mouvement, que le plan pour fonc-
tionner, a besoin de patrons d'un autre type.
(4) Nous avons exposé quelques concepts fondamentaux de cette
méthode dans l'article « Sur la dynamique du capitalisme », publié
dans le n° 12 de cette revue (pp. 17 et suiv.). Voir aussi Leontieff
and others, Studies in the structure of American economy, 1953.
(5) Restriction importante, car les applications pratiques de cette
méthode n'ont presque pas été développées jusqu'ici, pour des raisons
évidentes.
19
2
un
liser par telle unité dans tel laps de temps. Elle permet en
même temps un grand degré de souplesse, car elle rend possible,
si l'on veut moditier un plan en cours d'exécution, de tirer
immédiatement les implications pratiques de cette modification.
Combinée avec d'autres méthodes modernes (0) elle permet à
la fois de choisir, une fois les objectifs globaux fixés, les
méthodes optimum de réalisation, et de détinir celles-ci pour
toute l'économie dans les détails. Brièvement parlant, la tota-
lité de l' « activité planificatrice » de la bureaucratie russe par
exemple, pourrait dès maintenant ètre transférée à une machine
électronique.
Le problème ne se pose donc qu'aux deux extrémités de
l'activité économique : au niveau le plus particulier, savoir,
traduire l'objectif de production de telle usine en objectif de
production pour chaque groupe d'ouvriers des ateliers de cette
usine, et au niveau universel, savoir, fixer pour l'ensemble de
l'économie les objectifs de production des biens d'utilisation
finale.
Dans les deux cas, le problème n'existe que parce qu'il y a
et qu'il aura encore plus dans une société socialiste
développement technique (au sens large du terme). Il est en
effet clair qu'avec une technique stable le type de solution (sinon
les solutions elles-mêmes qui dans leur teneur précise varieront
par exemple s’il !" a accumulation) serait donné une fois pour
toutes, qu'il s'agisse de la répartition des tâches au sein d'un
atelier (parfaitement compatible avec l'interchangeabilité des
producteurs aux différents emplois) ou de la détermination des
produits d'utilisation finale. Ce sera la modification incessante
des combinaisons productives et des objectifs finaux qui créera
le terrain sur lequel devra s'exercer la gestion collective.
IV. L'aliénation dans la société capitaliste.
Par aliénation moment caractéristique de toute société de
classe mais qui apparaît dans une étendue et une profondeur
incomparablement plus grande dans la société capitaliste
nous entendons que les produits de l'activité de l'homme
qu'il s'agisse d'objets ou d'institutions
– prennent face à lui
une existence sociale indépendante et, au lieu d'être dominés
par lui, le dominent. L'aliénation est donc ce qui s'oppose à la
créativité libre de l'homme dans le monde créé par l'homme ;
elle n'est pas un principe historique indépendant, ayant une
source propre. C'est l'objectivation de l'activité humaine, dans
la mesure où elle échappe à son auteur sans que son auteur
(6) Voir T. Koopmans, Activity analysis of production and allo-
cation, 1951.
20
de sol
puisse lui échapper. Toute aliénation est une objectivation hu-
maine, c'est-à-dire à sa source dans une activité humaine (il
n'y a pas de « forces secrètes » dans l'histoire, pas plus de ruse
de la 'raison que de lois économiques naturelles) ; mais toute
objectivation n'est pas nécessairement une aliénation (1) dans
la mesure où elle peut être consciemment reprise, affirmée à
nouveau ou détruite. Le socialisme sera la suppression de l'alié-
nation en tant qu'il permettra la reprise perpétuelle, consciente
et sans conflits violents, du donné social, en tant qu'il restau-
rera la domination des hommes sur les produits de leur activité.
La société capitaliste est une société aliénée en tant qu'elle est
dominée par ses propres créations, en tant que ses transforma-
tions ont lieu indépendamment de la volonté et de la conscience
des hommes (y compris de la classe dominante), d'après des
quasi-« lois » exprimant des structures objectives indépendantes
contrôle.
Ce qui nous intéresse ici n'est pas de décrire comment se
produit Talinénation sous forme d'aliénation de la société capi-
taliste ce qui impliquerait l'analyse de la naissance du capi-
talisme et de son fonctionnement mais de montrer les mani-
festations concrètes de cette aliénation dans les diverses sphères
d'activité sociale et leur unité intime.
Ce n'est que dans la mesure où l'on saisit le contenu du
socialisme comme l'autonomie du prolétariat, comme activité
créatrice libre se déterminant elle-même, comme gestion ouvrière
dans tous les domaines, que l'on peut saisir l'essence de l'aliéna-
tion de l'homme dans la société capitaliste. Ce n'est pas par
hasarı en effet que bourgeois « éclairés » et bureaucrates réfor-
mistes ou staliniens voulent réduire les maux du capitalisme à
des maux essentiellement écononiques, et, sur le plan écono-
mique, à l'exploitation sous la forme de la distribution inégale
du revenu national. Dans la mesure où leur critique du capita-
lisme sera étendue à d'autres domaines, elle prendra son point
de départ encore dans cette distribution inégale du revenu et
consistera essentiellement en variations sur le thème de la puis-
sance corruptrice de l'argent. S'agit-il de la famille et du pro-
blème sexuel, on parlera de la pauvreté poussant à la prostitu-
tion, de la jeune fille vendue au riche vieillard, des drames du
fover résultant de la misère. S'agit-ii de la culture, il sera ques-
(1) Tout produit de l'activité humaine (même une attitude pure-
ment intérieure) dès qu'il est posé « échappe à son auteur » et mène
une existence indépendante de lui. On ne peut pas faire qu'on n'ait
pas prononcé telle parole ; mais on peut cesser d'en être déterminé.
La vie passée de tout individu est son objectivation à ce jour ; mais
il ne lui est pas nécessairement et exhaustivement aliéné, son avenir
n'est pas définitivement dominé par son passé.
2
21
tion de la vénalité, des obstacles que rencontreront les talents
non nantis, de l'analphabétisme. Certes, tout cela est vrai, et
important. Mais cela ne concerne que la surface du problème ;
et ceux qui ne parlent que de cela regardent l'homme uniquement
comme consommateur et en prétendant le satisfaire sur ce plan,
ils tendent à le réduire à ses fonctions physiques de digestion
(directe ou sublimée). Mais pour l'honime il ne s'agit pas
d'« ingérer » purement et simplement mais de s'exprimer et de
créer, et non seulement dans le domaine économique, mais dans
la totalité des domaines.
· Le conflit de la société de classe ne se traduit pas simple-
ient dans le domaine de la distribution, comme exploitation et
limitation de la consommation ; ce n'est là qu'un aspect du
conflit, et non le plus important. Son aspect fondamental est la
limitation et en fin de compte la tentative de suppression du
rôle humain de l'homme dans le domaine de la production. C'est
le fait que l'homme est exproprié du commandement sur sa
propre activité, aussi bien indiyiduellement que collectivement.
Par son asservissement à la machine, et, à travers celle-ci, à une
volonté abstraite, étrangère et hostile l'homme est privé du véri-
table contenu de son activité humaine, la transformation cons-
ciente du monde naturel, la tendance profonde qui le porte à
se réaliser dans l'objet est constamment inhibée. La signification
véritable de cette situation n'est pas seulement qu'elle est vécue
comme un malheur absolu, comme une mutilation permanente
par les producteurs ; c'est qu'elle crée un conflit perpétuel au
niveau le plus profond de la production, qui explose à la moindre
occasion ; c'est aussi qu'elle conditionne un gaspillage immetise
à comparaison duquel celui des crises de surproduction est
vraisemblablement négligeable – à la fois par l'opposition posi-
tive des producteurs à un système qu'ils refusent et par le
manque à gagner résultant de la neutralisation de l'inventivité
et de la créativité des millions d'individus. Au delà de ces
aspects, il faut se demander daris quelle mesure le développe-
ment ultérieur de la production capitaliste serait même « tech-
niquement possible, si le producteur immédiat continuait à
être maintenu dans l'état parcellaire qui est actuellement le sien.
Mais l'alienation dans la société capitaliste n'est pas sim-
plement économique ; elle ne se manifeste pas seulement à pro-
pos de la production de la vie matérielle, mais affecte fondamen-
talement aussi bien la fonction sexuelle que la fonction culturelle
de l'homme.
Il n'y a en effet de société que dans la mesure où il y a orga-
nisation de la production et de la reproduction de la vie des
individus et de l'espèce — donc organisation des rapports écono-
22
miques et sexuels – et que dans la mesure où cette organisation
cesse d'être simplement instinctive et devient consciente - donc
contient le moment de la culture. (2)
Si donc une organisation sociale est antagonique, elle tendra
à l'être aussi bien sur le plan productif que sur le plan sexuel
et sur le plan culturel. Il est faux de penser que le conflit dans
le domaine de la production « crée » ou « détermine » un conflit
secondaire et dérivé sur les autres plans ; les structures de domi-
nation de classe s'imposent d'emblée sur les trois plans à la fois
et sont impossibles et inconcevables en dehors de cette simulta-
néité, de cette équivalence. L'exploitation par exemple, ne peut
être garantie que si les producteurs sont expropriés de la gestion
de la production : mais cette expropriation à la fois présuppose
que les producteurs tendent à être séparés des capacités de gestion
- donc de la culture - et reproduit cette séparation à une
échelle élargie. De même, une société où les rapports interhu-
mains fondamentaux soni des rapports de domination présuppose
à la fois et entraîne une organisation aliénatoire des rapports
sexuels, à savoir une organisation créant chez les individus des
inhibitions fondamentales, tendant à leur faire accepter l'auto-
rité, etc... (3)
Il y a en effet de toute évidence une équivalence dialectique
entre les structures sociales et les structures « psychologiques
des individus. Dès ses premiers pas dans la vie l'individu est
soumis à une pression constante visant à lui imposer une atti-
(2) Comme disait Marx, ir l'abeille, par la structure de ses
cellules de cire, fait honte à plus d'un architecte. Mais ce qui, de
prime abord, établit une différence entre le plus piètre architecte
et l'abeille la plus adroite, c'est que l'architecte construit la cellule
dans sa tête avant de la réaliser dans la cire ». (Le Capital, trad.
Molitor, t. II, p. 4). Technique et conscience vont évidemment de
pair : un instrument est une signification matérialisée et opérante,
ou encore une médiation entre une intention réfléchie et un but
encore idéal.
Ce qui est dit dans ce texte de Marx de la fabrication des cel-
lules des abeilles, peut être dit tout aussi bien de leur organisation
« sociale ». Comme la technique représente une rationalisation des
rapports avec le inonde naturel, l'organisation sociale représente une
rationalisation des rapports entre individus du groupe. Mais l'orga-
nisation de la ruche est une rationalisation inconsciente, celle d'une
tribu est consciente ; le primitif peut la décrire, et il peut la nier
(en la transgressant). Rationalisation dans ce contexte ne signifie
évidemment pas « notre » rationalisation. A une étape et dans un
contexte donné, aussi bien la magie que le cannibalisme représentent
des rationalisations (sans guillemets).
(3) Voir sur la relation profonde entre la structure de classe de
la société et la réglementation patriarcale des rapports sexuels les
travaux de W. Reich, The Sexual revolution (1945), Character
analysis (1948) et La fonction de l'orgasme (trad. française 1952).
En particulier dans le dernier, l'analyse de la structure névrotique
de l'individu fasciste (pp. 186-199).
23
tude donnée vis-à-vis du travail, du sexe, les idées, à le frustrer
des objets naturels de son activité et à l'inhiber en lui faisant
intérioriser et valoriser cette frustration. La société de classe
ne peut exister que dans la mesure où elle réussit à imposer
cette acceptation à un degré important. C'est pourquoi le conflit
n'y est pas un conflit purement extérieur, mais il est transposé au
cæur des individus eux-mêmes. La structure sociale antagonique
correspond à une structure antagonique chez les individus, cha-
cune se reproduisant perpétuellement par le moyen de l'autre.
Le but de ces considérations n'est pas seulement de souligner
le moment d'identité de l'essence des rapports de domination,
qu'ils se situent dans l'usine capitaliste, dans la famille patriar-
cale ou dans la pédagogie autoritaire et la culture « aristocra-
tique ». C'est d'indiquer que la révolution socialiste devra néces-
sairement embrasser l'ensemble des domaines, et ceci non pas
dans un avenir imprévisible et « par surcroît », mais dès le
départ. Certes, elle doit commencer d'une certaine façon, qui
ne peut être autre que la destruction du pouvoir des exploiteurs
par le pouvoir des masses armées et l'instauration de la gestion
ouvrière de la production. Mais elle devra aussitôt s'attaquer
á la reconstruction des autres activités sociales, sous peine de
mort. Nous essaierons de le montrer sur l'exemple des rapports
du prolétariat au pouvoir avec la culture.
La structure antagonique des rapports culturels dans la
société actuelle s'exprime aussi (mais nullement exclusivement)
par la division radicale entre le travail manuel et le travail
intellectuel, ce qui a comme résultat que l'immense majorité
de l'humanité est totalement séparée de la culture comme acti-
vité et ne participe qu'à une infime partie de ses résultats. D'un
autre côté, la division de la société en dirigeants et exécutants
devient de plus en plus homologue à la division du travail
manuel et intellectuel (tous les travaux de direction étant des
travaux intellectuels, et tous les travaux manuels étant des
travaux d'exécution (4)). La gestion ouvrière n'est donc possi-
ble que si cette dernière division tend dès le départ à être
dépassée, en particulier pour ce qui est du travail intellectuel
relatif à la production. Cela implique à son tour l'appropriation
de la culture par le prolétariat. Non pas certes comme culture
toute faite, comme assimilation des « résultats » de la culture
historique; cette assimilation, au-delà d'un point, est à la fois
(4) Entre les deux se situe la catégorie dse travaux intellectueis
d'exécution, dont l'importance va croissant. Nous en parlerons plus
loin.
24
impossible dans l'immédiat et superflue (pour ce qui intéresse
ici). Mais comme appropriation de l'activité et comme récupé-
ration de la fonction culturelle, comme changement radical du
rapport des masses des producteurs au travail intellectuel. Ce
n'est qu'au fur et à mesure de ce changement que la gestion
ouvrière deviendra irréversible.
Pierre CHAULIEU.
(La fin au prochain numéro).
25
1
Le problème du journal
ouvrier
4
Ce texte, ouvre une discussion sur le problème du journal
ouvrier, qui se poursuivra aux prochains numéros de Socialisme
ou Barbarie. Il s'appuie sur l'expérience de Tribune Ouvrière,
publiée depuis plus d'un an par un groupe d'ouvriers úe la
Régie Renault, dont on a publié des extraits dans le nuniéro
précédent de cette Revue; et dont on trouvera de nouveaux,
extraits dans ce numéro-ci.
Le développement de la culture et celui du rôle des partis poli-
tiques sont à l'origine de l'énorme expansion de la presse qui
caractérise notre siècle. La division du travail d'autre part a fait
du journalisme une branche industrielle particulière, avec ses
lois propres. Ceci particulièrement dans le capitalisme « libéral »,
où la presse doit être en général une industrie rentable.
Bien que les régimes totalitaires suppriment cette autonomie
apparente, et lient le journal étroitement au régime, il n'en est
pas moins vrai que le journal du parti communiste dans une
démocratie populaire doit obéir aux mêmes règles fondamentales
que le journal libéral dans une démocratie occidentale: informer,
influer sur l'idéologie des lecteurs --et avant tout : être lu. C'est
ainsi que même dans les pays totalitaires le journal doit faire
des concessions aux lecteurs; comme elles ne peuvent pas étre
faites sur le plan politique ou idéologique, le rôle du journaliste
est de trouver justement le moyen d'intéresser le lecteur par la
bande. Nous ne ferons pas ici le procès du journalisme et l'ana-
lyse des contradictions dans lesquelles il se développe.
Face à la presse officielle s'est dressée la presse des orga-
nisations révolutionnaires; celle-ci, en particulier pendant les
26: -
périodes de crise révolutionnaire de la société, se trouvait favo-
risée par le fait que son contenu politique correspondait aux
intérêts de ses lecteurs ouvriers. Mais, bien que leur contenu
politique soit complètement différent, les journaux révolution-
naires ont toujours ceci de commun avec les journaux bourgeois,
leur séparation de la classe ouvrière; le journal est dans les deux
cas un organisme à part, avec son personnel attitré, sa hiérar-
chie de rédacteurs, dont les uns ont pour tâche la propagande.
sortes de journaux; conclure, sous prétexte que tous deux font
les autres l'information, etc.
Nous avons donc d'un côté le journal bourgeois ou stalinien,
de l'autre le journal révolutionnaire, qui diffusent chacun leur
idéologie propre. Notre but ici n'est pas d'amalgamer ces deux
sortes de journaux ; conclure sous prétexte que tous deux font
de la propagande et de la politique, qu'ils ont la même idéologie,
serait une stupidité que l'on ne retrouve que dans les courants
syndicalistes et anarchistes.
Mais si nous avons parlé de ces journaux et que nous leur
avons découvert un caractère commun, c'est bien pour leur oppo-
ser un autre type de journal, que nous appellerons le journal
ouvrier.
Hl ne s'agit pas d'une idée nouvelle, produit d'une élabora-
tion intellectuelle ; de tels journaux ont déjà existé dans l'his-
toire du mouvement ouvrier (journaux ouvriers du xixe siècle).
Et, comme nous essaierons de le montrer par la suite, cette idée.
fait partie de la conception fondamentale du socialisme, de la
capacité de la classe ouvrière de détruire le capitalisme et de
gérer elle-même une société socialiste.
Ce journal ouvrier sera un journal qui n'aura pas un appa-
reil autonome ; c'est-à-dire que ses rédacteurs, ses diffuseurs, ses
lecteurs seront un ensemble assez large d'ouvriers. Non seule-
ment l'appareil du journal ne sera pas séparé de ses lecteurs, mais
aussi le contenu du journal sera déterminé par cet ensemble de
rédacteurs, diffuseurs, lecteurs ouvriers. Le journal n'aura pas
comme objectif de diffuser une conception politique déterminée
dans la classe ouvrière, mais partira des expériences concrètes
des ouvriers, individuelles ou collectives, pour répondre aux pro-
blèmes qui préoccupent ceux-ci.
Quels sont ces problèmes ?
Ce sont d'abord les problèmes de l'exploitation, qui se posent
tous les jours, au sein de la production - et nous n'entendoris pas
seulement par là les problèmes de revendications, mais tous les
aspects de l'aliénation des ouvriers dans le cadre de la production
capitaliste. Ce sont ensuite tous les problèmes que le cadre social
du capitalisme pose aux ouvriers. Mais la classe n'est pas seule-
27
ment maintenue à son rôle d'exploitée par les lois économiques du
capitalisme, mais aussi par l'idéologie de cette société. Les préoc-
cupations des ouvriers sont déviées de leurs véritables objectifs
par les idéologies dominantes : soit que les courants bourgeois ou
staliniens déforment des problèmes qui préoccupent les ouvriers
(par exemple le problème des salaires relié à la productivité par
les patrons, ou au réarmement allemand par les staliniens), soit
qu'ils introduisent dans la classe des préoccupations qui lui sont
au fond étrangères (loi électorale). Enfin, l'existence même de
ces idéologies et leur diffusion au sein de la classe quvrière pose
un problème en elle-même. Quels sont ces courants idéologiques,
dans quel sens influencent-ils les ouvriers, dans quel sens les
ouvriers réagissent-ils ? Répondre à ces problèmes est le but que
le journal doit se proposer. Il est donc aussi absurde de dire au
départ que le journal ouvrier ne parlera que de la situation poli-
tique internationale, que de dire que le journal ne parlera que
des rapports entre les ouvriers et la maîtrise. Donc, le journal
doit être en une certaine mesuré « empirique » ; il doit suivre
le courant des préoccupations des ouvriers. Seules, les organisa-
tions bureaucratiques ou bourgeoises peuvent avoir peur de ce
courant ; les révolutionnaires n'ont rien à perdre dans ce dia-
logue, its ont tout à gagner car seule la classe ouvrière peut
apporter les moyens et les formes de lutte contre la société capi-
taliste.
Si nous sommes amenés à parler aujourd'hui de ce problème,
c'est qu'il existe deux expériences de journal de ce genre, l'une
aux Etats-Unis avec le journal Correspondance, l'autre en
France, chez Renault, avec la Tribune Ouvrière. Nous exami-
nerons le problème à la lumière de l'expérience de Tribune
Ouvrière, à la fois sur le plan théorique et sur le plan pratique,
et nous essaierons de tirer les leçons de cette expérience, aussi
minime soit-elle.
Nous resterons ainsi fidèles à cette préoccupation fonda-
mentale qui est la liaison entre l'organisation révolutionnaire
et la classe ouvrière, entre la théorie et l'expérience pratique
des, ouvriers. Ces deux éléments devront nécessairement se
rejoindre, et leur jonction ne sera pas seulement une assimila-
tion de l'idéologie révolutionnaire par la classe ouvrière, mais
aussi une assimilation de l'expérience ouvrière par les militants
révolutionnaires. Dans cet article, nous essaierons de mettre face
à face notre conception théorique fondamentale et la dynarnique
de l'effort des ouvriers qui participent à ce journal. Nous serons
toujours guidés par ces deux éléments, et dans les conclusions
nous essaierons de joindre ces deux éléments, le plus abstrait et
28
le plus concret, pour formuler des conclusions précises sur le
développement du journal ouvrier.
LES DEUX PROCESSUS DE POLITISATION.
La politique, dans la société capitaliste, est devenue une
profession spécialisée, une sorte de science qui nécessite des
études; l'initiation y cst ardue et décourage beaucoup d'ou-
vriers qui finissent souvent par classer tout ce qu'ils ne compren-
nent pas dans la « politique ». Il existe ainsi dans la classe
ouvrière une division entre ceux qui font de la politique et
ceux qui n'en font pas.
Pour les militants socialistes ou staliniens ou trotskistes, il
s'agit de « politiser l'ouvrier », c'est-à-dire de l'initier sous une
forme vulgarisée et simplifiée aux mystères de cette science.
L'initiation vise à persuader que le parti en question défend
Touvrier et qu'à son tour l'ouvrier doit défendre le parti.
Pour les staliniens. cette politisation consistera à initier les
ouvriers au mécanisme de la politique de la bourgeoisie aussi
bien sur le plan intérieur (signification des partis bourgeois) que
sur le plan extérieur (signification des accords internationaux).
Pour les trotskistes, l'initiation des ouvriers à la politique est
beaucoup plus complexe et difficile : elle exige une interpréta-
tion cie l'histoire du mouvement ouvrier (dégénérescence de la
Révolution russe et de la Troisième Internationale), une expli-
cation meme tronquée des théories marxistes sur l'économie
et la politique, etc...
Aussi bien les tentatives d'initiation des ouvriers à la poli-
tique bourgeoise que la tentative de les initier aux problèmes
abstraits reposent sur une conception particulière du rôle des
organismes et des mouvements de masse. Pour le stalinisme et le
trotskisme, les organismes et les mouvements de masse ne sont
que des réservoirs dans lesquels le parti puise ses militants
ouvriers, et sur lesquels le parti essaie d'imprimer sa propre
orientation, au moyen du noyautage et de maneuvres diver-
ses. On tend à substituer à la politique des organismes de
masse la politique du parti, à l'initiative des ouvriers l'initia-
tive du parti : il s'agit de substituer aux problèmes qui nais-
sent dans la production ou dans la vie publique des ouvriers
les problèmes politiques généraux qui préoccupent le parti.
C'est ainsi qu'on explique aux ouvriers que les bas salaires
sont dus aux accords de Paris, ou qu'ils sont dus à la dégéné-
rescence de la révolution russe --- ce qui représente, à des degrés
divers, une absurdité et une mystification.
29
Dans les deux conceptions, nous retrouvons la même idée :
les problèmes politiques généraux qui préoccupent le parti.
aucun intérêt, le seul intérêt réside dans la politique du gou-
vernement français ou la politique de la bureaucratie russe.
Indépendamment de son contenu mystificateur, cette concep-
tion repose sur une erreur théorique fondamentale ; elle mécon-
naît l'existence de deux processus de politisation, un qui est
propre aux militants, un autre qui est propre à la classe ouvrière.
Si la forination du militant révolutionnaire est une for-
mation presque exclusivement intellectuelle, surtout dans les
périodes comme celles que nous avons vécues où l'absence
de mouvements ouvriers a déraciné les minorités révolutionnai-
res de la classe, la formation politique des ouvriers est au
contraire, presque exclusivement pratique. C'est au cours de ses
différentes luttes que la classe ouvrière assimile, d'une façon
plus ou moins durable, une certaine expérience politique et crée
ses propres méthodes de lutte. (1)
S'il est évident que ces deux pôles, l'expérience immédiate
des ouvriers et l'expérience théorique des militants révolution-
naires doivent se rejoindre, la question controversée est de
situer leur point de rencontre. La conception stalinienne ne
considère qu'un aspect des rapports de l'organisation et de la
classe, celui suivant lequel le parti donne l'idéologie révolution-
naire à la classe ouvrière. L'autre aspect, passé sous silence,
c'est que l'idéologie que donne l'organisation d'avant-garde à
la classe ouvrière, elle la puise elle-même dans cette classe. Là,
il n'existe pas seulement un courant unique, allant de l'orga-
nisation à la classe et de la classe à l'organisation. Dans ce
sens, si la classe ouvrière a besoin de l'organisation révolution-
naire pour théoriser son expérience, l'organisation a besoin de
la classe pour y puiser cette expérience. Ce processus d'osmose
a une importance déterminante.
Quand on dit que l'organisation puise dans la classe ouvrière,
on ne veut pas dire qu'elle y puise seulement la méthode de se
faire comprendre, la façon d'inculquer ses théories au proléta-
riat, mais aussi les éléments essentiels pour l'élaboration de
cette théorie. Pour schématiser, l'organisation révolutionnaire
n'a rien à voir avec l'Eglise qui inculque un dogme en utili-
sant tous les modes d'expression, en argot aux ouvriers, en
(1) Il est bien évident que ces deux processus sont réduits ici à
un schéma, mais qu'en réalité ils n'existent ni l'un ni l'autre à l'état
pur. Dans la formation des militants évolutionnaires il y a toujours
une part d'expérience pratique, et dans la formation des ouvriers
d'avant-garde il existe une part de formation intellectuelle.
30
musique aux artistes. Ce n'est pas le problème de trouver un
langage accessible à la classe, mais de dégager les idées qui
s'élaborent au sein de celle-ci.
Ainsi on est amené à reconnaître la liaison profonde entre
les réactions élémentaires et spontanées des masses et l'instau-
ration d'une société socialiste ; mais alors, le rôle de l'orga-
nisation révolutionnaire n'est plus de soutenir ces réactions
par tactique et uniquement pour s'attacher les masses, ou bien
de les transposer sur le terrain de la politique bourgeoise. Ce
sont ces aspirations élémentaires et profondes qui doivent nous
servir de guide.
Il n'y a pas en effet deux problèmes séparés, dont l'un serait
la lutte contre le système capitaliste culminant dans la prise
du pouvoir, et l'autre la réalisation du socialisme et la gestion
de la société par les ouvriers ; et le rôle de l'organisation révo-
lutionnaire n'est pas de « conquérir » les organismes de masse,
mais de les aider à devenir la charpente de la société.
En effet, le socialisme n'est réalisable que si les ouvriers
sont capables de gérer cette société. La capacité de gestion doit
être au maximunt développée au sein même de la société capi-
taliste. Cependant, cette gestion ne peut se faire dans la pro-
duction capitaliste, mais seulement dans la lutte contre la
gestion capitaliste ;-autrement dit, il n'est pas question que
les ouvriers puissent gérer quoi que ce soit aussi longtemps que
le capitalisme subsiste, sauf précisément leurs propres organes
destinés à lutter contre ce capitalisrne. Et les méthodes par les-
quelles se fait cet apprentissage à la gestion doivent être dès le
départ imprégnées du but à réaliser. Comment développer cette
capacité gestionnaire de la classe ouvrière ? C'est à cette ques-
tion que doit répondre le journal ouvrier, non seulement dans
son contenu, mais aussi dans sa conception même, et dans son
mode de fonctionnement ; c'est-à-dire qu'il doit être géré lui-
même par les ouvriers.
LA NATURE DU JOURNAL OUVRIER.
Le journal ouvrier doit donc être à la fois l'expression de
l'expérience des ouvriers (et dans ce sens, nous le verrons, il
ne peut être écrit que par les ouvriers eux-mêmes) et le moyen
d'aider à la théorisation de cette expérience (et par là d'aider
à ce processus de politisation de la classe ouvrière). Mais le
journal ne doit pas se séparer de cette expérience, car autre-
ment il échappe obligatoirement au contrôle de la classe ouvrière.
Dans cette définition, le journal ouvrier n'est ni un jour-
nal politique, ni un journal syndical, ni un document.
31
a) Ce n'est pas un journal politique ; cela veut dire qu'il
n'est pas l'expression d'une organisation politique, qu'il ne
colporte pas l'idéologie de cette organisation politique au sein
des masses. Il ne suppose pas un accord préalable entre diffé-
rentes tendances politiques sur un programme. Le principe qui
le fonde et suffit à le délimiter de toute autre entreprise, c'est
que « la classe ouvrière est capable elle-même de résoudre les
problèmes de son émancipation ».
Cela ne veut pas du tout dire que le journal ne traitera pas
de politique. Il peut traiter de questions politiques. Mais les
conceptions politiques qui sortiront de ce journal ne seront que
les conclusions des expériences faites ; elles ne seront jamais
posées comme les pensées ou les postulats impliquant l'accep-
tation préalable d'une idéologie quelconque.
b) Mais ce ne sera pas non plus un journal syndical qui ne
s'occupe que des questions économiques.
Nous avons déjà eu l'occasion de montrer que cette sépa-
ration entre questions économiques et politiques ne correspon-
dait aujourd'hui à rien de réel, que tout syndicalisme aussi
pur soit-il, est politique. Le journal ne sera pas un journal syn-
dical dans le sens où les problèmes traités dépasseront le
.cadre du syndicalisme.
c) Ce ne sera pas un document. Le journal ouvrier ne peut
pas être un magazine qui se contenterait de retracer de façon
anecdotique la vie de l'ouvrier en usine. Ce qui se passe en
usine, l'ouvrier le sait ; la description de son lieu de travail
et de ses raports avec la direction n'ont d'intérêt que pour
les gens étrangers, à l'usine. Et ce n'est pas le cas du journal,
La description d'un événement dans l'usine ou ailleurs n'a
d'intérêt que si on peut extraire de cet événement des consi-
dérations qui intéressent l'expérience ouvrière en général.
Le journal ne sera ni un journal politique ni un journal syn-
dical, ni un documentaire sur la vie des ouvriers, mais il sera
tout.cela à la fois. Nous ne disons pas que le journal ouvrier
doit être un journal dont une partie sera réservée à la politi-
que, l'autre à l'économique, l'autre à la description.
Le journal aura un sens plus universel dans la mesure où
il condensera le politique, l'économique, le social. C'est en ceci
qu'il atteindra le sens plus profond de la politique.
Dans les journaux traditionnels une partie est réservée aux
problèmes politiques qui sont les problèmes politiques de la
bourgeoisie des différents pays : l'évolution des rapports entre
les classes dominantes des différents pays, les rapports entre les
différents partis politiques, etc.
Une autre partie est réservée aux problèmes économiques
32
et consiste à poser des revendications de telle ou telle catégo-
rie professionnelle ou de tel ou tel syndicat.
Un effort constant est fait par ailleurs pour relier entre eux
ces secteurs. Par exemple, la campagne menée par la C.G.T.
contre le réarmement allemand est liée directement avec toutes
sortes de revendications minimum des ouvriers. Ce qui revient
à peu près à cela : pour l'augmentation de vos salaires, luttez
contre le réarmement allemand.
Il y a donc deux pôles, l'un politique, l'autre économique et
il s'agit pour les journaux des partis de tracer un chemin qui
aille d'un pôle à l'autre. C'est dans ce sens qu'aujourd'hui le
syndicat est un organisme politique et que le parti politique
est un organisme syndical. Il s'agit d'aller d'une revendication
qui rallie l'accord des ouvriers, qui est comprise par tous, à une
politique générale qui ne peut être très bien comprise par per-
sonne. Par exemple, le fait que les syndicats défendent un pro-
gramme revendicatif tel que « 40 heures. payées 48, 3 semaines
de congés payés » fera peut-être que les ouvriers accepteront
la politique de ces syndicats, non pas pour elle-même, mais pour
la revendication. Les municipalités communistes s'occupent des
vieux travailleurs, des sinistrés, des cuvres sociales, etc... pour
donner crédit à leur politique générale et le fait que sur ce
plan les communistes sont imbattables vient de leur situation
d'opposition aux gouvernements.
Une minorité qui est encore plus détachée de l'appareil
d'Etat bourgeois que ne le sont les staliniens, qui n'a donc rien
à perdre, peut sur ce plan rivaliser et dépasser les organisations
communistes.
C'est ce que font le plus souvent les organisations trotskis-
tes et anarchistes qui surenchérissent sur les revendications
posées par les organisations syndicales aussi bien que sur les
moyens de lutte.
Ainsi apparaît toute une échelle hiérarchique des luttes
politiques ou révendicatives. Le Syndicat Chrétien ou F. 0.
demandent dix francs d'augmentation, en proposant un jour
de grève. La C.G.T. demandera vingt francs et deux jours de
grève ; les trotskistes et les anarchistes demandent 1.000 francs
d'augmentation et grève illimitée.
Le chemin qui conduit de la simple revendication économi
que à la revendication ou l'action politique est tortueux. Les
uns lieront les revendications à la question du réarmement
allemand, pour d'autres, les revendications seront liées à la
destruction du système capitaliste et à la prise du pouvoir poli-
tique par la classe ouvrière.
Pour les uns comme pour les autres, il existe deux problè-
33
un
mes. L'un est celui de la revendication immédiate des ouvriers,
celui de l'action spontanée des ouvriers, de la lutte de classe à
l'état le plus élémentaire ; l'autre est celui de la prise du pouvoir
politique. La liaison entre ces deux problèmes peut se résu-
mer ainsi : « si vous nous aider à prendre le pouvoir politi-
que, vous n'aurez plus à lutter pour vos revendications immé-
diates : nous vous les accorderons. »
Cette propagande tend à proposer une sorte de marché à la
classe ouvrière pour lui montrer que dans toute l'affaire elle a
plus à gagner à voter pour tel parti, et mettre ce parti au pou-
voir ou à faire la Révolution qu'à revendiquer 10 francs d'aug-
mentation de l'heure tous les six mois.
En fait, cette politique consiste soit à montrer que la classe
ouvriere se trompe de route quand elle revendique ou se défend
ainsi, soit qu'elle n'en demande pas assez et qu'en demandant
plus elle pourra arriver peu à peu à provoquer des crises et à
précipiter les contradictions du régime et s'opposera ainsi de
plus en plus au système lui-même.
Mais pour toutes ces organisations la lutte des ouvriers est
considérée comme accessoire, comme secondaire, comme
moyen pour arriver au but final.
Le journal ouvrier part d'une autre conception. Cette concep-
tion est que la lutte de classe la plus élémentaire contient en
elle-même des éléments fondamentaux pour la destruction du
système capitaliste et pour l'institution du socialisme. Et ce
sont ces éléments que le journal doit chercher et développer.
Pour elle, il y a une liaison profonde entre les conceptions révo-
lutionnaires du socialisme et la lutte ouvrière de tous les jours.
Nous ne voulons pas dire du tout que toute lutte de classe
pose dans son ensemble le problème fondamental de la destruc-
tion du système capitaliste et de l'instauration du socialisme.
Toute lutte de classe porte l'empreinte des influences de l'idéo-
logie bourgeoise ou stalinienne; et c'est d'abord de ces influen-
ces que le journál doit dégager la lutte de classe. Mais ceci ne
peut se faire en augmentant l'ampleur de la lutte comme le font
les trotskistes ou anarchistes, mais en découvrant les véritables
objecifs de cette lutte. Ainsi par exemple, pour la grève du
28 avril 1954, les trotskistes et les anarchistes lancèrent l'idée
de grève illimitée + sans se préoccuper de la revendication
elle-même. Au contraire, nous dégageâmes le sens faux de la
revendication, qui était hiérarchisée. Cela avait une signification
politique plus profonde que de surenchérir sur un mouvement
qui né reposait que sur un objectif de tactique et dont la base
était fausse dès le départ.
34
Cependant, le journal ne peut aborder tous les problèmes
fondamentaux ni apporter une conclusion automatique à tous les
problèmes. L'expérience de la classe ouvrière est souvent une ex-
périence particulière: le rôle du journal sera de partir de ces
expériences particulières pour en tirer des conclusions géné-
rales ---- cela ne veut pas dire que les conclusions générales
soient toujours possibles.
Le journal devra aussi combattre les conceptions bourgeoises
et staliniennes. Pour ce faire, il sera parfois obligé de discuter
de façon générale et abstraite, mais essaiera de relier le plus
possible ces problèmes à l'expérience vivante des ouvriers.
Tout ce que nous venons de dire sur le contenu du jour-
nai correspond à une certaine orientation idéologique. Cela est
indéniable et il serait hypocrite de vouloir présenter le journal
ouvrier comme un journal n'obéissant à aucune ligne de conduite
guidé simplement par « ce que veulent et pensent les ouvriers ».
Un journal qui n'aurait pas de ligne directrice serait auto-
matiquement un journal contradictoire qui, tôt ou tard, tom-
berait sous l'influence des éléments politiques les plus habiles.
Le journal a une ligne. C'est la discussion et la confrontation
des ouvriers, mais ce sont seuls des militants révolutionnaires
qui ont compris l'énorme signification de cette discussion et de
cette participation des ouvriers aux problèmes politiques, éco-
nomiques et sociaux, qui peuvent empêcher l'étouffement de cette
discussion par des politiciens habiles.
Le rôle des militants révolutionnaires dans le journal ne se
limite pas à cela. Le militant révolutionnaire n'est pas un spec-
tateur qui voit s'affronter des ouvriers dans une discussion ou
qui récolte comme un collectionneur, les réflexions de la classe
ouvrière. Il est un défenseur de cette discussion, mais aussi un
participant. Le militant révolutionnaire cherchera à approfon-
dir et à développer la discussion qui deviendra un dialogue entre
les ouvriers et l'organisation révolutionnaire. Le militant révo-
lutionnaire essaiera de faire triompher son idéologie mais à la
différence des politiciens bourgeois et staliniens il ne se servira
que de l'expérience ouvrière, c'est-à-dire qu'il luttera sur le ter-
rain des ouvriers, sur le terrain des questions concrètes. Dans ce
sens, son dialogue avec les ouvriers sera un dialogue réel et non
un monologue.
Ainsi sera donc évité le danger que le journal ne soit qu'une
confrontation des partis politiques et qu'il ne puisse sortir de
l'orniere traditionnelle de ces partis. Le rôle du militant révo-
lutionnaire est d'aider la classe ouvrière à sortir de cette ornière
et c'est cela qui sera la ligne directrice du journal.
35
Dans ce sens, la séparation entre articles politiques et « arti-
cles qui intéressent les ouvriers » doit disparaitre. Dans les jour-
naux bourgeois ou staliniens, il est de coutume pour faire ava-
ler l'article politique de le délayer avec des faits divers, des
choses qui se passent dans la société de tous les jours.
Ainsi, les deux choses sont séparées; les aspects concrets de
la vie et les aspects abstraits, les choses : « du peuple » et les
choses « des politiciens » ou des « initiés ». Ces choses qui
se passent tous les jours et dont les ouvriers peuvent se rendre
compte sont considérées comme les ragots, les potins dont la
presse à grand tirage fait son succès.
Le reproche aux journaux à grand tirage est non pas qu'ils
traitent de cette vie quotidienne mais qu'ils la déforment et
qu'ils la traitent accidentellement, dans le sens de leur morale et
en fonction de leur idéologie. Mais dans la mesure où ce
sont les préoccupations idéologiques des couches exploiteuses qui
donnent une interprétation aux faits réels, il s'ensuit que les
faits eux-mêmes subissent une altération,
La réalité devient elle aussi par ce fait irréelle, surtout
pendant les périodes où le prolétariat tend à se détacher des
idéologies dominantes.
Ainsi on représente des hommes abstraits avec des senti-
ments imaginaires. Le prolétariat idéal tel qu'il devrait être
pour un bureaucrate communiste ou pour un bourgeois. Ainsi
le Superman communiste a plus de parenté avec un person-
nage de l'Histoire Sainte qu'avec le lecteur ouvrier qu'il est
censé représenter.
Le journal ouvrier ne contiendra pas ces deux éléments
séparés - le théorique d'une part et la réalité de l'autre,
non pas pour fiatter ou pour avoir une plus grande clientèle
mais parce que les problèmes de la vie courante sont des pro-
blèmes essentiels que la classe ouvrière et son avant-garde doivent
résoudre, et parce que vouloir limiter les préoccupations des
ouvriers aux aspects < politiques » de la lutte est l'héritage d'une
fausse conception qui ne voit dans le prolétariat qu'une force
susceptible seulement d'appuyer le parti politique.
! Le but final, la solution de tous les problèmes est incontesta-
blement la suppression de la société capitaliste et son rempla-
cement par une société socialiste.
Le but final est une solution abstraite dans le sens où il
correspond à une notion purement intellectuelle. Ce but final
est le schéma, la charpente que le militant révolutionnaire a
assimilé. Mais cette notion reste abstraite jusqu'au jour où l'ex-
périence de la classe ouvrière l'amène à concrétiser ce schéma,
36
à recouvrir cette charpente de tout un réseau d'actions prati-
ques. Mais avant cette période le fossé qui sépare l'action réelle
des ouvriers et le but final ne peut être comblé par un saut de la
situation actuelle à une solution abstraite. Ainsi, nous avons
critiqué cette façon de traiter artificiellement tout problème en
concluant chaque article par la nécessité de faire la révolution
socialiste. Le journal pour rester sur un plan concret ne peut
donc franchir ce fossé artificiellement. Si toutefois nous vou-
lons donner une conclusion, une perspective qui soit assimilable,
qui paraisse concrète, nous risquons de tomber dans certains
pièges. La simple constatation du rôle positif de la bureau-
cratie d'une usine ou de l'Etat, par exemple, peut entraîner la
conclusion qu'il suffit de supprimer les parasites dans le cadre
même de la société pour résoudre les problèmes.
C'est là qu'apparaît le rôle essentiel du militant révolution-
naire, qui, s'il ne peut donner une conclusion concrète à ce
problème peut montrer que toute solution de réforme de cette
société est impossible. Dans ce sens, le journal devient le cadre
d'un véritable dialogue qui peut se continuer à travers plu-
sieurs numéros.
Même si la solution de tous les problèmes se trouve réunie
dans la destruction du système capitaliste, il existe des actions,
des possibilités de défense ou de lutte contre la société capita-
liste ; ces luttes arrivent à développer la conscience des ouvriers,
à faire progresser leur expérience. Les militants devront enri-
chir toutes ces luttes de leur propre expérience de théoriciens,
sans pour cela dire qu'ils peuvent obligatoirement donner une
solution à tous les problèmes.
LE JOURNAL OUVRIER DANS LA PERIODE ACTUELLE.
Si nous posons aujourd'hui le problème d'un journal ouvrier
ce n'est pas uniquement parce que ce journal ouvrier découle
de nos conceptions théoriques fondamentales, mais aussi et sur-
tout parce que ce journal apparaît d'une façon concrete comme
réalisable. Il.correspond à la forme d'activité la plus adéquate
dans la période actuelle, la forme d'activité qui peut être le
trait d'union entre les militants révolutionnaires et l'avant-
garde ouvrière. Il est nécessaire ici de définir plus précisément
cette période.
Dans la période qui suivit la Libération, le prolétariat adop-
tait la politique des partis staliniens. Les problèmes que se
posaient les ouvriers se trouvaient résolus par les partis. Dans
la mesure où les solutions proposées par les partis n'étaient que
de fausses solutions, l'adhésion des ouvriers à ces forces politi-
307
ques ne pouvait étre de longue durée. C'est ce qui s'avère aujour-
d'hui de plus en plus nettement. Ainsi, nous pouvons dire qu'un
journal ouvrier dans cette période était impossible dans le sens
où le prolétariat mettait encore tous ses espoirs dans les forces
politiques qu'il suivait. Si aujourd'hui, le rapport entre les
ouvriers et « leurs » partis a changé, il n'a pas changé dans
le sens où les organisations trotskistes l'espéraient. Les ouvriers
n'ont pas changé de politique. Ils n'ont pas modifié leurs idées
sur la Russie pour progressivement se constituer en fraction ou
parti plus à gauche que les staliniens, pour enfin se raprocher
des positions trots istes, puis trotskistes de gauche. C'est en gros
ce que les organisations de gauche ont attendu pendant des
années et la plupart des luttes entre les groupements ont été
basées sur la tactique à adopter pour former un parti de masses
plus à gauche que les staliniens. Si beaucoup d'ouvriers ont
gardé leur espoir sur la Russie, ils se sont détachés peu à peu
de la politique stalinienne. Ils ont refusé de suivre leurs mots
d'ordre, de se syndiquer, de lire leur presse; etc.
Dans cette évolution de la classe ouvrière on peut dire que
l'influence des partis socialistes ou des syndicats F.O. n'a été
d'aucun poids dans la mesure où toute la propagande et toute
l'idéologie de ces organisations se limitaient à un antistalinisme
qui devenait ainsi leur propre raison d'être.
Si les ouvriers se détachent du stalinisme après l'avoir fait
du parti socialiste, ce n'est pas pour allez chez les trotskistes,
c'est pour ne pas faire de « politique » ; les ouvriers s'intéres-
sent de moins en moins à la « politique ».
Là, nous avons vu une réaction unanime de tous les partis
de gauche, des socialistes aux trotskistes, qui se sont indignés
d'une telle attitude du prolétariat. Tout le monde a vu là une
évolution réactionnaire qui pouvait amener le fascisme.
Pour tous ces partis, le prolétariat est une force qu'il s'agit
de dominer, de canaliser dans son propre sens. Que les ouvriers
soient mystifiés par le stalinisme ce n'est qu'un moindre mal.
Pour les autres, il s'agit de trouver la tactique ou la méthode
pour s'accaparer les ouvriers par des compromis, des allian-
ces, etc.
Mais que les ouvriers ne veuillent pas se laisser canaliser
par aucune des organisations existantes, voilà qui fait frémir
amèrement tous ces politiciens.
A la différence de tous ces partis, nous avons pensé que ce
détachement du prolétariat de la « politique » avait un sens
positif.
38.
Non seulement, le prolétariat se détachait du centre d'inté-
rêt où les bourgeois ou le parti stalinien essaient de le river
depuis des années et qui est leur propre politique. Mais ce
détachement très profond ne se soldait pas par un suivisme
vis-à-vis d'autres partis politiques, mais par une méfiance
généralisée.
Dans ce sens, on peut dire que le détachement du proléta-
riat de la politique est une prise de conscience qui a une
valeur politique infiniment plus profonde que la découverte
de la dégénérescence de la Russie.
Ces deux traits caractéristiques de la classe ouvrière aujour-
d'hui (détachement des partis et passivité) sont, il est vrai,
applaudis par la bourgeoisie qui voit d'une part l'affaiblisse-
ment d'une force concurrente
le stalinisme russe, - et
d'autre part, une désorganisation idéologique de la classe
ouvrière. Par le passé, les ouvriers qui rompaient avec les par-
tis, dépassaient ces partis par leur action directe. Ce fut le cas
des minorités communistes au sein de la social-démocratie. Si
la bourgeoisie se réjouit de la passivité de la classe ouvrière, nous
pouvons voir les difficultés qu'entraîne cette même passivité
pour le développement de sa propre politique. Car le détache-
ment des ouvriers du parti stalinien est à la fois un détache-
ment très profond de la classe ouvrière des classes dominantes.
Ainsi, par exemple, la mobilisation des ouvriers par les stali-
niens pour une manifestation nationaliste contre le réarme-
ment allemand ne fait, en réalité, que renforcer l'idéologie natio-
naliste, même si elle se trouve étre dirigée contre la bourgeoi-
sie dans une certaine période. Par contre, le refus des ouvriers
à se mobiliser pour des mots d'ordre « contre la C.E.D. » signi-
fie une certaine rupture avec l'idéologie nationaliste, c'est-à-
dire l'idéologie bourgeoise. Cette rupture a des répercussions
sur un autre plan. Lorsque la bourgeoisie essaiera d'embrigader
la classe ouvière pour son idéologie nationale, pour cette armée
européenne ou pour le maintien de sa domination dans les colo-
nies, elle se trouvera devant le même refus des ouvriers qui la
favorisait dans le cas précédent. Voir l'action du prolétariat
comme un élément positif en lui-même, même si cette action
est complètement ou en partie dirigée vers des objectifs bour-
geois revient à considérer l'action du prolétariat et le proléta-
riat lui-même comme un insrument capable simplement d'agir
sans déterminer lui-même son orientation. D'une telle concep-
tion, découle par exemple toute la propagande trotskiste qui
consiste à mener toute action des ouvriers en appuyant ces
actions et en essayant de les faire dépasser leur cadre,' < en
poussant le mouvement ».
39.
Nous pensons que la passivité du prolétariat est positive
dans la mesure où elle est une forme de détachement de l'idéo-
logie bourgeoise. Cela ne veut pas dire que nous saluons cette
passivité; le prolétariat se trouve dans une période où il cherche
sa propre voie en se débarrassant de plus en plus de l'idéolo-
gie bourgeoise et stalinienne. Ce n'est que dans la mesure
où se dégage cette autonomie qu'un journal ouvrier est réali-
sable.
Le schéma de la situation actuelle dans laquelle se deve-
loppe l'expérience ouvrière doit cependant être précisé.
Si la classe ouvrière aujourd'hui a accumulé une certaine
expérience « politique », il faut tracer de suite les limites de
cette expérience.
Le rôle du parti stalinien en France n'a pas été poussé aussi
profondément que dans les pays de « démocratie populaire ».
le rôle de la bureaucratie syndicale réformiste ne s'est pas davan-
tage développé comme dans les pays tels que l'Angleterre ou
l'Amérique. La France est restée à mi-chemin entre les ancien-
nes. formes de domination capitaliste et les nouvelles formes
bureaucratiques. Dans ce sens. l'expérience ouvrière se trouve
dans une situation bien ambiguë et c'est de cette situation que
vient la difficulté de la création d'un journal ouvrier qui puisse
se différencier sur tous les plans des autres tendances politiques.
Le journal ouvrier n'aura donc pas à lutter seulement contre
les tendances nouvelles d'exploitation, les tendances bureaucra-
tiques, il aura aussi à combattre les anciennes formes et là il se
trouvera à côté des forces staliniennes ou réformistes dont il
lui sera difficile de se délimiter.
Le journal ouvrier aura à combattre deux forces :
Les forces patronales traditionnelles ;
Les forces bureaucratiques (réformistes ou staliniennes).
La grande majorité des capitalistes français est composée
de petits patrons privés qui gèrent eux-mêmes leur entreprise.
Dans beaucoup d'usines, les syndicats sont à peu près inexis-
tants. Le militant syndicaliste risque de se faire congédier, il
n'existe pas de bureaucratie syndicale. La lutte contre le patro-
nat a gardé ses anciennes formes et là les ouvriers auront même
recours aux syndicats pour faire respecter les lois aux patrons.
A côté de cela il existe de grandes usines privées ou nationali-
sées où la bureaucratie syndicale a joué un certain rôle dans
l'appareil productif et où des formes de domination « moderni-
sée » ont succédé aux formes brutales, traditionnelles.
En parallèle avec la diversité des formes de domination du
capitalisme français se trouve la diversité des formes de résis-
40
tance à l'exploitation. Le fait que la bureaucratie syndicale n'a
pas pu jouer son rôle en France, le fait que le stalinisme se
trouve dans une situation de parti d'opposition, ont donné à
ces forces un caractère qui est différent de leur véritable rôle.
Ainsi, les forces syndicales et staliniennes, au lieu de revendi-
quer la gestion de la société, se contentent de reprendre bien
souvent une politique puisée dans l'arsenal réformiste tradition-
nel : parlementarisme, querelles municipales, etc.
Dans cette situation complexe, la lutte des ouvriers contre
un petit patron ou la lutte des ouvriers contre les brimades de la
direction de l'usine, peut être soutenue par les syndicats stali-
niens ou réformistes. La lutte des ouvriers contre la bureaucra-
tie syndicale peut être soutenue par la direction de l'usine. La
lutte contre les réformistes peut être soutenue par les staliniens.
Ce n'est que dans des cas particuliers et bien caractéristi-
ques que la lutte des ouvriers contre leur exploitation sera à
la fois une lutte contre le patronat et contre les bureaucraties
syndicales ; c'est sur les problèmes les plus fondamentaux que
cette lutte se réalise ainsi sur les trois plans.
De ceci, il ressort avec évidence que l'expérience de la classe
ouvrière française sur le stalinisme et la bureaucratie syndicale
est une expérience larvée et incomplète, et c'est de là que vont
surgir les principaux obstacles à la réalisation du journal
ouvrier.
1.
LES OBSTACLES.
Nous essaierons mainenant de décrire les problèmes que nous
avons rencontrés dans l'expérience pratique d'un journal ouvrier:
La Tribune Ouvrière.
Difficulté de délimitation avec les autres forces.
a) Lutte contre le patronat.
A un stade élémentaire, il se trouve que notre lutte contre
les formes de domination du capitalisme est identique à celle
menée par le stalinisme.
On peut citer quelques exemples :
La direction licencie un ouvrier.
Un ouvrier est accidenté par le manque d'appareils de
protection.
La direction fait faire une collecte pour les obsèques
du directeur général.
En face de tels faits que ce passe-t-il ?
Les ouvriers discutent; les uns s'indignent; d'autres sont
passifs; d'autres enfin acceptent et justifient même les procédés
de la direction.
- 41,
La réaction des ouvriers les plus conscients est de protester
devant de telles choses. Ils veulent en parler, le faire savoir
aux autres et cela se justifie. Mais il est impossible d'en parler
d'une façon différente des staliniens, à moins que ceux-ci lient
les trois faits à une question politique quelconque. La seule
façon de se délimiter serait d'approfondir les faits en remontant
le cours de l'histoire. Pour le troisième cas par exemple: « vous
vous indignez pour la collecte du directeur, mais pourtant en
telle année vous le glorifiiez ». Mais déjà la différenciation
semble artificielle ou de mauvaise foi. On peut répondre qu'au-
trefois le parti communiste faisait des erreurs, etc.
b) La lutte contre le stalinisme.
Le patronat en France est aujourd'hui anti-stalinien. Nous
avons parlé aussi des tendances antistaliniennes représentées
par les syndicats F.O., chrétien ou gaulliste. La nécessité de se
délimiter est incontestable mais la délimitation est parfois diffi-
cile. Exemples :
- La C.G.T. demande une minute de silence pour com-
mémorer la mort de Staline.
La C.G.T. demande de faire une action pour soutenir
une campagne contre le réarmement ou la libération de Duclos.
- La C.G.T. lance une grève d'avertissement vouée d'avance
à l'échec. Là les ouvriers se trouvent partagés entre deux blocs,
ce partage souvent ne représentant pas une délimitation sur les
positions de lutte de classe.
Certains ouvriers font grève parce que pour eux la grève est
un moyen de s'opposer à leur exploitation : « Tout ce qui est
contre le patron est pour l'ouvrier. » D'autres au contraire ne
font pas grève même s'ils partagent les idées des staliniens sur
la Russie parce que la grève leur demande un effort, un sacrifice,
un risque qu'ils ne veulent pas courir, parce qu'ils ont peur de la
maîtrise, parce qu'ils veulent se faire bien voir par la direction.
Quand la séparation se fait de telle façon on est en droit d'affir-
mer que cette séparation, malgré son caractère politique faux,
correspond en réalité à une séparation sur un plan de classe,
séparation entre les bagarreurs et les jaunes.
Mais la séparation est dans la plupart des cas bien plus
complexe. Prenons comme exemple la grève du 28 avril 1954.
Beaucoup d'ouvriers voyaient réellement la mystification du
mouvement et son impossibilité de réussir. D'autres refusaient
de faire grève pour montrer qu'ils ne voulaient plus suivre un
syndicat qui les avait trompés. Le refus de la grève était le
refus de suivre la direction syndicale. D'autres encore ne vou-
laient pas faire grève pour se venger des syndicats qui les avaient
42
et qui doit; d'autre?
entraînés dans certaines périodes presque de force dans des mou-
vements qu'ils désapprouvaient. Quelle position adopter dans
de telles circonstances ? Toute position peut prêter à équivoque.
Faire grève, c'est se voir reprocher d'être un instrument du
syndicat ; ne pas faire grève c'est se voir reprocher d'être un
défenseur du patron. Comment éviter cette équivoque ? Nous
résolûmes la question de la façon suivante. Nous dénonçames
la grève à tous ceux qui nous demandaient notre avis, en ajou-
tant toutefois que nous ne voulions pas être des briseurs de
grève et que nous suivrions la majorité, en affirmant que ceux
qui refusaient de participer à cette grève n'étaient pas obliga-
toirement des jaunes. Nous adoptions une position très ambiguë
en participant au mouvement.
c) La lutte contre les syndicats réformistes.
- Les syndicats réformistes acceptent d'assister à la com-
mémoration des obsèques du directeur de l'usine.
- Les syndicats réformistes font une collecte en commun
avec la direction pour venir en aide aux sinistrés.
Dans notre critique nous nous trouvons côte à côte avec les
staliniens.
En face de tels problèmes le journal ouvrier se trouve devant
une alternative :
ou bien de traiter de ces faits et de risquer d'augmenter
peut-être la confusion.
ou bien de faire le silence sur ces faits parce qu'ils ne per-
mettent pas de délimiter suffisamment le journal,
Ne pas s'élever contre une brimade de la direction sous pré-
texte qu'il nous sera impossible de le faire sans pouvoir 'se
délimiter de forces anti-ouvrières serait la négation même du
journal qui doit traiter les problèmes qui intéressent les ouvriers
de l'expérience ouvrière.
Vouloir diminuer' artificiellement certains problèmes sous
le prétexte qu'ils sont en voie de disparition la lutte contre
le paronat privé, par exemple serait faire preuve d'un secta-
risme absurde.
C'est à des problèmes réels que la classe ouvrière rencontre
tous les jours que l'on doit répondre. Si l'histoire était découpée
en tranches bien distinctes, si l'évolution du monde se faisait au
même rythme, si le développement de la société était partout
uniforme, de tels problèmes ne pourraient pas se poser : mais
le fait que des problèmes sont en voie de disparition ne veut
pas du tout dire qu'ils ont disparu et c'est pourquoi nous devons
encore y répondre.
Dans certaines périodes on risque donc de trouver un jout-
nal ouvrier qui aura son originalité uniquement parce que ses
articles seront savamment dosés, et qu'il critiquera à la fois les
trois tendances, patronale, réformiste et stalinienne.
Prétendre qu'un journal ouvrier ne puisse exister que le
jour où il pourra se délimiter sur toutes les questions, qu'on ne
pourra poser le problème du journal ouvrier que dans une pé-
riode qui aura permis de à la classe ouvrière de faire une expé-
rience beaucoup plus poussée est une absurdité; car, cette période
sera la période de domination totalitaire de la bureaucratie. Alors
le problème du journal ouvrier sera dépassé, il sera irréalisable et
la classe ouvrière devra trouver d'autres iormes d'expression.
II.
Difficultés dues à la passivité de la classe ouvrière.
La rupture de la classe ouvrière avec les forces politiques
traditionnelles ne s'accompagne pas d'une activité autonome
il semble que l'expérience des ouvriers dans les partis politiques
ou les syndicats ait usé leur sentiment de révolte, leur besoin
d'activité. Et c'est là justement un des obstacles à l'apparition
d'une activité aussi réduite qu'est la rédaction, la diffusion et
le financement d'un journal ouvrier.
Dans une situation de crise aiguë entre la direction et les
ouvriers ou entre la bureaucratie syndicale et les ouvriers le
problème du journal est facile à résoudre ; lorsqu'un fait a
suscité la colère ou l'indignation des ouvriers, lorsque la divi-
sion des ouvriers s'exprime par des discussions et des engueu-
lades, lorsqu'il se forme deux camps - ceux qui approuvent,
ceux qui critiquent -- le militant révolutionnaire n'a qu'à
recueillir ces polémiques, à ranger les arguments et l'article
est créé. Il intéressera, il correspondra à un effort des ouvriers
d'avant-garde à résoudre ce problème.
Mais il n'en est pas tout le temps ainsi. L'antagonisme entre
les ouvriers et la machine, entre les ouvriers et l'appareil de
gestion ne suscite pas continuellement une opposition violente ;
cet antagonisme est comme une plaie qui se cicatrise pendant
certaines périodes. Le rôle du journal n'est pas d'ouvrir artili-
ciellement les plaies il n'en a pas d'ailleurs le pouvoir ;
l'antagonisme ne peut ñaitre que des faits eux-mêmes. Le jour-
nal ne peut tout au plus que donner une explication, faire
s'exprimer et orienter cet antagonisme de classe.
Dans ces périodes les ouvriers n'éprouveront pas le besoin
de s'exprimer et le journal ouvrier retombera sur un noyau
d'ouvriers les plus conscients, les plus politisés mais qui auront
44
tendance à exprimer alors leurs propres problèmes politiques
ou théoriques. Le journal ouvrier aura donc tendance à retomber
dans la même ornière que les autres journaux. Il perdra de
son intérêt, les problèmes traités ne correspondront pas à la
préoccupation des ouvriers. Des ouvriers accorderont leur
confiance à leurs camarades, les désigneront pour parler, pour
écrire, pour penser à leur place. On voit ainsi le danger d'une
telle attitude qui peut amener les ouvriers qui ont la confiance
des autres à exprimer à leur tour des idées personnelles sans
liaison avec les problèmes ouvriers.
L'autre danger est qu'une direction du journal se crée de plus
en plus séparée des autres ouvriers ; que la passivité des uns
entraîne une certaine habitude des dirigeants à décider à leur
place.
!
HII.
Difficultés dues à l'opposition avec les ouvriers.
Nous sommes partis en affirmant que le journal devrait
refléter le niveau de l'expérience des ouvriers. Mais là deux diffi-
cultés surgissent :
La première c'est de situer ce niveau ;
- La seconde c'est de répondre aux problèmes que les
ouvriers se posent à ce niveau.
Nous avons dit que les problèmes qui intéressent les ouvriers
sont les problèmes essentiels qui doivent être résolus. Cela est vrai
mais il faut toutefois apporter certaines restrictions à cette idée
restrictions de deux ordres. L'influence de l'idéologie bour-
geoise ou stalinienne sur la classe ovrière : les discussions autour
de l'élection de Mendès-France par exemple. Quand la majorité
des ouvriers arrive encore à l'heure actuelle à être influencée par
une vague de chauvinisme, il est évident que de tels prolèmes. s'ils
sont traités, le seront en opposition avec cette majorité des
ouvriers.
Dans un autre ordre d'idées, il se trouve des problèmes qui
divisent les ouvriers entre eux ; par exemple, un ouvrier veut
écrire un article qui critique la division du travail et la hié-
rarchie mais cette critique se fait uniquement contre ses propres
camarades ; il rejette la faute de sa condition à ses camarades.
Un tel problème est traité d'une façon qui abonde dans le sens
de la direction et il est impossible de l'accepter.
Donc dans certaines situations on se trouve devant le
dilemme suivant : soit d'accepter le courant réactionnaire dans
les lignes du journal ouvrier, soit de s'opposer à une majorité
· 45
d'ouvriers. Il va de soi que sur ce plan nous avons toujours
choisi la deuxième solution.
Nous nous trouvons aussi parfois devant l'impossibilité
de répondre à certains problèmes. Devant cette impossibilité,
les rédacteurs auront tendance à remplacer les solutions par des
articles démagogiques qui retombent dans la critique que nous
avons faite plus haut au sujet des journaux syndicaux ou poli-
tiques. On proposera une revendication qui recueillera l'appro-
bation des ouvriers mais qui restera un væu pieux, ou bien on
lancera des injures contre la maîtrise, la direction ou le gou-
vernement.
IV. - Les difficultés dues à l'élargissement du journal.
Le niveau de l'expérience ouvrière n'est pas le même partout;
il diffère avec la profession, le secteur industriel, la tradi-
tion corporative, le milieu géographique. Il diffère aussi pour
les mêmes raisons suivant la nature des problèmes.
Il suffit pour cela de se rapporter aux polémiques sur la ques-
tion syndicale pour constater la diversité des problèmes. Ainsi,
un article concernant les O.S. sur chaîne de Renault n'intéressera
pas obligatoirement ou ne répondra pas aux problèmes de
l'ouvrier du bâtiment de Toulouse. Le développement d'un tel
journal ne peut donc se faire que d'une façon inverse de celui
des autres journaux ; ce développement sera conditionné par
l'accroissement du nombre de ses participants et rédacteurs. Il
se pose ici un dilemme qui peut se résumer ainsi : le journal
doit intéresser les ouvriers pour qu'ils y participent et expriment
leur propre expérience, mais ces ouvriers ne peuvent s'intéresser
au journal que s'ils y trouvent des problèmes qui traitent eux-
mêmés de l'expérience qu'ils ont vécue.
V.
Les difficultés de la forme.
La politique comme le journalisme tend à se détacher de
la réalité sociale, à devenir une science particulière. Ainsi
le langage politique et journalistique tend-il à se séparer du
langage réel.
Il ne faut pas croire que les ouvriers quand ils veulent
s'exprimer, rédiger un article soient débarrassés de ces préjugés
littéraires. Il est entré dans les meurs de parler d'une façon et
d'écrire d'une autre. Aussi les articles faits par les ouvriers
sont-ils le plus souvent empreints de cette forme journalistique,
pleins de clichés, de formules toutes faites et inexactes. Les
- 46
ouvriers qui sont le plus aptes à écrire sont justement ceux qui
ont subi le plus cette influence journalistique et qui, initiés à
ces mystères, pensent qu'ils ne doivent s'exprimer que d'une
façon aussi tortueuse ou à l'aide d'expressions qui sont le plus
souvent incompréhensibles pour la majorité des ouvriers. La
tâche du journal est donc là aussi de débarrasser les ouvriers
des préjugés littéraires, les encourager à s'exprimer d'une façon
aussi simple que leur forme naturelle d'expression parlée. Les
allusions, les images, les références, les comparaisons ne peuvent
être qu'empruntées qu'à la vie prolétarienne de tous les jours.
Dans ce sens les plus aptes à écrire seront à la fois les ouvriers
les plus conscients, les plus cultivés mais aussi ceux qui seront
débarrassés le plus de l'influence idéologique bourgeoise ou sta-
linienne.
CONCLUSION.
1
Nous avons développé quelques idées fondamentales sur le
journal ouvrier, sur ce qu'il devrait être. Nous avons examiné
les principaux obstacles qu'un journal de ce type rencontre. En
fonction de tout ceci une question se pose :
Un journal ouvrier est-il réalisable aujourd'hui ?
Faire un journal ouvrier aujourd'hui comporte une série
d'inconvénients.
Dans les périodes où le journal ne répondra pas au besoin
des ouvriers il risque de devenir un journal sans intérêt. Un
journal qui n'aura pas d'échos dans la classe ouvrière, peut
décourager les quelques ouvriers militants qui s'y consacrent et
les perdre définitivement. Mais pouvons-nous renoncer au jour-
nal après l'avoir créé, après avoir eu l'appui des ouvriers, le
délaissant uniquement parce que pendant six mois ou plus les
ouvriers semblent s'en désintéresser ?
Peut-on penser que la combativité des ouvriers croît d'une
façon continue, qu'il n'y a pas des périodes de calme et de
découragement, même quand la classe ouvrière progresse dans
son expérience ?
De toute façon, dans les périodes de combativité de la
classe ouvrière peut-on penser pouvoir créer de toutes pièces un
journal avec une telle formule du jour au lendemain ? Peut-on
croire que, parce que les ouvriers auront compris le rôle du stali-
nisme et des syndicats, ils viendront spontanément écrire sur un
journal que nous mettons à leur service ? Ne se méfieront-ils
pas de nous aussi ? Ne vaut-il pas mieux que ce journal existe
pendant les périodes qui suivent et qui précèdent ces moments ?
- 47
Ne devons-nous pas préparer les ouvriers les plus expérimentés
et les plus conscients à être les cadres de ce journal ?
Un journal intermittent est impensable et irréalisable.
Quel bilan pourrons-nous tirer d'une expérience qui remonte
à moins d'un an ?
Malgré les erreurs que nous avons commises dans le journal
il apparaît que nous avons réalisé notre objectif sur quatre
points et ce sont les plus importants.
1° Les ouvriers plus d'une quinzaine - ont participe et
écrit sur ce journal la majorité parmi eux n'avait jamais
écrit.
2° Les sujets du journal sont les problèmes de l'usine et les
problèmes soulevés par les ouvriers et non plus les problèmes
de la bourgeoisie traités par les journaux habituels.
3° Le journal est en grande partie compris non plus seule-
ment par des initiés, mais par les ouvriers même les moins cul-
tivés et les moins politisés.
4° Le journal suscite de vives discussions dans les ateliers.
Nous pensons qu’un tel bilan est positif et qu'il nous permet
de conclure qu’un tel journal doit être continué, enrichi, déve-
loppé. Mais cela ne dépend pas que de nous ; il dépend des
ouvriers qui s'y intéressent.
D. MOTHE.
48
--
1
DOCUMENTS
La vie en usine
V.
LES OUVRIERS ET LEURS REPRESENTANTS.
Face au fond de l'exploitation et aux manifestations de
l'arbitraire patronal, les ouvriers présentent les diverses atti-
tudes de lutte mentionnées précédemment (1). Dans ce combat
incessant, même lorsqu'il paraît éteint, les bons apôtres des
organisations ouvrières traditionnelles font ressortir
que
l'ouvrier n'est pas seul, livré aux solutions du désespoir, et qu'il
peut compter sur les organisations syndicales d'une part, et sur
les organismes permanents de représentation ouvrière auprès
de la Direction : Délégués du Personnel et membres élus du
Comité d'Entreprise, d'autre part. Il n'entre pas dans le cadre
de ce document de faire l'historique des associations ouvrières
ni de rappeler les conditions de la naissance des délégués d'ate-
lier, et en 1944-45, des Comités d'Entreprise. Ce qui nous
intéresse, c'est de décrire leurs activités, leurs résultats, la signi-
fication qu'ils ont pour les ouvriers et les conclusions qu'ils en
tirent. Car c'est à leur contact que les ouvriers font l'expérience
de la bureaucratie militante.
Nous verrons d'abord les phénomènes plus récents que sont
les organismes élus, parce qu'ils représentent, à l'étape actuelle
du développement de cette bureaucratie, ses premiers succès
et ses bases d'agitation. Qu'elle soit d'obédience stalinienne ou
réformiste, elle vise à jouer un rôle autonome dans la gestion
de l'économie. A ce titre elle offre une telle antithèse des idéaux
révolutionnaires que son action pratique endigue le courant
(1) Voir les parties précédentes de ce texte dans les nºs 11, 12, 14
et 15-16 de Socialisme ou Barbarie:
49
revendicatif né de la base, s'efforçant de contrôler son cours,
et d'annexer le cas échéant ses succès.
Le Comité d'Entreprise, une création astucieuse du capita-
lisme et des partis-rois à la Libération, n'a jamais été une
revendication ouvrière. Il avait son rôle de mystification à jouer
dans la farce du « produire d'abord ». Doté de pouvoirs nuls,
sauf celui de répartiteur des miettes des cuvres sociales, il se
survit, dans l'indifférence générale quant à son efficacité.
Dans cette usine (et on peut généraliser sans risque d'erreur)
l'expérience du Comité d'Entreprise se solde ainsi : côté patro-
nal, suivant les ordres du jour, refus de toutes les suggestions
n'apportant pas une augmentation de la production, rejet des
demandes sur les salaires, chipotage sur le budget des deuvres.
De cette façon les délégués patronaux jouent le jeu, le Comité
ayant été créé à leur bénéfice. Reste que la situation politique
et économique a entraîné une désaffection ou une hostilité de
circonstance des grandes « organisations ouvrières » vis-à-vis
de la production à outrance, d'où une inutilité flagrante pour le
patron des réunions du C.E. Côté délégation ouvrière, le but
unique des rencontres est de présenter des revendications d'aug-
mentation de salaires, en application des mots d'ordre des cen-
trales syndicales, afin d'en faire une plate-forme d'agitation
auprès du personnel. Dans ce domaine comme dans celui des
cuvres sociales, la surenchère est de rigueur.
De loin, ces discussions apparaissent comme des dialogues
de sourds, chaque partie exposant ses propres statistiques, bilans
et budgets. De près, il est bien évident que, coupé de sa base
politique, le C.E. n'est plus qu'une tribune contradictoire, où
chacun s'efforce de marquer des points.
Quant au personnel, il ne prête strictement aucun intérêt
à la partie « production » des comptes rendus de réunions du
C.E. et beaucoup plus aux discussions concernant les primes,
les réajustements de salaires, le budget des colonies de vacances,
et autres rubriques semblables. Ceci pour constater que le patron
* a lâché ce qu'il voulait bien lâcher ». De fait, l'octroi de
primes épisodiques ou l'élévation des taux de base n'ont jamais
été le couronnement de l'argumentation et du prestige des délé-
guésouvriers, mais résultent d'une appréciation critique du
paronat quant à sa propre situation économique et quant à la
pression de la base ouvrière.
Dans les conversations, lorsqu'on parle du Comité d'Entre-
prise, c'est presque exclusivement pour propager le « tuyau »
d'une prime éventuelle, dont la discussion semble aboutir (et
ceci au maximum trois fois l'an, et s'étageant hiérarchiquement
50
de 3.000 à 5.000 francs envion). Sur la nature du Comité d'En-
treprise, sur son fonctionnement. 'il n'y a pas de discussion.
Tout se passe, pour les ouvriers, comme si les réunions du CE.
étaient de simples appendices aux réunions mensuelles des délé-
gués avec la direction ; le rôle prétendu d' « embryon de gestion
ouvrière », vide de contenu, se perd dans l'indifférence géné-
rale.
Il est remarquable, conjointeinent, que, même si l'on admet
que les « membres élus » sont tenus au secret sur certaines
questions concernant la marche de l'entreprise, ils ne se com-
portent nullement en délégués ouvriers. Ils rendent compte
uniquement aux syndicats qu'ils représentent, sauf à quelques
occasions : d'abord lors du battage électoral annuel, et pour
la propagande sur des points précis, par exemple la nécessité
économique des échanges Est-Ouest, reprise d'un mot d'ordre
politique. On n'a jamais vu, dans cette usine, une motion
ouvrière véritablement issue de la base, recourir aux bons soins
du C.E. pour résoudre des questions d'organisation du travail ou
de remise en ordre des salaires.
Le C.E. est bien mort, et sa suppression légale ne ferait que
traduire un état de fait.
Malgré tous leurs efforts d'il y a quelques années, les stali-
niens n'ont pas pu intéresser la classe ouvrière au sort des C.E.
Tendant tactiquement à donner sur le plan national un rôle
économique plus grand aux C.E., dont ils s'étaient efforcés
d'avoir le contrôle, ils n'ont pas trouvé d'appui ouvrier.
Bien que parfaitement désillusionnés sur la valeur du C.E.,
les ouvriers ne continuent pas moins à voter régulièrement en
masse à chaque élection. Il n'y a donc pas de leur part une
prise de conscience parfaite du rôle mystificateur du C.E. Le
boycott est le fait de quelques isolés. Pour la majeure partie,
il s'agit seulement de voter CONTRE le patron, rien que pour
signifier une opposition permanente à l'exploitation.
Tout aussi massive, et pour les mêmes raisons, est la partici-
pation aux élections de délégués du personnel. L'intérêt qu'on
y prend s'explique encore par la compétition ouverte entre les
divers syndicats ; on retrouve donc à ces élections le même
climat politique et les mêmes conflits idéologiques que lors des
élections législatives.
Les votes se font non sur la personne, mais sur le programme
syndical, reflet d'un programme politique. A l'occasion des
élections, chaque syndicat, par tracts, affiches ou prises de
parole, revendique comme siennes les améliorations apportées
dans l'entreprise, et présente des revendications alléchantes.
#
$
51
Mais les votes ne se déterminent pas en fonction de ces vantar-
dises et de ce programme. Voici une preuve : un accord patro-
nat-CFTC-CGTFO sur les salaires en 1951, valable pour toute
l'entreprise et apportant des réformes au régime des salaires,
n'a pas eu comme conséquence aux élections suivantes un boom
sur les listes CGTFO ou CFTC. C'est que les ouvriers avaient
voté pour une centrale, pour un parti politique : on vote « pour
les communistes », « contre les communistes ».
La conclusion à tirer de cette attitude, qui fait tenir pour
négligeable les traits particuliers de la vie à l'entreprise, est que
la classe ouvrière n'attend pas de salut sur une base corporative
ou industrielle, mais par une refonte de l'économie qui trans-
formerait la condition ouvrière. La prise de conscience de leur
propre force et du danger bureaucratique faisant défaut, les
ouvriers votent pour ceux dont la voix, qui parle de révolution,
est la plus forte.
En tant que personnes privées, délégués du personnel et
membres du Comité d'Entreprise ne jouissent pas d'un prestige
particulier auprès des ouvriers. Ils restent des camarades de
travail dont on sait bien qu'ils ne renverseront pas le pouvoir
patronal, mais auxquels on aura recours pour transmettre des
doléances. Pour tous, ils sont en quelque sorte les avocats chargés
de faire respecter le « droit coutumier » de l'entreprise, c'est-à-
dire le règlement et les lois sociales. Nul doute que dans des cas
particuliers ils aient empêché des licenciements ou fait régula-
riser des situations injustes (droits aux vacances, etc...). Ceci
de gré à gré, du moment que l'interlocuteur patronal n'a pas
Vu le principe de son autorité et de ses lois mis en cause. Mais
dans les cas où les arguments « légaux » font défaut au délégué
(et la marge d'interprétation patronale est vaste) seule l'action
collective, débrayage ou grève, peut amener une solution satis-
faisante pour les ouvriers. Ainsi les travailleurs font quotidien-
nement l'expérience du peu de poids des délégués quand il
s'agit d'arracher une victoire, et prouvent que le dernier
recours pouvant payer est l'action. De leur côté les délégués
sont limités par les accords d'entreprise dans leur terrain d'action
et s'en satisfont pleinement. Les plus honnêtes eux-mêmes,
après un échec, conviennent que « le cas n'était pas défen-
dable » ou que « la demande n'était pas justifiée ». Bien sûr,
ils mettent l'accent sur l'injustice ou la ladrerie patronale, mais
la répartition des droits et des devoirs leur apparaît, tout
compte fait, rationnelle.
Pourquoi et comment a-t-on recours au délégué ?
Les cas de requête sont les suivants : demande de promotion
52
dans la hiérarchie ou d'augmentation de salaire, protestation
contre un ticenciement ou une sanction ; ceci pour les cas
individuels. Collectivement, des ouvriers font parfois appel au
délégué pour protester contre une cadence, une sanction, ou
pour appuyer une grève ou un débrayage.
Ce que l'on attend à chacune de ces occasions, de l'interven-
tion du délégué auprès de l'autorité compétente (du chef d'équipe
au Directeur général), c'est qu'il mette en valeur le bien fondé
de la demande ouvrière, en jouant de tous les arguments que
peuvent lui procurer, outre les dispositions de la législation
du travail et du règlement intérieur, la jurisprudence propre
à l'entreprise, ou si l'on préfère, la petite histoire des précédents
créés et des faits acquis dans des circonstances similaires. Toutes
ces revendications particulières, qui tiennent à caur à ceux qui
les formulent et ne sont pas appuyées par une action décidée,
offrent un terrain plein de chicanes et de chausse-trappes.
Par exemple : sous-classement d'un ouvrier ou de toute une
catégorie, licenciement pour refus d'exécution d'un travail,
demande de réajustement d'un « temps » trop faible. A moins
de s'appuyer essentiellement sur le soutien actif (débraygae
en premier lieu) de ses camarades, l'intéressé n'aura d'autre
défense que ses protestations sans poids. Ce que lui apporte un
délégué, c'est l'éventualité d'une prise en défaut du système qui
l'a brimé. L'astuce est alors la ressource du délégué. Elle ne sera
récompensée que si le cas à déjà été tranché favorablement dans
le passé ou bien s'il est entièrement nouveau. De toute façon la
marge d'action du délégué est restreinte.
Selon la majorité des ouvriers « les délégués ne fichent rien ».
Critique imméritée toutefois dans le sens où ce ne sont pas les
délégués seuls, mais aussi les travailleurs qui n'agissent pas.
Il serait faux de conclure que les ouvriers remettent leurs inté-
rêts économiques aux mains de quelques-uns, et qui plus est,
dans le cadre d'institutions qui limitent leurs possibilités de
libération.
Le fait réel est qu'aucun d'entre eux ne possède une vue
d'ensemble sur l'équipement technique, le système organisa-
tionnel, le volume d'affaires, la situation du marché, les plans
de transformation, en bref sur tous les éléments qui constituent
la gestion de l'entreprise. Ils sont pourtant de première impor-
tance, car d'eux dépendent et les salaires et les conditions de
travail. L'ouvrier ne peut donc agir sur aucune de ces données
à titre préventif. Devant l'effort patronal de rationalisation
et d'augmentation de la productivité, il est placé en permanence
devant des faits accomplis : nouvelles machines, nouvelles
- 53
.
chaînes, nouvelles cadences..., auxquels, dans le meilleur des
cas, il ne s'attendait que très vaguement. En conséquence les
délégués sont bien bons pour faire face aux cas posés par le
train-train quotidien, mais pour les moments-clés qui marquent
un tournant dans la vie d'un atelier, d'une équipe, ils ne sont.
plus que des auxiliaires de l'action autonome suscitée par la
colère ouvrière.
La délégation de pouvoirs qui leur est concédée annuelle-
ment est donc purement symbolique, et le fait de voter, derrière
le délégué, pour tel ou tel syndicat, le prouve bien. D'autre part,
l'attitude ouvrière sur ce point pose la question de savoir si
la classe est condamnée historiquement à se battre dans des
positions définitives, élevant une digue devant chaque crue
patronale, pour sauvegarder un niveau de vie stagnant, ou même
en régression. Ce sera un des points examinés dans notre conclu-
sion.
De toute façon, l'expérience quotidienne de l'exploitation
et de l'aliénation est suffisamment ressentie pour que, au moins
confusément, conscience soit prise de la nécessité de rapports
« plus humains » et du renversement de ceux existants. Ainsi
ce sentiment de la dépendance économique est à la base de la
formation, pour chacun, d'une opinion de classe sur les questions
économiques et politiques.
C'est sur cette somme de constatations et de raisonnements
individuels que vient agir la propagande des partis et syndicats
« traditionnels » entre lesquels les ouvriers sont invités à choi-
sir, ou par qui ils sont convoqués périodiquement à l'unité. Nous
avons déjà rencontré (voir section « La Lutte Collective » (1)
ces organismes dans leur action lors de grèves ou de simples
débrayages. Reste à savoir quel est l'accueil que reçoivent en
temps normal, c'est-à-dire en période de statu-quo des rapports
ouvriers-patron, leur propagande et leurs mots d'ordre, et quels
sont les mobiles dų choix ou de la désaffection ouvrière pour
l'un d'entre eux, ou pour tous.
Les éléments de programmes économiques syndicaux qui
sont grosso modo portés à la connaissance des ouvriers com-
portent sur le plan de l'entreprise :
relèvement des salaires;
attribution de primes diverses;
sécurité de l'emploi;
sur le plan corporatif :
parachèvement de la Convention Collective;
(1) Voir N° 15-16 de cette revue, p. 50 et suivantes.
54
sur le plan de l'économie nationale :
programme de la C.G.T.;
rien des autres centrales.
En résumé, tout ce qui est également monnaie courante
dans les autres entreprises. Quant au domaine de l'information
politique, il est le monopole du P.C., secondé activement par la
C.G.T. Jamais les autres, partis ou syndicats, ne se manifestent
sur ces questions à l'intérieur de l'usine.
Bien qu'en régression actueilement, le volume d'activité P.C.-
C.G.T. est sans commune mesure avec celui des autres organi-
sations.
De ces faits, de ces remèdes proposés, que retiennent les
ouvriers et de quelle façon les utilisent-ils ?
Côté revendicatif, ' les propositions de tous les syndicats,
égalisées par la surenchère, n'incitent pas à un choix précis. La.
constatation de la médiocrité des salaires et du désir de tous
de gagner davantage est un fait d'évidence, et il n'est pa
besoin des syndicats pour le dire et préconiser l'union. Rien non
plus dans la tactique proposée qui marque une divergence sus-
ceptible d'entraîner une adhésion raisonnée.
C'est dans les problèmes politiques que le partage s'effectue,
et c'est bien là l'origine des divers syndicats de l'époque actuelle.
Déjà, l'audience à une prise de parole, les applaudissements ou
les ricanements, sont déterminés par l'opinion de chacun sur
la politique internationale et sur la politique intérieure. A plus
forte raison l'adhésion pure et simple à une organisation, et le
bulletin de vote annuel, transposent assez bien les attitudes
poliiques telles qu'elles s'expriment statistiquement aux élections.
législatives.
A l'arrière-plan des élections d'usine, il y a en définitive
les « Russes » et les « Ricains ». En effet, si la plate-forme
anti-capitaliste est
est . commune à
toutes les organisations
« ouvrières », c'est l'appréciation de la société russe qui marque
la rupture. L'opinion générale fondée ou bien sur des critères ou
bien sur la simple crédulité et sans examen, est que « les
Russes » ont supprimé le régime capitaliste, et c'est ce qui est
avant tout retenu par les uns comme motif de sympathie;
quant aux autres, ils insistent avant tout sur l'aspect totali-
taire et anti-démocratique du nouveau régime. Que cette option
domine la vie politique à l’usine ne doit pas entraîner à
conclure que les ouvriers perdent le sens des problèmes éco-
nomiques à l'échelon de l'entreprise, mais bien au contraire
qu'ils ont parfaitement conscience que tous les problèmes de
leur émancipation politique et économique sont contenus dans.
- 55.-
la rivalité U.R.S.S.-U.S.A,, si bien qu'en se domaine aucun ne
reste indifférent, à commencer par ceux qui prétendent « ne
pas faire de politique >>
Le problème revendicatif de base à l'usine : l'augmentation
générale des salaires, se ramène tout naturellement au niveau
de la politique nationale, le patron se retranchant derrière son
syndicat, ledit syndicat derrière le Gouvernement et celui-ci
derrière la stabilite monétaire.
La nature du Gouvernement est mise en cause, et les partis
politiques sont là pour en discuter. Nous pensons que c'est sur
le lieu du travail, dans les rapports de production que se trouve
la racine de l'exploitation et que c'est là que l'ouvrier peut
prendre conscience de son aliénation; mais sans anticiper sur
notre conclusion, on doit constater que, désireux de voir leur
condition soit progressivement « améliorée », soit radicalement
transformée, les ouvriers, eux, ne voient pas d'autre issue que
politique, et à l'échelon national. C'est ce qui revient dans les
conversations privées (avec la critique du train-train de la pro-
duction dans l'atelier et des conflits avec la maîtrise), mais
pas ' l'idée, même fragmentaire et voilée d'incertitude, que la
transformation de la Société dans un sens socialiste implique une
refonte des rapports de production eux-mêmes dans le cadre
de l'usine.
La stérilité de la période de fort courant revendicatif (grosso
modo, jusqu'en 1950) a entraîné les ouvriers vers toute une
période de moindre tension, concrétisée par une agitation spora-
dique et un désintéressement pour l'étude et l'interprétation,
dans leurs grandes lignes, des phénomènes d'ordre politique
(tels que chutes successives des ministères, problèmes nord-
africains, laïcité) ou économique (coût de la vie, variation
des salaires, concentration). Les opinions émises sur ces sujets
sont les moins élaborées possible et offrent une confusion
extrême. Seule la propagande communiste oblige à prendre
position et à discuter, sur les problèmes qu'elle choisit. L'exploi-
tation du très riche thème « Paix au Vietnam » (auquel a
succédé le « non au réarmement allemand ») explique le succès
de Mendès-France, dont la popularité à l'usine a tenu autant
que les staliniens l'ont bien voulu. Mais si les staliniens con-
quièrent l'adhésion raisonnée ou résignée des ouvriers à leur
mot d'ordre, ils sont incapables de les entraîner à l'action.
Enchaînés par la pauvreté de leurs arguments de cicons-
tance, les militants à l'usine, c'est-à-dire 90 % de staliniens
et 10% de réformistes chrétiens ou socialistes, ne sont rien
en l'absence d'une montée ouvrière. L'impuissance de leurs
56
organisations respectives a été démontrée, mais chacun d'eux
retrouve l'estime que son comportement dans les luttes lui a
valu; quant à ses sympathisants politiques, leurs critiques ne
portent valablement que sur l'organisation.
Très significatif, pour conclure sur ce point, est le mépris
dans lequel, est tenu, par la plupart, le syndicat F.O. Il est
évident, que ce mépris n'a pas pour origine une attitude
« jaune >> de la section syndicale F.O. de l'usine au cours des
luttes. F.O. ne se désolidarise pas des autres à l'occasion des
diverses luttes limitées. Lors de la grève de février-mars 50,
il a tenu consciemment, comme les autres, son rôle de leader
imbécile d'un mouvement condamné, et jusqu'au bout. Tout
au plus peui-on lui reprocher d'avoir l'invective anti-patronale
moins vive et plus rare. Mais la raison même de cette hostilité
remonte à la scission qui vit la formation de la centrale F.O.,
et depuis, à la la ligue politique pro-américaine prise par F.O.,
chapeautée par la F.I.S.L., et au plat réformisme de son action
économique. Ainsi, à moins d'une bévue énorme, sur le plan
revendicatif, de la section C.G.T., les efforts des militants
F.O. pour gagner des sympathisants ont pour seul résultat de
de leur créer des sympathies personnelles, mais leur organi-
sation n'en bénéficie pas. Cette impasse, qui n'est pas exclusive
à F.O., sera étudiée dans nos conclusions.
VI. L'USINE ET LA VIE FAMILIALE ET SOCIALE.
Si l'on fait la part des propos tout faits et des banalités
courantes, les conversations des ouvriers ne sont pas seulement
révélatrices de leur emploi du temps et de leurs goûts, mais
aussi de leurs aspirations sociales et de leurs vues propres sur
la famille et les institutions sociales. Cela est d'autant plus
facilement discernable que les échanges sont faits avec franchise,
sans réticence ou fausse pudeur.
La place la plus considérable revient aux soucis matériels,
dont l'origine n'est autre que la médiocrité du pouvoir d'achat,
et qu'apportent les questions de fogement, d'équipement ména--
ger, et les charges familiales. C'est une obsession qui s'exprime
spontanément et indique, si besoin était, que la situation de
dépendance vis-à-vis du patron possède son prolongement au-
delà de l'usine.
Sur l'utilisation des loisirs, les ouvriers sont également
intarissables. Quels sont-ils principalement ? Le bricolage, le
jardinage, la pêche, le cinéma, les sports. (Sans références sta-
tistiques, mais d'après de nombreuses indications.)
- 57
Bricolage et jardinage présentent le double caractère d'être
à la fois un moyen d'améliorer le niveau de vie familial, et
l'expression du besoin de créer, refusé à l'ouvrier, rouage dans
la chaîne de production. La culture du poireau et les construc-
tions ménagères ou réparations automobiles, par exempie, sus-
citent des colloques passionnés.
Quant à la pêche, au cinéma, ou aux spectacles sportifs,
ils représentent ce qui exige le moindre effort intellectuel de la
part d'hommes qui s'épuisent 45 ou 50 heures par semaine.
On peut dire, sans entrer dans une étude sociologique du
comportement de l'ouvrier en dehors de la production, qu'il
tend à satisfaire un profond besoin d'expansion, de dignité, de
« respectabilité ». Il cherche à atteindre ce but dans la vie
familiale en particulier. Mais il est poursuivi jusque là par
son rôle de producteur salarié, qui vient briser ses projets,
tronquer sa vie familiale, limiter son horizon intellectuel et ses
possibilités de réflexion, soit par la fatigue, soit par le besoin.
Mêmes obstacles pour l'accession à la propriété privée du
logement (maison meulière, 400 m2 de terrain) qui est le rêve
d'une écrasante majorité, et l'ambition suprême.
Ce 'refuge est accessible, au prix de grands sacrifices, à de
nombreux professionnels qualifiés, sans parler des employés.
Cet aperçu rapide sur la vie ouvrière en dehors de l'usine
ne prétend pas à l'originalité, mais à mieux exposer les inci-
dences que cette vie implique dans le comportement de tous,
et de chacun, vis-à-vis du travail et de la discipline.
Jusqu'à présent, dan's cette étude, on s'est efforcé de décrire
le poids de l'oppression imposée par le rythme et la nature du
travail et par l'appareil de Direction, ainsi que la résistance
individuelle et collective, plus particulièrement ouvrière, à
l'exploitation. Mais l'ouvrier, en entrant à l'usine pour la pre-
mière fois, n'est pas un homme neutre dont les réactions seront
déterminées uniquement par ses rapports de travail. Il y entre
avec tout le bagage de jugements et d'idées qui lui ont été
inculqués par ses éducateurs et son entourage, principalement
familial. Et quotidiennement, par la suite, il sera à même de les
reviser ou non; ce qui revient à dire que la notion de classe
aura pour lui ou une signification réelle et permanente, ou cir-
constancielle, ou sera niée. Et les liens familiaux et sociaux ne
pèseront pas peu dans la balance.
En schématisant, il apparaît que tout le contexte social
est là pour convaincre chaque producteur qu'il est un atome
d'une société où la seule lutte est celle de tous contre tous, et où
les rapports normaux entre hommes son ceux de dirigeants et
58
de dirigés. C'est un état d'esprit que l'on rencontre constamment
chez quelques-uns, et dont les survivances sont nettes chez tous
en période dite « de lassitude », ou bien jour après jour dans
l'acceptation de la hiérarchie des fonctions.
Plus concrètement, les charges familiales, les ambitions pri-
vées, tendent à détruire les liens de fraternité avec les cama-
rades de travail. Ce sont elles qui agissent comme régulateur du
comportement de chacun vis-à-vis du travail, des camarades,
des cadres, et jouent à plein lors des grèves. Entendons-nous bien,
il ne s'agit pas de dire qu'en fonction de ses besoins et de ses
aspirations un ouvrier prendra ou ne prendra pas conscience et
de l'exploitation à laquelle il est soumis et même de la nécessité
d'une révolution dans ce que nous appelons « rapports de
production ». Non, mais, que, généralement parlant, pour lui,
la notion de classe et de lutte sera vue non de façon idéaliste,
mais sera appréhendée en fonction des intérêts immédiats.
Nous avons remarqué plus haut qu'il arrive un moment
ou la lutte individuelle fait place à la compréhension de la
nécessité et de l'efficacité de la lutte collective. Mais ces enga-
gements sociaux sont assumés de façon ou d'autre suivant les
engagements non liés à la production.
Ainsi le mode d'acceptation et de prise en charge du travail
varie énormément, non pas seulement suivant les postes de la
hiérarchie (cela nous l'avons vu), mais aussi suivant les charges
sociales (avec, comme auxiliaires, l'âge ou le sexe). Aussi bien
pour ce qui concerne l'assiduité, que la ponctualité ou la doci-
lité aux ordres, le dépassement des cadences, la présence aux
heures supplémentaires, la discipline et la conformation au
règlement.
Jeunės ou vieux, célibataires ou pères de famille, homnies ou
femmes, dans le corps-à-corps quotidien avec un travail continu,
y apportent l'intérêt et l'ardeur que commandent leurs situa-
tions personnelles. Concrètement cela signifie : qu'un vieil
ouvrier (et pour le patron on est vieux à cinquante ans) sera
plus « coulant » et soumis à la discipline générale qu'un jeune,
qui, de son côté, s'absentera plus souvent ou bien par exemple,
se rebiffera à la moindre vexation. Egalement, un père de
famille sera plus enclin à l'assiduité qu'un célibataire.
Sur ce point la variation est infinie, comme elle l'est par voie
de conséquence dans les rapports avec les camarades d'équipe
ou d'atelier, commandés par les mêmes situations et les mêmes
soucis personnels.
Et encore ne s'agit-il là que de l'adaptation individuelle à
un appareil collectif de production donné dont le fonctionne-
59
ment (hiérarchie: moyens techniques, rythme) va, comme l'on
dit, « de soi ». Mais lorsque l'on doit prendre les risques que
comporte toute action revendicative, débrayage ou grève, les pro-
blèmes personnels ne peuvent manquer de dominer les réflexions
de tous. Et par la suite, au cours d'une grève, c'est l'acuité de
ces problèmes et les moyens matériels de chacun pour y faire
face; qui décident du sort du mouvement.
Enfin, dans une large 'mesure, le temps important et parfois
exclusif que certains sont obligés pratiquement de consacrer à
leur famille, interdit tout approfondissement des problèmes de
lutte de classe dont les données sont en vrac dans l'activité
productrice quotidienne.
Pourtant, si la nécessité économique, pesant sur les individus
d'un poids plus ou moins écrasant, et les contraignant à une
servitude plus ou moins bien tolérée, se présente comme un frein
à l'activité revendicative ou révolutionnaire (et indépendam-
ment de la question du bien-fondé de leurs mots d'ordre, les
militants de toute organisation se heurtent à un mur de rési-
gnation); il ne faut pas perdre de vue que c'est cette même
nécessité économique qui est à l'origine des mouvements reven-
dicatifs. Il ne s'agit pas d'un paradoxe. En effet, s'il apparaît
comme évident que le simple fait de la subordination d'une
classe à l'autre entraîne un antagonisme irréductible, il semble
égaleinent fondé d'affirmer que sous l'aiguillon de la concur-
rence entre capitalistes, les conditions de travail et de salaire
des ouvriers ne font qu'empirer, et que de ce fait tous sont
entraînés, bien qu'à des degrés divers d'intensité, vers la lutte
comme seule issue. C'est alors que les rivalités personnelles, les
jalousies entre équipes ou à l'intérieur d'une équipe (soigneuse.
ment entretenues par le système) et les charges personnelles, sont
balayées par un réel sentiment de fraternité d'armes.
G. VIVIER
(La fin au prochain numéro).
-
60
DISCUSSIONS
L'unité syndicale
La lettre du camarade Henri Féraud, un des dirigeants
de la tendance syndicale de l'enseignement, Ecole Emancipée,
que nous publions ci-dessous, se réfère aux textes de D. Mothé
« Le problème de l'unité syndicale » (publié dans notre N° 14,
pp. 27 à 38) et de G. Fontenis « Présence dans les syndicats »
(Nºs 15-16, pp. 60 à 65). La discussion sur le problème syn-
dical ainsi engagée se poursuivra dans les numéros à venir
de « Socialisme ou Barbarie ».
Chers camarades,
Je voudrais vous dire d'abord tout le bien que je pense
de Socialisme ou Barbarie, dont les articles sont toujours
intéressants et parfois remarquables. Il y a longtemps qu’un ef-
fort théorique de cette sorte n'avait pas été entrepris en France.
Pour ma part, il me semble qu'il faut remonter à la « Critique
sociale » qui paraissait avant guerre, aux alentours des années
trente.
Je voudrais aujourd'hui vous faire part de quelques réflexions
au sujet des textes de Mothé et de Fontenis à propos du syn-
dicalisme. Permettez-moi de vous dire qu'après vingt-cinq ans
de vie syndicale, je n'ai pas appris à désespérer de cette forme
organisationnelle et qu'en fin de compte sans être libertaire,
j'approuve tout à fait les points de vue de Fontenis.
Je pense que la thèse de Mothé :
1. méconnaît la nature et le rôle du syndicat,
2. considère cette organisation comme si elle devait jouer
le rôle d'un parti et mieux encore d'un parti composé de révo
lutionnaires.
Ce n'est point ce qu'il dit expressément, mais ce sont les pos-
tulatst implicites qui me semblent orienter sa pensée et lui
donner sa signification.
- 61 -
Que les syndicats soient réformistes, c'est ce que l'on ne
saurait nier, mais de toute évidence, ils l'ont toujours été plus
ou moins nettement et ne peuvent pas ne pas l'être.
Qu'ils sont divisés selon les affinités bureaucratiques, c'est
encore évident, mais pratiquement il en fut toujours ainsi.
Même lorsqu'en apparence, ils semblent ne constituer qu'une
seule organisation, l'unité est plus apparente et bureaucratique
que réelle.
« comme
au
L'unité se fera-t-elle sous d'autres formes organisationnel-
les que les syndicats ? Je ne pense pas, parce qu'elle n'a jamais
été réellement faite; d'ailleurs ce n'est pas un problème majeur.
Certes, l'unité syndicale est utopique, mais elle l'a toujours été
et le sera toujours. Cependant, il importe d'y être attaché
comme à un principe que l'on rappelle parce qu'il donne un
« sens » à la propagande révolutionnaire.
Voyons plus en détail ces différents points. Le syndicat
est-il au sens plein du mot une organisation révolutionnaire. ?
Théoriquement, le rôle révolutionnaire est dévolu au Parti
Politique. En fait je pense que selon les circonstances histo-
riques, c'est la classe sociale qui, par une catharsis assez brus-
que s'éveille à la conscience et à la volonté révolutionnaire.
Mais la catharsis est favorisée ou freinée selon que parti et
syndicats ont plus ou moins réussi à contrebalancer, psycho-
logiquement parlant, l'influence des idéologies de la classe
dominante. Le rôle du syndicat est de prendre les travailleurs
ils sont », donc réformistes et travers du
réformisme, qui ne peut être nié, mais seulement surmonté,
d'ouvrir des perspectives révolutionnaires. C'est la vertu
fondamentale de l'organisation syndicale et cette veriu
elle est déjà dans le fait même de « l'organisaion ». L'accepta-
tion de l'organisation est déjà par elle-même le premier pas
dans la voie de la désaliénation théorique et pratique. Mais il
est évident que le réformisme peut se renier à un moment quel-
conque de l'évolution historique selon la conjoncture et l'acti-
vité syndicale pratique-critique. Les mouvements d'août 53 en
France et d'août 54 en Allemagne sont sur ce point des expé-
riences cruciales.
Le rôle du syndicat est d'amorcer le renversement dialecti-
que de la conscience ouvrière et de la signification de son action;
il prépare un terrain. De ce point de vue, je ne vois guère ce
qui pourrait le remplacer. L'idée d'un syndicat ou de toute autre
autre organisation susceptible de jouer le même rôle et compo-
sée de travailleurs conscients de leur tâche historique est une
contradiction dans les termes.
62
En outre une organisation qui prétendrait se substituer au
syndicat ne pourrait en aucun cas se désintéresser des reven-
dications dites immédiates, ce qui nous ramène au réformisme.
Le spectacle de la division syndicale n'est pas nouveau
et l'histoire ouvrière est l'histoire de constantes scissions
et de constantes réunifications. Mais c'est là un des aspects
normaux de l'aliénation. Suivant le degré et les aspects his-
toriques de l'aliénation les travailleurs enflent les effectifs syn-
dicaux ou au contraire s'en retirent. Mais il n'y a à ce fait rien
d'étonnant. Si les grèves d'août 53 avaient été victorieuses, on
aurait assisté à un afflux de travailleurs. La conjoncture veut
que les travailleurs depuis des années aillent de défaites en
défaites. C'est le signe d'un renforcement du pouvoir de la
classe dominante, non d'une diminution profonde de la comba-
tivité ouvrière et la division ouvrière favorise la puissance de
classe de la bourgeoisie. C'est le jeu normal de l'histoire, mais
ce n'est ni définitif, ni en fin de compte significatif. C'est un
aléa de la lutte des classes, qui n'en subsiste pas moins et peut
changer de face. A vrai dire pour voir la division ouvrière sur-
montée autrement que d'une manière bureaucratique, il faudrait
une situation objective révolutionnaire et un mûrissement accé-
léré de la conscience des exploités. Mais s'il est bureaucratique
de songer à une réunification par la volonté des Etats-Majors
syndicaux, ce ne l'est pas moins d'y songer par la vertu d'une
autre organisation créée de toutes pièces. On ne fait pas l'his-
toire par décret. C'est que l'authentique unité n'est pas une unité
organisationnelle apparente, mais l'unité d'une action et d'une
conscience de classe assumant une responsabilité et un rôle his--
torique. De ce point de vue le spectacle de la vie syndicale
actuelle ne doit pas nous effrayer, ni nous rebuter, parce que
nous savons que, en toutes circonstances, les exploiteurs vivent
de leur aliénation qui est leur raison d'être, alors que sous des
formes diverses et plus ou moins conscientes le travailleur
tend à la désaliénation et sa raison d'être est justement son
refus. Il ne faut donc pas prendre les apparences pour la réalité.
La division syndicale fait partie des apparences de l'histoire.
Elle est un des effets passagers d'une évolution aliénée. Elle
est donc . « mensonge », tout comme l'aliénation qui l'engen-
dre.
Lorsque donc on lutte pour l'unité syndicale, ce n'est pas
pour une utopie organisationnelle. C'est pour une signification
de l'action ouvrière. Même si elle ne devait pas être dans les
63
faits parce qu'il n'y a pas conjonction de la situation objective
et des possibilités organisationnelles, on devrait néanmoins con-
tinuer à souligner la nécessité de l'unité, qui en ce sens, ne peut
être que le signe d'une classe qui se ramasse et se reprend pour
une lutte révolutionnaire,
Comme vous le voyez, l'impatience révolutionnaire de Mothé
par ailleurs fort sympathique ne saurait se substituer aux exi-
gences de la dialectique historique.
Le militant révolutionnaire a sa place au syndicat, non pas
en dépit, mais parce qu'il est révolutionnaire. Fuir le syndi-
cat n'est pas une solution. D'ailleurs son rôle est-il si inutile ?
Dans nos syndicats, particulièrement difficiles, puisqu'il s'agit
d'éléments issus de la petite bourgeoisie, des tendances comme
l'Ecole émancipée progressent indubitablement. Peut-être aux
yeux d'ultra-gauchistes de la révolution, cette tendance n'appa-
raît-elle pas assez révolutionnaire ? Il reste cependant que telle
qu'elle est, elle représente une action et une conscience syndi-
cale, comme on voudrait en voir beaucoup dans les rangs
ouvriers. Il est remarquable, compte tenu, je le répète, de la
composition sociale des syndicats de l'Enseignement, qu'elle
ait obtenu cette année au Congrès Fédéral 480 mandats, ce qui
représente une influence sur environ 47.000 syndiqués. Ce n'est
déjà pas si mal et on ne peut parler d'un travail inutile et
vain.
Je me permettrai maintenant de reprendre quelques-uns des
points de vue de mon camarade Fontenis. Il me paraît dou-
teux que l'inactivité et l'incapacité relative des syndicats ait
pour cause essentielle la division syndicale. Je croirais plu-
tôt que l'incapacité, l'inactivité et la division elle-même sont
des effets des rapports de classe. En fait, tout cela traduit
dans les faits un rapport des forces défavorables aux opprimés,
et, ipso facto, une aggravation de l'aliénation. Nous payons
encore, la criminelle trahison qui a saccagé les possibilités révo-
lutionnaires de la fin de la dernière guerre mondiale. A cette
époque, incontestablement, se trouvaient réunies un certain nom-
bre de conditions favorables à une révolution et d'abord la quasi-
disparition du pouvoir bourgeois. Mais là ce sont ceux à qui
incombait la mission révolutionnaire qui n'ont pas hésité devant
l'une des plus importantes trahisons de l'histoire. En ordon-
nant la dissolution des milices populaires et le désarmement du
peuple, le parti communiste assumait l'une des plus terribles
responsabilités qu'un parti puisse encourir. Une fois de plus,
ils se montraient à visage découvert, leur vrai visage, celui de
naufrageurs patentés du destin de la classe ouvrière. Mais une
64
révolution manquée se paye chèrement. Nous ne faisons autre
chose depuis dix ans que de payer. Rien n'assure cependant que
tout est definitivement perdu et que la classe ouvrière soit
condamnée à renier sa mission. Or, ce serait dans ce cas et
dans ce cas seulement que l'on pourrait désespérer de l'organisa-
tion syndicale comme d'ailleurs de toute autre organisation de
classe. C'est un désespoir qui nous est étranger et nous sommes
prêts à montrer dans notre travail quotidien la patience qu'exige.
toute tache historique.
L'unité syndicale dépend de nous en tant qu'elle est lucide
idéal de désaliénation, mais elle ne dépend pas de nous en tant
qu'elle doit s'inscrire dans un certain nombre de conditions
objectives. Lorsqu'elle est objectivement possible, les disserta-
tions sont inutiles et les travailleurs ont tôt fait de trouver la
voie de cette unité. Les grandes grèves de 53 ont montré combien
fragile est la désunion et l'échec de ces mêmes grèves a montré
combien fragile est l'union. lorsque échoue l'action de classe,
Mais ce qui fut hier, sera demain. Pourquoi miser sur la défaite
et la barbarie ? Ce que sera l'unité, je n'en sais rien. Comment
elle se realisera. je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que
ce sont les travailleurs eux-mêmes qui nous donneront des leçons.
Il importera seulement à ce moment-là de nous montrer nous-
mêmes à la hauteur de ces leçons.
Henri FERAUD.
-65
1
NOTES
La nouvelle diplomatie russe
On a pu s'interroger longtemps sur l'ampleur du tournant diplo-
matique russe, depuis la mort de Staline. Maintenant, l'hésitation n'est
plus permise. Il y a eu le règlement indochinois, la signature du
traité autrichien, il y a maintenant la légitimation de l'opposition
titiste et l'invitation lancée à Adenauer. Ces événements sont pro-
bants et l'on peut d'ailleurs ajouter quelques autres de moindre impor-
tance mais également significatifs : la reconnaissance de fait du
Téarmement allemand aussitôt qu'il fut décidé et ceci, malgré la
campagne forcenée d'intimidation qui avait précédé ; l'exclusion de
l'Allemagne de l'Est du NATO oriental ; le nouveau plan de désar-
mement proposé aux Nations Unies. Dans ce climat, le nouveau style
de relations des dirigeants russes avec la presse occidentale, le réta-
blissement d'un certain tourisme étranger en URSS, la modéra-
tion des attaques contr l'impérialisme américain prennent eux-mêmes
une certaine portée. Il ne servirait à rien de considérer comme
simple effet de propagande cette politique. D'abord parce qu'une pro-
pagande à cette échelle est autre chose que du bruit, elle a une
efficacité, influe sur les forces susceptibles de soutenir l'URSS, trans-
forme les réactions de l'adversaire. Ensuite, parce que certains des
événements énumérés ont une réalité. Il est par exemple fort clair
(Mendès-France a dû le rendre public pour se défendre contre le
clan jusqu'auboutiste), que le Viet-Minh a fait preuve d'un esprit de
conciliation «inespéré», étant donné sa supériorité militaire. Il est
non moins clair que si l'URSS n'a fait aucun sacrifice substantiel en
signant la paix avec l'Autriche, elle a pourtant renoncé d'un coup
à des positions qu'elle avait depuis des années présentées comme
inaltérables : dans un tel cas, la concession a une réalité car les
rapports de force ne s'évaluent pas seulement en termes économi-
ques ou militaires, ils sont aussi largement idéologiques. Enfin, les
nouvelles propositions sur le désarmement ont elles-mêmes un
tain poids. Il ne suffit pas de considérer en effet les discussions sur
cette question comme un jeu où les adversaires se contentent de
bluffer ; comme tous les jeux, celui-ci a des limites et le bluff
s'effectue dans des cadres précis. Les joueurs sont obligés de comp-
ter avec l'éventualité (très improbable, certes)' d'être mis au pied
du mur, c'est-à-dire d'agir comme ils jouent. Or, l'URSS a soudain
changé ces cadres : elle a admis, comme on sait, ce qu'elle avait
jusque-là obstinément refusé : 1° que la réduction des armements
de type traditionnel précède la destruction et l'interdiction des armes
nucléaires ; 2° que la limitation des forces armées des grandes puis-
sances soit uniforme et non pas proportionnelle aux forces existan-
tes ; 3º qu’un contrôle soit immédiatement installé aux principaux
points des territoires intéressés. Bien sûr le bluff continue et les
manoeuvres à propos de la définition du contrôle ou des grandes
puissances (la Chine peut-elle traitée comme l'égale de l'URSS et des
cer-
66
Etats-Unis ? risquent fort d'être, interminables. Il n'empêche que
l'URSS « imagine » maintenant de faire une démobilisation plus
large que ne le serait celle des Etats-Unis (puisqu'elle entretient
actuellement des armées plus importantes), « imagine » un contrôle
sur son territoire qui équivaudrait à la suppression du rideau de fer,
désavoue enfin un thème de propagande interdiction immédiate
des armes nucléaires qui fut le thème essentiel de sa campagne
idéologique mondiale et le reste, d'ailleurs, pour tous les P.C., en retard
sur la nouvelle ligne, comme d'habitude, et continuant de récolter les
pétitions pour l'abolition de la bombe atomique.
De toute évidence, cependant, c'est la négociation avec Tito qui a
la plus grande portée et doit retenir notre attention. Cet événement,
en effet, plus que tout autre a des implications variées : il met en
cause le nouveau comportement du gouvernement du Kremlin et
donc, par extension, les changements dans le régime politique sur-
venus dans ce pays "il intéresse le développement des démocraties
populaires qui ont été le théâtre d'oppositions à certains égards ana-
logues au titisme il est enfin directement lié à la politique de
l'URSS en face du bloc occidental. Ces trois ordres de signification ne
sont certes jamais séparés, mais dans le cas présent, nous sommes
mis en demeure de les aborder ensemble et de les éclairer l'un par
l'autre.
A cet effet, il convient d'abord de relever quelques traits caractéris-
tiques de la négociation de Belgrade. Ce qui frappe, c'est que la
forme paraît en dépasser le fond. En fait, dans les questions de cette
importance, la forme ne dépasse jamais le fond et l'apparence contraire
est seulement le signe de déterminations cachées. Mais il est très
important de noter ce décalage. Voici plus de deux ans que des
relations diplomatiques ont étě rétablies entre Moscou et Belgrade,
des missions d'experts ont été échangées, des discours officiels ont
proclamé, de part et d'autre, la nécessité de rétablir des échanges
économiques et des rapports pacifiques, indépendamment des diver-
gences dans les régimes politiques. A lire la Déclaration commune,
qui fait suite à la négociation, il ne s'est agi à Belgrade que de
sanctionner et de consolider cet état de fait : on souligne l'intention
commune de contribuer à la paix mondiale et de procéder dans
l'avenir à des échanges économiques et culturels. Apparemment, la
normalisations des rapports entre l'Etat russe et l'Etat yougoslave ne
justifiait donc pas l'extraordinaire mise en scène qui l'a accompagnée,
le déplacement des trois principaux dirigeants russes et leur specta-
iculaire autocritique.
Avant de nous interroger sur les mobiles de cette mise en scène,
remarquons qu'on ne saurait lui trouver de précédent dans l'ère
stalinienne. Non pas que Staline n'ait opéré des tournants à 180°
dans sa politique étrangère comme dans sa politique intérieure. Mais
ices tournants n'étaient jamais expliqués, justifiés en regard du passé;
c'est le trotskisme qui les expliquait en les dénonçant. Dans le cas
présent, les dirigeants russes reconnaissent qu'ils se sont trompés.
Certes, ils recourent encore à un mythe : Béria le traître a toute
la responsabilité du passé. Mais peu importe, le mythe est bien une
manière de rendre compte du passé, et celui-ci ne dupe personne,
il permet seulement de dire que la direction russe a eu tort. Une autre
déclaration non moins sensationnelle se trouve dans le texte de la
Résolution finale : « (les) formes différentes de développement socia-
: liste concernant uniquement chacun des pays pris individuellement.>>
Une telle formule n'était pas inconcevable du temps de Staline. Celui-
ci faisait assez bon marché de la théorie marxiste pour lui faire
dire n'importe quoi. Mais à la condition que ce qui était dit servit sa
propre politique ; ainsi Staline pouvait bien dire que les démocraties
populaires suivaient une voie propre dans l'édification du socialisme
qui ne devait pas être celle qu'avait suivie l'URSS, mais cette voie
qui était celle des autres, il la décidait. La formule de Belgrade a un
tout autre sens puisqu'elle légitime une voie choisie par les Yougo-
67
slaves contre l'URSS. On a dit dans la presse que c'était reconnaître
et officialiser l'hérésie. Le terme n'est pas bon parce qu'il suggère.
qu'il y a une doctrine stalinienne orthodoxe, alors qu'il n'y en
jamais eu et que Tito n'est ni plus ni moins hérétique que Mao, Rako-
si ou Khrouchtchev. En fait, les thèmes fondamentaux de l'idéologie
bureaucratique sont partout les mêmes (les nationalisations font de
l'Etat le représentant des masses populaires, l'abolition de la pro-
priété privée élimine le gaspillage et la lutte des classes, l'industria-
lisation assure automatiquement le progrès social, la hiérarchie des
fonctions garantit la meilleure utilisation des compétences, etc...) et
s'il y a conflit entre les bureaucraties, celui-ci n'implique pas plus
l'hérésie que ne le fait un conflit entre les bourgeoisies de type tradi-
tionnel. La connaissance du titisme s'enrichirait si au lieu de parler
d'hérésie, on remarquait au contraire que son opposition au stali-
nisme russe venait de ce que leurs principes étaient identiques car
on verrait alors qu'il tient à la nature des bureaucraties, classes
dont les privilèges sont liés à l'exploitation d'un prolétariat et d'une
société donnés, d'entrer en conflit d'intérêt. Ce qui nous importe de
faire ressortir pour l'instant, c'est que les méthodes de la bureau
cratie russe (et non son idéologie) ont changé; la dictature centrale
stalinienne qui, jusque-là, au travers de tous les zigzags et au prir,
d'une série de scissions dans divers partis nationaux, avait imposé
son autorité absolue, accepte de la voir contestée. Mais dire que, des
méthodes ont changé est insuffisant, car celles-ci sont toujours une
expression, ne prennent sens que dans un cadre social.
Le stalinisme de Staline changeait de procédés, il pouvait étre”
belliciste puis pacifique, tour à tour opportuniste et sectaire comme
disait Trotski qui continuait anachroniquement de lui appliquer les
catégories du bolchévisme : il ne changeait pourtant pas dans sa
méthode. Dans tous les cas devait jouer le mécanisme de la politi-
que dictatoriale appliquée rigoureusement à tous les niveaux et dans
tous les secteurs, en dépit quelquefois des pires incohérences. Ce
qu'on a appelé « la ligne » exprime le caractère de cette politique
strictement monolithique. Or cette politique exprimait même
temps, la nature de la bureaucratie en U.R.S.S. Bureaucratie en
devenir qui s'était constituée à partir dse anciennes couches privilé-
giées, des cadres politiques de la paysannerie et du prolétariat et
dont l'hétérogénéité fut d'abord compensée par le totalitarisme absolu
de sa direction. Tandis que la nouvelle classe se sélectionnait à
partir des éléments les plus divers de la société préexistente et n'avait
d'abord de spécifique que sa situation privilégiée par rapport à celle
des ouvriers c'est-à-dire de participer à la répartition de la plus
value extorquée aux producteurs la dictature soudait ces éléments
en forgeant au jour le jour une politique (au sens le plus large du
terme) en regard de laquelle devaient se définir et se juger tous
les secteurs et tous les actes de la vie sociale. Le trait essentiel de
cette. dictature est qu'elle réduit tout au même modèle : le travail
productif de l'individu dans la société, l'invention technique, la
science, l'art ou la littérature ont immédiatement un même sens
politique (toute erreur est sabotage, toute divergence trahison). Et
le sens du politique se réduit lui-même à celui qu'a défini la direc-
tion étatique (la politique est la police). Il serait certes superflu de
penser que la dictature a fait la bureaucratie ; en réalité celle-ci s'est
développée et solidifiée comme classe à travers le processus d'indus--
trialisation qui a fondé dans les rapports de production des diffé-
renciations de fait. Mais la bureaucratie comme société a été précédée
par la bureaucratie comme politique et l'industrialisation elle-même.
n'a eu les effets qu'on connaît en U.R.S.S. que parce que la classe
en formation a été coulée dans le moule stalinien. Les purges des:
premières planifications donneraient aussitôt la preuve, s'il en était
besoin, du rôle déterminant de la dictature dans la consolidation
de la classe, que le simple processus économique ne suffit pas à ren-
dre homogène. Il est vraisemblable que le rôle historique du stali-
en
.
68
nisme devait à la longue se trouver dépassé par l'évolution même
de la classe bureaucratique. Répondant à la période héroïque de la
bureaucratie, à la nécessité de son accumulation primitive (et nous
parlons de l'accumulation de son existence autant que celle de son
capital) la terreur stalinienne ne répond pas aux besoins d'une classe
stabilisée, dont l'homogénéité ne pose plus de problème et qui cher-
che à jouir effectivement des privilégiés que lui assure son statut
économique. Nous avons déjà formulé dans Socialisme ou Barbarie
l'hypothèse d'une nouvelle phase dans le régime bureaucratique en
U.R.S.S., et qu'on pourrait nommer « libérale » si le terme n'avait
pris dans l'histoire de la bourgeoisie un sens déjini. Si cette nypo-
thèse est exacte (encore qu'il soit trop tôt pour parler d'une nou-
velle phase et qu'il soit plus juste d'évoquer un processus de « libé-
ration ») des conséquences d'une certaine ampleur peuvent en décou-
ler quant aur rapports de la bureaucratie russe et des autres bureau-
craties. La négociation avec Tito s'éclaire dans cette perspective en
même temps qu'elle la confirme. Car ce qui se manifeste dans ce
cas ce n'est plus seulement la recherche d'une détente internationale,
dont la diplomatie russe donnait depuis deux ans des signes clairs,
mais qui ne pouvait être reliée avec certitude à des changements
intérieurs ; c'est un nouveau mode de relations avec le bloc bureau-
cratique. Le passage de la Déclaration sur les diverses voies du socia-
lisme, que nous avons cité, a une signification très forte aussitôt
qu'on pense à sa répercussion dans les démocraties populaires. Peut-
être les négociations de l'U.R.S.S. avec la Chine avaient-elles déjà
sanctionné un nouveau rapport de forces entre l'ancien maître et
les partenaires nouveaux, mais ce n'était que dans les faits ; la recon-
naissance de ce rapport de forces est maintenant publique et trouve
pour ainsi dire sa charte dans la Déclaration de Belgrade. En même
temps donc qu'un certain type de dictature se trouve abandonné en
U.R.S.S., un certain type de domination des bureaucraties associées
l'est aussi. Est-ce trop que d'établir ici plus qu'une corrélation ? La
dictature de Staline se justifiait internationalement sur la base de
l'enfance de la bureaucratie ; tant que les P.C. dans les différents
pays étaient des oppositions minoritaires (quelquefois très restrein-
tes), leur étroite dépendance par rapport à l'U.R.S.S. était une néces-
sité. L'U.R.S.S. leur assurait une cohésion idéologique, quelle que fut
dans certains cas l'incohérence de ses directives, par
seui fait
qu'elle représentait le modèle achevé vers lequel s'orientaient les
bureaucraties embryonnaires des autres pays. La voie qu'essayaient
de se frayer, entre la bourgeoisie traditionnelle et le prolétariat, des
couches sociales souvent fort hétérogènes, l'existence de la bureau-
cratie russe l'éclairait. Ce qui eut été inconscient sans elle devenait
conscient.. Voilà qui fondait absolument l'autorité de Staline et
excluait des conflits mettant en péril l'unité du système. Mais il ne
peut qu'en aller différemment quand des bureaucraties s'installent,
se développent, gagnent une existence autonome, prospèrent par l'ex-
ploitation de leur propre proletariat : tel est le cas des démocraties
populaires. L'U.R.S.S. ne peut avoir pour elles la même fonction
qu'autrefois. Cette interprétation est générale et elle appelle donc
toute une série de corrections ; par exemple il faut se garder de pen-
ser que les démocraties populaires entretiennent toutes la même
relation avec l'U.R.S.S. Leur position géographique, leur force réelle
dans leur pays, leur dépendance économique à l'égard de l’U.R.S.S.
sont autant de facteurs qui déterminent leur rapport de force avec
le leader du bloc (un titisme tchèque réussissant à vivre des années
nors de l'orbite russe était inconcevable). Il faut tout autant récuser
un mode d'interprétation mécaniste qui voudrait qu'à un certain
degré de leur développement les bureaucraties prennent une conscience
de leur autonomie par rapport à l'U.R.S.S., ou que l’U.R.S.S. elle-
même soit mise dans la nécessité à un certain moment de composer
avec ses partenaires (la disparition de Staline a pu jouer un rôle
important dans la modification du rapport de forces). Il faut enfin
69
et surtout tenir compte des difficultés que rencontrent les diverses“
démocraties populaires dans leur industrialisation, principalement dans
l'exploitation d'un prolétariat de moins en moins solidaire du nouveau
régime, car ces difficultés donnent une grande acuité aux différences
d'intérêts des bureaucrates autochtones et des bureaucrates russes.
Le schéma que nous indiquions reste cependant valable dans ses gran-
des lignes. A une période où la dictature mondiale du parti russe
est incontestée parce qu'elle répond à un besoin historique, succède
une période où la politique du bloc doit prendre de nouvelles formes.
Il semble bien que Khrouchtchev ait sanctionné le passage à la
seconde étape. La rencontre de Belgrade a eu une portée politique
intéressant au plus haut point le bloc bureaucratique et à laquelle
participaient comme témoins invisibles toutes les autres démocraties
populaires. On a nié pourtant cette portée dans la presse en arguant
que Tito avait constamment cherché à maintenir le débat sur le
terrain d'une négociation entre Etats « quelconques » en excluant la
question de politique stalinienne. En réalité la presse bourgeoise se
berce le plus longtemps possible avec l'illusion que la Yougoslavie
est dans l'orbite occidental et qu'elle ne se rapprochera pas des
autres démocraties populaires, De sérieux. indices prouvent toutefois
qu'elle se trompe. C'est Tito qui a exigé une véritable autocritique,
comme le prouve le discours qu'il prononçait deux mois plus tôt et
dans lequel il traitait d'insanités (sic) des propos de conciliation de
Molotov. Pour Molotov il y avait eu des erreurs de part et d'autre
et c'était le moment de passer l'éponge. Pour Tito il n'y avait que
des erreurs russes et il était inutile de négocier si l'aveu n'en était
pas fait. Pourquoi Tito aurait-il manifesté une telle intransigeance
et pourquoi aurait-il souscrit à une déclaration concernant les diver-
ses voies du socialisme s'il tenait à ce que są négociation avec l’U.R.S.S.
n'ait pas d'autre caractère que celle de Nehru avec Mao ? Pourquoi
l'U.R.S.S. enfin aurait-elle accordé ces concessions-là si elles étaient
incompatibles avec la situation du bloc oriental ?
De tout ceci nous ne cherchons nullement à déduire que l'U.R.S.S.
a fini de jouer son rôle de leader du bloc et que va s'instaurer demain
une sorte de pluralisme bureaucratique qui donnera à chacun le
droit de disposer de soi dans le meilleur des mondes bureaucratiques
possible. Suffit-il d'évoquer le cas de l'Allemagne orientale, en
moment même, pour voir que le stalinisme « nouvelle manière » sait
encore jouer avec ses satellites et, si besoin est, leur passer par dessus
la tête pour s'adresser directement à leur adversaire ? Ce qu'on veut
seulement dire et ce que montrent les événements c'est que les
rapports inter-buraucratiques sont comme tous les autres des rapports
de force et qu'ils se modifient en conséquence. D'une part la préémi-
nence économique et militaire de l'U.R.S.S. lui assure son rôle de
leader et tend à empêcher toute sécession, d'autre part le développe-
ment de nouvelles puissances bureaucratiques tout particulièrement
de la Chine met en question l'autorité de l'U.R.S.S. et interdit
l'emploi des anciennes méthodes dictatoriales. Conclusion assez vague,
il faut le reconnaître. Mais qui a cependant l'intérêt de mettre en
évidence l'instabilité des rapports interbureaucratiques. Cette insta-
bilité n'est pas conjoncturelle, elle tient à la structure des bureau-
craties, qui une fois qu'elles s'affirment comme classes régnantes
rencontrent des problèmes spécifiques (l'industrialisation, l'exploita-
tion du prolétariat indigène, l'intégration de la paysannerie...) et
voient leur intérêt diverger partiellement de celui de l'U.R.S.S. Ce
qui était conjoncturel c'est bien plutôt l'unité du stalinisme qui a
présidé à la genèse de la bureaucratie à l'échelle internationale. Il
demeure qu'il est impossible de prévoir jusqu'à quel point cette insta-
bilité peut se manifester. Car, nous ne le répéterons jamais assez,
les raisons qui militent en faveur d'une solidarité croissante des
bureaucraties ne sauraient perdre de leur importance : c'est la néces-
sité de l'imperialisme super-étatique à la mesure de la lutte pour la
domination du monde, c'est aussi la nécessité qui subsiste de rendre
ce
70
homogènes les politiques des divers P.C. dans le monde (organes de
bureucraties qui ne sont encore qu'embryonnaires). L'unité du syst'
tème, incarnée par la direction de Moscou peut donc encore préva-
ioir (et ne manquera pas de prévaloir) d'une façon brutale, cest-
à-dire stalinienne « classique » aux dépens des aspirations des élé-
ments. A cet égard, on ne peut qu'être conscient de ces processus
contradictoires et attendre le développement des événements pour
apprécier leur portée respective. Tout au plus peut-on noter dès main-
tenant (nous l'avons déjà fait dans Socialisme et Barbarie) que les
nouvelles méthodes de Moscou qui répondent à la crise du bloc peu-
vent en quelque manière l'aggraver. Par exemple la reconnaissance
du titisme implique un assouplissement dans les rapports de ĽU.R.S.S.
et de ses satellites, mais cet assouplissement peut à son tour favo-
riser l'essor des oppositions bulgares, hongroises, ou tchèques en les
justifiant et donc accentuer les forces centrifuges dans le bloc.
Cependant insister comme nous venons de le faire sur cet aspect
de la négociation avec Tito ne doit pas faire oublier qu'elle s'intégrait
au premier chef dans une stratégie internationale. Ce que visaient
les dirigeants russes ce n'était pas une nouvelle relation avec les
bureaucraties bien que celle-ci fut acceptée. La preuve en est (nous
y avons déjà fait allusion) que Moscou essaya des formules de récon-
ciliation moins compromettantes que celles qui furent finalement
employées à Belgrade ; on ne passa à l'auto-critique que lorsque le
langage de Molotov et de: Jukov s'avéra insuffisant. Vu dans son
cadre diplomatique le rapprochement avec la Yougoslavie a la même
signification que divers actes de l’U.R.S.S., que nous mentionnions
au début de cette note. Il fait cependant plus que de les confirmer.
En reprenant de très près le texte de l'accord Nehru-Mao, la Décla-
ration de Belgrade prend la valeur d'un programme et met en relief .
le trait essentiel de la nouvelle diplomatie : la constitution d'une
zone neutralisée (ce qui ne signifie pas nécessairement neutre) tant
en Europe qu'en Asie. En Europe, l'Allemagne apparaît la pièce cen-
trale à neutraliser, elle est expressément mentionnée dans la Décla-
ration et on peut en conséquence penser que l'invitation à Adenauer
est autre chose que du bruit. L'U.R.S.S. cherche réellement un règle-
ment de la question allemande et à travers celui-ci un règlement tem-
poraire avec les Etats-Unis. Que ce règlement reste partiel, constat
d'un rapport de forces momentané plutôt que partage en bonne et
due forme, qu'il soit susceptible d'être remis en question par une
modification de ce rapport de forces c'est ce qui nous paraît aussi
certain aujourd'hui qu'hier (les blocs chercheraient-ils la coexistence
pacifique, il faudrait pour qu'ils l'obtiennent qu'ils acquièrent d'abord
une existence pacifique chacun pour soi et leurs contradictions inter-
nes sont suffisamment explosives pour écarter cette perspective). Mais
que l'U.R.S.S. cherche un règlement et à faire reconnaître pour un
temps le principe de non ingérence dans les zones respectives de cha-
que bloc c'est ce qui est devenu très probable à la lumière des récents
événements. Nous avons déjà dit que cette nouvelle politique était
largement déterminée par la situation des nouvelles bureaucraties aux
prises avec des tâches d'industrialisation qui demandent du temps.
Nous venons de redire que le temps lui-même est gros de contradic-
tions parce qu'il accuse les divergences des diverses bureaucraties
entre elles. Nous sommes donc renvoyés, des relations entre les deux
blocs aux relations inter-bureaucratiques et de celles-ci à celles-là.
Les facteurs sont inextricablement emmêlés et il serait artificiel de
croire que la politique de l'U.R.S.S. les domine. De cette complication
des facteurs, des limites dans lesquelles évolue la politique russe, des
chocs en retour que celle-ci peut déclencher la négociation avec Tito
est vraiment symbolique. C'est, comme nous avons tenté de le mon-
trer, le type même de l'événement surdéterminé et surdéterminant.
Claude MONTAL.
- 71 -
LES LIVRES
Le mouvement ouvrier
en Amérique Latine
de Victor ALBA (1)
« Seul le mouvement ouvrier reste capable de donner à l'Amé-
rique latine son vrai visage », écrit Alba dans l'introduction de ce
livre. Cette formule est doublement étrange : 1" parce qu'on igno-
rait que l'objectif des mouvements ouvriers fût en général de resti-
tuer aux nations leur pittoresque ; 2" parce que, si l'on croit Alba,
d'autre part le mouvement ouvrier latino-américain est précisément
incapable de remplir ce programme minimum, et parce que le livre
est, au fond. écrit pour donner l'initiative de la lutte aux « classes
moyennes ». Perspectives ambitieuses, comme on peut le voir ! De
sorte que la formule citée en commençant, par son académisme et son
faux jour, est assez capable de donner au livre d'Alba son vrai
visage.
Le mouvement ouvrier latino-américain est, selon Alha, extrême-
mnent faible, du moins jusque dans le premier quart du XXe siècle (199).
Cette faiblesse doit être attribuée au « caractère artificiel » de ce
mouvement, « le mouvement ouvrier n'était pas proprement latino-
américain, il n'était pas un produit spontané de l'Amérique latine.
C'est là la cause essentielle de son maigre développement » (105).
Ce mouvement se contentait d'importer d'Europe ses programmes et
ses tactiques. Or, que signifie au juste l'expression « produit spon-
tané. » ? Le bolchevisme était-il le produit spontané de la classe
ouvrière russe ? De toute façon, il y a toujours coopération d'une
fraction de l'intelligentsia issue des classes privilégiées. Le problème
ne doit pas être posé en termes de nation, mais en termes de
classe et de lutte de classes. Ce n'est pas parce que les programmes
qui ont animé le mouvement ouvrier latino-américain n'étaient pas
nés en Amérique latine qu'ils n'ont pas donné à ce mouvement l'im-
pulsion et la direction nécessaires, . c'est parce que les programmes
ne sont pas parvenus à caractériser correctement les « particulari-
tés » du développement de l'Amérique latine. Et s'ils ont échoué dans
cette analyse, ce n'est pas davantage parce qu'ils étaient « importés »,
(1) Editions Ouvrières, Paris.
72
c'est seulement en raison du caractère arriéré de l'économie et de la
société latino-américaine à cette époque ; plus précisément le socia-
lisme ne pouvait mûrir dans un pays où l'industrialisation était peu
développée, où le prolétariat industriel était largement minoritaire
en face des masses paysannes illettrées.
Cependant pour Alba « l'avenir de l'Amérique latine dépend de
la création d'un mouvement populaire qui, dans l'action comme dans
la doctrine, soit un produit particulier de la réalité latino-améri-
caine » (149). Aussi les seuls doctrinaires qu'il agrée sont ceux qui
ont tenté d' « américaniser le marxisme », ce qui aurait pu, paraît-il,
« donner au mouvement ouvrier un contenu idéologique plus solide »
qué le stalinisme, trop « européen » (142). Ainsi Haya de la Torre,
fondateur de l'APRA (Alliance populaire révolutionnaire américaine)
se voit félicité d'avoir tenté une « interprétation de l'histoire qui
constitue comme une adaptation du marxisme à la réalité latino-
américaine » (148). En quoi consiste cette « adaptation » ? Les prin-
cipaux objectifs de l'APRA étaient : lutte contre l'impérialisme, indé-
pendance, unification économique et politique de l'Amérique latine,
nationalisation des terres et des industries. Sa tactique supposait le
front commun des trois classes opprimées : prolétariat, pàysannerie,
classes moyennes. Elle passait par des « étapes de transformation
économique et politique, et peut-être aussi par une révolution
sociale... la révolution prolétarienne viendrait ensuite (1) (147). Alba
ne décrit pas comment l'Aprisme envisage le passage d'une étape à
l'autre ; mais nous retrouverons dans son propre programme des
éléments qui peuvent être rapprochés du programme de Haya. En
tout cas, « l'adaptation du marxisme à l'Amérique latine » ne donne
pas les résultats prodigieux qu'en attendait Alba : l’APRA a été
un échec, de l'aveu -d'Alha même, et ce n'est pas parce qu'elle n'était
pas latino-américaine, c'est, au contraire, parce qu'elle l'était. Elle
exprime, en effet, l'inquiétude de la petite bourgeoisie naissante
devant la pénétration de l'impérialisme nord-américain, sa recherche
d'un « soutien populaire » pour faire pression sur cet impérialisme
et surtout son vif désir de renvoyer sine die la révolution socialiste.
Selon Alba, si le mouvement ouvrier latino-américain a un carac-
tère « artificiel », c'est parce que le développement industriel de ces
pays aurait
lui-même caractère artificiel. Il est en effet
évident que l'industrialisation n'a jamais été déterminée par les
besoins du marché latino-américain lui-même, lequel importe des
produits manufacturés en grande quantité à des prix élevés et exporte
à bas prix les produits bruts agricoles et miniers. L'impérialisme des
USA a à peu près monopolisé les échanges (30 % des exportations
et 59% des importations latino-américaines en 1946) après une
période d'exploitation partagée avec la Grande-Bretagne et quelques
capitalismes européens. Si c'est en sens qu'il faut entendre le
« caractère artificiel » de l'industrialisation en Amérique latine, quel
est alors le pays capitaliste où l'industrialisation ne soit pas « arti-
ficielle.» ? Pour autant que la « révolution industrielle » a été le fait
du capitalisme, il est clair qu'elle n'a jamais été gouvernée par les
besoins « naturels . », mais par les possibilités du profit.
Le caractère « artificiel » de l'industrialisation produirait enfin
son effet le plus grave sous la forme du « parasitisme de la classe
ouvrière ».
« Le grand danger politique et social de l'industrialisation, écrit
Alba, telle qu'elle est actuellement menée, c'est qu'elle tend à séparer
eu
un
ce
(1) Souligné par nous.
73
la classe ouvrière du reste de la population laborieuse et à empêcher
cette unité d'action si indispensable à l'émancipation de tous les tra-
vailleurs latino-américains. Les ouvriers industriels, en effet, dans
les secteurs-clé tout particulièrement, deviennent assez souvent des
privilégiés par rapport à la grande masse paysanne, et même par
rapport aux artisans et aux couches inférieures de la classe moyenne.
Il est, certes, beaucoup plus facile au mouvement ouvrier de
faire payer au consommateur les succès qu'il arrache en apparence
au capitalisme étranger, que de prendre la tête d'une politique réa-
liste et responsable. Mais le résultat, si l'on y réfléchit, c'est que les
ouvriers latino-américains, si bas que soit leur niveau de vie, vivent
au crochet des grandes masses de la population qui sont réduites,
elles, à la complète misère » (204).
Mais « au crochet » de qui vit cette classe ouvrière parasitaire,
au crochet du consommateur ou au crochet de la paysannerie ? Au
crochet des classes moyennes ou au crochet des couches les plus
misérables, comme le prolétariat en haillons des banlieues ? Pour
admettre que le prolétariat est parasitaire, il faudrait démontrer
d'abord qu'il consomme une quantité de valeur supérieure à celle
qu'il produit ! Il n'y aurait plus alors de capitalisme du tout, ni
de pro ariat i on ne comprend absolument pas qu'une classe
productrice en général puisse être parasitaire. Ou bien alors il fau-
drait dire que les ouvriers au travail dans toutes les sociétés capi-
talistes vivent au crochet de « l'armée de réserve » des chômeurs,
par exemple, et conclure qu'il faut, de toute urgence, qu'ils aban-
donnent une partie de leur temps de travail et de leur salaire pour
les partager avec les sans travail. Bel objectif révolutionnaire !
Ce prolétariat, qu'il soit chilien, mexicain, russe ou indonésien est,
faut-il le rappeler, une classe qui produit plus de valeur qu'elle n'en
consomme.
Cependant, l'impression de parasitisme que peut donner la classe
ouvrière latino-américaine s'expliquerait peut-être par la différence
de son niveau de vie avec celui de la paysannerie. C'est, en tout
cas, ce que suggère Alba. Il donne du reste à entendre que la déjà
lointaine origine européenne de ce prolétariat n'est pas étrangère
à ses privilèges. Mais d'abord, cette différence de niveau de vie
n'entraîne pas automatiquement que l' « aisance » du proletariat
soit assise sur la pauvreté de la paysannerie ; et ensuite cette
couche d'ouvriers qualifiés venus d'Europe, ou bien s'est incorporée
aux cadres, ou bien 's'est intégrée à la petite bourgeoisie, ou bien
enfin constitue plus qu'une couche privilégiée de la classe
ouvrière (celle, par exemple, qui fait carrière dans les bureaucra-
ties syndicales) parce que le développement des industries de
transformation et la pénétration des rapports capitalistes à la cam-
pagne (comme dans toute l'Amérique Centrale sous la United Fruit
Company) ont transformé en ouvriers mineurs, industriels et agri-
coles, une masse croissante des anciens paysans. Mais cette classe
tout entière n'est pas privilégiée, Alba confond en réalité classe
et syndicats « Il y a beaucoup de ce parasitisme syndical »,
écrit-il (205).
A propos de la nationalisation du pétrole au Mexique en 1938,
Alba cite les thèses de Trotsky relatives à la participation des syn-
dicats à la direction de l'industrie nationalisée (1) où Trotsky
dénonce « la transformation des représentants mandatés du prolé-
..
ne
:
(1) Voir Ive Internationale, oct-nov. 46, « L'industrie nationa-
lisée et la gestion ouvrière ».
- 74
en
.
tariat en otages de l'Etat bourgeois » et la « dégénérescence bour-
geoise des appareils syndicaux à l'époque impérialiste, non seule-
ment dans les vieilles métropoles, mais aussi dans les pays colo-
niaux ». Il ne s'agit probablement pas d'une simple dégénérescence
bourgeoise, mais d'une bureaucratie favorisée au Mexique ou
Argentine, par exemple, par l'étatisation de certaines branches de
la production : de toute façon, que ce soit sous la forme d'un
réformisme de soutien ou d'une bureaucratie fasciste, il est vrai
qu'une fraction de la classe ouvrière passe dans l'appareil parasi-
taire, il est faux que la classe elle-même devienne parasitaire. Et
ici encore Alba s'administre à lui-même un cinglant démenti
il montre en effet (129) qu'au Mexique, lors de la nationalisation,
26 % du revenu national provenaient des bénéfices et 30,5 06 des
salaires, tandis qu'en 1952 ce rapport est passé à 41,4 % contre
23,8 %. Comme pendant cette période 100.000 personnes ont été
incorporées définitivement à la classe ouvrière (Alba' 130), on peut
considérer que le taux d'exploitation de celle-ci s'est accru sensi-
blement : cette aggravation est sans doute due à la formation d'un
proletariat agricole, et il est bien évident que le syndicalisme a pu
favoriser telles autres branches du prolétariat (pétroliers et chemi-
nots au Mexique, selon Alba). Cela prouve şeulement que le taux
d'exploitation varie en fonction de la résistance ouvrière. Mais
dans la mesure où la tendance générale est à l'exploitation accrue
des ressources locales, c'est-à-dire à la consolidation de l'impéria-
lisme, cette tendance doit se traduire par une aggravation de la
condition ouvrière,
Le cas de l'Argentine est significatif à cet égard. Peron avait
formé, pour financer son premier plan d'industrialisation (1947-51),
un organisme qui achetait les produits agricoles à très bas prix
et les exportait aussi cher que possible; faisant ainsi subir le poids
de l'accumulation nécessaire pour industrialiser, aux propriétaires
fonciers qui, à leur tour, le faisaient peser sur les travailleurs agri-
coles. Comme, simultanément, Peron accordait aux ouvriers orga-
nisés dans ses corporations, quelques avantages, parce qu'il avait
besoin de leur soutien, tout se passait comme si les privilèges
octroyés à la classe ouvrière étaient extorqués à la paysannerie. En
réalité, cette opération supposait les besoins mondiaux en matières
premières agricoles ; dès que ceux-ci, après la fin de la dernière
guerre mondiale, faiblirent, la résistance de l'aristocratie foncière
jointe à la mévente devaient obliger Peron à faire machine arrière.
Le nouveau plan quinquennal (1952-57) ralentissait l'industrialisa-
tion, relâchait la pression sur la propriété foncière et le grand
capital, et se traduisait dans la rue par la fusillade des ouvriers,
écourés des démagogues péronistes. Qui paiera les frais de
l'opération, si ce n'est le prolétariat agricole et industriel ? Qui
est parasitaire, ce prolétariat ou la bureaucratie péroniste ? Le
premier plan quinquennal n'avait été possible que parce que, le capital
argentin se trouvait transitoirement en bonne position pour imposer
ses prix à ses acheteurs capitalistes ; mais la logique de l'impéria-
lisme devait le ramener à sa fonction subalterne, et condamne ainsi
le peronisme, qui n'est plus nécessaire pour l'instant. Il ne faut
donc pas dire que le prolétariat argentin est objectivement parasi-
taire, il faut dire que l'appareil politique et syndical partiellement
issu de ce prolétariat, a pu installer son existence parasitaire à la
faveur des conditions économiques mondiales. Ce n'est pas tout à fait
la même chose.
Pour en finir avec le caractère « artificiel et parasitaire » du
proletariat latino-américain, disons seulement qu'il y a un problème
75
fondamental à résoudre, dans ces pays comme dans tous les pays
à structure coloniale ou semi-coloniale : ce problème est celui des
rapports du prolétariat industriel et de la paysannerie précapita-
liste. L'Amérique latine n'est pas un pays artificiel, c'est un pays
dont la structure obéit à une loi de développement combiné, c'est-à-
dire où les rapports capitalistes de production se sont installés par
dessus des rapports pré-capitalistes sans les détruire pleinement.
« A la base de l'impuissance ouvrière, écrit justement Alba, on
retrouve finalement le problème de la terre » (209). Ce problème est
comparable à celui de la Russie avant la Révolution : formidable
paysannerie à peine sortie du servage, prolétariat minoritaire mais
puissamment concentré dans des industries qui reflètent l'état de
développement de l'impérialisme, enfin aristocratie foncière soutenue
par le grand capital des vieilles métropoles. La petite bourgeoisie
russe ne pouvait pas faire sa révolution démocratique en détruisant
les formes féodales de l'exploitation paysanne ; elle ne le peut pas
davantage en Amérique Latine. Cependant Alba écrit : << ...lorsque
la classe moyenne aura pu détruire le régime féodal de la terre... (132).
Même s'il avait oublié la Russie, le double échec de la révolution
mexicaine et de la révolution guatémaltèque, dirigée l'une et l'autre
par les classes moyennes soutenues par le prolétariat, devait rafraî-
chir sa mémoire quant aux « particularités » de l'Amérique Latine.
Inutile . donc d'insister longuement sur le programme et sur la
tactique définis par Alba.
Son programme tient en un mot : industrialisation (Lénine
ajoutait : les Soviets). Cette industrialisation doit s'effectuer sous
la forme « nationalisée », paraît-il. « Mais, ajoute Alba, pour effec-
tuer la nationalisation des mines ou des terres, il faut disposer de
techniciens et de cadres capables, c'est-à-dire d'une sorte de bour-
geoisie. Que ce soit en régime capitaliste ou en régime socialiste, il
s'agit de créer une classe dirigeante non parasitaire », etc. (201). Ce
gouvernement et cette administration, « forcément recrutés dans
la classe moyenne », devront avoir « le soutien moral et matériel » du
mouvement ouvrier (202, nous soulignons). On voit assez bien se
dessiner ici, dans la position d'Alba, et à l'insu d'Alba, une ligne
stalinienne de la conquête du pouvoir dans un pays arriéré. Toute-
fois, ce n'est pas un stalinisme conscient, c'est seulement un réfor-
misme musclé, puisqu'il ne s'agit jamais dans ce programme que
de « co-gestion » et de « contrôle » ouvrier (et paysan) dans les
usines. Les mesures proposées : répartition équilibrée du capital étran-
ger dans les deux secteurs (biens de production et de consomma-
tion), réinvestissement obligatoire d'une large fraction des bénéfi-
ces, pénétration des méthodes capitalistes à la campagne, encoura-
gement des petites entreprises locales, accélération des réformes
sociales, développement de la conscience de classe du prolétariat
agraire, protection des capitaux indigènes, participation du prolé-
tariat, de la paysannerie et de la classe moyenne (bien sûr !) au
développement et à l'application du système toutes ces mesures
« servent au développement du capitalisme », Alba le consent, « mais
il ne faut pas en conclure que ce n'est pas au prolétariat de les faire
adopter » (203). Belle consolation ! Nous ne sommes pas loin de
Haya de la Torre, et de la révolution socialiste pour plus tard...
En fait le problème agraire qui pèse sur l'Amérique latine ne
peut être résolu que par un gouvernement ouvrier mondial, c'est-
à-dire capable de fournir au prolétariat latino-américain au pouvoir
les fonds nécessaires à l'accumulation pour faire l'industrialisation
sans risquer la dégénérescence bureaucratique. L'objectif stratégique
76
à atteindre est la formation de soviets ouvriers et de soviets paysans
unis sur des plates-formes communes. L'objectif tactique est d'enga-
ger la lutte simultanément, par l'expropriation de fait des expropria-
teurs à la campagne . et à l'usine. Le problème central reste celui
de la coordination. Il ne nous paraît pas que ce problème puisse être
résolu a priori : ses éléments et par conséquent les éléments de sa
solution ne seront donnés concrètement que dans le développement
historique. L'histoire sociale de l'Amérique latine montre suffisam-
ment que la maturité, la combativité et l'imagination des classes
ouvrière et paysanne de ces pays ne seront pas en défaut pour résou-
dre ce problème. Dans l'immédiat la tactique doit donc être celle d'une
dénonciation permanente, non seulement de l'impérialisme, mais encore
des falsifications petites bourgeoises, comme celles de l’APRA ou
d'Alba lui-même, plébeiennes, comme celle de Peron, ou staliniennes
(mais elles sont moins importantes en Amérique latine); cette dénon-
ciation doit permettre d'éclaircir les rapports du prolétariat indus-
triel et de la paysannerie, rapports que le développement du prolé-
tariat agricole doit faciliter.
Alba enfin ne situe pas du tout le mouvement ouvrier latino-amé-
ricain dans le cadre de la lutte opposant Washington et Moscou. On
pourrait penser qu'il a raison parce que l'Amérique Latine paraît
devoir rester pour longtemps la chasse gardée de l'impérialisme des
U.S.A. L'affaire guatémaltèque récente en est un signe supplémen-
taire.
Toutefois cette question ne pourrait être éclaircie que si l'on
montrait d'abord que les conditions objectives de la formation de
la bureaucratie n'existent pas en Amérique latine. Or la condition
permanente d'une telle possibilité dans les pays arriérés paraît être
en général l'incapacité où se trouve la bourgeoisie locale de faire
la révolution bourgeoise : destruction des rapports féodaux à la
campagne, extension des nouveaux rapports capitalistes, etc. Sur
cette base, et dans certaines circonstances favorables, la paysannerie
asservie peut parvenir à s'organiser en armée, conquérir les terres,
résoudre ainsi le problème préliminaire de la transformation écono-
mique et sociale. L'appareil militaire et politique qui a unifié la pay-
sannerie peut alors, selon des modalités variables, mettre en tutelle
la bourgeoisie, puis la remplacer par sa propre bureaucratie appuyée
sur ·un capitalisme d'Etat. Ces perspectives sont-elles ouvertes en
Amérique latine ? Nous avons relevé dans le programme d'Alba lui-
même une tendance bureaucratique (« techniciens et cadres capa-
bles, c'est-à-dire une sorte de bourgeoisie »... « Créer une classe diri-
geante non parasitaire qui puisse assurer le passage d'un pays arriéré
à la civilisation industrielle...») ; dans le programme de l'APRA,
la même tendance s'esquisse ; la nécessité d'étatiser apparaît sous
des formes diverses pour les classes dirigeantes de plusieurs pays
(Argentine, Mexique...) ; . enfin « l'expérience guatémaltèque », qui
était celle d'un Front Populaire sous la direction de techniciens, de
militaires, de leaders syndicalistes et d'intellectuels, avait des chan-
ces d'évoluer vers une « démocratie populaire », sans l'intervention
nord-américaine soutenant la trahison de la petite bourgeoisie et l'as-
saut du grand capital. Il ne nous semble donc pas qu'on puisse éli-
miner purement et simplement l'hypothèse d'une bureaucratie et bien
entendu sans qu'il soit question d'en préciser l'échéance.
Pour être posé en termes corrects, ce problème devrait être replacé
dans le problème plus large de la bureaucratie en pays arriéré, et
notamment dans les pays coloniaux et semi-coloniaux.
F. LABORDE.
– 77
La réunion des lecteurs
de « Socialisme ou Barbarie »
La publication du dernier numéro de la Revue a été suivie, comme
à l'ordinaire, d'une réunion de lecteurs. Celle-ci, qui s'est déroulée à
la Mutualité le 3 décembre dernier avec la participation d'une qua-
rantaine de camarades, était consacrée à la politique du gouverne-
ient Mendès-France. Chaulieu a tenté, dans son exposé, comme il
l'avait fait dans son article, de donner un tableau de la décadence
du capitalisme français, décadence qui ne s'inscrit pas seulement
dans celle du capitalisme mondial mais qui a des caractères spéci-
fiques et se manifeste par un recul constant de la production indus-
trielle française par rapport à celle des autres grandes puissances.
Il a fait ressortir l'irrationalité de la gestion politico-économique
de la bourgeoisie française qui, incapable de se hausser au niveau
de ses intérêts collectifs, a laissé ses diverses fractions poursuivre,
chacune pour soi, le maximum de profit immédiat. C'est cette conduite
de gaspillage qui a entretenu la guerre d'Indochine amenant l'Etat
à supporter les charges sans commune mesure avec les profits que
tirait de la situation une fraction capitaliste ; c'est elle qui a amené
la bourgeoisie au bord de la catastrophe et qui a justifié le recours
ultime à Mendès, l'homme d'un capitalisme conscient et organisé,
le champion d'une gestion fondée sur des plans à long terme, et sur
la discipline des groupes dirigeants. Ce que Chaulieu s'est employé
à montrer c'est l'extrême précarité de l'expérience Mendès-France,
D'une part, celui-ci ne s'appuie sur aucune force réellè au parlement ;
il profite d'une conjoncture « catastrophique » qui rend sa présence
nécessaire aux yeux des différents partis et lobbies politiques, mais
la situation qui régnait avant son avènement demeure inchangée et
l'on n'attend que la fin du « rafistolage » pour reprendre le jeu tra-
ditionnel. D'autre part Mendès-France lui-même est contraint dans
la mesure même où il veut se conserver de renoncer à toute entre-
prise qui léserait sérieusement une aile de la bourgeoisie ; il est
incapable de mettre sur pied et de faire appliquer un programme de
redressement économique et n'adopte que des mesures mineures de
rationalisation. Chaulieu montre ensuite le véritable caractère de
Mendès en matière de salaires. Les ouvriers s'aperçoivent que les pro-
messes ne sont pas tenues, la revalorisation a été dérisoire et le gou-
vernement ne peut durer sans que les illusions se dissipent. Mais
dans uelle mesure .y a-t-il illusion ? Les ouvriers ont-ils réelle-
ment attendu quelque chose du gouvernement ? Dans quelle mesure
la politique de paix en Indochine, les promesses sur l'Afrique du Nord,
les manifestations d'indépendance (relatives à l'égard des Etats-
Unis ont-elles eu uri écho dans le prolétariat ? Ne faut-il pas plutôt
- 78
en
reconnaître que les ouvriers - n'ont qu'un intérêt très superficiel pour
le Mendessisme, que les problèmes qui paralysent la classe et l'avant-
gardé n'ont que peu de choses à voir avec le personnel politique en
place ? Ce sont ces dernières questions que Chaulieu pose aux cama-
rades présents en les engageant à faire part de leur expérience.
Un certain nombre de camarades sont intervenus dans la discus-
sion et la manière même dont celle-ci s'est orientée aurait suffi à
montrer quelles étaient les préoccupations de l'avant garde, car très
rapidement le sujet de la réunion a été dépassé. Ce n'est pas de
la politique de Mendès qu'on a traité, de ses chances, ni même de
ses incidences immédiates sur le pouvoir d'achat ouvrier ou sur les
revendications ; c'est du rapport de la classe et de son avant-garde,
de la nature même de cette avant-garde, des possibilités de formes
d'organisation autonomes.
Il faut cependant mentionner les interventions, fort différentes:
des autres, de deux camarades trotskystes, aguichés sans doute par
le sujet de la réunion, et qui ont saisi l'occasion de proclamer que
la révolution était imminente (qu'elle embrassait déjà l'Afrique du
Nord), que la question du régime allait se trouver posée incessam-
ment, plus fortement encore qu'en 1953 (sic), qu'une fois de plus
l'avenir dépendait de l'attitude du P.C., du degré de trahison dont
il allait faire preuve, que le proletariat quant à lui ne voulait plus
qu'une lutte, générale etc... Bref ils n'ont rien dit d'autre que ce
que la définition de trotskyste impose de dire quels que soient le
lieu et la circonstance.
Le camarade Bourt a ramené la discussion sur un terrain solide
montrant les difficultés qu'affrontaient quotidiennement les
ouvriers à l'usine, et les militants ou les éléments d'avant-garde cha-
que fois qu'ils essayaient de susciter une action si minime soit-elle.
D'après Bourt l'écrasement des ouvriers n'a jamais été si complet,
la passivité si dure à secouer ; chez Renault, par exemple, la direc-
tion se permet d'appliquer des mesures vexatoires, autrefois impos-
sibles, et les militants ne parviennent à les contrecarrer qu'en déployant
des efforts démesurés pour éveiller les protestations de leurs cama-
rades. Bourt note que les ouvriers écourés par le stalinisme sont
rebelles à toute organisation. Ce qu'il faut faire selon lui c'est profi-
ter de toutes les circonstances celles même qui n'intéressent que
des détails de la vie quotidienne pour réapprendre la politique
aux ouvriers ; les éléments qui ont une formation doivent enseigner
aux autres l'histoire du mouvement ouvrier et tout relier au fait.
central de l'exploitation. Le camarade Henri note de son côté que
la classe est extrêmement hétérogène ; il y a une minorité qui cher-
che à s'intégrer dans le système d'exploitation certains par la
débrouillardise individuelle, la recherche des améliorations de salaire
par le travail supplémentaire, certains par la participation à la bureau-
cratie stalinienne. La majorité est passive, incertaine de l'avenir,
ignorant le passé de luttes de la classe, dépourvue de toute culture
socialiste. Il serait d'ailleurs faux de croire que les illusions réfor-
mistes voire nationalistes n'ont plus de poids sur la masse
ouvriers se sont laissés abuser par la campagne stalinienne contre
la C.E.D., ils n'ont pas vraiment lutté contre la guerre d'Indo-Chine,
ils ont fait quelque crédit à Mendès-France. Mais' l'essentiel d'après
Henri c'est le découragement des ouvriers, le sentiment qu'ils ont
d'être des « zéros » politiques et professionnels. C'est ce décourage-
ment qu'il faut vaincre en reprenant avec patience et obstination
le travail d'éducation et d'organisation qu'ont mené dans le passé
les partis révolutionnaires.
: les
+
79
Ce que Chaulieu et Montal reprochent à Henri c'est sa confiance
dans les méthodes d'organisation traditionnelles qui sont pourtant
en échec depuis longtemps. S'il suffisait aux militants de bonne
volonté de se rassembler pour diffuser patiemment les grandes idées
du marxisme, on ne comprendrait pas pourquoi différents groupes
et notamment le P.C.I. ont été et demeurent si largement ineffica-
ces. Ce ne sont pas leurs erreurs théoriques par exemple sur
l'U.R.S.S. qui les condamnent au premier chef auprès de l'avant-
garde, c'est leur volonté d'endoctriner les ouvriers, de leur apporter
le socialisme, de jouer mieux qu'il ne le joue le rôle que joue le sta-
linisine. La résistance que les ouvriers opposent à l'endoctrinement
politique ne provient pas seulement de leur passivité ; elle signifie
aussi que les rapports des militants et de l'avant-garde, de l'avant-
garde et de la classe, de la politique et de la vie des hommes dans
la production ne peuvent plus être les mêmes. A cet égard Henri
ne donne pas une bonne description de l'hétérogénéité de la classe.
Au sens où il l'entend, cette hétérogénéité a d'ailleurs toujours existé,
il y a toujours eu un décalage entre les masses et l'avant-garde, tou-
jours eu aussi des courants plus ou moins accusés selon les époques,
d'évasion individuelle ou de bureaucratisine. S'il y a une caractéris-
tique de la situation présente c'est que l'avant-garde a une physio-
nomie nouvelle. Elle ne groupe pas simplement les ouvriers les plus
combatifs : ceux-ci sont souvent staliniens ; elle se manifeste à tra-
vers les éléments les plus conscients du danger bureaucratique. Ceux
là qui ont vu le vrai visage du stalinisme et qui sentent aussi qu'il
n'est pas un simple accident, qu'il tient aux difficultés essentielles
que connaît le prolétariat pour s'organiser dans la société d'exploita-
tion, ceux-là de toute évidence sont aussi ceux qui résistent le plus
à de nouvelles formes d'organisation. Cette avant-garde, diffuse, il
faut la reconnaître et lui permettre de se reconnaître. Le meilleur
moyen de le faire n'est pas un travail de « politisation » tradition-
nel. Il faut mettre en évidence toutes les réactions des ouvriers qui
dans le cadre même de la production témoignent du refus de l'ex-
ploitation, de la tendance à l'autonomie. Les rendre évidentes c'est
d'abord faire parler les ouvriers, donner la parole à une masse silen-
cieuse dont on masque les problèmes souvent par les slogans poli-
tiques. Les militants ont trop souvent tendance à penser que leur
tâche est d'apporter les vérités politiques à la classe, alors qu'elle est
d'aider la classe à exprimer ses vraies. revendications immédiates
et historiques, de donner forme assurément, d'anticiper à quelque
degré, mais de trouver le programme même dans l'expérience de
l'avant-garde. Les camarades soulignent pour terminer l'importance
d'un journal comme Tribune Ouvrière qui, chez Renault, essaye à une
échelle modeste de réaliser cet objectif.
C'est à cette réunion que se réfère la lettre d'un camarade, dont
nous publions ci-dessous des extraits.
LETTRE D'UN CAMARADE
...La première chose qui saute aux yeux, c'est que le sujet choisi
a tourné court. On était venu parler de Mendès-France ; et l'on parla
des problèmes essentiels qui se posent à la classe. C'est assez dire
que, dans un sens, « le thermomètre était mal placé ». Il y a belle
lurette que Mendès, Pinay et autres n'intéressent plus les ouvriers et
c'est déjà le problème de l'organisation de la classe qui se pose, bien
que confusément. D'ailleurs personne ne nous a donné d'exemples
précis de la réaction d'approbation envers Mendès au début de son
80
règne (si ce n'est l'impression générale d'un soupir de soulagement
‘poussé à la fin de la guerre d'Indochine). Donc, la critique du gou-
vernement Mendès paraît davantage destinée aux « gens de gauche »
qu'aux ouvriers, infiniment moins impressionnés.
...D'une manière générale, il faut reconnaître que l'ordre du jour
convenait plus aux intellectuels qu'aux ouvriers (d'où la présence des
trotskistes dans la salle). Le goût de prendre la température des
masses, de jauger et, par la suite, de vouloir mesurer, quantifier, ossi-
fier, est typiquement un travers de l'intellectuel dans le régime
d'exploitation. Un souffle de vie ouvrière est entré dans la réunion
lorsque Bourt a raconté ce qui s'était passé, l'après-midi même, dans
son atelier. Par delà les revendications et la lutte quotidienne impo-
sée par la bourgeoisie, par delà les marchandages de tous ordres,
l'incident de placardage d'affiche qu'il rapportait traduisait la dignité
ouvrière et les ambitions infinies de la classe. Les ouvriers sont des
hommes et veulent travailler comme des hommes, non comme des
robots. Pour eux, il ne s'agit pas de grimper dans la hiérarchie, de
rechercher une médiocre stabilisation. Ce qui compte, c'est la recherche
sérieuse d'une amélioration fondamentale, qui permette à chacun de
donner sa mesure d'homme. C'est ainsi que la lutte collective, comme
épreuve de force à court terme, n'est pour eux qu'un moyen, pas une
fin, et c'est ce qui les différencie des prétendues directions ouvrières.
Ce sont les directions qui, à dessein, appuient sur l'aspect bagarre.
Foncièrement, ce que veut l'ouvrier c'est une autre humanité et non
pas tel ou tel parti qui se bat plus ou moins bien et remporte telle
ou telle victoire.
... Les intellectuels, eux, même quand ils sont des ennemis consé-
quents de Mendès, soupèsent et mesurent: le rafistolage que celui-ci
opère ; en ceci ils sont en arrière des ouvriers qui affrontent les
problèmes fondamentaux que pose l'abolition de l'exploitation.
Il y a un infini entre le comportement d'un ouvrier et celui d'un
trotskiste. Le trotskiste « a appris des choses dans les livres, », et
il les répète. L'ouvrier vit l'exploitation chaque jour, dans sa com-
plexité et son progrès, là où elle est le plus intense dans la pro-
duction, il expérimente les possibilités de transformation qui lui sont
offertes. Il ne retrouve pas sa vie dans la phraséologie trotskiste.
Il voudrait voir clair, rassembler d'une manière cohérente et ordon-
née les éléments de son expérience ; c'est à cette tâche qu'il voudrait
qu'on l'aide. D'une certaine manière, il sait tout, mais il ne sait pas
encore comment le dire, comme l'écrit en substance un camarade du
journal américain Correspondence.
Quand il veut la retraite à 55 ans, peut-être est-il aussi sceptique
que le camarade qui le réfute en lui expliquant qu'une telle mesure
est impraticable dans le système capitaliste ou que, si même il
l'obtenait, il n'en demeurerait pas moins un exploité, écrasé au
moment de sa retraite, et qui n'aurait gagné qu'un privilège au détri-
ment de ceux qui travaillent. Mais ce qu'il pense, sur la foi de son
expérience de la production moderne, c'est que le progrès technique
permettrait d'accorder cette retraite, qu'il ne faut pas lui en conter
sur l'éternelle misère et la nécessité des sacrifices.
Il connaît la production, parce que c'est lui le producteur. Non
seulement il sait trouver la parade individuelle chaque fois qu'on
cherche à lui extorquer plus de travail, mais il sait assimiler, inté-
grer toutes les nouvelles méthodes de production ; il a conscience
de l'accroissement de la capacité productive, il voit qu'il actionne
avec ses camarades des ensembles mécaniques de plus en plus com-
plexes et puissants. Certes, il sait que des techniciens ont été néces-
81
"saires pour les construire. Mais, qui donne vie à ces ensembles, par-
tout et toujours ? Qui se trouve à tous leurs embranchements, à
toutes leurs ramifications ? Qui en assure le fonctionnement ?
Les ouvriers savent, sans avoir besoin de consulter les statis-
tiques des exploiteurs, que le rendement augmente sans cesse et
qu'il augmenterait bien davantage sans l'exploitation et le gaspillage
qui en est inséparable. Ceux qui viennent parler, dans un langage
paternaliste, de la nécessité de nouveaux dirigeants, ne se rendent
pas compte de cette conscience ouvrière. Ils font autant preuve
d'imbécillité que d'hypocrisie. Et les ouvriers ne se gênent pas pour
faire comprendre à ceux qui s'amènent avec leurs histoires de partis
ouvriers qu'ils tombent de la dernière pluie. Tel était le sens de
l'intervention de Bourt, m'a-t-il semblé...
...Cette réunion nous a encore montré combien il était nécessaire
d'approfondir la notion de culture. Car celle-ci nous ramène à la
question des rapports intellectuels-ouvriers. En effet, à entendre K...,
le prolétariat ne peut rien sans que les intellectuels lui apportent
l'idéologie socialiste. Chaulieu avait montré, au contraire, dans son
article contre Sartre, que les intellectuels sont loin d'avoir le mono-
pole de l'histoire du mouvement ouvrier, et ceci pour deux raisons :
1° parce que les souvenirs des événements passés existent chez de
nombreux ouvriers d'un certain âge, qui se chargent de les propager
comme une trainée de poudre dans les moments décisifs ; 2° parce
que cette histoire existe, encore bien mieux résumée, condensée,
portant ses conclusions dans les structures mêmes auxquelles ont
affaire les ouvriers. C'est ainsi que la transformation du syndica-
lisme en bureaucratisme est une évidence, même pour un Os illettré
de vingt ans. Et c'est pour cette raison que les moyens de lutte
futurs tiendront implicitement compte de l'expérience passée. Peu
importe qu'un ouvrier sache qui était Trotski et ce qui le différencie
de Staline, ce qui compte pour lui, c'est que la production moderne
contient la bureaucratie exploiteuse et qu'on ne peut lutter contre
elle comme on luttait contre la précédente direction,
...Rien n'est plus urgent, à l'étape actuelle, que la classe explicite
sa propre culture, qui n'est certes pas livresque, mais qui est infi-
niment plus riche que ce que peuvent connaître les groupes révo-
lutionnaires à eux seuls. Il faut reconnaître que nous sommes arrivés
aujourd'hui à un plafond dans notre connaissance purement théo-
rique et que nous ne pouvons progresser que par cette immense
expérience que peuvent seuls formuler des millions d'ouyriers rom-
pant le silence. C'est cette tâche qui nous attend et qui est vrai-
ment nôtre : faire parler les ouvriers et apprendre d'eux plutôt que
de faire, une fois de plus, les professeurs de révolution.
...Les intellectuels peuvent aider les ouvriers. Mais il ne faut
pas oublier qu'ils sont au moins autant, sinon plus, aliénés qu'eux
: 1° ils travaillent encore largement sur le mode artisanal ;
2° ils sont constamment dans le bain de la classe dominante qui les
déprime peut-être davantage encore que les ouvriers, car c'est sur
leur cerveau qu'elle agit ; 3° ils sont constamment tentés par l'évasion
« arriviste ». Les intellectuels doivent être donc modestes, ils ne
jouent qu'un rôle de catalyseur dans la révolution. Rien de plus.
L'émancipation est et restera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes.
C'est encore une forme d'aliénation de croire à la toute-puissance
des théories et des concepts. Ce n'est qu'en communiquant étroite-
ment avec l'expression ouvrière que les intellectuels peuvent être
utiles, et c'est bien le sens qui se dégageait en définitive de la
réunion.
car
82
LA PRESSE OUVRIERE
Nous avons déjà publié dans nos numéros précédents des extraits
du journal ouvrier américain « Correspondance » (N" 14, p. 74 à 79)
et du journal publié par un groupe d'ouvriers de la Régie Renault
* Tribune Ouvrière » (N" 15-16, p. 71 à 82). Les textes ci-dessous aide-
ront nos lecteurs à se faire une idée plus précise du caractère et de
l'orientation de ces journaux.
LE PROBLEME DE L’AUTOMATISME.
(« Correspondence », 8 janvier 55).
L'automatisme et ses conséquences font le thème de nombreuses
discussions parmi les ouvriers, les chefs syndicaux et les capitalistes
Chacun y est intéressé à sa façon et s'efforce de savoir en quel
sens il en sera affecté. Les travailleurs ont acquis une longue expé-
rience des transformations techniques de la production. Ces trans-
formations ont toujours signifié chômage, accélération des caden-
ces, perte du contrôle sur le travail, destruction de l'habileté tech-
nique, domination accrue de la machine et de la chaîne d'assemblage
dans la vie d'usine.
Du fait du renouvellement constant des modes de production, tes
capitalistes ont été à même d'élever monstrueusement la producti-
vité. Mais la classe ouvrière a payé un prix terrible pour ces pro-
grès qui, tous, furent réalisés à ses dépens.
PAS DE BENEFICES AUTOMATIQUES.
La classe ouvrière n'a pas bénéficié automatiquement de l'accrois-
sement de la productivité. Les ouvriers ne furent pas seulement
les premiers et même les seuls à souffrir de ces changements, mais
ils furent les derniers à en retirer quelque avantage.
L'accroissement du niveau de vie, la journée de huit heures et
les autres progrès furent, acquis seulement à la suite de longues et
dures batailles. Les travailleurs ne se font pas d'illusions quant
aux intérêts que poursuivent les capitalistes, ou à ce qu'on peut
espérer d'eux. Le vrai problème est celui de la bureaucratie syndi-
cale. Que peuvent en attendre les ouvriers ? Il est très instructif
que les dirigeants syndicaux fassent grand bruit autour de l'auto-
matisme.
83
LES DIRIGEANTS SYNDICAUX.
Il est excellent qu'ils pensent à l'avenir et s'interrogent sur
un problème qui se posera dans quelques années. Tout serait pour le
mieux si les travailleurs n'étaient déjà aux prises avec : un pro-
blème tout aussi pressant, et le problème de l'automatisme ne sert
qu'à obscurcir celui auquel les ouvriers ont à faire face dans le
présent.
Il est aussi utilisé pour diviser la classe ouvrière et pour créer
les bases indispensables à la bureaucratie syndicale parmi les tra-
vailleurs, en offrant un appât, un espoir, une perspective aux ouvriers
qualifiés. L'automatisme signifie : le remplacement de milliers de
travailleurs à la chaîne par des centaines d'ouvriers spécialisés dans
l'entretien. L'automatisme n'est pas pour les ouvriers qualifiés une
mais un bienfait.
menace
LE CHOMAGE.
Le problème qui se pose est celui du chômage actuel. Et les pré-
visions indiquent qu'il ira en s'accroissant. Cette situation n'est
pas due à l'automatisme. Elle est celle à laquelle chacun s'atten--
dait quand le pays revint à l'économie de paix. Nous aurons fait un
grand pas vers la solution des problèmes les plus urgents quand les
ouvriers auront compris qu'ils ne peuvent compter sur la bureaucrar
tie syndicale. Quand cela sera devenu clair, et sera entré dans les
jaits, une nouvelle perspective sera ouverte aux luttes ouvrières.
LA BASE.
Il n'y a que trop longtemps déjà que lon a laissé les dirigeants
syndicaux traiter avec les employeurs en l'absence des ouvriers.
Dans le monde entier, les ouvriers ont appris à leurs dépens qu'on
ne peut faire confiance aux bureaucrates.
Cette année, quand les Reuther, et autres Macdonald négocieront
avec les patrons, ce sera la tâche des ouvriers, dans leurs syndicats,
que d'organiser leurs propres comités à la base pour défendre leurs
intérêts. Il n'y a pas d'autre voie.
GRIEFS ET RECRIMINATIONS.
« Correspondence », 22 janvier 1955).
On nous reproche fréquemment de publier des informations qui
ne sont, aux yeux de certains de nos amis et lecteurs, rien de plus
que des griefs et « récriminations ». Si les conditions de vie et de
travail qui sont décrites dans Correspondance ne constituaient
que des problèmes strictement personnels, ceux-ci ne seraient alors
que des « griefs et récriminations » et il n'y aurait aucun intérêt à les
publier. Il est tout à fait vrai qu'il y a des gens qui assomment
les autres avec leurs maux et leurs peines, auxquels aucun remède
ne peut être apporté. Et il n'y a rien de plus irritant et décevant que,
d'entendre continuellement quelqu'un gémir sur ses problèmes per-
sonnels.
LES PROBLEMES SONT SOCIAUX.
Cependant les griefs et récriminations que correspondance publie
ne sont pas de ceux qui sont particuliers à telle ou telle personne.
Quand des millions de travailleurs expriment les mêmes récrimi-
nations envers leur travail, le contremaître, le syndicat et la compa-
gnie, ce ne sont plus là des récriminations : cela devient un pro-
blème social. Ces griefs et récriminations n'affectent plus seulement
84
tel ou tel individu, mais intéressent toute la société.
Quand les problèmes du mariage, de la famille, de l'école, se
posent fondamentalement de la même manière à des millions de
personnes, ce n'est plus une affaire personnelle, mais une question
qui intéresse chacun de nous.
ATTITUDE ENVERS LES QUESTIONS ESSENTIELLES.
Autrefois, la poliomyélite était une maladie rare et en général
on la regardait comme une affaire personnelle. Aujourd'hui, en rai-
son de son extension, de sa fréquence, on n la considère plus comme
telle. La poliomyélite est devenue un problème social essentiel.
Il en est de même pour les griefs et récriminations que nous
publions, ils nous intéressent dans la mesure où ils concernent des
millions de gens dont dépend le bien-être économique et social du.
pays.
Et ces griefs et récriminations ne sont pas futiles. A travers eux,
se manifestent des attitudes envers les questions essentielles du jour :
production, libre entreprise, guerre, paix, dépression.
UN BUT DEFINI.
Finalement tout ceci a un but précis. L'organisation du C.I.O.
n'est pas tombée du ciel ou de l'imagination de J.-C. Lewis.
Ce sont les conditions de vie et de travail qui existaient anté-
rieurement au C.1.0. qui déterminèrent l'allure et la structure de
l'organisation que les travailleurs s'efforcèrent de créer pour résoudre
leurs difficultés et satisfaire à leurs récriminations.
Il en sera de même dans le futur. La prochaine tentative des
ouvriers pour créer une organisation propre à résoudre leurs pro-
blèmes sera largement déterminée par la nature des problèmes exis-
tants. Ni Correspondance, ni personne ne peut le faire à la place
des travailleurs. Mais ce sont les travailleurs eux-mêmes qui doivent
le réaliser. Au mieux, tout ce que nous pouvons faire est de four-
nir à la condition ouvrière l'occasion de s'exprimer.
OUVRIERS ET INTELLECTUELS.
(« Correspondence », 5 février 1955).
Il n'y a pas d'animosité contre l'activité intellectuelle dans la
classe ouvrière considérée dans son ensemble, même si certains élé-
ments s'efforcent de susciter un sentiment anti-intellectuel, dans le
hut de désorienter les ouvriers et de leur imposer leurs lois réaction-
naires. En fait, John L. Lewis, président du Syndicat des Mineurs,
s'est écarté de sa route habituelle pour faire étalage de ses capacités
intellectuelles devant les mineurs. Ce qui me fait penser que Lewis
reconnaît qu'il existe chez les mineurs un respect réel et même une
estime pour l'intelligence. Et, dites-moi, qui connaît mieux les mineurs
que Lewis ? Le conflit entre les intellectuels et les ouvriers ne naît
pas d'une animosité contre l'activité intellectuelle. Bien au contraire:
c'est le manque de rigueur intellectuelle chez l'intellectuel qui est à
la source du confiit.
Les travailleurs ne « pensent rien » des intellectuels, parce que ce
n'est pas là leur problème, mais un problème que les intellectuels ont
à résoudre eux-mêmes.
Tout mouvement de masse de la classe Ouvrière voit venir à lui
des individus originaires de toutes les classes de la société. La tâche
première d’un individu issu d'une autre classe et qui rejoint le
mouvement ouvrier, est d'oublier résolument son possé et de s'iden-
85
tifier et de s'adapter parfaitement à la classe ouvrière. Dans la
mesure où l'intellectuel y parvient, tout conflit entre intellectuels et
ouvriers disparait.
Le conflit surgit lorsque un intellectuel ne parvient pas à com-
prendre le mouvement ouvrier. La fonction d'un intellectuel est
d'aider le mouvement, et de mettre ses capacités intellectuelles à la
disposition des ouvriers.
Un intellectuel vient à la classe ouvrière parce que l'avenir dépend
de celle-ci. Sa tâche est de contribuer à la réalisation de cet avenir.
Ce n'est que lorsque l'intellectuel se présente lui-même comme un
obstacle sur la route de l'avenir que se développe le conflit entre
ouvriers et intellectuels.
ENCORE SUR LE TRAVAIL AU RENDEMENT.
< Tribune Ouvrière »
Extraits du N° 6 (Novembre 1954.)
Dans le dernier numéro de notre journal, un camarade a posé
le problème des cadences. En conclusion, l'article oppose à la dimi-
nution des cadences la suppression pure et simple de celles-ci. D'un
autre côté, l'article affirme que ce sont les ouvriers qui doivent
déterminer les temps, et non les chronométreurs qui n'en seraient
pas capables.
Il faut d'abord s'entendre sur le terme de cadences. Si l'on veut
parler d'un rythme de travail qui est imposé à une chaîne de pro-
duction d'O.S., cela signifie quelque chose. Mais si l'on parle du
travail au rendement en général, cela ne veut plus rien dire du
tout. On nous parle de cadences dans des cas où, il ne s'agit
en fait que du travail aux délais chez les outilleurs.
QUELLE EST D'ABORD LA SITUATION DANS L'USINE ?
Pour 90% des cas, le travail au rendement n'est qu'une mysti-
jication pure et simple; car si après la libération les patrons, avec
l'aide des syndicats, ont voulu étendre le système du salaire au
rendement à la totalité des ouvriers sur machines et jusqu'aux
employés, ils le firent pour obliger l'ouvrier à travailler plus inten-
sément. Ils généralisèrent ce système pour faciliter la tâche de la
maîtrise qui n'avait plus aucune autorité et pour obliger l'ouvrier
à accepter lui-même d'accélérer son travail, en lui faisant croire
qu'il gagnerait davantage. Le travail au rendement est en fait un
contremaître derrière chaque ouvrier, accepté par celui-ci.
On s'aperçoit aujourd'hui, après dix années d'expériences, que
nous avons travaillé de plus en plus vite, que cela continue en
s'aggravant, et que nos salaires n'en sont pas augmentés pour
autant. De plus, ce système n'est même plus réalisable. Pourquoi ?
1° Parce que dans les ateliers de production la plupart des O.S.
n'ont pas de tâches individuelles, mais doivent fournir la
quantité de pièces lancées dans la chaîne et suivre le rythme
des machines.
2° Parce que le déplacement fréquent des ouvriers dans la pro
duction des ateliers n'a pas permis de comptabiliser chaque
pièce qu'ils font.
Petit à petit, les O.S. sont passés du boni individuel au boni
collectif.
Il y a, dans les ateliers de production, un rythme de travail, une
intensité de travail, et c'est sur ce terrain que se situe la lutte.
Les ouvriers essaient par tous les moyens de s'opposer à l'accélération
86
des cadences. Il n'y a plus de rapport direct entre une quantité de:
travail et le salaire, car toute le monde est réglé à 145 90 dans ces;
ateliers de production.
Le but de la direction a réussi. Ce but était de faire réaliser".
90 minutes dans l'heuſe. Et ce sont les ouvriers qui ont permis cela,
en crevant les plafonds et en pensant ainsi gagner davantage. Ils
le firent surtout poussés par les syndicats en qui ils croyaient.
QUELS SONT LES OUVRIERS QUI TRAVAILLENT
EFFECTIVEMENT AUX DELAIS ?
En dehors des ouvriers et ouvrières du décolletage, les seuls qui
sont encore au boni individuel sont les P. 1, P. 2 et P. 3 travail : ;
lant à la fabrication de machines ou d'outillage. Ils sont au boni
individuel, car leur travail est un travail individuel.
Voyons d'abord le cas du décolletage. Nous trouvons là le pur:
système du travail aux pièces avec tous ses avantages et ses incon-
vénients. C'est-à-dire : il y a le bon et de mauvais travail, le bon
travail va toujours aux mêmes et le mauvais aussi. Ce régime est
tout à fait rentable pour la direction, celle-ci trouve des défen-
seurs acharnés du système parmi les ouvriers privilégiés qui règlent
à 160, 180 et même 200 pour cent. Les plafonds sont libres jusqu'à
200 pour cent, parce que c'est le moyen pour la direction de trouver
le plus juste temps pour réaliser une pièce et cela dans la concur-
rence que se livrent les ouvriers contre eux-mêmes. Comme de toute
jaçon, les salaires de base sont très bas, la direction a tout à
gagner avec ce système. De plus, le chronométrage révise périodique-
ment les temps et aussi périodiquement on change ies ouvriers.
Chez les outilleurs, la situation est plus confuse. L'objectif de
la direction est d'avoir une diversité totale des salaires pour dresser
les ouvriers les uns contre les autres. Nous avons d'abord les caté--
gories, souvent artificielles, et on voit des P.1. faire du travail de
précision pendant que des P. 3 font pendant des mois du travail
de fabrication de série. Ensuite, les temps sont beaucoup plus dif-
ficiles à établir et, en général, les chrono mettent des temps infé-
rieurs à seule fin de faire réaliser les temps par les compagnons. Il
restera que l'ouvrier qui a la cote sera payé, et les autres seront
coulés. Nous nous trouvons ici devant la mystification la plus fla-
grante, dans l'arbitraire le plus absolu, comme si l'on considérait
en haut lieu que le salaire qui est donné aux outilleurs était trop
fort et que le moyen de faire des économies consistait à poyer
les compagnons au mini.
En dehors des rts permanents que cela entraîne, il faut bien
dire que la qualité du travail s'en ressent, et souvent une pièce
de grande importance est sabotée parce que le compagnon veut la
réaliser dans le temps.
Nous nous trouvons devant deux problèmes distincts que l'on a
voulu lier ensemble.
1° le rythme du travail individuel ou collectif.
2° la mystification qui consiste à lier le salaire à une quantité
abstraite de travail.
LE RYTHME DU TRAVAIL.
Dans l'industrie moderne de production de masse, le rythme,
l'intensité du travail se sont considérablement accélérés ces der-
nières années. Dans le même temps, le travail, par sa division
même, perdait de plus en plus tout caractère intéressant. Le monde
moderne n'aura plus besoin que d'O.S., approvisionneurs de machi-.
87
nes, ou d'O.S. de la planche à dessin. Aujourd'hui comme demain,
dans une société socialiste, la tâche que l'on doit remplir pour la
société dans la grande production ne peut plus être un but en soi.
C'est en dehors du travail que l'homme commence à vivre. Mais,
pour qu'il puisse vivre, il faut que cette intensité du travail lui
permette de travailler un nombre d'heures toujours moindre. La
seule solution aux cadences c'est la diminution de la journée de
travail.
LA MYSTIFICATION DE LIER LE SALAIRE
A UNE QUANTITE DE TRAVAIL.
Le patronat ne paie pas une quantité de travail, il paie la
nourriture et le logis d'esclaves de qui il demande toujours le maxi-
mum. Tous les systèmes et particulièrement le travail au rende-
ment, ont pour but de faire travailler l'ouvrier le plus possible. Et
si, de nos jours, nous faisons 48 heures par semaine, c'est parce
que, avec le rythme actuel, L'HOMME NE PEUT PAS EN FAIRE
PLUS, car déjà avec ces 48 heures, il sort exténué de l'usine. Si le
patronat a développé les différentes formes de travail au rende-
ment, délais ou pièces, c'est parce que, toujours, il faut qu'il camou-
fle son exploitation par différentes justifications, et celles-ci consis-
tent à faire croire à l'ouvrier que plus il travaille, plus il gagne.
Le premier acte de résistance à l'exploitation consiste donc à
refuser cette idée et à affirmer que nous n'avons pas à entrer dans
ces considérations, mais exiger de travailler toujours moins d'heures
d'abord, ensuite de résister à toutes les tentatives d'accélération du
travail, MAIS SURTOUT NE PAS ACCEPTER QUE NOTRE PAYE,
QUI N'EST QU'UN MINIMUM, PUISSE ETRE AMPUTEE PAR
DES TOURS DE PASSE-PASSE. Nous n'avons pas à entrer dans
des calculs de temps, nous n'avons pas à accepter d'aider en quoi que
ce soit toute cette mystification, ce salaire minimum que nous tou-
chons ne peut subir aucun 'abattement, nous devons donc refuser en
bloc tous ces systèmes.
SUPPLEMENTAIRES
ET
LA
DIVISION
DES
LES HEURES
OUVRIERS.
Si tous les ouvriers refusaient de faire des heures supplémen-
taires, si tous les ouvriers refusaient même de travailler plus de
40 heures tout en exigeant la même paye, les patrons seraient bien
obligés de céder. Cela tout le monde est d'accord pour le reconnai-
tre, mais personne ou presque ne croit que cela est réalisable. Les
ouvriers pensent qu'ils ne réussiront jamais à s'entendre,
Pourquoi donc une telle méfiance ? Cette méfiance des ouvriers
entre eux n'est pas quelque chose de naturel. Il y a eu des périodes
où les ouvriers avaient confiance en leurs camarades ; si aujour-
d'hui ils ne l'ont pas, si beaucoup cherchent à se débrouiller seuls,
c'est qu'il y a une raison. Pendant des années, les politiciens ont
• dressé des barricades entre les ouvriers, les ont montés les uns
contre les autres pour leurs propres intérêts. Ils ont montré à la
classe ouvrière que l'ennemi n'était pas la classe sociale d'en face,
en faisant croire aux Bons Patrons et aux Bons Gouvernements.
La plupart du temps, les luttes revendicatives ont été trans-
formées en un pugilat de politiciens et déviées de leurs voies. Pendant
des années, les syndicats ont jeté les ouvriers les uns contre les
autres selon qu'ils croyaient en la Démocratie Russe ou en la Déma-
cratie Américaine, mais ils se sont tus sur le problème de la hiérar-
88
chie des solaires et des heures supplémentaires. Bien plus, ils ont
approuvé de telles choses.
Aujourd'hui, on s'étonne que les ouvriers acceptent de faire des
heures supplémentaires et ceux qui s'étonnent le plus sont souvent
ceux qui ont crié le plus fort pour en faire. Aujourd'hui, les syn-,
dicats ne disent même plus aux ouvriers de refuser ces heures
supplémentaires. Ils disent qu'il faut revenir à la semaine de 40 heu-
res mais à côté de cela ils font des revendications pour majorer
les heures supplémentaires (projet de conventions collectives).
C'est tout cela qui a jeté les ouvriers dans le désarroi et la
méfiance. Avoir confiance en qui, se demande-t-on, après tant d'ex-
périences malheureuses ? La plupart des ouvriers acceptent aujour-
d'hui de faire des heures supplémentaires, c'est pourquoi les syndi-
cats se taisent sur cette question. Etant donné qu'ils ne peuvent
plus se servir des ouvriers comme masse disciplinée, ils ne veulent
pas neurter ces ouvriers, en qui ils ne voient que des machines
à voter. Bien plus, ils n'hésiteront pas à flatter, à faire toutes les
bassesses, à tout pardonner à l'ouvrier qui acceptera de poser sa
signature au bas d'une pétition patriotarde.
Ceux qui acceptent de faire des heures supplémentaires se ser-
vent de ce prétexte. Mais la faute est d'autant plus grande des orga-
nisations qui ont permis à ces ouvriers de se retrancher derrière
cette excuse. Si tous ces prétextes n'existaient pas, les ouvriers ne
pourraient pas les utiliser. Si tout le monde n'avait aucune raison
de se méfier, il est probable que personne ne se méfierait. Pour que
les ouvriers aient confiance en eux-mêmes, il faut donc briser ce qui
les divise : lutter contre les désaccords politiques qu'entretiennent
les organisations syndicales ; lutter contre les différentes hiérar-
chies qui opposent les ouvriers entre eux. Ce n'est que dans ce
sens que l'on pourra lutter effectivement aussi bien contre les heu-
Tes supplémentaires, que contre tout ce qui écrase la classe ouvrière.
Ce n'est que de cette façon, que les ouvriers pourront regagner
la confiance en leur propre force, LA CONFIANCE EN EUX-MEMES.
PRIME A LA SOUMISSION.
.« Tribune Ouvrière »
Extraits du N° 7 (Décembre 1954.)
Depuis un certain temps déjà est apparu le mécanisme des
primes dites trimestrielles, et il n'est que de lire les modailtės
d'attribution de ces primes pour comprendre tout de suite l'inté-
rêt que la Direction en retire.
Plus question de prendre quelques jours de congé supplémen-
taires, soit pour rallonger les vacances, soit pour profiter d'un pont.
Au bout de cing journées d'absence, la prime entière saute. De plus,
une certaine initiative étant laissée à la maîtrise pour juger si lab-
sence est justifiée ou non, cela crée encore un système de faveur.,
La prime n'est pas encore distribuée que déjà l'annonce de la
prochaine est faite. Ce procédé est connu sous le nom de la carotte
de l'âne.
Dans le budget d'une entreprise, la part qui est réservée aux
salaires est toujours calculée au plus juste, mais il apparaît à la
Direction de la Régie qu'il est préférable d'en soustraire une partie
pour la distribuer sous forme de primes à des moments opportuns
tels que l'approche des vacances ou des fêtes de Noël.
Du point de vue de la Direction, l'effet provaqué par cette prime
apparait beaucoup plus profitable que si elle nous l'avait incorporée
chaque jour dans le salaire. 7.000 francs sur un an n'apparaît pas
89
beaucoup sur la somme touchée chaque quinzaine (de 250 à 300 fr.). Il
n'en reste pas moins que les primes sont parties intégrantes du
salaire. La preuve, c'est qu'elle sont assujetties à la Sécurité Sociale,
'qu'elles sont intégrées à la somme globale que nous devons décla-
rer pour impôt sur le revenu et que la Direction les fait figurer dans
son bilan au chapitre salaires,
M. Lefaucheux dans sa lettre, précise : « Vous avez travaillé
dans le calme », laissant entendre que s'il y avait eu grève, les
primes n'auraient pas été distribuées. Quel abus de pouvoir ! Quand
les ouvriers font grève, ce n'est pas par sport mais par nécessité.
Dans les nombreux mouvements qu'ils ont été contraints de faire
pour défendre leur niveau de vie, les ouvriers ont souvent posé
comme revendication essentielle le paiement des jours de grève. Or,
non seulement M. Lefaucheux entend ne pas payer les jours de
grève (car de son point de vue la grève n'est plus un sport si elle ne
comporte pas de risques), mais encore il prétend retenir la prime,
ce qui revient à taxer d'une amende le fait de grève. C'est là un
procédé absolument inadmissible, et de plus illégal.
Par son système de primes, M. Lefaucheux retire plusieurs avan-
tages :
10 il fait le généreux en prétendant nous donner un sursalaire,
alors qu'en fait il retient dans ses caisses pendant plusieurs mois
une partie de notre salaire dont il garde l'intérêt.
2º Il prend une assurance contre la grève et gardé par devers lui
des sommes importantes dues aux ouvriers, de manière à pouvoir
se payer des pertes qu’une éventuelle grève pourrait entraîner.
30 En hiérarchisant cette prime, il entretient la division entre les
différentes catégories d'ouvriers.
4º En présentant les primes comme une récompense du bon esprit
et de la docilité des ouvriers, il tente de les avilir pour mieux les
tenir à sa merci.
5º En décernant une partie du salaire sous forme de prime, il freine
l'émulation de la lutte ouvrière qui se crée lorsqu'une grosse i
usine obtient une augmentation.
Après dix heures passées à l'usine, aurions-nous encore un merci
à dire à notre bon patron, pour toucher ce qui nous est dù ? En
tout cas, ce qui serait dangereux pour nous, c'est qu'à cause des
primes, nous nous laissions entraver dans notre action contre l'ex-
ploitation, et que nous ayons davantage confiance en la « généro-
sité » de la Direction qu'en notre propre lutte.
DEUX GREVES AUX VILLEBREQUINS DE LA 4 CV.
Un enseignement pour l'avenir.
« Tribune Ouvrière »
Extraits du N° 8 (Janvier 1955.)
Pour assurer son programme de fabrication, la Direction a ins-
tallé dans l'atelier 76.40, chaîne des vilebrequins, des tours dénom-
més « 300 ». Ces tours exigent un effort particulièrement pénible
de la part des ouvriers en raison de leur conception mécanique
ancienne ; les temps donnés par les services de méthode sont de 16
dans l'heure.
Dans le mois de juillet 54, les ouvriers travaillant sur ces machi-
nes ont trouvé un ordre écrit, les invitant à effectuer 17,5 dans l'heure.
En réalité, il s'agissait pour la haute maîtrise de préparer le stock
nécessaire à l'augmentation des cadences des chaînes de moteurs. A
cet ordre, les travailleurs des tours « 300 » ont répondu par le refus.
Pour parvenir à ses fins, la maitrise utilise un ouvrier, sous menace
de licenciement : « 17,5 dans l'heure, dit-elle, ou la porte ». La
surprise de la Direction fut grande de voir que les travailleurs de la
chaîne (secteur calme et inorganisé) ripostent par un mouvement
de grève spontané, et cela huit jours avant les congés.
Il importe de souligner l'unanimité des deux équipes : pas d'ef-
forts supplémentaires, les temps sont durs à réaliser..
Devant les faits, la Direction devait répondre aux délégués :
« Dites aux ouvriers : restons-en là, 16 dans l'heure, reprenez le
travail, pas de sanctions ». Mais au retour des vacances, un chrono-
démonstrateur avait pour rôle de « démontrer » qu'il était pos-
sible d'effectuer 17,5. Un peu plus de 18 pièces ont été faites dans
l'heure devant les délégués. « Les travailleurs des tours 300 en font
16, et ils ont raison » a dit la C.F.T.C., « il serait anormal d'en,
faire plus, les délégués de la C.F.T.C. vous conseillent de continuer
à ne pas produire les pièces demandées, ils vous appuieront dans
votre action ».
« Tous unis, faisons échec aux cadences, » a dit la C.G.T. (voir
tract du 7-10-54 et du 8-10-54).
Forts de leurs droits, les travailleurs ont résisté : 16 à l'heure,
pas plus. Première sanction de la direction : baisse de 800 francs
sur la paie des ouvriers des tours 300, pression de la maîtrise, convo-
cation du personnel devant la Direction, mutation et licenciement
d'un ouvrier. Les travailleurs de l'atelier des Vilebrequins ont soutenu
leurs camarades. Une collecte apporte avec la preuve de leur soli-
darité l'argent que la Direction avait retiré sur la paie des ouvriers
des tours 300. Toutes ces manifestations ne faisaient pas l'affaire
de la Direction. Bien que les cadences augmentaient dans l'ensemble
de l'usine, le coefficient de paie des ouvriers du Vilebrequin, plus fai-
ble, poussa les ouvriers à réagir de nouveau par un refus collectif
en une solidarité la plus complète des trois équipes dans la grève.
Travaillez ou évacuez, a dit la maîtrise. Non, ont répondu les
ouvriers, nous ne sommes pas d'accord, nous resterons-là. Un huis-
sier fut introduit par la Direction pour constat du fait d’occupation.
des lieux. L'intimidation n'est pas du goût des ouvriers qui contien.
nent parfois mal leur colère. Puisse se faire qu'un jour ces' mes-
sieurs aient à répondre de cette servilité envers nos exploiteurs.
On entend des réflexions d'ouvriers d'autres ateliers : « Va-t-on
laisser torpiller les gars des Vilebrequins ? » La grève s'étend à deux
autres chaînes voisines, c'est la réponse. C'est aussi la réponse à votre
lettre de chantage, Monsieur Nion (directeur du personnel) ; vous
disiez que les travailleurs perdraient du fait de la grève 3.000 francs
sur leur prime à la v soumission ». Vous disiez aussi que l'occupa-
tion des usines était illégale et qu'il y avait des risques. Vous disiez
également que nous avions fait grève sans vous avertir (vous vous
faisiez fort des engagements pris par les syndicats).
Au deuxième jour, la grève piétine. Et pourtant la C.F.T.C. avait
dit « Travailleurs, nous soutiendrons votre action ». La C.G.T.
avait dit « L'action unie fera échec aux cadences ». Qu'ont-ils
fait ? Devant l'isolement, les ouvriers s'interrogent, le travail reprend
dans les chaînes voisines. Les régleurs de vilebrequins ont une entre-
vue avec la Direction. Les régleurs décident de reprendre le tra-
vail. s'ils font 17,5 dans l'heure au tour 300, la Direction leur prom
met 3 francs d'augmentation sur le taux de base et rappel.
D'autre part, on tiendra compte des pannes de machines sur
le nombre de pièces à livrer et un seul jour de grève sera retenu sur
:
:
91
la prime trimestrielle (soumettez-vous et nous vous paierons prime
à la soumission).
C'EST AINSI QU'AVEC LA CONVICTION PROFONDE D'AVOIR
ETE DUPES, les travailleurs ont repris les manivelles.
Les ouvriers qui ont encore confiance dans les organisations syn-
dicales ont pu constater une fois de plus que leur soi-disant appui
se résumait à RIEN... qu'à des promesses,
Les cadences, l'intensification de la production, les machines.
en mauvais état ne sont pas spécifiques à une seule chaîne. Mais les
syndicats font de tout cela des questions particulières d'atelier, ce
qui nuit à toute solidarité contre le système des cadences qui peut
être combattu par un refus généralisé de tous les travailleurs de parti-
ciper à l'intensification de la production du système capitaliste.
Cette lutte des vilebrequins s'est terminée par un échec. Mais
cet échec est plus riche d'enseignements que certaines victoires annon-
cées à grands sons de cloche par les syndicats ; telles que certaines
augmentations dérisoires données de la main droite et reprises de
la main gauche.
Cette grève nous a montré à nous qui l'avons vécue qu'il est
impossible de collaborer à tout cet ignoble système dans lequel les
syndicats ont contribué à nous enfermer. Cette grève nous a
tré que la seule chose valable est de poser le problème de sa des-
truction. L'IMPORTANT AUJOURD'HUI EST DE LE COMPREN-
DRE, demain nous pourrons frapper plus fort.
P.-S. La grève aujourd'hui est terminée, mais la répression
commence
1 régleur des vilebrequins est mis à la porte.
1 autre déclassé.
1 ouvrier est muté.
4 ouvriers sont cités en justice pour... violation de domicile.
Voilà les échecs que nous ont rapportés des ouvriers qui ont
vécu la grève.
mon-
:
reconnu
LE ROLE DE LA DIRECTION ET DES SYNDICATS A L'ATELIER
DES « VILEBREQUINS ».
Nous avons dit que l'exemple des ouvriers des vilebrequins, bient.
qu'il ait échoué, est riche d'enseignemnts. Cela en effet veut dire
plusieurs choses.
Après la libération, une assemblée de farceurs qui existe tou-
jours, a mentionné dans la Constitution que le droit de grève étaiti:
comme légal. Aujourd'hui, des ouvriers des vilebrequins
viennent d'être renvoyés parce qu'ils ont fait grève. On a le droit
de grève, oui, mais pas le droit de rester à sa machine. Il faut quit-
ter les lieux du travail. Dans ces conditions, la Direction n'a rien
à craindre, elle peut faire évacuer un atelier en grève et embaucher
d'autres ouvriers, pour faire marcher les machines. Comme il s'agit
là d'ouvriers spécialisés qui peuvent faire le travail sans appren-
tissage, la direction agit avec beaucoup plus de désinvolture qu'avec
des ouvriers qualifiés que l'on remplace plus difficilement. Si la
Direction conserve encore quelques égards vis-à-vis des qualifiés,
par contre elle traite les O.S. comme des parias et cette différence
d'attitude a le but aussi d'empêcher la solidarité de tous les ouvriers.
Car c'est la solidarité ouvrière que craint le plus la Direction,
c'est pourquoi elle donne à chaque catégorie, chaque chaîne, chaque
atelier un statut différent. Ici, c'est le travail au délai qui brime les
uns et favorise les autres, là c'est le système du boni collectif, là
92
les cadences sont dures, ici elles sont plus douces. Ici ce sont des
O.S. qui touchent des primes (prime de chaleur, prime d'huile,
etc...), là des O.S. qui n'en touchent pas. Ici ce sont des profession-
nels outilleurs, là des professionnels de fabrication qui font le même
travail, là ce sont des professionnels au mois,
Elle prépare maintenant une accentuation de cette différencia-
tion entre ouvriers d'une même catégorie en créant « les études
de Poste ». Ainsi à l'atelier d'outillage central il existe un fichier
où le travail de l'ouvrier est soigneusement enregistré, (le nombre de
pièces loupées ou en litige, etc...) ; au bout d'un certain temps la
direction pourra ainsi en se basant sur le travail, la « moralité » et
la bonne conduite de l'ouvrier lui augmenter ou diminuer son salaire.
La Direction qui a besoin de plus en plus d'ouvriers dans ses
usines compense le danger de la concentration de cette force par
une hiérarchisation de plus en plus poussée. Mais les syndicats n'y
peuvent plus rien car eux aussi s'appuient sur ce cloisonnement, c'est
eux qui non seulement ont accentué avec la Direction cette hiérara
chie mais limitent tous les problèmes aux questions de revendica-
tions particulières.
En 1953, l'atelier des chaînes de montage de la 4 CV. se mettait
en grève. Les syndicats prétendaient qu'il s'agissait d'un problème
particulier à ce département. Quel avait été le résultat ? Lock-out
et échec de la grève. Le mois dernier c'était aux Vilebrequins où
les syndicats ont fait de ce mécontentement un problème particulier.
Demain, il y aura des ouvriers qui se battront contre les cadences'
ou les délais de leur atelier, la Direction accordera aux uns, refu-
sera aux autres selon qu'elle jugera sa force. Mais en 1953, comme
hier, comme demain, il ne s'agit pas d'un problème particulier, il
s'agit d'un problème général. Il paraît que le syndicat est l'orga-
nisme qui a pour fonction de coordonner l'action des ouvriers. MAIS
QUI A ENTENDU PARLER DE LA GREVE DES VILEBREQUINS
EN DEHORS DE CET ATELIER ?
Qui sait que les lettres envoyées aux ouvriers parce qu'ils n'avaient
pas évacué l'Usine ne sont pas du tout des lettres de chantage mais
que l'infraction aux règlements sera sanctionnée ?
Qui sait que la Direction s'est servie de mouchards qui, pendani
la grève, ont détecté les «
» pour qu'ils soient congédiés
aujourd'hui ?
Mais pour ces « chers syndicats » il ne s'agit là que d'une chose
hien banale. D'abord la majorité des ouvriers qui ont fait cette
grève ne faisait partie d'aucune boutique syndicale, et pour cause.
Puis ce sont des ouvriers qui se sont battus ainsi contre les caden,
ces, contre la production. Pour les syndicats se battre « ainsi » est
tout à fait secondaire. Ah, s'il s'agissait d'une grève pour aller
s'incliner devant « nos députés » on en aurait certainement beau-
coup plus parlé.
Nous croyons que le principal obstacle qui se dressait devant
les ouvriers était leur division et leur isolement des autres chaînes et
des autres ateliers. Ils ont réussi à vaincre déjà une division qui a
été créée par les syndicats, c'est la division politique. Et c'est cena
tainement parce que les syndicats n'avaient pas d'influence dans
le coin que cette division politique des ouvriers n'a pas joué.
Ils ont aussi pris l'initiative spontanée de s'organiser eux-mêmes
pour cette grève, ce, en quoi ils ont montré qu'ils étaient capables
de se passer des bureaucrates syndicaux. Mais ils n'ont pas pu bri-
ser leur isolement, ils n'ont pas pu en informer les autres ateliers,
les autres chaines, ils n'ont pas pu faire jouer la solidarité sur
meneurs
1
93
l'échelle de toute l'usine. Là, ils se sont heurtés au grand mur de
silence que l'on a dressé entre nous et dont les syndicats se sont
faits complices.
Les délais, les cadences, c'est le problème de tous les jours
pour la majorité des ouvriers, c'est le problème commun à tous.
Pour la direction, il n'y a qu'un problème : accentuer les cadences,
diminuer les délais. Pour les ouvriers, il n'y a aussi qu'un pro-
blème : diminuer les' cadences, augmenter les délais. C'est cette
cohésion et c'est cette coordination que nous voudrions faire avec
notre journal. Ce serait déjà un premier pas. Il faut que ceux qui
se bagarrent contre les cadences dans leur coin, sachent qu'ils ne
sont pas seuls à le faire et qu'il y a eu l'exemple des ouvriers des
Vilebrequins.
SPECTACLE CHEZ RENAULT.
« Tribune Ouvrière >>
Extraits du N° 10 (Mars 1955.)
Ce fut grandiose le 19 février 1955, les représentants du gouver-
nement célébrèrent la mémoire de feu notre Directeur général. Il y
avait là présents, depuis les célébrités youvernementales : ministres
et généraux jusqu'au manoeuvre à moins de 40.000 francs par mois
en passant par les délégués des syndicats dits « libres ».
Il fallait pour que le tableau soit de bon yoût un ouvrier qui
porte le drapeau tricolore. Le Syndicat F.O., toujours avide de char-
ges officielles, fit brandir l'emblème de notre exploitation par un
de ses représentants.
Que ce fut grandiose dans cette Ile Seguin, où juste à la même
place en 1945, une cérémonie aussi solennelle et aussi tricolore avait
présenté le même Directeur général aux ouvriers. Les discours étaient
prometteurs et pleins d'optimisme, celui qui présidait la cérémonie
d'alors était de plus un ministre communiste, Marcel Paul qui avait la
confiance des ouvriers et qui faisait confiance à Lefaucheux. L'usine
devait être celle des ouvriers : fini le bagne Renault ; une ère de pros-
périté était annoncée.
En 1955, M. Grillot se promet de continuer cette ère de prospé-
rités, mais, cette fois-ci dans le choeur qui, célèbre la grande cuvre
de Lefaucheux les communistes ne sont pas présents. Ils boudent
la direction qu'ils avaient tellement encensée et celui dont ils avaient
fait un membre éminent du Comité FRANCE-U.R.S.S., celui qu'ils
avaient tellement aidé de leur propagande et de leur politique.
La Direction a présenté aur' ouvriers l'oeuvre de Lefaucheux comme
une cuvre personnelle, les Communistes et la C.G.T. aussi.
Etait-il bon ? Etait-il mauvais ?
Le Gouvernement l'a présenté comme « bon » et il avait raison.
Il a fait prospérer la Régie, réalisé des bénéfices qui ont alimenté
les caisses de l'Etat. Mauvais Lefaucheux ? Et pourquoi donc, il a
rempli le rôle de Directeur d'une usine capitaliste.
Lefaucheux était un rouage de cette grande machine qui sert à
nous exploiter, dans ce sens il était socialement notre ennemi. Lefau-
cheux n'était ni plus grand, ni plus petit que les autres, c'était un
Directeur comme il y en a eu et comme il y en aura.
La propagande de la Direction essaie de nous présenter la Régie
comme une grande famille. Le « Patriotisme Renault » est inculqué
aux ouvriers. On leur fait croire qu'ils gagnent plus que les autres,
qu'ils sont plus heureux, qu'ils ont des clubs sportifs plus forts, une
organisation meilleure... etc... Comme dans toute famille on place
à la tête un père responsable. Cę père, cet emblème qu'a été Lefau-
cheux, père bombardé de qualités qu'il avait et qu'il n'avait pas. On
94
a fait croire aux ouvriers que ce père prodigue se donnait beaucoup
de mal pour nous trouver du travail. Qu'avait-il d'autre à faire ?
Mais ce qu'il nous donnait si charitablement, n'était-ce pas juste-
ment pour nous le voler ? Si on ne nous donnait pas de travail, com-
ment paierait-t-on les inutiles ? Comment entretiendrait-on une
armée ? Avec quel argent vivraient les ministres et les généraux qui
sont venus verser leur larme de remerciement à un homme qui a
bien administré cette mine d'or que représente pour eux la Régie.
Mais dans tout cela les ouvriers qu'avaient-ils à remercier ?
On a fait croire aux ouvriers que c'est grâce à Lefaucheux que
nous recevions des primes. Mais dans toutes les usines les ouvriers
reçoivent des primes. Lefaucheux, comme les autres patrons, préfé-
rait le système des primes au salaire fixe, et nous savions pourquoi.
Si nous avons les salaires aussi élevés que dans beaucoup d'usines,
plus élevés que dans d'autres, n'est-ce pas parce que nous avons un
peu lutté pour cela ?
Le fait que nous sommes plus de 40.000 ouvriers dans une usine
qui rapporte, n'est-ce pas une raison suffisante pour nous ménager ?
Pour justifier que nous sommes tous d'une même famille, la Direc-
tion a tenu à faire participer les ouvriers à cette cérémonie. En
dehors des larbins porte-drapeau qu'elle peut puiser à profusion, ceux
des syndicats qui lui sont dévoués, il lui fallait un appui véritable
des ouvriers : c'est pourquoi elle organise une collecte. Elle fixe à
dix francs par ouvrier l'hommage à Lefaucheux. Dix francs, c'était
un piètre hommage pour une si « grande peuvre », mais dix francs
c'était le symbole et le plébiscite de l'adhésion des ouvriers à leur
exploitation.
Un Directeur est mort, un autre le remplacera. Comme le pré-
cédent l'appareil de direction essaiera d'en faire un emblème. Mais
comme le précédent, grand ou petit, le Directeur ne donnera des
augmentations que si les ouvriers l’y obligent. Il ne resserrera la
discipline que si les ouvriers l'acceptent. Il ne vendra ses voitures
que si les marchés internationaux le permettent.
Devant ces problèmes le Tout puissant Directeur, n'est qu'un
jétu de paille moins fort que l'ensemble des ouvriers et prisonnier
lui-même d'un système dont il n'est qu'un exécutant docile.
LE TRAVAIL ET LA MORT
Depuis que je travaille dans mon atelier, quatre de nos cama-
rades sont morts. Le premier était juste sorti de l'apprentissage, il
avait travaillé deux ans, puis mobilisé en Algérie il eut la polio-
myélite et mourut.
Le second était lui aussi très jeune et c'est à son retour du Ser-
vice qu'il mourut. En effet de retour au travail, il se marie et seulement
quelques mois après sa libération il fut appelé un jour à aller faire une
période. La veille de son départ, sa femme fit un gâteau pour le lende-
main, mais ils ne le mangèrent jamais car ils demeuraient dans une
maison si vieille et avec des tuyauteries en si mauvais état, que dans
la nuit une fuite de gaz les asphyxia tous les deux.
Le troisième était un vieux compagnon de l'atelier, il avait tra-
vaillé toute sa vie très durement, fait des heures supplémentaires,
n'avait jamais manqué un jour. Depuis quelques années il avait
réussi à avoir une petite maison pour laquelle il avait tout sacrifié,
il venait juste de s'acheter une 4 CV, et il comptait les mois pour la
retraite, mais d'un seul coup l'usure de sa vie de labeur le terrassa,
et il mourut.
Notre quatrième camarade est mort cette semaine. Il avait tra-
95
vaillé toute sa vie, jusqu'à 67 ans, il fit deux années supplémenta
res pour arriver à toucher vingt années de retraite aux Usines Renaul
toute sa vie il avait économisé pour avoir sa petite maison et que
ques années de tranquillité. Il voyait l'avenir sans trop de difficu.
tés, ayant la retraite de la S.S., la, R.L.S. Renault et quelques éco
nomies, c'était en tout : 25.000 fr. par mois. Il me disait : « Nous n
mangeons pas de viande tous les jours mais j'ai le moyen de boir
tous les jours mon apéro ». Un an et demi après sa retraite į
mourut. Les copains ont pris sa mort avec fatalisme : « Quand oi
s'arrête de travailler, on se laisse aller, on n'a plus de hut, alor
on s'éteint ».
Le travail, pour l'ouvrier, c'est toute sa vie. Il n'a jamais fai
autre chose et n'envisage pas de faire autre chose. Le travail est s
dur, si long, que lorsque nous en sortons nous n'avons plus le cou:
rage de faire, de nous intéresser à autre chose. C'est pourquoi ži
est si difficile que nous arrivions collectivement à sacrifier nos heu.
res de loisirs, à prendre notre sort en mains, à étudier nos problè-
mes et à agir pour notre émancipation. Mais le vrai problème est
sans doute de savoir comment nous, qui travaillons toute notre vie
derrière les machines, nous arriverons malgré cela à vivre comme
des hommes et non pas seulement comme de simples automates
qui, lorsqu'ils sont usés, n'ont plus qu'à mourir.
Il y a là trois problèmes :
1" Le temps de travail qui est sans doute la question la plus impor-
tante car si nous avions plus de temps à nous, nous aurions la possi-
bilité de faire AUTRE CHOSE dans notre vie que de travailler. C'est
d'ailleurs le cas des intellectuels bourgeois, voyons Claudel qui vient
de mourir : il a travaillé (comme ambassadeur) mais il avait à côté
de son travail, qui n'était sans doute pas très fatigant, une seconde
activité ; et celle-ci était bien aussi importante que son activité pro-
fessionnelle. C'est sans doute pour cela et aussi avec l'usilre en moins,
qu'il a pu vivre jusqu'à près de 90 ans.
Lorsque l'ouvrier arrête son travail à 65 ans, il n'a plus rien
car le travail ne lui a pas laissé le temps de faire autre chose que
de récupérer par des distractions faciles et par le sommeil la fatigue
quotidienne. Et lorsque nous nous trouvons devant les heures sup-
plémentaires, il ne faut pas seulement penser à la fatigue supplémen-
taire que cela représente dans l’immédiat, mais surtout que c'est,
pour les multiples raisons citées, une abréviation de la vie.
2° Le rythme du travail est devenu si intense dans notre produc-
tion, que ce n'est pas 48 heures que nous devrions travailler, même
pas 40, mais seulement 20. Cela est possible étant donné le dévelop-
pement de la productivité humaine, et c'est dans ce sens que nous
sommes de nos jours plus exploités que les "esclaves de l'antiquité.
3° Mais si nous voulons vivre plus longtemps, il faut que nous
ayons d'autres activités, d'autres buts dans la vie, et parmi ces acti-
vités il y a sans doute tout ce qui est effort manuel ou intellectuel,
notamment l'activité de l'homme vers la réalisation d'une société dans
laquelle il aurait la possibilité de s'intéresser à l'organisation de l'amé-
lioration de son sort et de celui de tous ses frères.
Un de nos camarades est mort dans l'inutilité de l'armée, l'autre
dans la misère de l'habitation, le troisième dans l'usure au travail,
et le quatrième dans l'impossibilité après une vie de labeur, de pou-
voir profiter pleinement de la vie ; car, trop fatigué et sans ressort,
il n'avait plus la force de recommencer à vivre.
Avis à ceux qui n'ont jamais assez d'heures supplémentaires à
faire.
- 96
SOMMAIRE
I
26
49
61
Sur le contenu du socialisme, par Pierre CHAULIEU
Le problème du journal ouvrier, par D. MOTHE
DOCUMENTS :
La vie en usine, par G. VIVIER
DISCUSSIONS :
L'unité syndicale, par Henri FÉRAUD
NOTES:
La nouvelle diplomatie soviétique, par Claude MONTAL.
Les livres : Le mouvement ouvrier en Amérique latine,
de V. Alba, par F. LABORDE
La réunion de lecteurs de Socialisme ou Barbarie
La presse ouvrière : Extraits de Correspondance et de
Tribune Ouvrière
66
72
78
83
Tous les lecteurs de la Revue sont fraternellement
invités par notre groupe à la
REUNION PUBLIQUE
organisée le
VENDREDI 8 JUILLET 1955
à 20 h. 30
AU PALAIS DE LA MUTUALITE
(Métro Niaubert-Mutualité)
LA SALLE DE REUNION SERA AFFICHEE
AU TABLEAU
A l'ordre du jour :
LE PROBLÈME DU JOURNAL OUVRIER
SOPRECO
24, rue de Ménilmontant