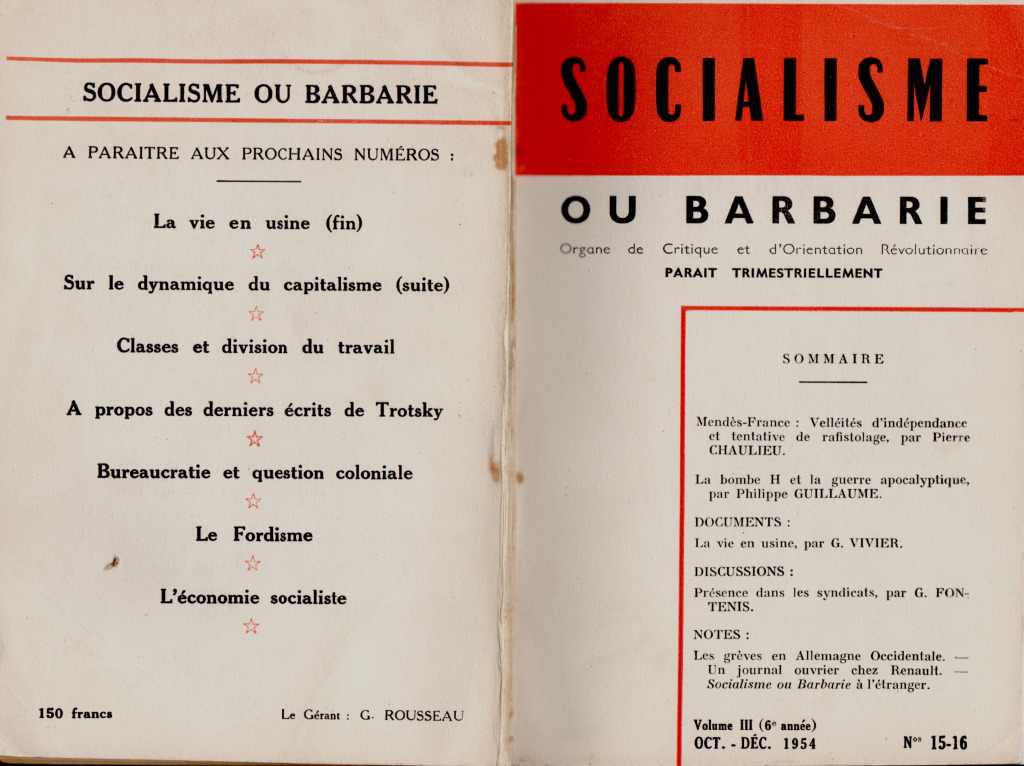CHAULIEU, Pierre: Mendès-France: Velléités d'indépendance et tentative de rafistolage 15-16:1-21 = FR1954E
GUILLAUME, Philippe: La bombe H et la guerre apocalyptique 15-16:22-43
DOCUMENTS:
VIVIER, G.: La vie en usine (IV) 15-16:44-59
DISCUSSIONS:
FONTENIS, G.: Présence dans les syndicats 15-16:60-65
NOTES:
GARROS, André: Les grèves en Allemagne occidental 15-16:66-71
Un journal ouvrier chez Renault 15-16:71-82
Socialisme ou Barbarie à l'étranger 15-16:82-83
ANNONCE: Réunion publique 15-16:[84]
SOMMAIRE: 15-16:[85]
À PARAÎTRE AUX PROCHAINS NUMÉROS
Socialisme ou Barbarie - NO. 15-16 (OCTOBRE-DÉCEMBRE 1954)
Table des matières
SOCIALISME OU BARBARIE
Parait tous les trois mois
9, rue de Savoie, Paris VI
Ne pas envoyer de mandat
sans écrire auparavant.
Comité de Rédaction :
P. CHAULIEU
Ph. GUILLAUME A. VEGA
Gérant : G. ROUSSEAU
LE NUMERO
150 francs
ABONNEMENT UN AN (4 numéros)
500 francs
Import
SOCIALISME
OU U BARBARIE
Mendès-France : Velléités d'indépendance
et tentative de rafistolage
Rien n'est plus caractéristique de l'impuissance et du ridi-
cule de la "gauche” française que les clameurs triomphales
qu'elle a poussées à l'arrivée de Mendès-France à la prési-
dence du Conseil. Comme l'expliquait M. Martinet dans
France-Observateur, on savait bien que le gouvernement Men-
dès-France ne pouvait être qu'un gouvernement bourgeois
el que sa tâche ne pouvait être que d'essayer de consolider le
capitalisme français — mais, précisément, la "gauche” se doit
d'appuyer un “bon” gouvernement bourgeois ; seul un tel gou-
vernement peut dissiper la confusion actuelle, qui empêche
le mouvement populaire d'avancer. Il est vrai que nous autres,
la gauche française, sommes minables, dit à peu près M. Mar-
tinet, mais est-ce notre faute ? Regardez la pourriture de la
politique bourgeoise, et rappelez-vous qu'un pays ne peut avoir
que la gauche de sa droite. La conclusion de cet éminent tac-
ticien, formulée dans le style d'Archimède, serait en gros
celle-ci : donnez-moi un bon gouvernement de droite, et je
ferai remuer la terre de France.
Cette argumentation de Gribouille traduit en fait la vérita-
ble idéologie des intellectuels “de gauche" en France. Ceux-ci
ne reprochent pas au capitalisme français d'être du capitalisme,
mais d'être du mauvais capitalisme, incohérent, pourri, sta-
gnant et servile face aux Américains. Cette motivation agit
d'ailleurs également chez une foule d'intellectuels pro-stali-
niens. La bureaucratie russe, classe exploiteuse ? Peut-être ;
mais elle développe la production - tandis que la production
française stagne; sa politique extérieure est brutale, elle impose
une tutelle impérialiste à une série de pays ? Soit, mais elle
le fait en vertu d'une politique à long terme tandis
que la
bourgeoisie française est incapable d'avoir même une politi-
1
que instantanée ; elle exerce une dictature policière, écrase
toute opposition ? Admettons ; mais elle est dirigée par des
hommes de fer, tandis que les ministres français ont “des nerfs
de fille" et "s'évanouissent à la tribune" (1).
On comprend donc le printemps d'espérance qui s'est levé
dans le coeur de ces gens lorsque l'investiture de Mendès-
France leur a paru ouvrir une perspective de renouveau du
capitalisme français. On avait enfin "un courant bourgeois
réformiste, qui n'est dépourvu ni de dynamisme ni d'effica-
cité" (2), et, en dépit ou plutôt à cause des "contradictions"
inhérentes à ce courant, il fallait "tout mettre en cuvre pour
que l'expérience Mendès-France ne tourne pas court ; pour
que les couches sociales qu'elle a reveillées... participent tout
entières à 'son nécessaire élargissement, à sa nécessaire évo-
lution”. C'est la politique-gigogne : le gouvernement essaie de
réformer le capitalisme français, la gauche du gouvernement
à réformer sa droite, tandis que France-Observateur, utilisant
la pression populaire, réformera la gauche du gouvernement.
Il ne manque à l'ingénieux appareil, pour qu'il soit présen-
table au concours Lépine, qu'une ou deux chevilles peu im.
portantes en vérité : l'appui des masses, et la possibilité objec-
tive de faire remonter au capitalisme français le courant de
sa décadence historique.
La décadence du capitalisme français s'exprime par la rela-
tive stagnation de la production, la multiplication de conflits
entre les classes n'aboutissant pas à une solution nette, la
décomposition de l'appareil politique et étatique. Elle ne prend
sa pleine signification que placée dans le contexte organique
du développement du capitalisme mondial. Dès la fin du siè-
cle dernier, la puissance réelle de la bourgeoisie française,
relativement à celle de ses rivales, commençait à décliner et
correspondait de moins en moins à l'étendue de son empire
colonial et au rôle qu'elle voulait continuer à jouer dans la
politique mondiale. Si, à la faveur de la victoire de 1918, elle
a encore pu maintenir une certaine autorité internationale pen-
dant une dizaine d'années, et connaître à travers une série de
crises une expansion économique jusqu'à 1929, la période 1930-
(1) J.-P. Sartre, « Les Temps Modernes », avril 1954, p. 1734. Dans la
nouvelle argumentation de Sartre en faveur du stalinisme, une considéra-
tion fondamentale introduit toutes les autres : la bourgeoisie française
laisse la production stagner. Quant à la majorité des autres pays capita-
listes, qui font tout ce qu'ils peuvent pour la développer, c'est de l' « abs-
traction » : moi je suis français, dit Sartre, et m'intéresse à mon pays.
L'idée que « son pays » soit une abstraction, et la pire, n'effleure pas le
cervelle de ce philosophe.
(2) G. Martinet, dans « France-Observateur » du 30 septembre 1954.
2
1939 a révélé sa faiblesse irrémédiable. Sa production indus-
trielle, qui n'a jamais pendant cette période pu retrouver le
niveau de 1929, était, à la veille de la guerre, inférieure à
celui-ci de 20 % ; sa monnaie avait été dévaluée à plusieurs
reprises ; sa domination sur les ouvriers n'avait pu être sau-
vée que grâce à Blum et à Thorez. La guerre de 1939-40 a
consommé sa ruine.
Il est impossible d'analyser ici les racines complexes de
cette décadence, mais il est indispensable, à cause de leur
importance actuelle, de mentionner deux facteurs qui ont joué
un rôle déterminant : la politique de la bourgeoisie française
face à la paysannerie, la forme particulière qu'a prise la
concentration monopolistique en France. Dès le milieu du
XIX° siècle, et surtout depuis 1871, la bourgeoisie française a
cherché auprès des campagnes un appui contre le proletariat
urbain. Le contraste que présente à cet égard l'évolution de
la France et celle de l'Angleterre est caractéristique, La bour-
geoisie anglaise a laissé son agriculture dépérir sous la pres-
sion de la concurrence des céréales importées à bas prix ; ce
faisant, d'un côté elle obligeait les paysans à venir grossir
l'armée industrielle de réserve dans les villes, d'un autre côté
elle profitait de la baisse du coût de la nourriture de ses ouvriers
et pouvait maintenir des salaires nominaux plus bas qu'il n'eut
été autrement possible. La bourgeoisie française, anticipant
avec terreur le jour de l'“enfin seuls” en tête à tête avec le
prolétariat le plus révolutionnaire de l'époque, s'est rapide
ment orientée vers une protection intense de son agriculture,
maintenant une solide couche de paysans riches et moyens
dans la prospérité et le reste de la paysannerie dans les illu-
sions de la petite propriété. En ralentissant ainsi énormément
l'exode paysan vers
les villes, elle protégeait à court
terme sa stabilité sociale et économique ; le maintien d'une
agriculture importante garantissait aux produits industriels
un débouché plus stable que les marchés d'exportation, la
faiblesse du chômage permanent rendait moins graves les fluc-
tuations de l'emploi industriel lors des crises. Mais ces résultats
favorables dans l'immédiat devenaient catastrophiques à long
terme. La stabilité relative des débouchés ralentissait l'accu-
mulation, la rationalisation de la production et la concentra-
tion des entreprises ; l'absence d'une armée industrielle de
réserve importante tendait à freiner plus tôt qu'ailleurs les
phases d'expansion du cycle industriel. Enfin, la protection
de l'agriculture, dans la mesure où elle atteignait son but
maintenir les prix agricoles plus élevés en France que sur
le marché mondial signifiait que, pour un même degré d'ex-
3
ploitation du travail en termes réels, les salaires nominaux
et le niveau des prix tendaient à être plus élevés en France
qu'à l'étranger, d'où une tendance à la faiblesse compétitive
chronique de la production française sur les marchés inter-
nationaux (3)
Cette tendance explique le degré de protection particuliè-
rement fort en France pour l'ensemble de la production et
aussi, en partie, l'autre phénomène typique du capitalisme
français, à savoir que la concentration monopolistique y a pris
beaucoup plus la forme de l'organisation des entreprises de
chaque secteur en cartels, ententes ou “comptoirs", fixant les
prix et éventuellement répartissant les commandes, et beau-
coup moins la forme d'une fusion des entreprises (qui va, en
général, de pair avec la rationalisation et la réduction des
coûts sinon des prix). La concentration très lente des entre-
prises en France (où le nombre moyen d'ouvriers par établis-
sement industriel est passé de 6 en 1901 à 10 en 1936, les chif-
fres correspondants pour les Etats-Unis étant de 24 et 56) ex-
prime cet état de choses (4). Elle a été accompagnée d'une accu-
mulation faible du capital, les capitalistes étant très peu
soumis à la pression de la concurrence et se transformant gra-
duellement en rentiers industriels, tandis qu'une bonne partie
des profits était investie à l'étranger, dans des placements qui,
souvent, se sont volatilisés par la suite.
Ainsi, la participation de la France à la production indus-
trielle mondiale tombait de 10,3 % en 1870 à 6,4 % en 1913,
4,5 % en 1936-38 et 3,3 % en 1952, tandis que les exportations
françaises qui représentaient 10,9 % des exportations mondiales
en 1876-80, n'en représentaient plus que 7 % en 1911-13 et
4,1 % en 1936-38 (5).
(3) Dans la mesure où la protection agricole vise à assurer à l'agricul-
ture un revenu supérieur en termes réels à celui qui correspond à sa pro-
ductivité comparée à la productivité des pays exportateurs de produits
agricoles, l'équilibre des échanges extérieurs ne peut être réalisé que si le
capitalisme français peut reprendre ce qu'il perd sur son agriculture à
quelqu'un d'autre et notamment au proletariat industriel. Avec une
agriculture importante et peu productive, la force concurrentielle de l'indus-
trie française sur les marchés internationaux ne peut être maintenue que
si les salaires réels sont plus bas pour la même productivité du travail
industriel. Dans la mesure où le proletariat n'accepte pas ce niveau de
Balaires, le problème est insoluble.
(4) V. l'article de Mme Cahen : « La concentration des établissements en
France de 1896 à 1936 » (Etudes et conjoncture, sept. 1954, p. 840 et s.,
spécialement p. 856-7 et 874) pour la France, et le "Statistical Abstract of
the United States" de 1951 (p. 739) pour les Etats-Unis.
(5) V. « Industrialisation et commerce extérieur », S.D.N., Genève 1945,
p. 14 et 187-197. Le pourcentage de la production industrielle française par
rapport la production industrielle mondiale en 1952 a été calculé par nous
à partir des indices publiés dans le “Bulletin mensuel de statistiques des
Nations Unies (New-York, octobre 1953, p. XV et 21).
L'effondrement de 1939-40 a été le résultat logique de cette
évolution ; et la “victoire" de 1945, loin de résoudre quoique
ce soit, a placé le capitalisme français devant les problèmes
les plus difficiles qui se soient jamais posés à une classe domi-
nante, et ceci à un moment où l'appareil de direction et de
domination de la bourgeoisie, l'Etat et les partis politiques,
était complètement décomposé et pratiquement sans emprise
sur un société en révolte contre le système capitaliste.
On connaît la situation de la bourgeoisie française à l'is-
sue de la guerre : ses installations productives à moitié détrui-
tes, son empire colonial craquant de tous les côtés, son proléta.
riat ne pouvant être maintenu dans les cadres sociaux exis-
tants que grâce au parti stalinien, ses prétentions de mainte-
nir la place et les prérogatives d'une “grande puissance" vic.
torieuse réduites à néant par l'inexistence de tout potentiel
militaire et économique.
Théoriquement, tous ces problèmes comportaient leur solu-
tion : sur le plan économique la reconstruction - c'est-à-dire
l'accumulation du capital à un rythme accéléré impliquait
d'un côté une réduction des salaires réels qui a bien eu
lieu en fin de compte — et d'un autre côté l'orientation ration-
nelle des investissements et la limitation de toutes les formes
de consommation improductive. Sur le plan colonial, il s'agis-
sait de comprendre que l'écroulement de la puissance éco-
nomique et militaire du capitalisme français et le réveil des
peuples coloniaux ne permettaient plus dans certains endroits
Indochine - le maintien de la domination française, ou
qu'ils imposaient dans d'autres Afrique du Nord – des
concessions importantes afin d'éviter de tout perdre. Une cer-
taine influence sur le plan international n'aurait pu être rega-
gnée qu'en fonction de l'ampleur de la reconstruction écono-
mique et de l'abandon des parties irrécupérables de l'ancien
empire colonial.
Ces solutions ne restèrent pas théoriques parce qu'irréalisa-
bles en soi. Dans d'autres pays, elles ont été réalisées, et précisé-
ment après cette guerre-ci : le capitalisme anglais a su, sur le
plan colonial, maintenir la souplesse nécessaire pour éviter de
tout perdre, de même que, par des voies différentes, la même
Angleterre, la Belgique ou l'Italie ont pu réaliser leur recons-
truction à moindres frais. Mais il manquait à la bourgeoisie
française les conditions sociales et politiques de leur réalisa-
tion. Dans sa fraction quantitativement et qualitativement la
plus importante, le prolétariat français était sous le contrôle
du parti stalinien, et celui-ci, loin de mettre par-dessus tout
la défense de l'ordre établi, avait ses propres objectifs, par rap-
5
-
.
port auxquels la collaboration avec la bourgeoisie sur le dos
des ouvriers ne représentait qu'une tactique transitoire. La
“paix sociale” devait être achetée au prix d'un condominium
avec le P.C. à la durée et à l'issue incertaines. D'autant plus
incertaines, que face au monolithisme du parti stalinien appuyé
par Moscou, l'appareil politique et étatique de la bourgeoisie
française présentait une incohérence et un effritement sans
précédent.
Le morcellement du personnel politique bourgeois en France
est un phénomène ancien. A l'opposé des autres grands pays
capitalistes, la France n'a pas, de longue date, connu un grand
parti bourgeois, homogène et discipliné. Mais sous la Troi-
sième République, la fragmentation des organisations politi-
ques de la bourgeoisie (ou la friabilité de celles qui existaient
en nom), si elle s'est reflétée dans des changements presque
trimestriels de gouvernement, n'a pas empêché la poursuite
d'une politique relativement cohérente. Les querelles quasi
professionnelles du personnel politique n'affectaient pas la
solution des problèmes essentiels pour le capitalisme français
Celle-ci paraissait et était à cette époque relativement claire,
n'impliquait que rarement une limitation des intérêts de tel
ou tel groupe capitaliste au nom des intérêts généraux du sys-
tème, et laissait une marge confortable aux querelles et à la
démagogie des agences électorales de la bourgeoisie. Rien
de tout cela ne subsistait après la guerre. Des problèmes de
tous ordres se posaient à une échelle inconnue auparavant, et
les moyens d'y faire face faisaient cruellement défaut; la
puissance du parti stalinien rendait extrêmement difficile l'ap
plication de toute politique à laquelle celui-ci ne se rallie-
rait pas, c'est-à-dire dans laquelle il ne verrait pas son propre
intérêt ; il s'agissait donc de ménager la chèvre et le chou. Une
solution correcte des problèmes bourgeois, même supposant
qu'elle put être trouvée, aurait donc consisté nécessairement
à une danse sur la corde raide et n'aurait pu être appliquée
que si la bourgeoisie était capable de se créer l'organe unitaire
d'élaboration et d'application d'une politique, s'imposer à elle
même une discipline totale et même des "sacrifices", écraser
impitoyablement toute tendance d'un groupe bourgeois quel-
conque de faire passer ses propres intérêts avant les intérêts
généraux de la conservation du capitalisme.
Or, dans les conditions de décomposition sociale et politique
résultant de la défaite et de l'occupation, de division au sein
de la bourgeoisie, de banqueroute de la majorité de son per-
sonnel politique, de déréglement des mécanismes normaux de
l'économie capitaliste un tel organe ne pouvait surgir ex nihilo
6
.
ni après quelques jours, ni après quelques mois. La solution
extrême, qui serait la suppression du parlementarisme, était
exclue aussi bien sous la forme du fascisme - la naissance
d'une idéologie fasciste étant à ce moment impossible -- que
sous la forme d'un coup d'Etat bonapartiste, qui ne pourrait
s'appuyer sur un appareil étatique en dislocation ; dans les
deux cas d'ailleurs cette solution » n'aurait fait
que déclen-
cher une guerre civile, grosse à son tour d'une guerre interna-
tionale.
Ainsi, la bourgeoisie n'a pu gouverner que par le moyen
de quatre ou cing partis et deux fois autant de groupes et
intergroupes parlementaires, dont l'existence était liée à la
fois à des coalitions d'intérêts particuliers au sein de la bour-
geoisie elle-même, et à une démagogie adressée à des catégo-
ries spécifiques de la population, économiques, professionnelles
ou idéologiques. Aux débris des partis d'avant-guerre socia-
listes, radicaux ou modérés sont venues s'ajouter des for-
mations qui ont essayé de rénover la miteuse idéologie bour-
geoise libérale à l'aide d'oripeaux religieux (M.R.P.) ou natio-
naux (R.P.F.) mais toujours bien entendu sur le fond "social"
imposé par l'époque.
Il en a résulté une instabilité et une incohérence politiques
qui auraient été graves même en temps normaux, mais qui,
dans les circonstances données ont été catastrophiques. Car
même lorsqu'elle a réussi, grâce aux contradictions internes de
la politique du parti stalinien, à se débarrasser de celui-ci
(1947), et lorsque l'usure croissante de l'emprise active (en tant
qu'elle se distingue de l'emprise électorale), du stalinisme sur
le prolétariat a enlevé à l'action du P.C. toute efficacité immé-
diate (à partir de 1948), la bourgeoisie n'a pu ni trouver ni
appliquer la politique qui l'aurait faite sortir de sa crise,
Si elle a pu imposer à la classe ouvrière la réduction des
salaires réels nécessaire pour réaliser la reconstruction de son
capital, cette reconstruction s'est effectuée au milieu d'un gas-
pillage immense, accompagnée d'une inflation permanente et
de dévaluations successives malgré les quantités importantes
de dollars reçues des Etats-Unis. Incapable de s'imposer une
discipline “dirigiste”, comme la bourgeoisie anglaise, ou "libé-
rale”, comme la bourgeoisie belge ou italienne, elle a laissé
ses membres se remplir les poches aux dépens des intérêts
généraux de leur propre classe ; elle est presque arrivée à
transformer l'exploitation capitaliste de la France en un sys-
tème de pillage à court terme de l'économie par
d'intérêts auxquels sont inféodés des "lobbies" politiques con-
trôlant chacun un secteur de l'appareil étatique. Tout cela ne
des groupes
- 7
se passe plus seulement dans la coulisse : il est impossible
d'énumérer les mesures "légales” qui accordent des subven-
tions, des exemptions, des privilèges et des protections spécia-
les à tel ou tel autre groupe de capitalistes ou à tous globa-
lement.
C'est cette situation qui a déterminé, tout au moins au début,
la politique coloniale de la bourgeoisie. L'affaire d'Indochine,
cet engrenage dans lequel le capitalisme français a laissé sa
chance de récupérer une certaine puissance internationale après
la guerre, a été dès le départ une entreprise sans espoir que
la fraction du capital français ayant des intérêts au Vietnam,
soutenue par un essaim d'affairistes, de contrebandiers au sens
du Code Pénal, et de politiciens véreux, a pu imposer, malgré
ce qu'il pouvait en coûter au capitalisme français dans son
ensemble. Ce ne fut que beaucoup plus tard que la continua-
tion de la guerre d'Indochine fut dictée par l'impérialisme amé
ricain, dans le cadre de sa lutte contre l'extension du stali.
nisme en Asie. L'essence de la politique appliquée en Afrique
du Nord n'a pas été différente, où ce que pourrait par le
moyen de concessions préserver le capitalisme français dans
son ensemble a été mis en péril par l'intransigeance des grou-
pes ayant des intérêts sur place et n'en voulant rien céder.
L'interaction de ces deux problèmes, l'économique et le colo-
nial, est évidente. Egalement évidente est la détérioration de la
situation du capitalisme français sur le plan des rapports de
force internationaux qui résulta de son incapacité à mettre
dans son économie un ordre quelconque et à liquider à temps
l'expédition coloniale la plus coûteuse et la plus absurde de
son histoire. Incapable de résoudre ses propres problèmes, il
s'enfonça dans la vassalisation vis-à-vis des Américains, les dol-
lars mendiés à Washington bouchant péniblement les trous
creusés dans le budget et la balance des paiements extérieurs
par la guerre d'Indochine, le gaspillage, la fraude et le main
tien de taux de profit excessifs. Ce faisant, non seulement il
accumulait le mépris compréhensible des. Américains pour le
valet nécessiteux, mais il faisait voir à ceux-ci qu'ils n'avaient
pas grand-chose à en attendre dans leurs plans militaires et
les amenait à miser sur la restauration de la puissance alle-
mande comme « bouclier de l'Europe ». Ainsi, le capitalisme
français provoquait pour une large part lui-même son rem-
placement par son ennemi traditionnel, l'Allemagne, à la
place du troisième grand de la coalition atlantique. Ses poli-
ticiens ont cru pouvoir échapper à ce danger en proposant un
mécanisme — la C.E.D. - destiné à "contrôler" l'Allemagne
par la France ; en fait, étant donné le rapport des forces réel
8
entre les deux nations, la C.E.D. risquait d'aboutir au con-
trôle de la France par l'Allemagne. S'étant aperçus de leur
bévue, ils n'ont pas osé demander à leur Parlement la ratifi-
cation du traité qu'ils avaient signé et se sont cantonnés dans
une inaction chaque jour plus intenable, face aux menaces
et au chantage des Américaing.
Le gouvernement Laniel a marqué l'apogée de l'incohé-
rence et de l'inaction caractéristiques de tous les gouverne-
ments depuis 1945. Il commença par dresser contre lui l'en-
semble des salariés du secteur public en voulant réaliser des
ridicules "économies" sur leur dos alors que, sans parler même
des dépenses militaires, les subventions, privilèges et fraudes
de toutes sortes dont profitent les capitalistes se chiffrent par
centaines de milliards dans le budget. S'étant brûlé les doigts
dans cette première tentative, il s'est borné désormais à jouer
la mouche du coche économique, Edgar Faure ayant présenté
sous forme de « plan de relance de l'économie » ce qui était en
train de se passer (comme l'autre grand homme de la bour-
geoisie, Pinay, s'est vigoureusement attaqué à la hausse des
prix trois mois après que celle-ci se fut arrêté d'elle-même).
Sa seule initiative fut d'accorder une légère augmentation du
salaire minimum, afin d'éviter l'éclatement de grèves dont cel-
les d'août 1953 avaient donné l'avant-goût. S'étant engagé à
faire ratifier la C.E.D. par le Parlement, le gouvernement n'a
pas osé pendant un an présenter ce traité au vote. Il a laissé
en Afrique du Nord le conflit entre les populations et l'admi-
nistration française prendre une forme chaque jour plus grave,
sans oser ni recourir à la répression totale ni faire des conces-
sions. Assistant jour après jour à la dislocation des positions
militaires françaises en Indochine, il en a su profiter pour
extorquer quelques dollars supplémentaires aux Américains,
mais s'est voilé la face jusqu'à la dernière minute devant le
dilemme : se retirer du Vietnam sous une forme ou une autre
ou s'engager à fond dans la guerre. Lorsqu'il a accepté la
"négociation” avec le Vietminh, il s'y est présenté avec des
prétentions et des exigences sans rapport avec sa force réelle.
L'armistice ne pouvant pas être conclu sur cette base utopique,
il a voulu entraîner les Américains à une intervention active à
Dien Bien Phu, allant ainsi au-devant d'une généralisation du
conflit avec une légèreté criminelle du point de vue des inté-
rêts du capitalisme français et partagée, d'ailleurs, par le clan
Radford aux Etats-Unis ; il a fallu l'intervention in extremis
des Anglais pour sauver le bloc occidental d'une aventure folle
qui pouvait facilement tourner à la catastrophe.
9
La chute de Dien Bien Phu, en conjonction avec l'impasse
de la conférence de Genève, a brusquement réveillé les par
lementaires. Ils ont été forcés de se rendre compte que les
problèmes ne pouvaient plus être ajournés indéfiniment, qu'en
ne voulant rien céder on était en train de tout perdre, et,
le plus grave, que leur propre sort était désormais en jeu.
Il fallait essayer de transformer la banqueroute en liquidation
judiciaire et il était adroit de charger de celle-ci quelqu'un de
« neuf », préservant ainsi le personnel «consulaire » de la
IVe République de la nécessité de prendre des mesures désa-
gréables et se réservant, le cas échéant, la possibilité de pré-
senter comme un fossoyeur celui qui aurait fait régler l'addi-
tion.
Ainsi, Mendès-France est venu au pouvoir porté par le vide
de l'espace politique, les forces qui avaient dominé la scène
jusqu'alors, usées, corrompues, effrayées, ayant dû implicite-
ment reconnaître leur faillite et se retirer provisoirement avant
que l'édifice ne s'écroule sur elles.
Mais au-delà de la déconfiture des politiciens, la constitution
du gouvernement actuel a exprimé quelque chose de plus pro-
fond : la prise de conscience de la grande bourgeoisie qu'il
était impossible de continuer dans la même ornière, que des
concessions devaient être faites dans le domaine colonial,
qu'une certaine rationalisation de l'économie était inévitable
sous peine d'un écroulement total du système, qu'en même
temps on pouvait essayer de limiter l'emprise des Américains
sur la conduite des affaires françaises. La conscience du besoin
d'un rafistolage et les velléités d'indépendance avaient fait un
bout de chemin depuis un an chez la bourgeoisie. Celle-ci
a beau être définitivement inféodée aux Américains sous tous
les aspects importants, elle essaie naturellement de même
par exemple que la bourgeoisie anglaise - de limiter leur
domination chaque fois qu'elle va directement à l'encontre
de ses intérêts. Le nouveau dans la situation a été de recon-
naître qu'une certaine limitation effective de la domination
américaine ne pourrait avoir lieu que dans la mesure où la
bourgeoisie française accepterait elle-même une dose de dis-
cipline et certains « sacrifices ».
C'est là en fin de compte la « mission » du gouvernement
Mendès-France : prendre les mesures de rationalisation deve-
nues indispensables et les faire accepter à la fois par l'en-
semble de la bourgeoisie et par le reste de la population ;
appuyé sur cette mise en ordre, réduire le degré de l'emprise
américaine sur le capitalisme français. Mais ce qui montre
précisément les limites de cette action est que le gouvernement,
10
obligé dans certains domaines de parer au plus pressé, ne peut
y agir que par amputation, par des abandons totaux ou partiels
et que dans les autres, il n'est capable de procéder que par
des mesures mineures qui n'atteignent pas la structure déca-
dente du capitalisme français.
Le caractère de la solution >> donnée en Indochine est
clair. Il s'agit, en fait, d'une solution de capitulation totale,
simplement masquée par l'existence de l'Etat « indépendant »
du Sud-Vietnam. Les restes des intérêts et de l'influence du
capitalisme français en Indochine ont été en pratique sacri-
fiés. D'un autre côté, l'accord avec le Vietminh laisse en sus-
pens le sort futur du pays ; les élections prévues pour 1956,
si elles se faisaient, livreraient certainement l'ensemble du
Vietnam à Ho Chi Minh et pour cette très bonne raison elles
ne se feront pas plus qu'en Corée. Pas plus qu'en Corée, un
« assainissement » du régime du Sud-Vietnam n'est conceva-
ble, et, encore moins qu'en Corée ou en Allemagne, le main-
tien indéfini de la situation actuelle ne représente une « solu-
tion ». L'Indochine reste un foyer d'incendie qui couve, non
seulement à cause de la division artificielle du pays en deux
- cet artificiel est devenu naturel à l'époque actuelle - mais
parce que le régime du Sud-Vietnam est totalement inconsis-
tant. La décomposition des couches privilégiées locales est telle
que non seulement il est impossible, avec ou sans le soutien
des impérialistes français et américains, de mettre sur pied
un régime parlementaire, comme en Allemagne occidentale,
mais qu'il est même très difficile d'y maintenir une dictature
efficace au moins sur le plan policier, comme en Corée du
Sud (6). Il est d'ailleurs important de noter que cette capitula-
tion totale du capitalisme français n'en est pas une pour
a
(6) La comparaison avec l'Allemagne permet de voir une des raisons les
plus importantes de la faiblesse de régimes comme celui de Syngman Ree
ou de Bao-Daï. Une des forces de l'idéologie bureaucratique est l'appel au
développement de la production, l'industrialisation, etc. Par définition, cet
aspect n'est efficace que dans les pays arriérés ou ceux parmi les pays
capitalistes dont la décadence arrêté le développement économique
(France). On peut expliquer pour un temps au paysan chinois qu'il est
peut être tout aussi misérable qu'auparavant, mais que maintenant on
construit des usines et des routes. Mais c'est là une chose impossible à
faire admettre à l'ouvrier allemand : exploiter pour construire des usines
et encore des usines, c'est ce que ses patrons ont fait depuis des siècles,
il n'y voit rien de nouveau. Toutes choses égales d'ailleurs, le stalinisme
aura donc beaucoup plus d'attrait et de force dans le cas d'un pays arriéré,
qu'effectivement il transforme, y jouant le « role historique » que la bour-
geoisie tardive a été incapable de remplir, que dans un pays avancé, où ce
rôle a été réalisé et continue à l'être. Dans le cas du partage d'un pays,
on comprend que la comparaison du développement des deux moitiés ren-
force le parti stalinien en Corée du Sud ou dans le Sud-Vietnam, et qu'elle
soit totalement dénuée de signification pour l'ouvrier de la Ruhr. Le Viet-
minh est appelé de ce fait à une influence accrue dans le Sud-Vietnam,
contre laquelle Bao Dai et ses marionnettes sont organiquement incapables
de lutter.
11
l'impérialisme américain ; celui-ci a préservé ce qui l'inté-
ressait principalement dans l'affaire indochinoise - le terri-
toire du Sud-Vietnam pouvant être utilisé comme base au cas
d'une guerre en Extrême-Orient.
Egalement clair est le caractère des « solutions >> données
en Afrique du Nord. En Tunisie, sous la pression d'une agi-
tation et d'une guerilla croissantes, qui risquaient de tourner
à la guerre tout court, Mendès France a été obligé pour sauver
l'essentiel — à savoir les intérêts économiques et militaires
de l'impérialisme français -- de céder une partie du contrôle
politique du pays à la bourgeoisie locale, espérant que celle-ci
serait obligée de s'appuyer sur lui chaque fois que le mouve-
ment des masses risquerait de poser le problème sur un plan
plus radical. Là encore, les problèmes essentiels ne sont pas
en fait réglés et ne le seront pas avec l' “autonomie interne".
Au Maroc rien n'a pu être fait, tellement la situation y
est inextricable ; l'absence d'une bourgeoisie locale sur
laquelle le capitalisme français pourrait pour un temps s'ap-
puyer, comme en Tunisie, rend impossibles des concessions
sauvegardant ses intérêts, et il est improbable que les quel-
ques miettes jetées par ailleurs à la population puissent conte
nir longtemps sa lutte contre la domination française.
Relativement à la C.E.D. et au réarmement allemand, la
tâche du gouvernement Mendès-France était de tirer aux
moindres frais le capitalisme français du guêpier où il était
allé se fourrer lui-même. Au-delà de la stupide mythologie
de la construction de l'Europe et de la supranationalité,
l'essence du problème allemand est claire : non seulement le
réarmement allemand est inévitable, parce que fermement
décidé par les Américains, mais, au-delà de la question du
réarmement, le retour de l'Allemagne à la place que sa puis-
sance lui confère dans le bloc occidental. Autrement dit, il
s'agit de consacrer ouvertement le recul de la France et l'acces-
sion de l'Allemagne à la place du "Troisième Grand" du bloc
atlantique. Il s'agit de reconnaître la réalité qui résulte du
rapport effectif des forces des deux capitalismes rivaux, et
cela ramène à ses véritables proportions la ridicule “tragédie"
de la C.E.D. Car ce rapport de forces pouvait être quelque
temps masqué ou limité dans son expression par des artifices
juridiques, mais non pas altéré dans son essence par des chif-
fons de papier.
La question s'est posée, on le sait, dès 1950, et en fait la
bourgeoisie française n'a jamais pu arriver à une solution
acceptable par tous ses éléments. La solution idéale pour le
12
capitalisme français eût été la réunification et la neutralisa-
tion de l'Allemagne ; garantie par les Américains, celle-ci per-
mettrait à la France de continuer à jouer le rôle de principale
puissance militaire du continent. Mais cette solution est abso-
lument inacceptable pour les trois principaux intéressés : les
Russes, qui n'abandonneront jamais pacifiquement leur zone ;
les Américains, qui non seulement comptent sur les divisions
allemandes mais ne désirent nullement laisser à portée des
Russes ce gage extraordinaire que serait une Allemagne uni-
fiée et désarmée ; en fin de compte, les Allemands qui aspirent
à occuper au sein du bloc atlantique la place qui correspond
à leur force.
La C.E.D. a été présentée par les politiciens français qui
l'ont inventée comme un moindre mal, par les "limites” qu'elle
posait au réarmement allemand, par la prépondérance qu'elle
octroyait à la France (nombre de voix supérieur accordé à la
France par rapport à l'Allemagne découlant du nombre res-
pectif de divisions, non participation directe de l'Allemagne
au Pacte Atlantique, espoir laissé à la France de pouvoir
manoeuvrer l'Allemagne en s'appuyant sur les quatres autres
pays), enfin par les avantages accordés à la France sur la
question sarroise. Mais en réalité, les possibilités effectives
d'un contrôle de l'Allemagne à travers le mécanisme de la
C.E.D. ont été dès le départ infimes. Et la lutte qui opposait
parmi les politiciens bourgeois partisans et adversaires de la
C.E.D. reflétait aussi bien une différence d'appréciation de ces
possibilités, que les oppositions plus profondes entre secteurs
ou groupes d'entreprises capitalistes « bien placés », qui
voyaient avec appétit un élargissement de leur marché aux six
pays, et les « mal placés » qui craignaient la concurrence alle
mande et le démantèlement graduel du système de protection
qui entoure la production française. D'autres facteurs sont
venus se greffer là-dessus, comme par exemple les perspectives
qu'ouvrait à la clique catholique du M.R.P. la domination
démo-chrétienne probable du parlement "européen".
Le déplacement des forces au sein de la bourgeoisie fran.
çaise et de ses politiciens de 1951 à 1954 a favorisé de plus en
plus les adversaires de la C.E.D. La raison véritable n'en a pas
été la découverte soudaine par le général König des méfaits
du militarisme ou par M. Daladier des possibilités de coexis-
tence pacifique avec la Russie, mais le développement relatif
de la situation du capitalisme français et allemand. Tandis
que le premier piétinait dans sa crise pendant ces trois années,
le second connaissait une expansion extraordinaire, dévelop-
pait sa production industrielle de 26 % et ses exportations
13
-
de 55 % (7). Il devenait de plus en plus clair que le mécanisme
de la C.E.D. servirait objectivement beaucoup plus à soumet-
tre le capitalisme français à l'Allemagne, qu'à faire contrôler
celle-ci par celui-là.
C'est fondamentalement ce raisonnement renforcé
par
les
résultats de la conférence de Bruxelles, où Adenauer a mon-
tré qu'il se savait le maître de la situation qui a conduit
au rejet de la C.E.D. Celui-ci évidemment ne réglait rien en
soi, sauf qu'il évitait dans l'immédiat au capitalisme français
le pire, à savoir la perte de nouvelles parcelles de son indé
pendance. Mais l'Allemagne ayant tous les atouts réels en
main devait obligatoirement imposer sa solution, inalgré les
stupides jubilations des journalistes français parlant de la
"gaffe” d'Adenauer à Bruxelles. Les astuces de Mendès-
France (8) n'ont pu empêcher que les accords de Londres
octroient à l'Allemagne beaucoup plus qu'elle n'avait obtenu
avec la C.E.D. (Wehrmacht indépendante, moindre limitation
des fabrications d'armements, participation au Pacte Atlanti-
que, remise sur le tapis du problème sarrois). L'essentiel de ce
que la bourgeoisie française avait voulu éviter par le moyen
de la C.E.D. est maintenant réalisé, et ce n'est pas l'engage-
ment anglais de maintenir quatre divisions en Allemagne (qui
auraient été maintenues de toute façon) ni le fantômatique
contrôle à exercer sur les armées européennes dans le cadre
du pacte de Bruxelles qui y changent quoi que ce soit d'es-
sentiel.
.
Le problème qui servira de test au degré de décomposition
de la bourgeoisie française est le problème économique. Lais-
sons de côté la rhétorique de Mendès France sur l'objectif
consistant à faire de l'économie française « l'économie d'une
grande nation moderne ». C'est là une tâche qui dépasse et la
durée et les moyens d'action d'un gouvernement capitaliste par-
lementaire et dont un tel gouvernement peut seulement aider
la réalisation si les facteurs essentiels en sont donnés par
ailleurs.
En réalité, il y a trois tâches précises qui se posent actuel-
lement au gouvernement. La première est d'éviter l'explosion
(7) Chiffres résultant de la comparaison des premiers semestres de 1961
et 1954.
(8) L' «intelligence » de celui-ci n'est pas en cause, même compte tenu
de l'avachissement des critères résultant de la succession de Pinay, Laniel,
etc., au pouvoir. Mais une situation historique comme celle du capitalisme
décadent fait que, dans le domaine de l'action, l' « intelligence » ne peut con-
duire tout au plus qu'à des astuces, car les conditions d'une création
politique ne sont pas objectivement données pour un politicien bourgeois.
La différence avec Bidault est que celui-ci fera des gaffes quelle que soit
la situation historique.
14
de luttes revendicatives des salariés, sur lesquels l'emprise syn-
dicale est de moins en moins efficace. La deuxième est de reg-
taurer la solvabilité du capitalisme français vis-à-vis de l'étran-
ger. La troisième, de rationaliser le fonctionnement du système
d'exploitation et en particulier de limiter dans l'intérêt général
du capitalisme les privilèges abusifs de certains groupes.
La création d'un « bon climat social » était le résultat visé
par les promesses concernant la révision périodique des salai-
res en fonction du niveau de la production et des prix. Or, les
mesures prises en octobre montrent qu'il s'agit d'une mystifica-
tion, et que Mendès-France ne fait rien de plus que ce que
Laniel et Faure avaient fait au début de l'année
en réalité
moins. Tout d'abord, l'augmentation accordée ne concerne que
le salaire minimum mensuel (porté au chiffre ridicule de
24.300 francs) tout comme la précédente. Cette dernière repré-
sentait une augmentation nominale de 15 % ; compte tenu de
la hausse du coût de la vie entre septembre 1951 - date où
le minimum légal avait été fixé à 100 francs l'heure et
décembre 1953, elle équivalait à une augmentation de 7,5 %
du salaire minimum réel. Du deuxième trimestre 1952 au
quatrième trimestre 1953, la production industrielle avait aug.
menté de 1,5 %, le total des heures-ouvriers effectuées avait
diminué de 3 %, le rendement horaire des ouvriers augmenté
de 5 %. L'augmentation en termes réels du salaire minimum
accordée en janvier 1954 était quelque peu supérieure à l'aug.
mentation de la productivité du travail pendant la période
considérée --- ce qui n'était évidemment qu'une goutte par rap-
port à l'énorme réduction des salaires réels qui avait eu lieu
depuis l'avant-guerre. Mais du quatrième trimestre 1953 au
deuxième trimestre 1954, la production industrielle a aug-
menté de 9 %, le total des heures-ouvriers effectuées n'a guère
varié (+0,3 %), le rendement horaire des ouvriers a donc
augmenté d'environ 9 % également ; en conclusion de quoi
Mendès-France, président d'un gouvernement « des travail-
leurs » (9), a bien voulu augmenter le salaire minimum de
5,6 % (l'augmentation en termes réels est même quelque peu
moindre, en raison d'une légère hausse du coût de la vie
depuis décembre 1953). (10) En deuxième lieu, la révision du
(9) Discours de Mendès-France à Louviers le 10 octobre.
(10) Voici les indices, tels qu'ils résultent du Bulletin Mensuel de l'INSEE,
pour le deuxième trimestre 1951 (avant la fixation du salaire minimum), le
quatrième trimestre 1953 (avant l'augmentation de ce salaire par Faure)
et le deuxième trimestre 1954 (avant la “révision” Mendès-France) :
Production industrielle
144 147 159
Heures-ouvriers
131,2 127,6 127.8
Rendement par heure-ouvrier
109,8 115,2 124,4
Coût de la vie à Paris
128,1 141,5 143,5
15
salaire minimum ne concerne qu'une minorité des salariés ;
pour les autres, les répercussions de l'augmentation seront pro-
portionnellement moindres que celle-ci, si même elles ont
lieu. Quant à l'appel à la conclusion de conventions collectives,
les ouvriers n'avaient pas besoin du gouvernement pour y pen-
ser. Mais ils savent que le contenu de celles-ci ne dépend que
de leur propre combattivité et de leur capacité d'imposer au
patronat et aux syndicats des concessions par la force.
Ainsi, les promesses de Mendès-France sur la liaison des
salaires avec la production se sont révélées, comme il fallait
s'y attendre, de la simple démagogie. Même en supposant d'ail-
leurs que le gouvernement les eût tenues, ou qu'il le fasse dans
l'avenir, la mystification en serait à peine moins grande. Le
salaire réel horaire moyen dans l'industrie est actuellement de
15 ou 30 % inférieur à celui de 1938 (selon qu'on tient ou non
compte des cotisations patronales à la Sécurité sociale), et ce
bien que le rendement du travail ait augmenté d'au moins
20 % (11). Il y a eu donc une énorme redistribution du revenu
national en faveur du capital et au détriment du travail depuis
la guerre. En liant les augmentations futures de salaire à l'ac-
croissement de la production, une révision périodique des
salaires même “honnête" ne ferait que ratifier définitivement
l'immense spoliation des ouvriers et l'annulation des conquê.
tes de 1936 que la bourgeoisie française, avec la complicité
des staliniens, a pu commettre depuis 1945 sous le prétexte
de la "reconstruction”.
La deuxième tâche est la restauration de la solvabilité du
capitalisme français vis-à-vis de l'étranger. La situation actuelle
de l'économie française est meilleure qu'elle ne l'a jamais été
depuis vingt-cinq ans. Les prix sont stables depuis deux ans et
demi, la récession de 1952-53 a été surmontée et, depuis ce
printemps, la production industrielle dépasse tous ses records,
la récolte de cet été (à l'opposé de ce qui s'est passé dans la
plupart des autres pays) a été très bonne, la productivité du
(11) Pour éviter de longues discussions statistiques, il suffit de citer le
rapport de la Commission des Affaires Economiques de l'Assemblée Natio-
nale (“Le Monde” du 31 août 1954) : « Même si l'on tient compte de tous
les avantages sociaux et de l'allongement de la durée du travail, il n'est
pas certain que le pouvoir d'achat du salaire moyen ait retrouvé son niveau
d'avant guerre ». Supposons que cela soit certain, Si le salaire total de
l'ouvrier est le même maintenant, avec une semaine moyenne de travail
de 44,5 heures, qu'en 1938, où cette semaine était de 38,8 heures, le salaire
réel horaire actuel est égal à 38,8/44,54* soit 87 % de celui de 1938, ceci
en y incluant les « avantages sociaux Si l'on exclue ceux-ci, il ne repré-
sente plus que 72 % de celui d'avant guerre (les « charges annexes du
salaire » sont passées de 15 % à 40 % du salaire direct de 1938 à mainte-
nant). D'un autre côté, de 1938 au premier semestre 1954 la production
industrielle (bâtiment exclu) augmentait de 55 % ; le total des heures-
ouvriers effectués de 27,5 %, donc le rendement par heure-ouvrier de 21 %
(chiffres calculés d'après le Bulletin Mensuel de l'INSEE, août 1954).
16
travail dans l'industrie s'accroît rapidement tandis que les syn-
dicats réussissent à faire taire aux ouvriers leurs revendica-
tions. La tache noire au tableau est le déficit des paiements
extérieurs. Malgré une augmentation importante des exporta-
tions, ce déficit reste encore élevé et n'est couvert que grâce
à l'aide” reçue des Etats-Unis (de l'ordre d'un milliard de
dollars par an). Or, d'un côté, cette aide doit diminuer rapi-
dement à la suite de l'arrêt de la guerre d'Indochine et de
la diminution des commandes d'armement passées pour le
compte des Etats-Unis à l'industrie française. D'un autre côté,
le déficit n'est actuellement ce qu'il est que par l'action d'une
série de facteurs qui doivent disparaître plus ou moins rapi-
dement : les subventions accordées par l'Etat aux exporta-
tions, le maintien quasi-intégral des restrictions quantitatives
à l'importation. Le gouvernement sera obligé d'abroger en
grande partie ces dernières, non pas par foi au libéralisme,
mais parce qu'il risque de s'attirer des représailles qui peuvent
lui coûter cher (12). Il n'est même pas certain qu'il pourra
maintenir les subventions à l'exportation. De toute façon, l'abo-
lition des restrictions quantitatives aurait à la fois le résultat
d'accroître les importations, donc le déficit extérieur, et de
créer une crise pour des nombreuses industries ou entreprises
françaises qui ne peuvent, au taux actuel du change, suppor-
ter la concurrence internationale.
L'issue technique est la dévaluation. Il est probable qu'à
400 ou 420 francs le dollar, l'économie française pourrait équi-
librer ses comptes extérieurs. Cependant une dévaluation n'est
pas simplement une manipulation monétaire ; elle comporte
un aspect réel car un déficit extérieur signifie que l'économie
considérée dépense à l'étranger plus qu'elle n'en gagne. La
suppression du déficit par une dévaluation signifie que désor.
mais elle devra donner davantage, recevoir moins, ou les deux
à la fois. Si la production nationale ne peut pas augmenter à
court terme, et dans les directions voulues (ce qui semble bien
être le cas actuel de la France), l'équilibre ne peut être atteint
que par un sacrifice réel, par le fait que l'économie en ques-
tion renoncera à une partie de ses dépenses totales, corres-
pondant à ce déficit. Cela revient toujours en pratique à limiter
la consommation des salariés, la hausse des prix intérieurs
faisant normalement suite à la dévaluation n'étant qu'en partie
compensée par les augmentations de salaire. Le succès de la
dévaluation (c'est-à-dire le fait que tous les prix et les coûts
(12) Une des raisons du développement des exportations françaises pen-
dant les deux dernières années est que les autres pays capitalistes euro-
péens ont aboli pour l'essentiel leurs restrictions quantitatives à l'impor-
tation,
17
.
intérieurs ne se retrouvent pas après l'opération exactement
au même niveau, en termes de monnaie étrangère, qu'aupara-
vant) présuppose donc que la classe ouvrière accepte la réduo
tion du salaire réel qui en résulte. Cette acceptation dépend à
son tour d'une foule de facteurs, qui dépassent évidemment le
plan économique. Actuellement en France il paraît difficile
que le prolétariat ne réagisse pas à une réduction de son salaire
réel de l'ordre de 3 à 5 % qu'exigerait probablement le "suc-
cès" de la dévaluation. Le gouvernement Mendès-France, avec
sa relative “popularité”, serait le mieux désigné pour faire
avaler cette réduction aux ouvriers.
Le troisième problème qui se pose au gouvernement, la limi-
tation des privilèges des divers groupes capitalistes dans l'in-
térêt de l'ensemble du système, est beaucoup plus complexe
et présente plusieurs aspects.
Tout d'abord, les privilèges au sens strict, par quoi le bud-
get de l'Etat devient la source des profits de certains groupes,
profits qui eussent été impossibles dans un fonctionnement
normal de l'économie capitaliste. L'exemple typique (mais nul-
lement unique) est celui des betteraviers. Il y a peu à dire sur
ce cas, car tout ici dépend du rapport des forces entre les
divers groupes privilégiés et entre leurs agents politiques et
parlementaires. Les garanties que leur donne Mendès-France
en procédant par étapes et en continuant à faire supporter par
le budget les frais des opérations d'assainissement" sont subs
tantielles, mais même de cette façon il n'est pas exclu qu'il soit
renversé sur une question de cette nature.
Ensuite, le système de protection de l'industrie française
dans son ensemble, assurée maintenant par des droits de
douane particulièrement élevés et par les restrictions quanti,
tatives à l'importation, et complétée sur le plan intérieur par la
cartellisation de presque tous les secteurs de la production. On
a vu que le capitalisme français est actuellement obligé d'ac
cepter une diminution de ce degré de protection, et en parti
culier de supprimer l'essentiel des restrictions quantitatives.
Ceci met en question les profits et dans certains cas l'existence
des entreprises les moins modernes, même si la libération des
importations était accompagnée d'une dévaluation de l'ordre
qu'on a envisagé plus haut. Pour les grandes entreprises, le
choc ne sera pas trop fort. Elles ont en général profité des
années d'après guerre pour étendre leur capacité de produc-
tion, moderniser et rationaliser leurs procédés de fabrication;
même si elles n'augmentaient pas le volume de leurs ventes, les
baisses de coût unitaire qu'elles réalisaient ainsi se traduisaient
pour elles par des profits unitaires en augmentation. Si les
18
importations étaient libérées et les entreprises peu producti-
ves éliminées, les ventes de celles-ci seraient partagées entre
les importations et les grandes entreprises françaises, qui pour-
raient compenser par une extension de leur chiffre d'affaires
les légères baisses de prix résultant éventuellement d'un cer-
tain degré de concurrence étrangère.
Dans ce domaine aussi la politique de Mendès-France vise
à adoucir la transition et à limiter au minimum les pertes que
les capitalistes les plus mal placés pourraient subir. Le « Fonds
de reconversion » institué par le gouvernement met en somme
à la charge du budget -- c'est-à-dire de la population dans son
ensemble --- les frais de sauvetage des capitalistes qui en sont
indignes d'après la loi même de leur système et qui auraient
dû être éliminés purement et simplement. Dans la plupart des
cas, d'ailleurs, il ne s'agit même pas de cela : le matériel de
ces entreprises est amorti depuis longtemps, leurs profits ont
été investis ailleurs, les entreprises ont continué à fonctionner
grâce à la protection douanière et quantitative. Les subventions
de modernisation seront dans ce cas un don au deuxième degré,
permettant à ces capitalistes de revaloriser des vieilles boîtes
qu'ils avaient consciemment et dans leur intérêt laissé dépérir.
Enfin, pour ce qui est de l'agriculture, certaines des absurdi-
tés les plus flagrantes de la situation actuelle (excédents de vin,
par exemple) peuvent être amendées ; mais la rationalisation
de la structure agraire du pays et, en général, la création d'une
"grande économie moderne" impliquerait des transformations
bien plus radicales (entre autres, le transfert d'une bonne moi-
tié de la population paysanne dans l'industrie) que celles que
le gouvernement a la possibilité ou même le désir de réaliser.
Les solutions données jusqu'ici par le gouvernement Mendès
France aux divers problèmes qui se posaient ont consiste en des
abandons totaux (Indochine, réarmement allemand) ou partiels
mais qui laissent en suspens l'essentiel (Tunisie) ou en un rafis-
tolage qui ne rompt pas fondamentalement la ligne suivie
les gouvernements précédents (mesures économiques). Telles
quelles, cependant, ne serait-ce que du fait qu'elles consacrent
la situation réelle du capitalisme français, elles représentent
une certaine rationalisation.
Est-il question d'aller plus loin ?
Les limites objectives posées à l'action de Mendès-France
sont clairement dessinées : il ne s'agit pas évidemment des
limites fondamentales qui sont celles d'un gouvernement capi-
taliste (on laissera à M. Martinet le soin de les explorer), mais
de celles, bien plus étroites, qui découlent de la situation du
capitalisme français, puissance de troisième ordre, vivant dans
19
la dépendance de l'impérialisme américain, essayant d'en alté-
rer quelque peu le degré mais ne pouvant ni voulant en chan-
ger la nature, disposant d'une base économique étroite qu'on
peut aménager mais dont il est exclu qu'on puisse désormais
faire « une grande économie moderne ». C'est ce dernier cadre
qui détermine objectivement le maximum de ce que Mendès-
France pourrait faire.
Mais ceci ne garantit nullement que ce maximum sera réa-
lisé effectivement. Des limites beaucoup plus étroites sont
posées à l'action de Mendès-France par les conditions politi.
ques et parlementaires, et en particulier par la décomposition
politique de la bourgeoisie française. Il est possible historique-
ment et conforme aux intérêts généraux du capitalisme fran-
çais de limiter les privilèges des betteraviers ou des industriels
du textile, mais il n'est pas certain que les agents de ceux-ci
dans le Parlement laisseront Mendès France ou n'importe qui
d'autre le faire. Ceci n'est d'ailleurs qu'une autre manière d'ex-
primer ce fait primordial, que le gouvernement Mendès-France
ne s'appuie sur aucune force politique propre, ni dans le
Parlement, ni dans le pays. Sa majorité caleidoscopique n'est
liée ni par une idéologie, ni par une organisation. Les divers
partis n'y ont participé qu'avec des arrière-pensées diamétra-
lement opposées. Pour le P.C., il s'agissait d'un soutien con-
joncturel aussi longtemps que Mendès-France était amené à
s'opposer à la politique américaine (Indochine, C.E.D.) ; il se
tournera évidemment contre lui à propos du réarmement alle.
mand et des problèmes économiques. Le désarroi et la confu-
sion des partis bourgeois et des socialistes ont pu jouer pendant
un certain temps pour Mendès-France, mais iront en diminuant
et risquent d'ailleurs aussi bien de jouer contre lui. Dans le
pays, Mendès-France est sans influence sur la classe ouvrière.
Il essaie de se créer une base politique en appelant à la
petite bourgeoisie et de fait, son seul soutien possible serait
un courant petit bourgeois "radical-socialiste" au sens de la
belle époque. Mais la saison est trop avancée pour qu'un tel
courant puisse actuellement prendre de l'importance, encore
moins s'organiser en une force politique coherente. L'emprise
des partis existants sur le corps électoral ne peut pas être
brisée par des causeries hebdomadaires. Un parti nouveau
autour de Mendès France ne ferait qu'ajouter à l'effritement
politique de la bourgeoisie sans pouvoir susciter un regroupe-
ment de l'ampleur nécessaire pour garantir la stabilité gouver-
nementale. Que le gouvernement tombe en novembre ou en
juillet, il n'aura été qu'un entracte dans la comédie de la
IVe République.
.
20
1
Résumons-nous. Le gouvernement Mendès-France représente
une tentative du capitalisme français de réduire le degré de
sa dépendance par rapport aux Etats-Unis et en même temps
de rationaliser dans une certaine mesure l'organisation de son
économie et de son domaine colonial. Cette tentative ne pou-
vait avoir lieu (comme le prouve l'investiture manquée de
Mendès-France en 1953) que sous la menace de la catastrophe.
Le gouvernement ne pourra pas survivre longtemps à la solu-
tion des problèmes qui présentaient une urgence extrême. Sur
le contenu de ces “solutions” il n'est pas besoin de revenir :
là où il ne s'agit pas d'amputations, elles ne sont que du rafis-
tolage.
Quant à la classe ouvrière, si elle a été en partie influencée
par la propagande stalinienne sur la C.E.D., elle sait qu'elle
n'a pas plus à attendre de Mendès-France que de Laniel ou de
Pleven. Les quelques augmentations de salaire qu'elle a pu
obtenir depuis l'année dernière ont été moins importantes que
l'accroissement de son rendement. La révision périodique des
salaires, promise par le gouvernement, s'est révélée une
mystification et ne serait, dans le meilleur des cas, destinée
qu'à consacrer définitivement (en liant toute augmentation ulté-
rieure des salaires à l'augmentation de la production), la redis-
tribution du revenu social en faveur du capital et l'extinction
des réformes de 1936 qui ont eu lieu depuis la guerre. La domi-
nation capitaliste ne change pas avec le nom du Président du
Conseil ; elle peut seulement présenter une anarchie interne
plus ou moins grande, un visage plus brutal ou plus raffiné.
PIERRE CHAULIEU.
- 21
1
La bombe H et la guerre apocalyptique
Lorsqu'en 1918, après la capitulation de l'Allemagne impé.
riale, un clairon désuet se mit à sonner le « Cessez le feu >
et qu'un silence insolite succéda tout à
coup
à
quatre années
de vacarme meurtrier, la guerre de 1939-45 vivait déjà d'une
existence fragile : les deux armes dominantes qui allaient être
les siennes le char d'assaut et l'avion de combat étaient
déjà nées dans le sein de leur mère moribonde. Pourtant ces
rejetons déjà vivaces durent tomber en sommeil durant vingt-
deux ans avant d'accéder à une maturité véritablement fulgu-
rante. C'est dans les plaines de la Pologne que s'affirma la
toute puissance du char. Rommel, l'homme qui en fut peut-
être l'incarnation la plus parfaite, était un de ses pires détrac-
teurs, alors même qu'il franchissait la frontière polono-alle-
mande. Trois ou quatre semaines plus tard, l'arme avait con-
quis l'homme et l'homme avait dominé l'arme. Certes il ne
s'agit là que d'une anecdote et il serait puéril, comme certains
le font, de limiter le phénomène guerrier à de telles anecdotes.
L'intérêt de cette histoire, qui a été celle du Grand Etat-Major
allemand pris dans son ensemble, réside uniquement en ceci :
l'arme dominante nouvelle, qui avait vu le jour lors de la
précédente guerre, ne s'est affirmée en tant que telle que dans
la nouvelle guerre elle-même. Ainsi le char, cette arme domi-
nante qui existait depuis 1917, ne s'est affirmé comme telle
que vingt-trois ans plus tard et uniquement à la faveur de
l'action guerrière elle-même.
Si maintenant nous envisageons la guerre 1939-45, quel est
le tableau qui se déroule devant nous ? Un tableau tout diffé
rent. Lorsque le 6 août 1945 éclata la bombe d’Hiroshima, non
seulement ce fut la première manifestation de l'antagonisme
nº 1 du monde d'après guerre, celui entre les Américains et
les Russes, mais encore ce fut clairement, aux yeux du monde
entier stupéfait, la naissance et l'affirmation de l'arme domi-
nante de demain. Toute la stratégie de la guerre qui venait
-22
de se terminer se trouvait reléguée d'un seul coup au musée
de l'histoire. Toute nouvelle stratégie à venir devait s'organi-
ser autour de la bombe atomique comme arme dominante.
Oui tout cela était clair, d'une clarté véritablement aussi
aveuglante que celle de la bombe elle-même. Pourtant à partir
de ce point de départ solide tous les raisonnements ultérieurs
des hommes d'Etat plus ou moins autorisés, de la presse, de
l'opinion publique même, ne servirent qu'à répandre la pire
des confusions. La clarté fit place à l'obscurité la plus totale.
Et avec l'obscurité vint l'obscurantisme avec les élucubrations
du type guerre apocalyptique, conception digne des auteurs
ignares et primitifs de cette Bible, qui ne pouvaient imaginer
l'élimination de l'aliénation qu'au moyen de la destruction
totale de la société, exploiteurs et exploités ensemble. L'appa.
rition de la bombe H poussa la confusion à son paroxysme.
Pourtant, à la fois l'explosion de la bombe H et l'enchaîne
ment des événements qui ont abouti à cette explosion, per-
mettent justement d'opérer un reclassement rationnel des
valeurs mises en cause et dont la compréhension est mainte-
nant à la portée de chacun. Logiquement deux erreurs con-
jointes sont à l'origine matérielle de la confusion qui règne.
La première porte sur l'appréciation de la stratégie prévalente
lors de la dernière guerre en matière de bombardements dits
stratégiques ; et cette erreur-là a semblé trouver sa confirma-
tion dans les conditions qui ont été celles du lancement des
bombes d'Hiroshima et de Nagasaki. La seconde porte sur la
ou les conceptions possibles d'une stratégie atomique et trouve
son origine dans la longue durée du monopole américain de
la bombe A et dans les tergiversations et les controverses des
sommités stratégiques américaines. L'objet de cet article con.
sistera d'abord à essayer de voir de plus près ce qu'il en est
de ces deux points.
LE BOMBARDEMENT STRATEGIQUE
COMME STRATEGIE
Les raids aériens massifs qui ont eu lieu durant cette guerre,
les souffrances des populations civiles, le souvenir quasi indé
lébile qu'en ont gardé tous ceux qui sont passés par cette
terrible expérience, la longue misère des survivants dans des
villes dévastées, tout cela a concouru à répandre dans l'opi-
nion populaire l'idée que le bombardement stratégique, ou
plus exactement le bombardement de terreur, constitue le fin
23
mot de la guerre et constituera la seule réalité de la guerre
de demain. L'immense tragédie d'Hiroshima et de Nagasaki
n'a fait que confirmer ce sentiment. Une telle réaction n'est
que trop compréhensible. Elle n'exprime pourtant rien d'autre
que la haine des peuples contre des guerres qui ne sont pas
les leurs, sur lesquelles ils n'ont aucun contrôle et qui les
dépassent dans leurs moyens et leur sont étrangères dans leur
idéologie.
L'attitude des cercles dirigeants est toute différente. C'est
eux qui détiennent le pouvoir et la guerre en question, c'est
leur guerre. Ils se penchent sur les problèmes qu'elle pose
avec le plus grand sérieux. Pour eux le massacre des popula-
tions celles de leur pays comme celles de l'adversaire
constitue un facteur secondaire, subordonné à ce qu'ils appel-
lent la victoire, leur victoire. Voyons ce que dit le général
américain Gruenther, chef militaire du N.A.T.O. (S.H.A.P.E.) :
« Si les Russes attaquent, ils auront au début des succès, mais
en fin de compte ils seront battus. » Le chef d'état-major russe
pense certainement : nous ne sommes pas à l'abri de revers
mais nous vaincrons en définitive. Pour les classes dirigeantes
donc la théorie de la guerre est une chose extrêmement sérieu-
be. Leur misérable sort de privilégiés en dépend.
Les masses laborieuses, et plus particulièrement le proléta-
riat industriel, ont un point de vue entièrement autre. En
matière de privilèges leur sort est réglé depuis toujours : ils
n'en ont aucun. Cela doit leur donner une liberté d'esprit que
n'ont certes pas leurs exploiteurs. La guerre pour elles n'est
qu'un surcroît d'exploitation, de misère et de sang. C'est une
grande tragédie au sein d'une tragédie encore plus grande.
Mais, par là même, c'est un phénomène qui a ses limites et
qui est donc susceptible d'être dominé. Normalement les
exploités doivent être en mesure de dominer les théories de
la guerre au lieu d'être dominés par elles. Chaque fois que
dans l'histoire les masses elles-mêmes sont rentrées en mouve-
ment elles en ont fait la preuve dans l'action. Le prix qu'elles
ont payé cependant a toujours été trop lourd. Pour la victoire
de la révolution il ne doit plus en être ainsi à l'avenir. Pour
cela il faut éduquer l'avant-garde prolétarienne dans la cri-
tique des théories des classes dominantes sur la guerre. Depuis
un demi-siècle l'extraordinaire accélération de l'évolution des
phénomènes guerriers a fait naître les théories les plus extrê-
mes et en même temps les a mises à l'épreuve. Nous allons
maintenant, à propos des bombardements « stratégiques »,
avoir l'occasion d'en étudier un des cas les plus frappants.
24
Un général d'aviation italien, du nom de Douhet (suivi d'ail-
leurs par les Américains Mitchell et Seversky) avait, dès 1920,
formulé une théorie suivant laquelle l'avion de bombardement
était devenu une arme si dominante et si décisive qu'elle
rendrait à l'avenir inutile toutes les autres. Plus précisément,
suivant cette théorie, la puissance militaire étant basée sur la
production industrielle et sur le moral des civils, une fois
privée de ces deux sources d'énergie, elle doit automatique-
ment s'effondrer. Par conséquent, ce qui est nécessaire c'est
d'obtenir la maîtrise de l'air et d'anéantir ensuite ces deux
fondements de la puissance. Durant cette dernière guerre cette
théorie, dans sa rigueur absolue, ne fut jamais entièrement
adoptée. Mais elle influença profondément la stratégie anglo-
américaine. C'est, avec cette restriction à l'esprit, que nous
ferons la citation suivante du général anglais Fuller, auteur
du livre classique “L'influence de l'armement sur l'histoire"
« Quoique entre 1939 et 1942, chaque grande offensive ait
démontré clairement qu'une conquête rapide, et par consé-
quent le raccourcissement de la guerre, dépendait de l'étroite
coopération des forces terrestres et aériennes, depuis 1942 les
Anglais et les Américains se fièrent surtout à ce que l'on
appela le bombardement stratégique. La théorie de Douhet
fut si bien acceptée (1), qu'en 1944, parlant du budget de
l'armée, le secrétaire d'Etat britannique à la Guerre disait :
"Nous avons
abouti à cette situation étonnante : la main-
d'ouvre consacrée à la production des bombes lourdes seules
est arrivée à être aussi importante que celle qui est assignée
à la production de tout l'équipement de l'Armée de terre." (2)
(1) Cette théorie ne fut en fait jamais entièrement « acceptée », pour la
bonne raison qu'un véritable bombardement stratégique, conforme à l'idée
que s'en faisait Douhet, et que l'on doit se faire, s'est révélé étre, dans les
conditions prévalentes, une entreprise irréalisable, Fuller s'en rend compte
lui-même lorsqu'il dit quelques lignes plus loin : « Pour justifier l'appella-
tion de "stratégique”, une fois satisfaits les besoins de l'armée en appui
aérien, le reste des forces de bombardement aurait dû être employé, non
pas contre les centres industriels ennemis, mais contre les sources d'énergie
et de communication. Si les mines de charbon et les usines d'essence syn-
thétique avaient été le plus rapidement possible l'objet d'un bombardement
constant, peu à peu, toutes les industries lourdes de l'Allemagne auraient
da fermer sans avoir subi de dommage. Ce ne fut qu'à la dernière période
de la guerre en Europe que l'on a eu recours à cette méthode d'attaque
systématique et le manque d'essence amena alors l'Allemagne à un effon-
drement total, » Malheureusement pour cette belle critique, tant que la
défense allemande resta réelle, un tel bombardement "stratégique" correct
fut positivement impraticable dans la majorité des cas.
(2) C'est sur le plan productif, et dans cette mesure uniquement, que la
stratégie de type Douhet a quand même été acceptée. A l'époque de la
détermination de la stratégie au niveau de la production de moyens de
destruction rien n'est plus engagé que les idées militaires, rien n'est plus
lourd de conséquences que le choix que l'on fait de favoriser la production
d'une arme plutôt que d'une autre.
25
Le résultat », poursuit Fuller, « fut que, au lieu d'une offen-
sive coordonnée, on livra deux batailles séparées ; l'une sur
le champ de bataille avec une puissance aérienne insuffisante,
l'autre contre les villes ennemies, avec des forces surabon-
dantes. Dans ces dernières attaques les pertes culturelles,
domestiques et humaines furent effrayantes. » Fuller considère
que cette orientation se solda, en fin de compte, par un échec
coûteux. De cet échec cependant il ne dit pas grand-chose.
C'est à l'aide du livre de Blackett, intitulé "Les conséquen-
ces militaires et politiques de l'énergie atomique" (1949), que
nous pourrons mesurer l'ampleur de cet échec et surtout com-
prendre sa signification profonde.
Un mot d'abord sur son auteur. Professeur de physique à
l'Université de Manchester, Prix Nobel 1948, meinbre du
comité consultatif sur l'énergie atomique, Blackett était durant
la guerre un des membres les plus éminents des « groupes
opérationnels » dont la conception a vu le jour en Angleterre
au début de la guerre et dont les U.S.A. ont développé l'em-
ploi, à leur tour, avec une ampleur inouïe. La recherche opé-
rationnelle qui était l'objet de ces groupes a pour but essen.
tiel l'analyse scientifique des opérations de guerre. L'utilisa-
tion des méthodes statistiques et du calcul des probabilités
se substitue ici à la simple expérience et au « bon sens ». C'est
ainsi que le problème de la protection des convois maritimes
contre les attaques par sous-marins a été résolu durant cette
guerre par l'adoption des grands convois au lieu des petits
convois, contrairement à l'opinion qui était alors la plus
répandue, et ceci avec succès. Le livre de Blackett a pour
ambition d'appliquer ces méthodes des groupes opérationnels
aux bombardements de la dernière guerre, et d'en extrapoler
les enseignements à la guerre atomique A (c'est-à-dire utilisant
uniquement des simples bombes atomiques). Sans vouloir le
suivre sur ce terrain particulier, déjà dépassé par la bombe H,
voyons de plus près les jugements que porte l'auteur sur le
rôle de l'aviation dans la guerre européenne 1939-1945 et qui
constituent la matière du chapitre II de son ouvrage. Les
sources qu'il a utilisées sont essentiellement celles de la com-
mission américaine d'enquête sur les bombardements straté-
giques (U.S.S.B.S.). En effet, ainsi que le rapporte Eisenhower
en conclusion de son livre "Croisade en Europe", la première
tâche de l'Armée américaine dès la fin de la guerre a été de
lancer l'opération « Histoire ». Les moyens mis en cuvre
furent énormes et d'ailleurs mis en place au cours de la guerre
elle-même ; aussi la section historique de l'Armée s'est-elle
26
fort bien acquittée de sa tâche. Le matériel ne manquait pas,
après cinq années d'une guerre gigantesque.
On avait enfin l'occasion, pensait-on, de régler la plus grave
des controverses théoriques posée par la guerre moderne, celle
dont les promoteurs avaient pour noms Douhet, Mitchell et
Seversky. Voici en quels termes Blackett la définit à son tour :
* Fallait-il utiliser en premier lieu l'aviation pour des
opérations tactiques en soutien des forces terrestres et en liai-
son étroite avec celles-ci ; ou bien pour des opérations straté.
giques, dirigées loin à l'intérieur du territoire ennemi contre
les usines, des installations militaires, etc..., indépendemment
du déroulement des autres opérations militaires...? L'échelle
des destructions pouvait-elle être telle que la volonté de résis-
tance de l'ennemi fut sérieusement amoindrie ? Les enthou-
siastes prétendaient même que cette action pouvait avoir une
envergure suffisante pour provoquer à elle seule une capitu-
lation. » Sur la base de l'analyse des opérations aériennes de
la dernière guerre, et compte tenu des moyens existant alors,
l'auteur (d'accord en cela avec la plupart des critiques mili-
taires sérieux) conclut en ces termes : « ... cette conception
stratégique a conduit à la tentative de vaincre l'adversaire par
une destruction délibérée de ses villes, après que l'expérience
des conditions réelles de la guerre eut démontré qu'il était
impossible de frapper des objectifs déterminés de petites
dimensions. »(souligné par nous). « Ce qu'on a été conduit,
poursuit Blackett, à appeler attaque de "zones", attaques de
terreur", ou plus souvent et moins correctement “bombar-
dements stratégiques" naquit, comme une forme dépourvue
de bases techniques, de la conception primitive d'attaques à
grandes distances sur des buts militaires et industriels déter.
minés. » (souligné par nous).
60
Ce passage vaut que l'on s'y arrête. Toute l'histoire de la
guerre aérienne de ce dernier conflit a été celle de l'échec des
bombardements "stratégiques" de précision. C'est-à-dire de
l'échec du bombardement "stratégique" tout court, et sa subs-
titution par une sorte d'ersatz, dans le sens propre du terme,
qui s'appelle le bombardement de "zone" et qui, à la limite,
s'identifie au bombardement de "terreur". Cet échec, cepen-
dant, n'était pas dû à une quelconque carence technique abso-
lue, mais bien à l'évolution générale des rapports entre l'atta-
que et la défense, soit le blindage et le projectile, la vitesse
de croisière des bombardiers et la vitesse ascensionnelle des
chasseurs, les moyens de détection et les moyens de brouil-
27
au fait
lage, la visée et le camouflage, etc. – tout ce que Fuller
appelle le « facteur tactique constant ». (3)
A cela s'ajoute un phénomène particulier qui ne prend toute
son ampleur que dans les guerres modernes à base indus-
trielle : toute amélioration technique pour être utilisée effi-
cacement ne doit l'être qu'à une échelle massive afin de pro-
fiter de son effet de surprise et de provoquer le maximum de
dégâts avant que la parade inévitable ait été mise au
point. Inversement, lorsque la parade existe et permet à la
défense de s'assurer un pourcentage normal de destructions,
les forces attaquantes doivent être en mesure d'assurer un
remplacement normal lui aussi, en matériel et en hommes
qualifiés (pilotes par exemple), qui entraîne au niveau de la
production et de la formation des charges proportionnellement
beaucoup plus élevées, en pourcentage, que celles des pertes
considérées en elles-mêmes. Cela est dû
que
la rota-
tion, si l'on peut ainsi dire, du procès de destruction est beau-
coup plus rapide que la rotation du procès de production, et
cela est encore plus vrai par rapport à la rotation du procès
de formation technique des hommes. Au-dessus d'un très faible
pourcentage de pertes le remplacement des équipages et des
appareils ne demeure possible qu'au détriment de la forma-
tion d'autres techniciens et de la production d'autres armes.
Il en résulte que si, malgré les pertes, on veut persister dans
un secteur particulier à maintenir un même taux d'activité,
on ne peut le faire qu'en révisant au moins partiellement sa
conception stratégique d'ensemble, avec tous les risques ter-
ribles que cela comporte ou alors il faut mettre au point
de nouvelles améliorations techniques et donc attendre que
la production des nouveaux moyens de destruction soit suffi-
samment massive pour en rendre l'utilisation rentable ; c'est-
à-dire tendre à l'allongement de la durée du conflit et ainsi
tourner le dos au but immédiat de la guerre peut-être le plus
important : raccourcir la durée des opérations. L'allongement
des conflits modernes paraît ainsi découler presque mathéma-
tiquement de l'évolution moderne des conditions dans les-
quelles se matérialise cette loi du contre-perfectionnement
que Fuller nomme le facteur tactique constant.
Si l'on voulait donner des exemples concrets il faudrait citer
la presque totalité du livre du maréchal anglais de l'Air, Sir
Arthur Harris, intitulé "Les bombardiers attaquent" et qui
retrace les péripéties de la guerre aérienne, de l'invention et
-
(3) Voici la définition résumée qu'en donne Fuller : «Chaque perfection-
nement apporté aux armes a toujours été en fin de compte suivi d'un contre-
perfectionnement qui rendait le premier suranné. »
28
la production jusqu'au combat. Nous nous contenterons de
dire quelques mots sur la personnalité de l'auteur et les con-
clusions auxquelles il arrive. L'un des promoteurs les plus
insolents et les plus ignobles des bombardements de terreur
pure il les avait préconisés avant guerre contre les tribus
arabes rebelles dans le Moyen Orient et se vante, à ce titre,
d'avoir été un précurseur - Harris reconnaît dans ce même
livre l'échec du bombardement de précision, le seul qui puisse
mériter le qualificatif de bombardement stratégique, ainsi que
l'échec, sur un autre plan, de la terreur pure et simple, au
moins, comme il l'avoue implicitement lui-même, lorsque cette
terreur s'exerce sur un pays de grande civilisation moderne,
et non plus sur des tribus pastorales. C'est explicitement, par
contre, qu'il avoue que les bombardements de terreur, les
bombardements de "zones", n'ont d'autre origine que l'inca-
pacité dans laquelle se trouvaient les forces attaquantes d'effec-
tuer des bombardements de précision sur une grande échelle.
Ainsi il n'est pas exact qu'une stratégie purement terroriste
ait jamais été entièrement et systématiquement adoptée durant
la dernière guerre. Cela ne veut pas dire qu'une telle stratégie
ne puisse l'être en aucune circonstance. Cela veut seulement
dire que, sur la base d'une expérience concrète, mise à l'épreu-
ve par les faits, les classes dominantes sont parvenues à la
vague notion que, d'une manière ou d'une autre, une telle
stratégie est en définitive relativement inopérante. Certes
l'apparition de nouveaux moyens plus puissants, tels que les
bombes A et H, remettent, comme d'habitude, en cause cette
"sagesse" expérimentale. A l'étape actuelle de notre raison-
nement ce qui nous intéresse c'est uniquement de prouver que
jusqu'ici une telle stratégie terroriste n'a pas été systémati-
quement adoptée, contrairement à l'opinion la plus répandue.
Il est vrai cependant que les bombardements de Hiroshima
et Nagasaki ont eu indéniablement ce caractère. Pourquoi ?
Premièrement parce que les conditions de la guerre véritable
n'étaient justement pas données dans ce cas. Compte tenu
même de l'effet de surprise et du fait que l'expérience ne
s'est pas renouvelée, le « facteur tactique constant » n'a pas
joué. La défense, déjà trop faible dans un pays à la veille de
la capitulation, ne s'occupait jamais des avions d'observation ;
or, le bombardier porteur de la bombe qui naviguait seul
avait été pris pour un avion d'observation, auquel personne
n'a fait attention et contre lequel personne n'aurait songé à
se protéger, même suivant les techniques de la défense passive.
Ensuite et surtout parce que cet acte de terreur était bien plus
destiné aux Russes qu'aux Japonais. Ce premier bombardement
29
atomique devait être le plus spectaculaire possible ou ne pas
être du tout. Premier acte de la guerre "froide” contre la
Russie (4), cette explosion devait être véritablement exem-
plaire. La naissance de la suprématie américaine incontestable
se devait d'être incontestablement affirmée. A la fois cobayes
effrayants d'une nouvelle arme et symboles d'une nouvelle ère
celle de la suprématie américaine — voilà ce que furent
les misérables victimes de ces deux jours d'août 1945. Mais
tout cela ne fonde pas une stratégie ainsi que la suite l'a
démontré.
Avec les trois auteurs que nous venons de citer nous avons
parlé de « l'échec des bombardements de cette dernière
guerre ». Il faut préciser. Il ne s'agit ici ni de sang, ni de
misère, ni de terreur, car de cela il y eut profusion. Ce n'est
pas cette aune-là qui sert de paramètre aux classes dirigeantes.
Il s'agit de chiffres. Sur la base de l'enquête américaine de
l’U.S.S.B.S., Blackett dresse le bilan mathématique des bom-
bardements de zones. Nous ne pouvons cependant en citer
ici que les extraits les plus caractéristiques. Voyons d'abord
les forces engagées : «Le poids total des bombes jetées sur
tous les objectifs par les forces anglo-américaines a été de
2.700.000 tonnes. Le nombre total des appareils perdus (bom-
bardiers et chasseurs d'escorte) a été de 40.000, et les pertes
en personnel de 160.000 (5). Le personnel total des services
engagés dans la guerre européenne a atteint 1.300.000 en 1944
et 1945 (U.S.S.B.S., 1). Le poids total des bombes lancées sur
l'Allemagne seule a été de 1.300.000 tonnes. Il y a eu environ
500.000 tués, soit une moyenne de 0,38 tué par tonne de
bombes. » Voici maintenant les résultats chiffrés. Les indices
de la production de guerre allemande ont évolué ainsi : 1940 :
100 ; 1941 : 101 ; 1942 : 146 ; 1943 : 229; 1944 : 285. La pro-
duction d'avions en Allemagne et en Angleterre varie de 1940
à 1944 de la manière suivante : Allemagne de 10.200 à 39.600,
avec un total de 100.000 ; Royaume Uni de 15.000 à 26.500 en
1944, avec un total de 111.400. Pour les tanks les chiffres sont
les suivants : Allemagne 1.500 à 19.000, total 42.800 ; Royaume
Uni : 1.400 à 4.600 (maximum en 1943 de 7.500) avec un total
de 26.900. Enfin on a évalué les pertes de production dues aux
bombardements stratégiques des villes allemandes comme suit :
en 1942 : 2,5 % ; en 1943 : 9,0 % ; en 1944 : 17,0 % ; en
(4) Voir dans le n° 4 de « Socialisme ou Barbarie » (p. 75' et s.) l'historique
de cette question qui ne laisse aucun doute à cet égard.
(5) Voir plus haut ce que nous avons dit des problèmes posés par la
vitesse de rotation du procès de destruction et son importance dans la
guerre.
30
1945 (4 premiers mois) : 6,5 %. En 1943 l'offensive de bom-
bardement total n'a réduit la production globale allemande
que de 10 % environ et la production des armements que
de 5%.
Ces chiffres ont donné lieu à une interprétation stratégique
générale que nous ne rapporterons que pour mémoire. Trop
partielle pour que l'on s'y arrête longtemps, elle est cependant
caractéristique des problèmes que pose la guerre moderne,
dont la stratégie, répétons-le, trouve ses véritables détermina-
tions au niveau de la production. Le raisonnement est le sui-
vant : ni l'Allemagne ni la Russie n'auraient pu emporter leurs
victoires décisives successives si elles avaient consacré à la
production de bombardiers stratégiques le potentiel qu'elles
ont utilisé à produire des avions de combat et de proche sou-
tien, qui ont joué un rôle vital dans les opérations terrestres.
Il y a là un choix dont les conséquences peuvent être très
graves parce que, se situant au niveau de la production, il
engage automatiquement pour une longue période sur les che-
mins d'une stratégie qui peut se révéler inefficace. Il est vrai
que ce choix-là ne se posait pas entièrement dans les mêmes
termes pour les Anglo-américains, qui, avant le débarquement,
n'avaient que peu d'autres possibilités d'intervenir activement
dans la guerre et pour qui une intervention active demeurait
une nécessité morale. Pour en terminer avec le livre de
Blackett nous rappellerons qu'il a pour objet d'extrapoler les
enseignements de la dernière guerre à une guerre atomique
éventuelle. Dans la mesure où ces extrapolations sont dépas-
sées
lorsqu'elles ne sont pas tout simplement contestables
nous ne nous y arrêterons pas. Néanmoins
pour
fixer les idées
et donner un aperçu des échelles de grandeur nous rapporte-
rons quelques passages essentiels de son raisonnement.
1° Une bombe au plutonium produit une onde de choc
comparable à celle que produirait l'explosion d'une masse de
20.000 tonnes de T.N.T. Cependant en se basant sur les études
attentives des dégâts occasionnés à Hiroshima et Nagasaki on
a déterminé qu'il faudrait à peine plus de 2.000 tonnes de
bombes à explosif de grande puissance - par exemple des
"blockbursters" de 10 tonnes pour produire sur les cons-
tructions les mêmes dégâts qu'une seule bombe au plutonium.
2° Sur la base d'une équivalence non plus de 2.000 tonnes
mais de 3.000 (pour tenir compte des améliorations apportées
à la bombe A depuis cette époque), l'auteur calcule que les
1.300.000 tonnes de bombes lancées sur l'Allemagne durant la
guerre pourraient être remplacées par environ 400 bombes
atomiques.
31
30 Toute une analyse de l'attaque et de la défense dans les
conditions actuelles (en 1949) suit, tendant à évaluer l'effort
productif total qui serait nécessaire, compte tenu des pertes.
pour arriver à un résultat analogue. Comme ce résultat s'était
révélé insuffisant, on voit les conclusions de l'auteur : il ne le
serait pas moins avec l'arme atomique A.
Cependant ces conclusions laissent de côté des aspects im-
portants du problème. Sans parler du fait que les destructions
produites par la bombe atomique sont beaucoup plus radicales
et durables (6), Blackett oublie que la bombe A, dans son
principe, portait en germe des développements infiniment révo-
lutionnaires, qui ont abouti à la bombe H. Il est vrai et
c'est une des caractéristiques les plus profondes de notre épo-
que - que les progrès techniques vont autrement plus vite
que l'imagination humaine. Ainsi l'auteur, tout professeur de
physique et prix Nobel qu'il soit, cite comme une vague et
improbable eventualité (au moins à court terme) une bombe
à hydrogène ou au lithium, dont « les qualités... sont toujours
dans le domaine des hautes spéculations ». Cinq années plus
tard, les atroces blessures des pêcheurs japonais ne matériali-
saient que trop ces soi-disantes spéculations.
LA BOMBE ATOMIQUE A ELLE SEULE
NE TIENT PAS LIEU D'UNE STRATEGIE
Nous nous sommes suffisamment étendus sur la première
erreur qui se trouve à l'origine matérielle de la conception
apocalyptique de la guerre, pour pouvoir aborder brièvement
la seconde. Il s'agit, rappelons-le, de la longue durée du mono-
pole américain de la bombe A et de la confusion qui règne
en Amérique dans le choix d'une stratégie ferme.
Il est exact que pendant toute sa durée ce monopole impli-
quait un avantage énorme. Il suffit de penser qu'une entre-
prise aussi gigantesque pour l'époque et aussi décisive, que
(6) Ce qui frappe dans les bombardements normaux c'est que si les
bâtiments sont soufflés, les machines demeurent pour la plupart intactes.
La capacité de récupération allemande a dépendu en grande partie de ce
fait. Il est donc inexact de dire avec Blackett que dans le périmètre utile
de destruction totale de la bombe A, il y ait surpuissance inutilisée. Sans
parler de la radioactivité dont la persistance, sur un périmètre d'ailleurs
plus large, entrave une remise en marche rapide, la chaleur dégagée est
suffisante pour faire littéralement fondre les installations et les machines.
D'autre part la nature des destructions dépend de la hauteur à laquelle on
fait exploser l'engin. Celles-ci dépendront donc de l'effet principal recher-
ché : destructions étendues mais plus superficielles ou destructions limitées
mais radicales.
32
le fut le débarquement en Normandie, eût été rendue absolu-
ment impraticable avec seulement une ou deux bombes A
bien placées (ou bien sur une des principales zones anglaises
d'embarquement, ou bien sur l'armada alliée, ou bien au
moment du débarquement). Mais c'est là un avantage défensif.
Aussi est-il vrai que durant la période du monopole américain
la situation d'une Russie attaquante n'aurait pas été enviable.
Toute entreprise majeure de sa part, au début des hostilités,
aurait pu être freinée et les éléments essentiels de l'attaque
que sont la surprise et le succès immédiats être réduits à zéro.
Par contre une dizaine de bombes A, ou même plus, dans les
mains des Etats-Unis ne pouvait en aucun cas être un gage de
victoire. Il aurait fallu que ce monopole soit conservé durant
un certain temps, assez long pour permettre un réapprovision-
nement suffisant, sans pour cela garantir, loin de là, que l'Eu-
rope puisse être victorieusement défendue.
De plus, il ne faut pas oublier, dans ce contexte, que si la
parade la plus radicale à l'arme atomique est l'occupation du
pays ennemi, celle de pays alliés ou neutres constitue une
parade déjà partiellement très efficace. L'utilisation de la
bombe A contre les centres industriels et humains d'une
France envahie par exemple, ne peut en aucun cas être mise
en parallèle avec les bombardements “stratégiques" de la der-
nière guerre par l'aviation américaine. On ne "libere"
pas un
pays en l'arrosant de bombes atomiques, on se l'aliène. C'est
certes faisable, mais cela pose alors tout le problème des
alliances et de leur utilité, pour ne parler que de cela. (7)
En fait cette période du monopole américain de la bombe A
a été caractérisée par un avantage américain des plus négatifs.
Sur le plan positif rien n'était résolu. Cela est si vrai que les
polémiques de l'époque portaient sur l'efficacité éventuelle des
moyens aériens de transport des bombes dans les conditions
réelles du combat. On se souvient de la polémique entre l'avia-
tion et la marine à propos du B. 36. Le chasseur embarqué
était-il capable d'intercepter le bombardier à long rayon d'ac-
tion ? C'était poser le problème des contre-perfectionnements
de l'attaque et de la défense dans le domaine de l'arme
aérienne, problème quasi insoluble a priori, ainsi que l'a
prouvé abondamment l'expérience de la dernière guerre. Pour-
(7) Voir nos conclusions à la fin de cet article.
33
tant là encore le choix réel se situait au niveau de la produc-
tion. (8) On ne peut tout produire à la fois : des super-porte-
avions, des bases aériennes fixes, des chasseurs d'interception,
des bombardiers lourds... et des réseaux radar d'une densité
suffisante pour assurer
une détection efficace. Porté à ce
niveau le vrai problème devient infiniment plus vaste et l'on
ne peut confier sa solution à la "sagacité" d'un calculateur
électronique comme cela fut le cas dans la controverse chas-
seur embarqué-bombardier lourd. En définitive la bombe A
et son monopole n'ont pu servir qu'à fonder la théorie amé-
ricaine de la guerre froide. Ce monopole eût été, à lui seul.
bien incapable de donner des bases solides à une guerre pré-
ventive contre les Russes qui soit efficace.
APRES LE MONOPOLE
+
Lorsque les Russes brisèrent le monopole américain de la
bombe A, ce fut l'effondrement. La guerre de Corée fut la
conséquence d'ailleurs décidée à tort de cette évolution.
Le plus clair de la réponse américaine sur le plan stratégique
le plus élevé, fut de faire passer les crédits militaires (qui
étaient d'environ 15 milliards de dollars) à un chiffre astrono-
mique dépassant les cinquante milliards de dollars. Quant à la
guerre de Corée elle-même, il n'y a que peu de choses à dire à
son propos concernant la grande stratégie, Guerre locale, elle
ne put même pas servir de banc d'essai aux armes nouvelles,
comme ce fut le cas de la guerre d'Espagne pour les puissan-
ces de l'Axe. Le risque conformément à la loi que nous
avons énoncée plus haut, – était et sera toujours trop considé.
rable, pour les deux camps, d'essayer sur une trop petite
échelle des armes nouvelles (bombes atomiques, fusées, engins
téléguidés, etc...), suscitant ainsi sans profit décisif des progrès
parallèles de la défense. Dans ce sens, les guerres locales seront
doublement catastrophiques pour les Américains, tant qu'ils
seront incapables de les mener, comme le font les Russes, par
personnes interposées et tant que, faute d'un appui populaire
quelconque, ils seront obligés d'y entrer avec un rapport de
forces qui leur est au départ défavorable.
(8) Les progrès techniques ne font qu'aggraver la chose, ainsi que nous
l'avons déjà noté. Les gros bombardiers modernes russes comme améri-
cains sont dotés d'un viseur électronique, qui, à lui seul, coate ce que
coûtait un chasseur bombardier. Ils n'en demeurent pas moins vulnérables
dans la défense, bien que plus efficaces dans l'attaque. Par contre leur
perte, et partant leur remplacement, représente sur le plan productif une
charge d'autant plus lourde.
31
L'impasse à laquelle avait abouti la stratégie américaine était
véritablement tragique. C'est dans ces conditions que fut déci-
dée la fabrication de la bombe H, alors qu'une partie des
savants nucléaires américains s'y opposaient avec toute la fer-
meté gratuite dont ils disposaient. Ils ne purent l'empêcher,
mais ainsi se trouvait ouverte la grande crise des savants amé-
ricains, qui n'est pas près de se clore.
En fait, en agissant ainsi, on ne faisait que reposer le pro-
blème sous un angle nouveau. Et cet angle nouveau semble se
situer à un niveau tel que, plus que jamais, il dépasse les som-
mités pensantes des classes dominantes. Des faits récents le
prouvent déjà partiellement. Le nouveau monopole américain
H dura ce que durent les roses. Bien mieux, les Russes mirent
au point une bombe H transportable par avion avant les Amé-
ricains (la première bombe H américaine était grande comme
un immeuble). En réponse, les efforts de ces derniers devin-
rent frénétiques. Les récentes expériences du Pacifique — d'ai).
leurs pleinement couronnées de succès - en font foi. Par ur
coup tragique du destin, les pêcheurs japonais ont de nou-
veau joué le rôle de cobayes.
Cette évolution éclaire la politique américaine d'un jour
nouveau. Celle-ci reflète les contradictions immenses que ren-
contre de nos jours la détermination d'une stratégie cohérente.
On a parlé récemment, et à nouveau lors des événements d'In-
dochine, du problème de la généralisation de la guerre en
Asie. Ce dilemme ne pose pas uniquement le risque d'une
guerre universelle. Il pose celui, plus grave encore au point
de vue des classes dominantes, de la détermination d'une stra-
tégie cohérente dans laquelle les cercles dirigeants puissent
avoir une confiance suffisante. Ce n'est pas d'aujourd'hui que
dans leur propagande ces messieurs disent que dans une guerre
moderne il ne peut y avoir de vainqueur, Hitler le disait en
1939 (9). En parlant ainsi, ils jouent sur les mots. Au vrai, il
leur suffit pour déclencher le massacre qu'ils aient confiance
dans leur capacité de battre l'adversaire éventuel. Pour cela il
leur faut une stratégie dans laquelle ils aient confiance et qui
leur paraît supérieure à celle supposée de l'adversaire. On peut
être sûr que le camp interventionniste américain, dit clan Rad-
(9) Il s'agit ici de vainqueur en définitive, c'est-à-dire sur le plan écono-
mico-social, et en cela ils ont partiellement raison, bien qu'au point de vue
étroit d'une classe dirigeante cela n'ait pas grand sens. Avec la bombe H
la seule chose que craignent véritablement les seigneurs modernes c'est
d'empoisonner la terre. L'autre aspect de la question c'est la peur de la
révolution des masses elles-mêmes. C'est ce que Hitler exprimait en disant
que le grand vainqueur risquait d'être « Trotsky ». Mais de nos jours ces
Messieurs n'y croient plus beaucoup.
35
1
ford, est en même temps celui qui croit posséder une doctrine
de guerre qui soit positive.
Nous sommes arrivés au terme de la deuxième erreur qui
se trouve à l'origine matérielle de la conception obscurantiste
de la guerre apocalyptique. L'exposé a pu sembler long, mais
rien n'est plus difficile que de combattre des erreurs collecti-
ves, collectivement véhiculées par tous les moyens modernes
de transmission et de diffusion. Que peut-on conclure provi-
soirement grâce au recul que confère l'analyse?
Premièrement, que la guerre purement terroriste ne s'est
encore pas imposée dans l'histoire comme la doctrine idéale,
mais qu'au contraire la terreur ne s'y manifeste que comme
un phénomène aberrant ; que ce phénomène aberrant lui-
même découle de la conjonction des conditions modernes in-
dustrielles et du « facteur tactique constant », conjonction qui
conduit à un allongement du conflit et à la limite à une véri-
table impasse stratégique ; que donc la terreur constitue bien
un des pôles idéaux de la guerre, mais que ce pôle est celui
que l'on peut qualifier
peut qualifier au point de vue de l'efficacité de pôle
négatif et non justement, comme on tend à le faire croire, de
pôle positif, lequel ne peut être, suivant la formule de Clau-
sewitz, que la mise hors de combat de l'adversaire, et non
l'annihilation de ses populations non combattantes.
Deuxièmement, que l'impasse stratégique croissante pousse
irrésistiblement à la recherche de la surpuissance comme solu-
tion, que tant que celle-ci n'est pas atteinte tout reste équi-
voque dans la guerre, que jusqu'à ce moment, toute théorie
de la guerre reste grevée d'une lourde hypothèque qui fausse
le raisonnement. Or, justement avec la bombe II, la surpuis-
sance véritable (10), celle qui ne peut être dépassée dans son
le raisonnement. Or, justement avec la bombe H, la surpuis-
essence qualitative, pour la première fois est atteinte dans
l'histoire de l'humanité.
QUELLES SOLUTIONS PRATIQUES LA BOMBE H
APPORTE-T-ELLE AUX PROBLEMES STRATEGIQUES
DE NOTRE EPOQUE ?
Arrivés à ce stade du raisonnement nous allons commencer
par examiner ce que la bombe H, grâce à un emploi limité et
(10) On peut trouver de meilleures armes, plus précises, plus efficaces
au point de vue stratégique, on ne peut plus accéder à une puissance de
feu qualitativement aussi différente de la bombe H que cette dernière l'est
par rapport aux explosifs classiques à base de T.N.T.
36
circonstancié, est capable de résoudre et qui n'avait pas été
résolu jusqu'ici.
Il faut le reconnaître sans détours sans les détours qu'em-
pruntait Blackett au prix d'une certaine gymnastique lorsqu'il
ne s'agissait encore que de la bombe A : une très grande partie
des problèmes jusqu'ici insolubles que posait le « bombarde-
ment stratégique » sont maintenant résolus. Cela tient tout
d'abord à la différence qualitative qui existe entre les deux
types de bombes. L'une -- la bombe A est limitée dans ses
effets destructeurs par l'impératif de la masse critique d'ura-
nium ou de plutonium qu'il convient d'utiliser pour que la
fission puisse avoir lieu. L'autre - la bombe H à laquelle
une bombe A sert d'amorce, est susceptible d'être grossie quasi
indéfiniment. Certes, dans un cas comme dans l'autre, ce n'est
qu'une infime partie de l'énergie libérée qui devient "utile"
mais dans le second cas cette infime partie elle-même devient
démesurée à l'échelle humaine. Cela ne signifie évidemment
pas que dans la pratique de la guerre une multitude de limi-
tes n'existent dans l'extension de la puissance de la bombe H ;
cela veut seulement dire que de telles limitations ne sont plus
inhérentes au principe même de la bombe, mais bien exté-
rieures à lui.
Toujours est-il que dans l'état actuel des choses, la puis-
sance théorique de la bombe H est de près de 1.000 fois celle
de la bombe A, et surtout, que son aire de destruction est de
100 fois supérieure : 20 kilomètres de diamètre de destructions
totales au lieu de 2 kilomètres, et 200 kilomètres de destruc-
tions partielles au lieu de 20. La première conséquence – et
peut-être la plus importante à court terme - de cet état de
choses c'est qu'il bouleverse un certain nombres de termes du
facteur tactique constant », tels qu'ils se posaient jusqu'ici.
On sait, par exemple, que la précision des fusées est inverse-
ment proportionnelle à leur portée, et que jusqu'ici cette préci-
sion, même à petites distances, n'est pas très grande. Sur une
distance proche de 1.000 kilomètres -- ce qui est un minimum
dans une guerre à l'échelle continentale une bombe A ris.
quait de tomber à plus de 20 kilomètres de son objectif. Avec
une bombe H, dans un rayon de moins de 200 kilomètres, des
destructions profondes et déjà durables peuvent être effectuées.
Un objectif comme le canal de Suez n'est plus à l'abri
d'une attaque par fusée téléguidée, au départ d'une base située
à 1.000 kilomètres environ (11). L'argument d'une exigence
moins considérable en matière de précision est aussi valable
(11) A condition évidemment que cette fusée ne soit pas interceptée.
37
pour l'aviation classique, compte tenu évidemment de la vul.
nérabilité à la défense antiaérienne plus grande de l'avion.
Ainsi, de nos jours, une guerre atomique de type H pour-
rait fort bien permettre les opérations stratégiques suivantes
avec plus ou moins de succès :
lº Attaque atomique H des centres de production atomique
de l'adversaire ;
2° Attaque atomique H ou A, des bases aériennes de départ
des bombardiers atomiques (et partant de la partie des stocks
de bombes qui sont entreposées à proximité de ces bases de
départ) ;
30 Attaque atomique des P.C. administratifs où sont con-
centrés les renseignements et les télécommunications, dans la
mesure où ils sont concentrés et ils le sont obligatoirement
plus ou moins ;
4° Attaque atomique des noeuds de communication et des
centres énergétiques les plus essentiels :-grands canaux, grands
lacs formant voies de communications, centres ferroviaires de
triage, régions pétrolières et charbonnières de grande densité.
On remarquera que dans ce schéma en quatre points prin-
cipaux, il n'est question que d'une destruction des bases et des
connexions matérielles de la société, et non, comme chez
Douhet, de ses bases humaines et de ses supports moraux. Si on
réfléchit un peu en effet on se rend compte qu'il n'est nulle-
ment indispensable pour gagner la guerre de pulvériser des
centres urbains de deux à dix millions d'habitants (au risque
d'ailleurs de subir un sort analogue à titre de représailles).
A vrai dire, c'est le contraire qui est vrai. Paralyser gravement
les transports et les sources énergétiques d'une société mo-
derne, c'est placer cette société dans un état de crise qui ne fera
que décupler les contradictions existant à l'état normal. La
bombe H, en tant que produit d'une civilisation hautement
industrialisée, découle directement de la concentration, aussi
n'est-il pas étonnant que ce
celle-ci soit sa première cible. Mais
cela peut être vrai, soit à un niveau primaire destruc-
tion
pure et simple des centres urbains de la concentration
soit à un niveau plus élevé : rupture des connexions qui exis-
tent entre ces centres urbains de concentration et la société
prise dans sa totalité, et, par là même, libération des forces
sociales explosives de la société adverse, forces dont la puis-
sance ne le cède en rien à la désintégration atomique.
La destruction aveugle de concentrations humaines, inverse-
ment, ne peut libérer que des forces hostiles à la société atta-
quante qui est à l'origine de cette destruction : la haine inex-
H
1
38
piable de l'ennemi" ne peut qu'en découler avec tout ce que
cela implique.
Certes, une telle stratégie serait celle qu'adopterait une
classe dominante agissant d'une manière “intelligente". Mais,
en fin de compte, même la classe dominante la plus obtuse et
la plus impuissante ne fera pas quelque chose de fondamen.
talement différent. Le seul argument réel existant en faveur
de la guerre apocalyptique réside en ceci : si nous ne la fai-
sons pas les premiers, c'est l'adversaire qui risque de la faire.
En fait, il s'agit là d'un sophisme, car chacun des deux adver-
saires fait le même raisonnement et sait que l'autre le fait. Il
n'y a que dans le cas d'une supériorité technique très mar.
quée de l'un sur l'autre, et donc à titre préventif (car une telle
supériorité ne peut qu'être éphémère), que la politique dite
des « représailles massives » (12), puisse se justifier. Or, non
seulement une telle disproportion des forces en présence est
une illusion, mais encore cette manière de voir les choses ne
tient pas compte des conditions réelles du combat.
En effet, qu'il s'agisse de destructions massives des popu-
lations ou seulement de destructions matérielles, l'existence
de la bombe H ne signifie nullement la solution enfin trouvée
de la guerre-éclair. S'il est vrai que l'étendue des destructions
H a relégué sur un plan plus modeste le facteur précision,
le problème de la livraison à très grandes distances des bombes
non seulement n'est pas facilité, mais au contraire devient
considérablement plus difficile. Et cela du fait de l'existence
même de l'arme atomique. En d'autres termes, la bombe ato-
mique elle-même intervient dans le processus d'évolution du
facteur tactique constant en tant qu'arme défensive.
Attaques massives, cela est bien beau, mais qu'est-ce que cela
veut dire ? Jusqu'ici, cela voulait dire, entre autres, dès qu'il
s'agissait de pénétrer profondément en territoire ennemi, atta-
ques aériennes en formations massives. C'était la seule manière
de mettre en échec les assauts de l'aviation de chasse enne-
mie. C'est aussi ce qui justifiait le développement, pour la
défense, de l'artillerie antiaérienne. Or justement, face à des
formations massives d'avions, l'arme antiaérienne idéale, c'est
la bombe atomique elle-même. En faisant exploser une bombe
atomique à proximité d'une armada aérienne, on est sûr de
(12) Cette expression utilisée par les Américains constitue un curieux
abus de langage. Représailles à quoi ? S'il s'agit de représailles à des
attaques atomiques elles-mêmes massives des Russes cela va de soi et ne
signifie rien. S'il s'agit d'une réponse à des conflits déclenchés localement,
cela signifie que l'on est prêt à déclencher la grande guerre à leur propos.
Enfin cela peut vouloir dire : même si vous n'utilisez pas cette méthode,
nous nous l'utiliserons, ce qui est gratuit comme avertissement.
39
la destruction totale. Dans le domaine aérien, comme dans
le domaine naval et le domaine terrestre, l'arme atomique
défensive fait de la dispersion un impératif absolu, alors que
la dispersion augmente la vulnérabilité aux armes classiques
et pour le moins favorise relativement la forme défensive.
Cette considération à elle seule suffit à ruiner la politique des
“représailles massives" : un coup terrible (comme ce fut par
exemple cas de Pearl Harbour) qui n'est pas décisif, se
retourne ineluctablement contre celui qui l'a donné, car loin
d'abattre l'adversaire, comme il se proposait de le faire, il ne
fait que fouetter son énergie et sa résolution dans le combat.
QUELQUES CONCLUSIONS
.
1
Si l'on veut étudier la guerre moderne à la lumière de la
révolution atomique, il convient avant tout de changer d'op-
tique. Tout y est à une autre échelle que celle des guerres
antérieures, y compris la dernière dont les deux seules explo-
sions nucléaires, pour atroces qu'elles fussent, n'eurent qu'un
caractère "expérimental”. Avec la bombe H, il suffirait de trois
exemplaires bien placés pour qu'un « petit pays » comme la
France ne voit que de bien petites parcelles de son ter-
ritoire épargnées. A ce titre, si la guerre apocalyptique était
inéluctable, les Anglais de la métropole n'auraient plus qu'une
chose à faire : rédiger tous leur testament au profit de quel-
ques parents émigrés à l'autre bout du monde.
En fait, la bombe H est à l'échelle d'une guerre entre conti-
nents et implique cette guerre. Dans cette mesure, une pro-
chaine guerre serait déjà, de par son existence même, quelque
chose de très différent, dans ses objectifs aussi bien que dans
ses moyens, des guerres “nationales" et même des guerres
“impérialistes” (telles que les définissait Lénine) précédentes.
Son objectif ultime ne peut être que la domination mondiale
et son enjeu immédiat en même temps que son moyen ne peut
être que la domination matérielle et idéologique de ce formi-
dable continent intermédiaire qu'est l'Europe. Enjeu immé-
diat parce que le potentiel de l'Europe, en grande partie mal
utilisé par les nations antagoniques qui la composent, est seul
capable de faire pencher la balance des forces dans un sens
ou dans l'autre. Moyen parce que, tant que l'Europe demeure
un enjeu, et non une partie intégrante de l'un des deux blocs,
son occupation et l'utilisation – même pas définitive mais
seulement temporaire -- de son potentiel matériel et humain,
4
40
nslu
a
Iue utilcurtjieith it d'arme atomique. Parade
d'abord parce que le continent européen confère à celui qui le
tient une profondeur stratégique supplémentaire ; parade
ensuite et surtout parce que sa conquête sociale et idéologi-
que reste à faire et que la surpuissance à cette échelle de
l'arme atomique met, provisoirement au moins, l'Europe à
l'abri de ses dévastations. Croit-on, par exemple, que si les
Russes étaient capables d'envahir et d'occuper l'Angleterre, les
Américains y riposteraient en la détruisant à coup de bombes
H? Poser la question, c'est y répondre.
Pourtant ce genre de réponse peut ne pas sembler entière-
ment satisfaisant, et ceci à juste titre. En effet les considéra-
tions précédentes pour être justifiées n'en sont pas pour cela
impératives : cela dépend des circonstances. Aussi convient-
il d'élargir encore la conception que l'on peut se faire d'une
guerre à venir. C'est non seulement une optique continen-
tale qu'il faut adopter mais encore une optique qui soit con-
forme aux conditions d'évolution de la technologie moderne.
On peut affirmer, sans crainte d'être démenti, que les pro-
grès techniques sont si rapides à notre époque que les con-
ditions techniques générales du combat se trouvent entière-
ment bouleversées dans un laps de temps qui ne fait que
diminuer au fur et à mesure que la société moderne industria-
lisée et proletarisée approfondit son emprise sur la nature.
Un seul exemple nous suffira pour en apporter la preuve.
Plus que jamais ce que l'on appelait autrefois la « maîtrise
de l'air » est devenu l'élément décisif de la guerre de demain :
il semblerait que l'air est devenu l'espace privilégié par rap-
port à la terre ou la mer. Pourtant, ce problème de la « mai-
trise de l'air >> qui est devenu le problème numéro 1 de la
guerre se trouve posé de nos jours dans des termes d'une
complexité telle que l'expression même de « maîtrise de l'air >>
se trouve vidée de toute signification concrète. Pour «maîtri-
ser » l'espace aérien, il faudra, à l'avenir, de plus en plus être
capable de s'assurer de la supériorité relative dans la quasi
totalité des domaines, aussi bien “terrestres” qu'aériens”,
aussi bien "tactiques" que “stratégiques". Dans le duel
terre-air, le rôle de l'artillerie" antiaérienne ayant pour
moyen essentiel la fusée qui est un engin volant à côté
de nombreux autres engins volants eux aussi, atteignant
une vitesse supersonique) transforme les rapports terre-air
d'une manière si radicale que la maîtrise de l'air et celle du
sol se posent dans des termes non plus particuliers et opposés,
mais généraux et communs à l'une et à l'autre : ceux de la
"maîtrise" de l'espace. Or, les progrès en ce domaine de "ram-
41
pants”, pour être moins spectaculaires que ceux de la bombe
atomique, n'en soint ni moins décisifs ni moins rapides. Il y a
deux raisons à cela : tout d'abord les progrès technologiques
se répartissent à peu près également dans tous les domaines :
en deuxième lieu, l'existence même des bombes A et H a joué
un rôle accélérateur important dans le développement inces-
sant de la technologie guerrière et de son organisation maté.
rielle et humaine. De plus, les effets de cette influence ne
feront que s'accumuler avec le temps, alors même que les pro-
grès en matière nucléaire (au moins sur le plan de la destruc-
tion) ne peuvent que marquer le pas pour un certain temps.
On se trouve donc en présence d'une évolution générale des
moyens de destruction et non pas seulement d'une évolution
particulière - et particulièrement importante il est vrai –
d'un type donné d'arme. L'arme atomique représente indénia-
blement l'arme dominante de demain, mais, d'une part toutes
les autres armes et tous les autres moyens matériels s'orga-
nisent en fonction d'elle et donc la circonscrivent dans un
ensemble et, d'autre part, son existence même accélère le
développement et le perfectionnement de ces autres armes
et de ces autres moyens sur une échelle comparable à celle de
sa puissance démesurée.
Nous avons là incontestablement une évolution générale de
la guerre et le problème que pose cette évolution générale est
celui de savoir si on peut lui trouver des lois et lesquelles.
Tout ce que nous avons voulu montrer dans cet article, c'est
que ces lois ne peuvent se résumer à une seule qui serait la
suivante : la guerre tend inéluctablement vers une destruction
totale réciproque. A défaut d'avoir prouvé décisivement ici que
cette proposition est fausse et montré ce que serait la vraie,
nous pensons que nous avons montré que jusqu'ici aucun argu-
ment sérieux n'a jamais été avancé pour la fonder. En d'au-
tres termes si le concept de la guerre apocalyptique est sans
conteste très répandu de nos jours, cela ne signifie nullement
qu'il repose sur des bases objectives et encore moins que l'on
puisse penser que son acceptation aille de soi.
Le degré de confusion auquel on est arrivé sur cette ques-
tion justifie à nos yeux la rédaction d'un article d'un caractère
aussi particulier que celui-ci. Il convenait de déblayer le ter-
rain avant d'aborder la
question
un angle plus
élevé et de tenter de donner une réponse positive au pro-
blème toujours renouvelé de l'évolution moderne de ce phé-
nomène que l'on appelle la guerre, c'est-à-dire une réponse
sous
42
qui soit directement reliée aux perspectives de la révolution
prolétarienne. Nous avons déjà abordé ce problème dans cette
Revue (13) et nous aurons l'occasion d'y revenir.
PHILIPPE GUILLAUME.
1
(13) « La guerre et notre époque », nºs 3 (p. 1 à 21) et 5 (p. 77 à 123).
43
DOCUMENTS
La vie en usine
IV.
APERÇUS SUR LA DYNAMIQUE DE LA LUTTE
OUVRIERE A L'USINE
Jusqu'à présent (1), cette étude s'est bornée à mettre en
valeur le cadre dans lequel s'exercent les divers antagonismes
qui sillonnent toute l'entreprise et dont le majeur est la lutte
patronat-ouvriers. Ont été ainsi fournis quelques éléments sur
les possibilités d'action de chacun, et de chacune des « cou-
ches » du personnel, suivant sa position propre dans la pro-
duction. On a insisté tout particulièrement sur le fait qu'il
n'y a pas d'harmonie dans la base des rapports de tous avec
tous, mais que nécessairement ceux-ci, caractérisés par l'ex-
ploitation capitaliste, se traduisent par un conflit général sans
cesse en mouvement,
C'est cette lutte permanente que nous allons examiner main-
tenant, à la lumière des faits, dans ses différentes manifesta-
tions et suivant son évolution, que ce soit sur le plan indivi-
duel ou collectif, sans omettre les interférences ineluctables,
en traversant les nuances du spectre qui va du pur égoïsme
individuel à la participation à l'action d'un organisme possé-
dant un programme social, quel qu'il soit.
(1) Voir les parties précédentes de ce texte, publiées dans les nos 11
(p. 48-54), 12 (p. 31-47) et 14 (p. 51-61) de « Socialisme ou Barbarie ».
44
Car il semble absolument indispensable, précisément à notre
époque où l'accent est généralement mis par la presse, aussi
bien que par les organisations se réclamant de la classe
ouvrière, sur l' « apathie » ouvrière, et son « incapacité » à
réaliser les objectifs socialistes, de déterminer plus précisé-
ment les données de la lutte ouvrière contre le capitalisme.
C'est ainsi qu'on doit examiner :
Dans quelle mesure un ouvrier acquiert un esprit de
classe, autrement dit comment il en arrive à combattre et
même à militer ;
En fonction de quels mobiles se déclenche la participa-
tion à telle action revendicative, ou la non-participation ;
Quelle est la réaction individuelle et collective aux mots
d'ordre tactiques et à la propagande idéologique des groupes
partis et syndicats ;
Si la lutte de tous contre tous est dépassée, en acte et en
développement, par une lutte révolutionnaire.
LA « DEFENSE > INDIVIDUELLE
Disons tout de suite, non seulement qu'elle existe à tous les
échelons, mais encore que nul n'en est exempté. Ce terme de
« défense » est assez commode pour désigner l'intérêt primor-
dial que chacun porte à sa propre situation dans l'usine et les
efforts qu'il fournit pour la préserver ou l'améliorer. Bien
entendu, cela représente un imbroglio d'astuces, d'intrigues et
de crocs-en-jambes.
Il apparaît sans utilité d'aborder la « défense » des cadres
supérieurs de l'entreprise, pour cette raison de principe que ce
jeu n'affecte pas plus la condition ouvrière que les rema-
niements d'état-major ne modifient le livret militaire de cha-
cun. Au surplus, à cet échelon, les coups de pied se distri-
buent avec urbanité et silencieusement ; quelques échos défor-
més en donnent le ton, mais sans exactitude. Sans grande consé-
quence non plus (pour notre objet) la défense des éléments
de la maîtrise, dont l'attitude en ce domaine a été signalée
plus haut (2). Leurs conflits internes ne mettent pas en cause
l'action de la classe ouvrière vers une prise de conscience de sa
situation et de son avenir. A ce titre, il convient de les lais-
ser là où ils se trouvent à l'aise : dans l'ombre protectrice du
patronat infaillible.
(2) Voir n° 12 (p. 46-47) et no 14 (p. 54-55).
45
Seule, nous préoccupe la lutte que chaque ouvrier ou
employé, de toute spécialité ou de toute formation, livre pour
s'assurer l'emploi, la catégorie, le poste de travail et le salaire
qu'il désire. Sans doute se manifeste ainsi dans le domaine
du gagne-pain la lutte fondamentale pour l'existence et qui sur
ce même domaine ne saurait disparaître qu'avec le dernier
régime fondé sur la nécessité. Toujours est-il que la concur-
rence qui s'exerce est énorme et que ses modalités influent
sur l'organisation collective des producteurs contre leurs
exploiteurs.
Déjà, dans une même équipe ou un même bureau, ceux qui
effectuent un travail de même nature s'efforcent mutuellement
de s'en assurer la meilleure part, c'est-à-dire ce qui est le moins
volumineux, le moins pénible et le moins complexe. Par exem-
ple, une ouvrière sur presses tendra vivement à travailler le
plus souvent possible : a) assise, b) sur de grandes séries (meil-
leur rendement par suppresions des temps morts, et aussi pos-
sibilité de musarder), c) à des opérations très simples (le tra-
vail se faisant « machinalement > sans exiger une attention
lassante), d) sur des pièces légères (des rondelles coupées dans
du feuillard exigent un effort physique minime, ce qui n'est
pas le cas pour les grosses feuilles de tôle). Mais dans une
équipe, toutes ont le même désir, et, finalement, si l'ancien-
neté ne parvient pas à jouer, ce sera la « considération »
auprès du chef d'équipe ou du contremaître qui jouera. Quant
aux critères de cette considération ce sont évidemment la doci.
lité, la ponctualité, l'empressement à effectuer si besoin est des
heures supplémentaires, etc... en bref, le « bon esprit ». Ce
n'est pas la « râleuse perpétuelle » qui obtiendra le gâteau.
De même, un employé joue des coudes pour laisser tomber le
travail ardu et délicat sur le dos des petits camarades.
Egalement, pour obtenir une augmentation de salaire, quand
on sait qu'elles sont attribuées en contingents (3), il est aisé
de comprendre qu'en bénéficie en premier lieu celui dont la
« tête revient » au chef, pour les mêmes raisons que ci-dessus.
Enfin, pour l'ouvrier ou l'employé qui est désireux de gra-
vir la hiérarchie de sa catégorie (souvent un même emploi
comporte trois échelons, voire plus), ou même la hiérarchie
de l'usine, il ne suffit pas de faire preuve de compétences pro-
fessionnelles, cela a déjà été dit (4).
Et c'est bien logiquement que dans l'intérêt du patronat
on fasse «monter » ceux qui ne peuvent perdre de vue l'inté-
rêt supérieur de l'entreprise.
(3) Voir n? 12, p. 38 et 42.
(4) Voir nº 11 (p. 52).
46
Donc, pour tous les problèmes d'amélioration de chaque
condition à l'usine, la concurrence est générale, les uns pliant à
dessein devant la hiérarchie, les autres obligés de se rebiffer
et de contre-attaquer. L'intensité, la durée, les conséquences
de cette lutte ne peuvent être éludées, car elle se présente
comme le contre-pied de la lutte de classes.
Les raisons d'être de cette situation se trouvent au plus pro-
fond de tout individu, qui tend tout naturellement à éten-
dre sa personnalité, fût-elle médiocre, et même aux dépens de
ses voisins, par tous les moyens disponibles.
Le fait sévit à l'état endémique, puisque le but est d'obtenir
le maximum d'avantages à son bénéfice et celui des siens, sui-
vant les différentes ambitions.
Dans la pratique, on peut inscrire dans ce cadre les multi-
ples demandes d'ouvriers, même professionnels qualifiés, pour
« passer mensuels » et quitter « les bleus » pour « la blouse >>;
également la préoccupation constante de ne pas se « faire
enfoncer » par un camarade d'équipe, le plus souvent nouveau
venu ; également le plastronnage auprès du chef d'équipe (ou
de bureau), par lequel on tient à se mettre en relief.
En période de dépression du travail, ces tendances atteignent
leur plus haut point, la hantise générale étant de passer ina-
perçu, de façon à détourner les sanctions (licenciement, muta-
tion) sur d'autres épaules.
Cette attitude semble être le fait tout d'abord du person-
nel non qualifié : maneuvres, O.S., employés aux écritures,
magasiniers, etc... en majeure partie composé de femmes, de
nord-africains, de jeunes venus des campagnes, de jeunes ban-
lieusards proches du lumpenproletariat, et qui, même titulari-
sant plusieurs années de présence, se savent à la merci du
patron, qui peut les remplacer aisément.
Le personnel qualifié étant, dans la période actuelle, sans
souci du chômage, étale plutôt sa concurrence dans la recher-
che d'emplois supérieurs, en faisant jouer tout à la fois les
compétences professionnelles, la camaraderie politique ou le
simple copinage, ainsi que l'universel « piston ».
Sur le plan général, les résultats apparaissent dérisoires par
rapport aux intrigues déployées : une mutation souhaitée, obte-
nue après un an de tirage de sonnettes, quelques francs de
l'heure en récompense du zèle, quelques places de sous-ordres
pour dix fois plus de candidats. Mais sur le plan individuel,
cela compte énormément, et la concurrence se renouvelle
comme se renouvellent les acheteurs de billets de la Loterie
Nationale, et pour les mêmes motifs.
1
47
-
-
Toutefois, et c'est une restriction d'importance, il ne faut
pas conclure que cet aspect négatif de la lutte ouvrière vient
contrebalancer efficacement la résistance instinctive au travail
qui est le fait de tous. Qu'on ne s'y méprenne pas, ce n'est
pas là le résultat atteint.
En effet, cette course aux satisfactions individuelles voit ses
mirages se ternir tour à tour aux yeux des compétiteurs. Elle
figure l'acceptation du système de production, dans lequel on
peut espérer se tailler une place modeste, mais tranquille et
confortable : mais à l'intérieur même de l'entreprise, cette
ambition est combattue du fait même du système : ce sont les
salaires-plafonds des catégories qui sont rapidement atteints,
puisque les taux de salaire sont bas par rapport au coût de la
vie ; ce sont aussi les « bonnes places », trop rares, qui vont
à ceux qui ont la chance d'un « piston » increvable. Comme
il l'a été dit pour d'autres, ces illusions peuvent tromper quel-
ques-uns tout le temps, ou tous quelque temps, mais jamais
tout le monde tout le temps.
Reste en période de crise le débrouillage individuel pour
conserver sa place, mais dont la démoralisation ne peut se
prolonger, la solution, c'est-à-dire le débauchage, intervenant
rapidement.
En regard, ce qui ne perd jamais de sa force, mais bien au
contraire en acquiert constamment avec l'expérience, c'est l'ap-
plication tenace et générale pour produire le moins possible,
ainsi que nous l'avons déjà remarqué. Jamais un ouvrier,
encore plus qu'un employé, ne perd de vue qu'il est exploité
par un patron, lui-même soutien du régime, et que c'est du
sort du régime que dépend l'amélioration de sa condition. Peu-
vent seules lui manquer l'audace ou la conviction.
On ne peut quitter le sujet de la « défense individuelle »,
considérée comme soumission à la classe exploiteuse, sans don-
ner un aperçu de deux formes de capitulation qui sont :
les heures supplémentaires, et le travail noir.
Heures supplémentaires, cela signifie pour beaucoup une
augmentation considérable du salaire de base (50 heures par
semaine font 130 % du salaire de quarante heures) ; aussi
exercent-elles un attrait puissant sur toutes les catégories d'ou-
vriers et d'employés, indistinctement. Les chefs de service ou
les contremaîtres, autant pour gonfler leur importance que leur
portefeuille, s'ingénient à justifier les dépassements d'horaire
de leur personnel... et d'eux-mêmes. De leur côté, les sans-
grade accueillent avec joie l'annonce de nouvelles heures, et
lorsque la baisse des commandes entraîne une baisse des heu-
res, les récriminations se font tout de suite entendre. Les
48
incidence que
14
« heures » font partie du salaire, en quelque sorte, puisqu'elles
en viennent compenser la maigreur, et c'est en fonction de leur
les salaires sont estimés corrects ou dérisoires.
Constamment, dans les discussions concernant les salaires, on
peut entendre : « Avec x heures supplémentaires, tu gagnes
tant, >> « Chez Y, ce n'est pas intéressant, ils ne font pas
d'heures. »
Le patron et le personnel de direction tiennent compte de cet
état d'esprit, et par exemple, ayant le choix dans un atelier
déterminé, entre le licenciement ou la mutation de quatre ou
cinq ouvriers sur cinquante, ou la suppression des « heures »,
choisissent la première solution, qui garantit les intérêts de
l'entreprise, évite des remous immédiats et maintient le statu
quo ouvriers-patrons. A la branche fabrication, les heures sup-
plémentaires subissent cependant des fluctuations, allant de
40 à 48 heures pour retomber parfois à 45 ou 42 h. 30 ; il n'en
est pas de même à l'outillage, où tous les ouvriers profession-
nels, depuis au moins huit ans, font régulièrement 50 heures.
Il est de notoriété publique que leur travail n'exige pas une
présence aussi importante ni aussi intangible, mais il est éga-
lement bien connu que les « heures » de l'outillage sont «intou-
chables ». En 1953, la Direction, sans doute afin de sonder la
résistance ouvrière, avait tenté de toucher à un avantage bien
particulier inhérent aux heures supplémentaires d'une équipe
d'outilleurs. Le débrayage spontané et les multiples délégations
de harcèlement lui ont fait retirer ses prétentions.
Une autre forme d'heures supplémentaires, incontrôlable
cette fois, est le travail noir. On sait que l'on désigne ainsi le
travail effectué en fraude en dehors de l'entreprise, après les
heures normales, ou bien les samedis et dimanches. Nombreux
sont les professionnels modeleurs, ajusteurs, ou tôliers qui sont
assidûment en plus menuisiers, serruriers ou mécanos. Nom-
breux aussi les O.S. qui deviennent le dimanche garçons de
café, accordéonistes, marchands de cacahuètes, courtiers d'ag-
surances. On est tout surpris d'en découvrir de nouveaux tous
les jours. A la différence du problème des heures supplémen-
taires, celui du travail noir n'affecte pas la totalité des travail-
leurs, mais en le passant sous silence, on négligerait un aspect
remarquable du comportement ouvrier vis-à-vis de l'exploita-
tion.
Ainsi, à des degrés divers suivant sa personnalité, la nature
de son travail, sa qualification, l'organisation de son milieu de
travail, l'ouvrier ou l'employé, est constamment sollicité pour
accepter la Société telle qu'elle est et son patron pour une
nécessité. Il arrive que quelques-uns y répondent toujours et
49
-
d'autres parfois, mais ce qui finit par s'imposer à tous, au sein
de l'entreprise, et ceci en fonction tant de l'expérience indi-
viduelle à l'intérieur de la « boîte » que des informations sur
le monde extérieur, c'est que :
Tous les soucis engendrés par le travail salarié, les peines
et les humiliations, sont dus au patron.
Toutes les menues différences de tâche et de salaire dans
une même équipe, ne sont rien auprès de la communauté d'ex-
loitation.
- Toutes les astuces auxquelles on doit recourir pour amé-
liorer la paie, sont dues aux salaires trop bas.
Chacun parvient à ces conclusions, qui ne sont autres que les
bases de la conscience de classe, et représentent, pour les mili-
tants, leur plate-forme d'agitation, pour la masse du person-
nel, les raisons de leur participation à des mouvements collec-
tifs de revendications.
LA LUTTE COLLECTIVE
Donc, à côté du phénomène général de refus du travail, qui
est la somme de tous les refus individuels, et trouve son origine
dans la passation même du contrat de travail, existe un climat
collectif de revendication axé vers l'amélioration des condi-
tions de travail et de salaire et issu de la prise de conscience
de l'identique condition des exploités. Une fois arrachés par
des démarches personnelles, les avantages minimes qui peuvent
dépendre d'un emploi dans une équipe, l'accession à une vie
meilleure dépend d'un effort collectif pour « en sortir ». C'est
ce qui apparaît à tous, par exemple, et le plus clairement
lorsqu'est evoquée la dépréciation des salaires de l'avant à
l'après-guerre, lorsque sont rappelées les conquêtes de juin 36,
et les employés, les ouvriers les plus « arriérés » (au regard de
l'avant-garde) sont obligés de reconnaître que l'action collec-
tive seule peut être payante.
Viennent stimuler cette prise de conscience, les conditions
de vie qui cernent les producteurs en dehors de l'usine, ainsi
que les événements politiques ou économiques dont ils pren-
nent connaissance, même par la voie frelatée de la grande
presse.
Ce climat de revendication présente la même permanence
que l'esprit de résistance au travail, et il serait erroné de ne le
découvrir qu'à l'occasion des actions épisodiques qui peuvent
se déclarer : grèves ou débrayages par exemple. Au contraire,
50
il ne cesse de régner sur la totalité du personnel, et s'extério-
rise dans les conversations fréquentes pendant ou après le tra-
vail, concernant soit la paie, soit les conditions de travail.
On ne peut détacher cet aspect : la permanence, de cet
autre : l'inéluctabilité. En effet, ce climat collectif naît des
bases mêmes de la réunion sur le lieu de travail d'une masse
d'exploités.
La multiplication des tâches, la hiérarchisation poussée, le
bouleversement incessant des catégories professionnelles, ne
suffisent pas à le détruire. Le patron peut bien, pour dix tra-
vaux sensiblement comparables par les connaissances, les apti.
tudes, et les efforts qu'ils requièrent, offrir dix salaires diffé
rents au plus, d'un extrême à l'autre, de 10 %, il n'arrivera
pas à faire que cette aumône, d'une part, soit une solution défi-
nitive pour les catégories « favorisées », d'autre part, détourne
ces mêmes couches des intérêts de l'ensemble. Evidemment,
ceci ne s'applique qu'à des situations comparables ; il est clair
qu'à l'opposé se situent les couches réellement privilégiées de
la maîtrise et des cadres. Pour eux, il n'y a pas de problème
social, mais uniquement technique, administratif ou commer-
cial.
Par l'octroi au compte-gouttes de satisfactions individuelles,
la Direction vise à détruire l'esprit de classe, et à semer la
méfiance ; elle a le même but en créant des catégories ou des
postes similaires à des taux apparemment incohérents. Dans la
mesure, où le jeu primaire de la colère et des rancoeurs répond
à ces mesures, elle atteint son objet, mais pour qui considère
la vie collective de l'entreprise, ce ne sont que des obstacles
fragiles et passagers au courant de lutte de classe, qui finit par
l'emporter. Ce qui représente en ce domaine le meilleur atout
du patron, c'est le fait que, si la classe ouvrière est une et a
une histoire, chaque ouvrier doit personnellement assumer sa
propre expérience de l'exploitation avant de marcher dans le
sens de cette histoire. Plus ce délai peut être prolongé, mieux
cela vaut pour la tranquillité de l'employeur.
ACTION COLLECTIVE SPONTANEE
Le climat de revendication se caractérise par sa permanence
mais il culmine dans l'action, cela va sans dire. La résistance
passive fait place à la lutte ouverte au cours de laquelle les
objectifs se précisent et les antagonismes sont exposés au grand
jour. Les motifs de l'entrée en lutte se rapportent indifférem-
-
51
ment à tout aspect des rapports de production : ce peut être
aussi bien un simple mouvement de solidarité en faveur d'un
ou plusieurs camarades de travail, licenciés ou victimes de
sanctions, ou encore la protestation contre une dégradation des
conditions de travail (en premier lieu, l'augmentation des ca-
dences, ensuite l'insalubrité des locaux, etc...), ou bien l'exi-
gence d'une augmentation de salaires ou l'octroi de primes spé-
ciales.
Quelques exemples : débrayage de l'atelier d'outillage en
faveur d'un ajusteur mis à pied pour bris de matériel,
débrayage de deux équipes de la fabrication contre le
licenciement d'un O.S. convaincu du « vol » d'un pain de
savon ; grève d'une chaîne de fabrication à l'annonce d'une
accélération des cadences, « justifiée » en partie seulement par
une amélioration technique ; débrayage pour une insuffisance
de chauffage l'hiver ; grève d'une équipe d'O.S. pour obtenir
la parité de salaires avec une autre équipe effectuant un tra-
vail comparable ; grève de l'équipe d'entretien pour obtenir
la non-récupération des heures supplémentaires (c'est-à-dire
leur paiement au taux majoré et non au taux de base).
Tous les exemples cités concernent des actions réellement
spontanées, non pas minutieusement préparées par des orga-
nismes syndicaux (qui s'y immiscent par la suite), mais éclo-
ses un beau jour d'un accord unanime. Comment cela ? Dans
le cas de la grève de solidarité en faveur d'un «voleur » (pour
qui la sanction fut finalement maintenue), l'annonce du renvoi
provoqua l'indignation par sa disproportion avec la valeur
de l'objet volé. L'optique patronale était que le vol seul impor-
tait et non pas son montant, donc qu'un « exemple » devait
etre fait. Le point de vue ouvrier était tout autre. Il était, i
est toujours, que tout vol peu important de matières premières
ou d'outillage n'est autre qu'un complément de salaire, une
«récupération», au même titre que la «perruque». Rares sont
les trop timorés qui n'ont jamais sorti en fraude : soudure
d'étain, feuilles de tôle, de laiton, d'aluminium, peinture, etc...
La masse de ces vols n'est pas calculable, et son incidence sur
la comptabilité sans doute négligeable, mais le fait, par son
volume, indique qu'il est entré dans les moeurs. Formulée ou
non, l'idée générale est celle-ci : « Ils nous volent bien plus
que nous ne pouvons leur reprendre ». Mais dans un tel cas,
comme il apparaît rapidement que l'intéressé est « indéfen-
dable », le mouvement se désagrége rapidement.
En ce qui concerne la grève ayant pour motif une augmen-
tation de cadences à la chaîne (vitesse de rotation accrue de
20 % environ), les ouvriers se sont fort peu souciés de com-
52
.
prendre que cette accélération, suivant les dires du patron,
était facilitée par une meilleure technique. Ce qu'ils ont vu
en premier lieu, c'est que pour un salaire égal leur rendement
et leur fatigue seraient accrus : la direction, une fois de plus,
se « moquait du monde » ouvertement, et l'attaque menée de
front trouvait une réponse appropriée.
L'équipe des professionnels de l'Entretien, astreinte depuis
de nombreuses années à « récupérer » les heures supplémen-
taires effectuées (au-delà de 45 heures), ce qui représente
un inconvénient d'horaire et un manque à gagner, était de ce
fait nettement désavantagée par rapport aux professionnels de
l'outillage. Leur grève résulta d'un commun accord.
Ces quelques exemples illustrent des cas d'action collective
limitée au cadre d'une équipe, ou au mieux, d'un atelier. L'en-
semble de l'entreprise ne suivit pas, se bornant à manifester
son appui sous forme de collectes. Cette attitude est intéres-
sante à deux points de vue :
D'abord, parce qu'elle prouve amplement que les dissensions
individuelles s'effacent devant l'intérêt commun de l'équipe,
ensuite parce qu'une revendication particulariste est incapa-
ble d'entraîner un vaste mouvement touchant toute l'usine.
Tout se passe comme si la masse des autres équipes était com-
plètement étrangère à ceux qui luttent pour des motifs qui
leur échappent.
Ceci ne veut pas dire que des mouvements spontanés écla-
tant dans un atelier, ne puissent se généraliser sans l'interven.
tion des organisations syndicales dans toute l'usine dès qu'ils
posent des revendications générales. Comme nous n'avons
voulu parler dans ce texte que de ce que nous avons observé
nous-mêmes, nous nous limiterons aux exemples cités plus
haut; mais on connaît l'importance des mouvements spon-
tanés se généralisant rapidement, comme la grève Renault, en
avril 1947.
Il n'y a pas dans ces mouvements d'équipe de préparation
bien ou mal accomplie, mais plutôt un long mûrissement
d'une situation de fait dont l'aiguillon devient de plus en plus
intolérable et qu'une vexation supplémentaire, un abus fla-
grant, font éclater. Qu'importe si le rapport des forces du
moment est défavorable (exemple : si l'équipe en grève est
fortement en avance sur son travail, ou si la direction dispose
rapidement d'une solution de dépannage). La question n'est
même pas envisagée par les ouvriers, et leur réaction sponta-
née trouve son dynamisme dans son seul bon droit, renforcé de
la masse d'amertume accumulé par chacun dans son emploi,
du fait du patronat et de la maîtrise.
53
La grève déclenchée, à la suite du rejet de telle réclama-
tion, l'objectif qui se précise alors plus clairement est de la
mener à bien, c'est-à-dire au succès. Pour cela, l'équipe mise
avant tout sur les difficultés que rencontrera la direction pour
assurer le rythme normal de la production.
L'expérience montre que, les stocks de produits finis repré-
sentant grosso modo près d'un mois de production, l'entrave
apportée par la grève ne se fait sentir qu'à la longue, alors
que la démoralisation des grévistes va plus vite, même s'ils sont
soutenus financièrement par ceux qui travaillent. Générale-
ment après une semaine, commencent les rentrées individuel-
les, et ces reprises, jointes à la marche inchangée des autres
ateliers, précipitent l'acceptation d'un compromis avec la
Direction, dont le premier point est régulièrement : pas de
sanctions pour fait de grève. Mais que le résultat soit un
plein succès (cas rare), un demi-succès ou un échec, les con-
clusions qu'en tirent les participants sont ambiguës : d'une
part animosité vis-à-vis des autres équipes qui « restaient bien
tranquillement au travail », et dont on jure bien qu'on ne
prendra pas plus les « crosses », le cas échéant, qu'ils n'ont
pris « les nôtres » (à rapprocher de l'animosité envers les gré-
vistes des différentes grèves des transports, qui « ne pensent
qu'à eux » « emm... d'abord les ouvriers », et « laissent tou-
jours tomber les métallos »), d'autre part, confirmation que
seule une grève d'ensemble peut amener le patronat à une
capitulation rapide.
Ceci est valable en tout premier lieu pour les O.S. dont le
poids dans la lutte dépend avant tout des effectifs engagés,
mais aussi pour les professionnels. Ainsi, le bilan de ces
actions, tout compte fait, n'est jamais négatif. Même en cas
d'insuccès, le découragement, le scepticisme et la ponction
financière retiendront bien de prendre part, à bref délai, à
d'autres actions, mais ces entraves s'effacent progressivement
à mesure que se clarifie l'idée qu'il faut que tous s'y met-
tent ».
C'est à travers des luttes de cette nature que se précise la
nécessité d'une action de classe, seule capable d'améliorer
réellement le sort des ouvriers. Les grévistes eux-mêmes
apprennent en effet : que le patronat n'est sensible qu'à la
violence ouvrière et ne discute que le couteau sous la gorge ;
qu'avec le patron on ne peut entretenir des rapports « ami.
caux », mais constamment et nécessairement hostiles, puisqu'il
bafoue les notions admises de justice et de bon droit ; qu'une
grève, pour réussir, doit entraîner la majorité et se présenter
dans des conditions favorables. Le succès d'une grève limitée
54
apporte, si besoin est, cet enseignement aux non-grévistes ;
l'échec, générateur d'amertume et de découragement, met éga-
lement en évidence la nature de classe de l'exploitation. Dans
le premier cas, le ton général est de triomphe, dans l'autre,
nombreux sont ceux qui jurent qu'on ne les y prendra plus,
que les patrons sont les plus forts, qu'on a bien tort de risquer
son emploi pour des « salauds » qui n'ont pas débrayé, qu'on
n'aurait pas dû suivre, etc... toutes réactions imputables au
désarroi, à l'humiliation, à la gêne financière, mais qu'en
résulte-t-il par la suite ? Pour la majeure partie, après réflexion
et atténuation du choc subi, c'est la même volonté de résistance
et de lutte (dont les causes objectives demeurent) puisque
c'est la seule façon d'obtenir satisfaction.
ACTION COLLECTIVE ORGANISEE
Il n'y a pas à l'usine d'action collective spontanée à l'état
pur, bien entendu. La spontanéité caractérise de nombreux
mouvements à leur origine, mais il arrive toujours que les
syndicats viennent les contrôler, ou tout au moins, en le ten-
tant, les influencent. Les responsables syndicaux et délégués
du personnel se mettent en contact avec les ouvriers en lutte
et s'imposent comme intermédiaires entre eux et la direction.
Cette initiative n'est pas mal vue par les intéressés, parce
qu'elle représente pour eux l'appui d'organismes « puissants »
et les « relie » aux ouvriers qui sont restés en dehors du conflit.
Cette « aide >> morale et matérielle est un stimulant pour la
lutte, ce qui fait qu'à l'issue du mouvement, les ouvriers, en
appréciant cette solidarité, sont renforcés dans l'idée de la
nécessité d'une union réelle de tous les travailleurs.
Il arrive donc que les ouvriers amènent les syndicats sur
leur propre terrain, mais le plus souvent ce sont les syndicats
ou organisations politiques qui présentent leurs mots d'ordre
revendicatifs ou politiques. L'initiative de délégations à la
direction, pétitions, débrayages, leur revient à propos de reven-
dications de toute nature, aussi bien sur le salaire que sur des
éléments accessoires ; ces mots d'ordre sont valables pour une
équipe ou un atelier, ou bien pour toute l'usine. Dans le pre-
mier cas, ce sont des questions particulières qui sont soulevées
et traduisent plutôt la prise en main d'une revendication
spontanée qui se prépare ; dans le second, ce sont les demandes
de relèvement général des salaires, telles qu'elles ont été déter-
minées par les centrales syndicales.
55
1
Dans la mesure où les revendications particularistes viennent
à maturité, les moyens d'action préconisés par les syndicats
sont suivis unanimement (débrayages d'une demi-heure ou
d'une heure, avec délégation), les ouvriers se serrent les coudes,
en ont parfaitement conscience et l'action se déroule dans la
bonne humeur suscitée par le climat de fraternité et la joie
de harceler le patron. En ce qui concerne les grands mouve-
ments demandés pour arracher une révision des salaires, il
en va différemment, précisément parce que sur ce point l'ou-
vrier quitte le domaine de sa propre équipe qu'il connaît bien,
où les conditions de travail, les rapports humains sont assi-
milés sans intermédiaire, pour entrer dans le jeu stratégique
où se bagarrent les patrons, le gouvernement, les syndicats et
les partis politiques. Il est vrai que pour lui sa participation
à une grève organisée est déterminée par le fait qu'il est tra-
vailleur exploité, mais d'autre part son entrée en lutte est
également conditionnée par son appartenance politique et son
appréciation personnelle de la conjoncture politique et écono-
mique. Ce n'est pas le sentiment du « bon droit » bafoué par
le patron qui l'incite à agir, mais l'estimation (qui peut être
entachée d'erreur) que la grève est bien engagée pour la
défense de ses intérêts, et qu'en plus elle se présente avec des
chances de succès, ce qui sous un certain angle revient au
même. La mise en train d'une grève dépend encore plus étroi-
tement, depuis quelques années, de la situation politico-écono-
mique, du fait de l'existence d'une pluralité de syndicats se
réclamant de la classe ouvrière et se livrant entre eux à des
manoeuvres, des crocs-en-jambe et une surenchère permanente.
Unis dans la volonté d'obtenir des conditions de vie meil.
leures, mais lassés par le jeu syndical et dégoûtés des que-
relles sordides, la majeure partie des ouvriers, quand elle suit,
ne suit que les mots d'ordre présentés en commun par plu-
sieurs syndicats.
Ainsi la grève du « salaire minimum à 25.166 francs » du
30 avril 1954, préparée dans l'entreprise par la C.G.T. et la
C.F.T.C., a réuni 90 % des ouvriers, tant qualifiés qu'O.S. On
peut dire que la totalité des participants se sont fort peu
intéressés au détail des revendications, mais ont tenu à démon-
trer simplement leur désir de salaires plus élevés. On peut
affirmer également que la plupart ne se faisaient pas d'illu-
sions sur l'efficacité du mouvement ; mais il fallait manifester
son mécontentement. Là-dessus la quasi-unanimité s'est réali-
sée. L'appel des syndicats sanctionnait donc purement et sim-
plement un état d'esprit général. Il fut également suivi parce
que de longue date une grève n'avait eu lieu.
56
Ceci nous ramène à la dernière grande grève de l'usine, qui
dura cinq semaines, en février-mars 1950. Elle avait été déclen-
chée par les divers syndicats de l'automobile, sur le plan pari.
sien. Après un grand meeting dans le hall de l'outillage, au
cours duquel prirent seuls la parole les leaders syndicaux,
parlant à un auditoire favorable, ce fut un «vidage » total des
ateliers, et de la moitié des bureaux ; la chose semblait aller
de soi, il ne fut absolument pas question d'occuper les locaux.
Le comité de grève élu par acclamations dans une atmosphère
de totale confiance fut celui que proposèrent les syndicats,
incluant quelques « inorganisés », parmi les bonzes C.G.T.,
C.F.T.C., F.O., Autonomes. Ensuite et jusqu'à la reprise, le
déroulement de la grève fut celui-ci : comptes rendus pério-
diques, devant l'assemblée des grévistes, de l'activité du comité,
résolution de poursuite de la lutte présentée par ledit comité
et mise aux voix. A l'échelon des décisions, le comité n'a
jamais eu à faire face à une opposition ouvrière ou à une
scission (par laquelle les ouvriers auraient pu nommer un
autre comité). Ses démarches auprès de la direction ont été
constamment couronnées d'insuccès, étant donné que l'usine
n'avait pas le souci de produire pour des clients (les grands
trusts automobiles) dont l'activité était également paralysée,
et aussi que la grève gardait son caractère corporatif, ne s'éten-
dait pas et ne revêtait pas d'aspect révolutionnaire. Pour le
patron, il fallait laisser « pourrir la grève ». C'est ce qui arriva.
La plupart des grévistes restaient chez eux au début de la
grève, venant de temps en temps aux assemblées, où ils se
retrouvaient par équipe et les plus combattifs remontaient le
moral de ceux qui flanchaient... et n'osaient « reprendre », par
souci de conserver l'estime de leurs camarades. Les résolutions
de poursuite étaient toujours approuvées, mais les discussions
et les hésitations se manifestaient dans les conversations de
la masse. Pendant quinze jours le comité jouit de la confiance
unanime. Ensuite il apparut à tous que la grève n'avait pour
elle que sa durée, et cependant aucun autre moyen de pres-
sion ne fut mis en avant ni par le comité, ni sur l'initiative
de la base. L'occupation ne fut pas décidée, ni même discutée.
La proportion des non-grévistes paraissait dérisoire pour nuire
à la puissance de la grève (en 1947, quelques piquets avaient
occupé l'entreprise, rapidement délogés par la police). Les
constantes consignes de méfiance envers les « provocateurs »,
le prestige des organisations syndicales, enlevaient toute possi-
bilité à une action autonome. Conscients de l'impasse où se
trouvait la grève, et de plus en plus dans l'impossibilité de
transformer sa nature, les ouvriers furent alors livrés au cou-
rant de reprise qui se manifesta dès la troisième semaine. Le
57
mouvement s'accentua pendant la quatrième semaine. Dès lors
la seule préoccupation des membres du comité fut de tirer
leur épingle du jeu. Aucune organisation syndicale ne se ris-
qua individuellement à donner l'ordre de reprise. Personne
ne voulut tenir le rôle du bouc émissaire, aussi la grève tint-
elle jusqu'à la cinquième semaine. Finalement, alors que res-
taient en lutte environ 50 % des gars, et la reprise menaçant
d'être totale une semaine plus tard, le Comité décida la reprise
« élus en tête, et la tête haute », à l'unanimité.
Cette action est la dernière en date à l'usine qui ait mis en
jeu la totalité du personnel ouvrier. Depuis plus de quatre
ans, aucune n'a atteint son ampleur. D'ailleurs les organisa-
tions syndicales se sont bien gardées d'en lancer une autre.
C'est que le passif était lourd et cruellement ressenti par la
masse. Cette grève a marqué une cassure très nette depuis
l'époque dite de la « Libération ». De 1944 à 1950, la combat-
tivité de la base » et l'autorité indiscutée des syndicats
(C.G.T. en tête) s'extériorisaient par de très fréquents arrêts
de travail, tant pour des mobiles revendicatifs que « politi-
ques » (guerre d'Indochine, plan Marshall, etc...) qui entraî-
naient chaque fois la majorité, ou plus, des ouvriers. Prises
de parole, distribution de tracts, en général toute l'action
d'agitation et de propagande était très dense et suivie de près.
Au contraire, depuis l'échec de la grève de 1950, l'activité
syndicale s'est raréfiée et même les « ténors » syndicaux, célè-
bres et populaires pour les « coups de crocs >> qu'ils donnent
au Patronat, ne retrouvent plus leur audience. Le dernier
effort d'envergure a porté sur «Ridgway-la-Peste » (1951-1952)
et s'est soldé à l'entreprise par un fiasco complet.
Sans entrer dans l'étude des rapports entre les ouvriers et
les syndicats et partis politiques, il importe de préciser les
raisons de cette absence de lutte générale à l'entreprise sous
une forme agressive, alors que le pouvoir d'achat n'a pas
retrouvé son niveau d'avant guerre.
En effet, la cause de cette « apathie » n'est pas à déceler
dans un soi-disant «embourgeoisement », car l'expansion de
l'industrie automobile d'une part et la stabilisation relative
des prix depuis deux ans environ ont seulement contribué à
stopper la précarité de la condition des métallos et à créer
dans leurs rangs, si l'on se réfère à la masse des salariés et
fonctionnaires des autres secteurs économiques, des « privilé-
giés » relatifs (5) qui peuvent par exemple acheter une 4 CV
ou faire construire. On ne peut nier que les ouvriers soient
(5) En 1954, à l'usine intéressée, un o.s, gagne, toutes primes comprises,
de 175 à 220 francs de l'heure.
58
au courant de ces avantages dont ils bénéficient, et que ce
soit pour la minorité des « béni oui-oui » un bon motif d'appli-
quer la devise des craintifs : « Reste tranquille, t'as la bonne
place ». Mais pour la majorité le sentiment de frustration et
d'exploitation domine, avec comme corollaire la tendance
vivace vers un mieux-être.
La cause réelle de la récession de l'activité revendicative
depuis quatre ans réside dans la prise de conscience, qui s'est
fait jour à l'issue de la grève de 1950, que les mouvements
organisés n'avaient pas été payants et qu'actuellement « il ne
pouvait pas en être autrement ». C'est donc la lassitude et le
découragement qui l'emportent sur la volonté de combattre.
Les ouvriers ont été à même de constater que l'union inter-
syndicale n'avait mené qu'à un échec. A plus forte raison
maintenant sont-ils prêts à ignorer tout mouvement présenté
par un seul syndicat. Et comme présentement il ne peut y
avoir de mot d'ordre qui soit commun à tous les syndicats...
La désaffection n'est pas seulement sensible pour l'action
mais aussi pour les syndicats qui sont réduits à leurs noyaux
d'activistes, dont la propagande et les slogans sont approuvés
ou non, mais en tout cas sans portée pratique. Le mouvement
du 30 avril a été suivi parce que intersyndical et limité à une
journée, donc purement démonstratif. On peut affirmer qu'un
mouvement de durée illimitée n'aurait rencontré aucun succès.
G. VIVIER
(La fin au prochain numéro.)
59
.
DISCUSSIONS
Nous avons reçu du camarade G. Fontenis, dirigeant de la Fédéra-
tion Communiste Libertaire, le texte publié ci-dessous. Notre désaccord
avec les positions du camarade Fontenis sur le problème syndical ne nous
empêche pas d'apprécier la clarté de son argumentation et nous pensons
que ce texte, en exposant d'une manière dense et précise le point de
vue des partisans de la participation aux syndicats, offre une excellente
base à la discussion que nous comptons poursuivre dans le prochain
numéro de “Socialisme ou Barbarie".
Le texte de Mothé que critique Fontenis a été publié dans notre n" 14
(p. 27 à 38).
Présence dans les syndicats
La thèse de Mothé est, à première vue, incontestable. Simple,
logique, séduisante. A mon sens, trop simple, trop séduisante,
trop logique. C'est que rien n'est simple dans le problème
syndical malgré les apparences, il faut, dans ce domaine plus
qu'ailleurs peut-être, se méfier d'un raisonnement logique qui
risque fort de passer au-dessus des véritables questions
celles que se posent à chaque pas les militants ouvriers -
et il est à craindre que les conclusions de Mothé ne séduisent
que parce qu'elles proposent une fuite devant des luttes diffi-
ciles et parce qu'elles flattent un certain goût de l'avant-garde
pour les positions tranchées et qui paraissent sans appel.
On peut ramener la démonstration de Mothé au schéma sui-
vant : les syndicats, réformistes par nature, sont aujourd'hui
divisés selon les affinités de leurs bureaucraties avec un bloc
impérialiste ou l'autre, les travailleurs se détachent de plus
en plus de ces syndicats agences impérialistes, l'unité
ouvrière se fera sous d'autres formes organisationnelles que les
syndicats, donc les révolutionnaires n'ont pas à lutter pour une
unité syndicale utopique et même ils n'ont rien à faire du tout
dans les syndicats.
Nous serons d'accord sur toute la partie théorique-histo-
rique de la thèse Mothé, mais non sur son opinion concernant
la désaffection des travailleurs pour les syndicats et moins
60
encore sur les conclusions. Nous admettons même qu'aucun
militant de l'avant-garde (quelques rares spécimens d'authen-
tiques syndicalistes-révolutionnaires mis à part) ne discute
plus l'incapacité révolutionnaire et la nature réformiste du
syndicat, caractères liés à ses tâches et à sa structure corres-
pondant aux conditions de la société capitaliste. Nous admet-
tons également que les syndicats se soient de plus en plus inté-
grés aux blocs impérialistes. Mais tout cela n'est pas neuf, et
quant au fond, Malatesta, de son côté, et Lénine du sien,
avaient déjà souligné le caractère réformiste des syndicats. Ils
n'en déduisaient pas pour autant, tout au contraire, qu'il fal-
lait les abandonner à eux-mêmes.
Les conditions sont-elles changées à un point tel que les
révolutionnaires doivent abandonner la lutte au sein des syn-
dicats, doivent considérer qu'il est totalement impossible de
lutter pour leur fonctionnement démocratique, pour la prise
de conscience de classe de leurs membres, en un mot qu'il est
impossible d'y contribuer à la préparation des conditions révo-
lutionnaires ?
Mothé ne raisonne-t-il
pas un peu comme s'il s'était fait jadis
des illusions sur le syndicat ? Découvrant leur caractère réfor-
miste, il s'en détourne, cherche autre chose comme instrument
révolutionnaire. Pour nous, ne nous étant jamais illusionnés,
nous ne pouvons être déçus et c'est en connaissance de cause
que nous travaillons et travaillerons dans le cadre limité des
syndicats. Nous ne devons pas avoir présente à l'esprit seule-
ment la pression générale de la société capitaliste et la pres-
sion des bureaucraties sur les syndicats, mais également la
pression exercée par les syndiqués sur leurs bureaucrates et
contre les obstacles du capitalisme, en vertu de leurs inté-
rêts de classe. Ceci suffirait déjà à justifier théoriquement la
présence des révolutionnaires dans les syndicats. Mais nous
devons maintenant examiner les conditions pratiques actuelles
de la lutte des révolutionnaires dans les syndicats.
**
**
Selon Mothé, les travailleurs se détournent de plus en plus
des syndicats. Sans doute, ne sommes-nous plus en 1936 ou en
1945, mais il y a encore aujourd'hui, par rapport aux années
1930, par exemple, un nombre important de syndiqués et
même de militants syndicaux. Se reporter aux années de
pointe 36 ou 45, c'est oublier l'expérience des vieux militants,
c'est se baser sur une donnée qui peut être factice, passa-
gère. La désaffection syndicale n'est ni aussi grave, ni aussi
générale que ne le voit Mothé qui se base peut-être exclusive-
61
ment sur quelques exemples. A côté du fléchissement limité des
effectifs, nous observons la création de sections syndicales, la
participation restée très importante des ouvriers aux élections
de délégués du personnel ou de membres des Comités d'en-
treprise, et surtout le maintien des effectifs là où l'unité a été
préservée pour des raisons particulières à la profession (Ensei-
gnement) et où cependant l'activité syndicale est discutable
et l'inefficacité syndicale manifeste.
Sans doute l'inactivité et l'incapacité relatives des syndi-
cats sont-elles pour quelque chose dans la baisse limitée des
effectifs, mais il semble bien que la raison essentielle de la
désaffection des travailleurs est la division syndicale. Les tra-
vailleurs manifestent fréquemment leur opinion sur ce point
et Mothé écrit lui-même que les travailleurs pour passer à l'ac-
tion attendent que les syndicats des diverses centrales se met-
tent d'accord. Faire état de jugements inconscients — et donc
inexprimés -- des travailleurs sur l'incapacité fondamentale
des syndicats serait fantaisiste. Nous devons nous en tenir à
ce qui est évident ou démontré.
Tombons-nous pour autant dans l'illusion trotskiste. de
l'Unité Syndicale réalisée par le miracle des confrontations
entre états-majors syndicaux ?
Nous dénonçons au contraire, avec Mothé, la manie exas-
pérante des trotskistes consistant à prétendre pousser les mas-
ses à des expériences déjà multiples ! -- en accroissant
la confusion. Mais nous pouvons, des justes remarques sur le
désir d'unité syndicale des masses, tirer de tout autres con-
clusions que les trotskistes, et celle-ci essentiellement : les
travailleurs restent attachés à la forme d'action syndicale qui
ne leur paraît ni périmée, ni stérile.
Pour ce qui est des possibilités d'unité, il nous paraît impro-
bable que la lutte des deux blocs passe par des phases telles
qu'une unification, même provisoire, puisse se réaliser. Ce n'est
toutefois pas totalement impossible et nous reverrions alors,
en cas d'unification, se produire un phénomène de montée des
effectifs, comme en 36, à la suite d'une période de division et
de stagnation.
Mais ce qui est à envisager avec davantage de probabilité,
c'est un renforcement des effectifs dans une des centrales exis-
tantes plus capable que les autres de conduire un mouvement
revendicatif réussi, ce qui n'est tout de même pas impensable.
Allons plus loin, des grèves menées en dehors des directions
syndicales, par des Comités de grève, peuvent concourir à ren-
forcer le recrutement syndical d'une centrale existante ou bien
aboutir à la formation d'autres organisations qui seront encore
62
des syndicats même si elles prennent un autre nom. L'expé-
rience a montré que les Comités de grève et les Comités d'ac-
tion ne survivent pas à l'action et que seuls des syndicats,
anciens ou nouveaux, sont capables de regrouper des travail.
leurs.
Pour en finir avec le problème de l'Unité, précisons que nous
ne pouvons qu'encourager les travailleurs à vouloir et exiger
l'unité, en leur expliquant que cette unité ne peut se réali-
ser vraiment que contre les bureaucrates, en les débordant,
et qu'elle ne peut se réaliser que dans l'action. Bien entendu,
Mothé nous dira alors que ce que nous envisageons, c'est l'unité
ouvrière et qu'elle ne se réalisera pas dans le cadre syndical.
Pourtant, nous pensons que des réalisations même localisées
d'unification d'organisations syndicales peuvent jouer un rôle
dans la prise de conscience antibureaucratique des travailleurs
et même si elle ne devait pas aboutir avant longtemps ou si
elle devait aboutir sous des formes imprévues, la tension de
la classe ouvrière vers l'unification mérite d'être utilisée par
les révolutionnaires au sein des syndicats.
Quant à l'unité ouvrière au sens large, sans doute Mothé a-t-il
raison lorsqu'il estime qu'elle peut se réaliser en dehors des
syndicats. Elle peut même se réaliser malgré les divisions syn.
dicales et elle se réalise souvent dès aujourd'hui. Mais croire,
comme Mothé, qu'elle se réalisera organisationnellement
et hors des cadres syndicaux bien entendu — c'est se placer
déjà dans le cadre de la période ouvertement révolutionnaire.
Quand cette unité se réalise aujourd'hui, c'est uniquement dans
des périodes de pointe et sous des formes organisationnelles
passagères qui avortent dès qu'on entre dans une période d'ac-
calmie ou de moindre activité. Les Comités de grève et les
Comités d'action ne survivent pas à l'action, nous le répétons.
Ce que les travailleurs veulent, c'est une organisation perma-
nente, solidement structurée (1) pour la défense contre le
patron (patron privé ou bureaucratie).
Et, qu'on le veuille ou non, cette organisation permanente
aura ses limitations réformistes (les travailleurs exigeront qu'on
s'occupe des petits problèmes, de l'application des lois socia-
les, etc...), ses dangers d'évolution bureaucratique. Même si on
veut appeler ces organisations d'un autre nom, même si elles
(1) Les travailleurs qui ne vont plus au syndicat ne disent-ils pas :
«Que faire ? Les critiques ne suffisent pas. Il faut constituer une orga-
nisation » ? Mothé a dû en faire l'expérience.
63
naissent sur la dépouille d'anciens syndicats vidés de leur
adhérents, elles seront aussi des syndicats.
**
**
Il apparaît donc que le militant révolutionnaire, s'il veut
dans les longues périodes de relative stagnation garder le
contact avec les masses et leurs problèmes immédiats, s'il
veut gagner l'estime et la confiance des travailleurs, doit par-
ticiper à l'activité syndicale. Or, cette estime et cette con-
fiance, difficiles à obtenir, sont nécessaires même au moment
de l'action révolutionnaire et dans le cadre d'organismes nou-
veaux comme les Conseils.
Au reste, on voit mal pourquoi les militants révolutionnaires
ne pourraient mener la lutte antibureaucratique au sein des
syndicats. C'est là justement qu'elle peut se mener au mieux,
et par des démonstrations vivantes. Lutter de l'extérieur, c'est
se fermer tout un auditoire. Et n'oublions pas que dans cer
tains secteurs ouvriers divisés en une infinité de lieux de
travail ou de petites entreprises, seule la réunion syndicale
permet de grouper l'ensemble des travailleurs et de se faire
entendre.
Et puis, ne resterait-il que 15 % des travailleurs dans les
syndicats, ces 15 % sont, même s'ils sont égarés, parmi les
plus combattifs, les plus accrochés aux luttes ouvrières et ce
serait une erreur fatale que de les laisser aux mains de leurs
bureaucrates. Attendre qu'ils s'éclairent tout seuls, c'est en
revenir à nier tout rôle de l'avant-garde. N'oublions pas que
des tendances oppositionnelles se manifestent au sein des mag-
ses syndiquées et qu'il faut leur venir en aide.
Nous sommes les premiers, communistes libertaires, à con-
tribuer aux Comités de grève, aux Comités d'unité d'action qui
se constituent au moment opportun, même en dehors des orga-
nisations syndicales et contre leurs bureaucraties. Et nous
savons bien que les formes d'organisation du prolétariat en
période révolutionnaire sont orientées vers le système des
« Conseils » et que les syndicats sont alors dépassés, appelés
à disparaître en tant que tels (2). Mais nous ne restons pas
dans l'expectative, nous militons dans les syndicats en pre-
nant notre parti de ce qu'ils sont et de leurs limites. Et bien
entendu, nous n'oublions pas que l'activité syndicale n'est pas
(2) Il est évident que les syndicats qui participent aux faits révolu-
tionnaires sont alors beaucoup plus et autre chose que des syndicats.
64
toute l'action ouvrière, et nous n'oublions pas non plus la
nécessité de militer sur le plan politique et de nous orga-
niser politiquement en vue de travailler, en dehors et au
sein des syndicats, à élever la conscience de classe des tra-
vailleurs, à les soustraire le plus possible aux bureaucrates,
à leur ouvrir des perspectives révolutionnaires.
G. FONTENIS.
1
-
65
1
Alors que
mensuels. La municipalité offre la moitié. Leur volonté de lutte est
vive, la grève éclate. Au même moment, les représentants officiels des
Länder (Etats) et du syndicat fédéral des services publics se réunissent
à Stuttgart pour discuter des salaires de toute la fonction publique. Alors
que certaines municipalités sont pour un compromis, les délégués du
Gouvernement Fédéral, appuyés par une déclaration du gouvernement de
Bonn refusant catégoriquement toute augmentation, se montrent intran-
sigeants. C'est également ce jour-là qu'ont lieu les événements de Bremer.
haven (base navale du nord de l'Allemagne), où la population manifeste
violemment contre les forces d'occupation, qui ont décidé de raser un
groupe de soixante immeubles ouvriers afin de construire des buildings
à l'usage du personnel civil américain. La bagarre éclate entre les mani-
festants et la police venue pour les disperser. Quelques jours après, les
Américains suspendront l'exécution de leurs projets.
la grève est en plein développement à Hambourg, paraly.
sant complètement la grande cité, les 250.000 métallos de Bavière entrent
en action le 9. Le lendemain, des accords limités à quelques usines dont
les patrons acceptent les augmentations demandées, réduisent de moitié le
nombre des grévistes. Mais les jours suivants, la bagarre éclate entre les
ouvriers et la police. Chez Siemens les ouvriers veulent empêcher les
jaunes reprendre le travail. Les heurts avec les matraques policières
sont particulièrement violents le 12, le 13 et le 18. Les travailleurs durcis-
sent leurs positions et les piquets de grève sont renforcés et défendus
vivement. Des manifestations de solidarité des autres travailleurs ont lieu,
comme celle des mineurs de Amberg venant à la rescousse des métallos
dans les bagarres avec les jaunes et la police.
A Hambourg, après cinq jours d'arrêt du travail, les autorités recher-
chent un compromis. Le Dimanche 8, une écrasante majorité de grévistes
avait repoussé les propositions transactionnelles jugées insuffisantes (5 pf.
c'est-à-dire 4 francs pour les ouvriers et 3 % pour les mensuels). Le 12
août, les grévistes acceptent 7 pf. (au lieu des 10 demandés initialement).
La grève a payé. Et c'est là l'enseignement le plus important pour les
travailleurs de Hambourg et d'Allemagne.
En Bavière, le conflit dure beaucoup plus longtemps. C'est la guerre
d'usure, dans laquelle le prolétariat ne peut que perdre du terrain s'il
n'est pas offensif. Les ouvriers ont tenu vingt-deux jours sur des posi-
tions défensives. Finalement un compromis a été réalisé le 31 août sur des
augmentations de 12 pf. (10 frs) de l'heure et de 5 à 7 % des traitements
des mensuels. Jusqu'au dernier jour, les patrons avaient essayé la divi-
sion, l'embauche individuelle, le lock-out. La clause principale de l'ac-
cord, outre l'élévation des salaires, est l'engagement pris par les patrons
de ne pas sanctionner les faits de grève.
Les métallos de la Ruhr (750.000) qui, au début de l'agitation avaient
dénoncé leurs conventions collectives pour le 31 août, ont accepté par
l'intermédiaire des syndicats des nouveaux accords leur donnant 8 pf.
de l'heure et 7 % pour les mensuels. L'action directe des métallos bava.
rois a fait céder les capitalistes de la Ruhr, mais en allant au-devant
des syndicats, ceux-ci s'en sont mieux tirés que leurs collègues de Bavière.
Quelle est la signification qui se dégage de ces grèves ? Quel rôle les
syndicats (la centrale D.G.B.) ont-ils eu dans le conflit ? Quelle est
l'importance de la combativité des masses ouvrières ?
La grande patience des ouvriers allemands est terminée. De l'aveu
même des bonzes syndicalistes * la lune de miel d'après-guerre avec le
patronat est définitivement révolue », et, d'après un chef syndicaliste de la
Ruhr,
68
}
C'est avouer clairement que depuis neuf ans, le D.G.B, a employé toutes
ses ressources de persuasion et de contrainte pour maintenir la classe
ouvrière dans la paix sociale. Le D.G.B., pratiquement la seule centrale
syndicale, réunit cinq millions de membres et dispose de ressources
financières abondantes. C'est la grande machine bureaucratique par excel.
lence et ses relations avec la politique gouvernementale sont certaines,
elles passent par le canal de la social-démocratie qui le contrôle bien
qu'elle se défende de vouloir influencer le syndicalisme allemand. Le
D.G.B. a perdu durant les deux dernières années, 500.000 adhérents vrai-
Bemblablement dégoûtés de son immobilisme traditionnel.
Celui-ci est fermement arrêté chez ses dirigeants qui déclarent sans
détour ne pas vouloir gêner l'économie nationale", ni perturber l'ordre
social. On comprendre encore mieux la nature du D.G.B. si on se rap.
pelle le rôle donné aux syndicats allemands aussitôt après la guerre.
Afin de les utiliser comme couverture de la renaissance des forces poli-
tiques classiques de la bourgeoisie allemande, les Alliés donnèrent aux
syndicats une place prépondérante, qui illustrait la politique de "dénazi.
fication" et de "renaissance démocratique" de l'Allemagne. Le mythe de
la co-gestion des entreprises, utilisé beaucoup plus que ne le furent. les
comités d'entreprise en France, a été l'appât lancé à la classe ouvrière
allemande. Après vingt ans de nazisme, un tel mythe, patronné par les
nations qui s'étaient dites les ennemis jurés des cartels et qui avaient
fait de l'antifascisme" le drapeau idéologique de la deuxième guerre
mondiale, ne pouvait que prendre sur les travailleurs. Les illusions à ce
sajet ont duré quelques années. Mais il semble que maintenant le pro-
létariat en a fait l'expérience et se rend compte qu'il a payé les frais
de cette "paix sociale", qui a servi d'un autre côté aux bureaucrates
syndicaux pour s'asseoir à côté des patrons dans les conseils de co-ges-
tion, à des places bien rémunérées. Il est facile de comprendre dans ce
contexte pourquoi les dirigeants du D.G.B. n'ont reconnu les mouvements
de grève
très prudemment qu'après leur déclenchement par les
ouvriers et qu'ils aient tenté immédiatement de les localiser, de les
fragmenter et de les étaler dans le temps.
Du côté de la classe ouvrière, on ne peut parler évidemment de lutte
révolutionnaire ; l'essence de la grève était purement revendicative et a
son origine à l'arrêt de l'amélioration du niveau de vie depuis le deuxième
trimestre 1953, et à la modification continue de la répartition du revenu
national en faveur du capital. Bien que la production industrielle eut
dépassé son niveau d'avant-guerre (1938), dès le deuxième semestre 1950,
les salaires réels n'ont rattrapé ce niveau que deux ans plus tard, en
1952. Ils ont encore augmenté quelque peu, mais moins que la produc-
tivité du travail, jusqu'au deuxième trimestre 1953, et sont restés station.
naires depuis lors, tandis que la productivité du travail et les profits du
capital continuaient à augmenter. Les augmentations demandées en août
n'auront pour effet que de freiner en partie l'augmentation de la part des
profite dans le produit national.
Mais dans ce cadre revendicatif limité, la volonté de grève fut tenace.
Les différents référendums proposés plutôt pour amollir le conflit que par
respect de la démocratie ouvrière furent significatifs à ce sujet. Plus
important encore, les ouvriers quittèrent leurs ateliers en postant des soli.
des piquets de grève. Il est vrai qu'il n'y a pas eu d'occupation d'usines,
mais les combats contre les jaunes et la police ont été immédiats et
violents. Cette volonté ferme de protéger leur grève place les grévistes
allemands à un niveau plus élevé que celui des grévistes français en
août 1954.
Le patronat allemand n'a pas manqué d'assimiler les grévistes aux
staliniens pour les discréditer ; mais le rôle de ces derniers fut certaine-
69
NOTES
Les grèves en Allemagne occidentale
En juin 1953, le prolétariat d'Allemagne orientale manifestait aux yeux
du monde son opposition irréductible à la bureaucratie stalinienne. En
août 1953, quatre millions de salariés français passaient outre leurs syn-
dicats pour lutter contre l'exploitation de plus en plus dure de la bour-
geoisie française. En août 1954, la classe ouvrière de l'Allemagne occiden-
tale bouscule les pronostics de « paix sociale » dans le « pays fort de
l'Europe » et se met en grève pour améliorer son niveau de vie.
Loin d'être identiques, ces trois mouvements ont cependant ceci de
commun, qu'ils représentent une recrudescence de la lutte de classe
après une longue pause, et, à des degrés divers, la crise de l'emprise des
organisations traditionnelles sur les ouvriers.
Pour les ouvriers allemands, c'est la première fois exception faite
des événements de juin 1953 depuis novembre 1932 que réapparaît un
mouvement intéressant une partie importante de la classe. C'est en effet
peu avant la prise du pouvoir par Hitler que les ouvriers des transports
berlinois se mirent en grève spontanément pour protester contre la déci-
sion de Von Papen, encore chancelier, de baisser les salaires. Les nazis
décidèrent de les soutenir, Goebbels ayant déclaré : « Cette décision
effraiera les milieux modérés. Mais là n'est pas l'essentiel. Nous les rega-
gnerons facilement, tandis que si l'on perd les ouvriers on les perd pour
toujours » (1). Le K.P.D. (parti communiste allemand) désavoua alors la
grève et donna l'ordre de reprise du travail. Le prolétariat allemand ne
devait plus entreprendre de mouvement important avant 22 ans. Hitler,
prenant le pouvoir en janvier 1933, procédait immédiatement à des arres-
tations en masse d'ouvriers et militants syndicalistes, socialistes et com-
munistes.
Malgré la très grande discrétion des agences d'information et même des
« journaux ouvriers » on peut déjà se faire une opinion sur l'agitation
qui met en mouvement les secteurs très variés des employés des services
publics de Hambourg (15.000), les métallos de la Bavière (250.000) et une
série d'autres branches, où des revendications sont posées et les conven-
tions collectives dénoncées (les demandes d'augmentation de salaire sont de
15 % chez les mineurs et les métallos de la Ruhr, de 10 à 15 % chez
les employés des P.T.T., plus importantes encore jusqu'à 50 % pour
certaines catégories chez les ouvriers du textile), Près de 900.000 fonc-
tionnaires posent également des revendications, de même que les chemi-
nots. En tout, quatre millions d'ouvriers et de salariés, plus du quart du
prolétariat allemand, sont en effervescence pour améliorer leurs condi-
tions de vie.
(1) J. Goebbels, « Kampf um Berlin », p. 191.
66
Celles-ci ont fait jusqu'ici les frais de la reconstruction du capital
allemand, Le "miracle" de l'expansion allemande depuis 1949 s'explique
par ce secret de polichinelle : maintien d'un bas niveau de salaires, profits
élevés et accumulation rapide du capital. La proportion du produit
national brut consacrée à l'accumulation (brute) (2) de capital constant, qui
était de 19 % dans l'Allemagne de 1936 (3), est passée à 21 % en 1949,
23 % en 1950, 25 % en 1952. (Le chiffre correspondant pour 1952 était de
16 % pour la France et de 18 % pour la moyenne des pays d'Europe occi.
dentale et pour les Etats-Unis.) De plus, 3 % du produit national en
1952 ont été consacrés à l'investissement extérieur. Par contre, la con-
sommation privée, qui absorbait 60 % du produit national dans l’Alle.
magne nazie de 1936, tombait à 56 % en 1952 (4).
La première condition de cette accumulation a été évidemment un taux
de profit exceptionnellement élevé. De 1948 à 1953, la production indus-
trielle a augmenté de 151 %, le rendement horaire des ouvriers dans
l'industrie de 73 %, les salaires horaires réels de 44 % seulement (5). Une
importante redistribution du revenu national en faveur du capital a eu lieu
pendant cette période. Les facteurs qui ont permis cette redistribution ont
été d'un côté le chômage massif dû à l'afflux de réfugiés de l'Est
(1.412.000 chômeurs fin 1950, 1.203.000 fin 1953) et la pression exercée de
ce fait sur les taux de salaire, de l'autre côté l'attitude des syndicats
exerçant toute leur influence pour atteler les ouvriers allemands à la
reconstruction de l'économie "nationale" et déviant leur attention des
revendications vers le mythe de la "cogestion" des entreprises.
Cette production croissant rapidement trouvait ses débouchés d'un côté
précisément dans l'accumulation, la formation de nouveau capital, d'un
autre côté dans un surplus d'exportation croissant. De 1950 à 1953, le
volume des importations allemandes a augmenté de 33 %, celui des expor.
tations de 80 %. Ce mouvement inégal des importations et des exporta-
tions, combiné avec des mouvements des prix mondiaux favorables à
l'Allemagne, a transformé le déficit commercial de 1950 (trois milliards
de marks) en un excédent important en 1953 (2,5 milliards de marks) qui
continue à croître (2,9 milliards au taux annuel du premier semestre 1954).
On connaît les difficultés que crée pour les autres pays capitalistes euro-
péens la concurrence allemande sur les marchés internationaux.
On a déjà dit que l'augmentation des salaires réels est restée loin der-
rière l'augmentation de la production et de la productivité du travail.
Encore ceci n'est vrai que jusqu'au début de 1953. Depuis le deuxième
trimestre de 1953 en effet, les salaires n'ont pratiquement pas varié, cepen.
dant que la production continuait à .augmenter, et que la production
par heure-ouvrier faisait un nouveau bond en avant. Le capitalisme
allemand, une fois les salaires d'avant-guerre (les salaires du nazisme)
approximativement restaurés, considérait qu'il devrait être le seul à pro-
fiter de touto augmentation ultérieure du produit social. C'est là la
condition immédiate des grèves du mois d'août.
Le mouvement u démarré à Hambourg le 7 août, lorsque la volonté
des éléments de base força le syndicat des services publics à déclencher
la grève. Ils demandent 10 pfennigs (8 francs) de l'heure et 6 % pour les
(2) C'est-à-dire comprenant les amortissements.
(3) Territoire correspondant à celui de la République Fédérale actuelle.
(4) Statistics of National Product and Expenditure (0.E.C.E.), Paris, 1954,
p. 18 et 52.
(5) Voir les notes statistiques i In An de ce texte.
67
ment négligeable. La presse bourgeoise a signalé par contre avec complai-
sance l'hostilité des grévistes bavarois vis-à-vis des distributeurs de tracts
staliniens. Quoi qu'il en ait été, il est certain que la classe ouvrière alle.
mande éprouve dans sa grande majorité une répulsion profonde pour
ceux-ci. Si les ouvriers allemands n'ont pas oublié la guerre et le nazisme
ils n'ont pas oublié non plus l'attitude des staliniens vis-à-vis d'eux pendant
la guerre et à la fin de celle-ci (6). Le souvenir des pillages et des viols
commis par l'Armée Russe, le mépris de celle-ci pour le proletariat alle-
mand, ont été pour eux la traduction claire et concrète du contenu
"socialiste" de l'Etat de Staline. Cette expérience, même si elle a eu lieu
en Allemagne orientale, s'est inévitablement diffusée dans l'Ouest du pays
par l'immigration permanente de gens venant de la zone russe, le retour
de prisonniers, les contacts gardés avec des parents et amis. On comprend
dès lors que les tentatives des staliniens de présenter les grèves comme
une partie de la « lutte des peuples pour la politique de paix de l'Union
Soviétiqus » aient été très mal reçues par les métallos de Bavière.
Les réactions de la bourgeoisie occidentale, principalement anglaise et
française, ont été déterminées surtout par ses préoccupations concernant les
marchés d'exportation, envahis de plus en plus par les produits alle.
mands. Les citations suivantes des journaux anglais sont caractéristiques
à ce sujet :
« La vague de grèves déferlant sur l'Allemagne est un problème intéres-
sant directement notre pays. Les industriels d'Allemagne bénéficient d'un
important avantage : les bas salaires. L'institution des hauts salaires en
Grande-Bretagne est une conquête qui doit être défendue. Mais cette
conquête serait bien plus assurée si la paye des ouvriers allemands était
aussi élevée que celles de leurs camarades britanniques. » (Daily Express.)
« Il serait bon pour l'Allemagne, et sans doute aussi pour l'Europe
en général, que la crise actuelle, sans devenir trop sérieuse, contraignit les
dirigeants politiques et économiques de l'Allemagne Fédérale à accorder
plus d'attention aux revendications des salariés des usines et des champs, »
(Manchester Guardian.)
Analogues ont été les commentaires du Monde. Quant aux staliniens
français, ils tiennent beaucoup plus à leur opposition parlementaire contre
la C.E.D. qu'à la solidarité ouvrière, et leur presse fut extrêmement dis.
crète sur les grèves.
Sur la scène politique allemande, cette réapparition du proletariat
comme force se conduisant indépendamment de la sage tutelle de ses
"représentants" a apporté quelque perturbation. Au moment où Adenauer
l'homme fort de l'Europe", jouait ses dernières cartes en faveur de la
C.E.D., cette intervention inopinée de la classe ouvrière a encouragé les
sociaux-démocrates à élever le ton de leur voix ; c'est le moment que
leur leader Ollenhauer a choisi pour proposer de renouer les négocia-
tions avec Moscou. Il se peut fort bien que l'échec de la C.E.D. et l'agita.
tion ouvrière marquent pour Adenauer la fin d'une période de direction
presque totalitaire de la vie politique allemande.
La classe ouvrière du pays le plus industrialisé du continent vient de
redécouvrir que la lutte de classe ouverte et directe paie, beaucoup plus
que la conciliation, la « participation à la gestion » des entreprises et les
promesses syndicales. C'est la réfutation la plus éclatante de la propagande
stalinienne sur la passivité et la discipline aveugle des ouvriers allemands
propagande qui vise à attiser la haine et le chauvinisme chez les
ouvriers français.
(6) « Il n'y a de bons allemands que ceux qui sont morts ». (Ilya Ehren-
bourg).
70
La bureaucratie syndicale, comme l'expérience l'a prouvé dans bien
d'autres cas et en particulier en France, emploie tout son poids et toute
sa technique pour empêcher l'extension des grèves. Le prolétariat alle.
mand pourra maintenant en tirer la leçon.
Enfin, si les grèves d'août ont pu paraître tourner court, elles posent
pour l'avenir une perspective de luttes, comme le déclarait un délégué
des ouvriers dans un meeting lors de la reprise des métallos bavarois,
des leçons. C'était la répétition générale ; nous savons qu'il y a encore
beaucoup à apprendre ».
ANDRÉ GARROS.
NOTE SUR LES STATISTIQUES. Les chiffres concernant la produc-
tion industrielle, la productivité du travail et les salaires réels s'appuient
sur les séries publiées dans le « Bulletin Mensuel de Statistique des Nations
Unies », New-York, juillet 1954. Les principaux éléments en sont indiqués
dans le tableau ci-dessous ; toutes les séries sont des indices sur la base
1948 = 100, sauf les gains horaires dans l'industrie (exprimés en pfennigs)
et la durée du travail hebdomadaire (exprimée en heures). Les données
trimestrielles ne sont pas exactement comparables avec les données annuelles,
qui sont plus complètes, et celles concernant le deuxième trimestre 1954
sont provisoires.
1948 1953
1953
1954
(Moyen, ann.)
II III IV I II
(trimestres)
Gains horaires dans l'in-
dustrie
105 163 160 163 163 163 163 166
Coût de la vie
100 108 109 108 108 107 108 108
Gains horaires réels
100 143,7 139,8 143.7 143,7 145,1 143,7 146.4
Production industrielle 100 251 235 250 251 276
274 293
Emploi dans l'industrie 100 130 126 131 134 132 133 138
Durée du travail hebdoma-
daire
42,9 47,4 45,9 48,0 48,6 48,9 47,4 48,5
Emploi corrigé pour varia-
tions des heures de travail. 100 145,2 134,8 146,6 151,8 150,5 147.0 156,0
Productivité par heure-ou-
vrier
100 172,9 174,3 170,5 165,3 183,4 186,4 187,8
Un journal ouvrier chez Renault
.
Des ouvriers d'un atelier de chez Renault ont publié, au mois d'avril
dernier, un tract sur la hiérarchie des salaires. L'écho que ce tract a provo,
qué, aussi bien dans leur propre atelier que dans d'autres ateliers de
l'usine a été important ; rapidement, des ouvriers de plusieurs ateliers
se sont mis en contact et ont décidé de publier un journal mensuel des-
tiné à toute l'usine. Le premier numéro de « Tribune Ouvrière », ronéo-
typé sur quatre pages, a ainsi paru au mois de mai et son succès auprès
des ouvriers a confirmé le besoin que ceux-ci éprouvent d'un organe
d'expression indépendant, non inféodé aux deux blocs impérialistes. Les
perspectives et le contenu de ce journal ont été un des principaux points
7
71
-
de discussion lors de la dernière réunion de lecteurs de « Socialisme
ou Barbarie ».
Depuis, il est paru quatre numéros de « Tribune Ouvrière », le der.
nier daté du mois de septembre. Les extraits que nous en publions
ci-dessous montrent dans quel esprit est réalisé cet effort, qui représente
pour la première fois depuis les Comités de lutte apparus dans quelques
usines en 1947, un essai de création, au niveau de l'usine, d'un embryon
d'organisation des ouvriers permanente et indépendante des bureaucraties
syndicales et politiques.
Notre groupe fera tout ce qui est en son pouvoir pour appuyer cet
effort matériellement et idéologiquement. Nous avons assuré jusqu'ici le
service de « Tribune Ouvrière » aux abonnés de la Revue. Les lecteurs qui
voudraient recevoir «T.O. » peuvent nous écrire ; toute aide financière
sera précieuse. Egalement précieuses seront les suggestions, contributions
ou critiques et en particulier celles provenant des ouvriers d'autres usines
et d'autres régions.
« Socialisme ou Barbarie > publiera, dans ses prochains numéros, des
textes consacrés à l'étude de cet effort, des problèmes qu'il soulève et de
ses perspectives.
LE TRACT PUBLIE EN AVRIL 1954.
« Des ouvriers de l'annexe de l'A.O.C. ont pris l'initiative de publier un
journal d'atelier qui puisse exprimer leurs positions sur des problèmes qui
touchent la classe ouvrière. Ils veulent que ce journal soit le reflet
de la vie de l'atelier. A tous les colonnes sont ouvertes pour qu'ils puissent
exprimer leur point de vue sur ces questions.
Ouvrons le débat sur la hiérarchie des salaires.
D'un côté nous savons que la direction de l'usine veut créer de nou.
velles sous-catégories en plus de celles qui existent déjà.
D'un autre côté, tous les syndicats soutiennent une revendication qui,
si elle était adoptée, ammènerait une augmentation horaire de salaire
s'échelonnant progressivement de 45,80 pour le maneuvre I (à condition
que ce dernier travaille au rendement) jusqu'à 77,05 pour le P 3.
Dans les deux cas, aussi bien le Patron que les syndicats tendent à
accroître d'une façon absolue l'éventail hiérarchique qui existait déjà.
Nous pensons qu'au contraire les ouvriers doivent tendre à resserrer
cet éventail, Non pas en demandant une augmentation seulement pour
les petits salaires, mais en demandant que tous les salaires soient aug.
mentés d'une façon dégressive.
Si les patrons et la direction de l'usine paient les O.S. moins cher que
le professionnel, c'est parce qu'il se trouve plus d'O.S. que de qualifiés
sur le marché du travail, c'est parce que l'on peut remplacer les O.S.
impunément sans que la production s'en ressente à condition de conser-
ver toutefois les qualifiés. Ceci permet à la direction une pression beau.
coup plus forte sur cette masse qu'elle exploite sans merci tandis qu'elle
paiera plus cher les professionnels pour se les attacher.
Cependant, les écarts hiérarchiques entre deux catégories voisines ne
sont le plus souvent pas justifiées ni par la quantité, ni par la qualité
du travail fourni. Les écarts de salaires entre un O.S. 1 et un O.S. 2 ou
!
72
-
entre un P 1 et un P 2, entre un P 2 et un P 3 ne correspondent à rien.
Des ouvriers faisant le même travail reçoivent des paies différentes.
La seule justification d'une telle différence est pour la direction la néces-
sité de diviser les ouvriers entre eux, de faire des privilégiés et des
brimés.
La direction veut à présent étudier les cas particuliers pour augmen-
ter cette division. Personne ne touchera plus le même salaire.
Quelques arguments nous ont été opposés. Les voici :
On nous dit qu'il faut soutenir la hiérarchie parce qu'elle permet l'ému-
lation dans le travail.
On s'étonne beaucoup que ce soit les syndicats ouvriers qui parlent
le langage que les syndicats patronaux pourraient tenir avec plus de
logique.
Qu'est-ce que les ouvriers ont à défendre, la production, le travail ou
leur salaire et leur solidarité ? Si on soutient l'émulation du travail, il
faudra la soutenir jusqu'au bout quand Lefaucheux viendra prouver par
A + B qu'un tel doit gagner plus qu'un tel.
Les intérêts de l'O.S. et du P 3 sont fondamentalement les mêmes :
se défendre contre l'exploitation. Alors pourquoi essayer encore de gros
sir le fossé qui sépare l'O.S. du P 3, fossé qui se solde par 20 et 30,000 fr.
de différence par mois. Est-ce cela rechercher l'unité de la classe ouvrière ?
On nous dit encore : si la différence hiérarchique n'est pas assez grande
tout le monde voudra passer dans les catégories inférieures.
Et alors ? En supposant cette absurdité que tout le monde préférerait
les travaux pénibles et fastidieux, ce n'est tout de même pas la volonté
des ouvriers qui détermine les besoins de direction.
S'il faut 18.000 O.S., tous les professionnels auront beau être tous maso-
chistes et vouloir aller travailler dans les chaînes, la direction n'en
accep-
tera pas un de plus.
De même, les 18.000 O.S. auront beau être tous docteurs en droit qu'ils
resteront tout de même O.S.
On nous dit aussi que les O.S. n'ont qu'à se débrouiller.
Dans les grèves, si tous les O.S. refusent de marcher le mouvement est
voué à l'échec. C'est cette union élémentaire de la solidarité que l'on a
même oublié. Le sort de tous les ouvriers est lié et pourtant jusqu'ici
tous les mouvements ont rapporté des augmentations hiérarchisées. Ceux
qui subissent les plus lourds sacrifices dans les grèves parce qu'ils sont les
moins payés, ne bénéficient que de la plus petite part des augmentations,
On nous dit qu'il faut avoir la maîtrise avec nous.
Ce n'est pas une façon d'avoir la maîtrise avec nous en la chouchou-
tant, en augmentant l'écart de salaire entre eux et nous, mais au con-
traire en les rapprochant le plus de notre condition.
Alors à ce moment peut-être...
Avec de telles idées, on pourrait alors dire :
« Lefaucheux avec nous », et pour cela il suffirait de ne rien revendi-
quer du tout, mais alors c'est nous qui serions « avec Lefaucheux ».
Nous savons que la hiérarchie est la base même de toute la société capi-
taliste, c'est pourquoi nous pensons qu'il serait utopique de penser que
la hiérarchie peut être supprimée dans le système capitaliste, mais nous
pensons qu'il est possible d'en restreindre l'éventail et que c'est dans
cette voie que toute revendication doit être posée. Ce n'est que dans
ce cas que peut se réaliser l'unité.
Nous posons le principe, il est impossible de déterminer à une faible
minorité quelle peut être la revendication à suggérer,
Mais nous demandons à tous les ouvriers des différents ateliers de dis.
cuter ce problème et dans le cas d'un accord, de prendre contact avec
3
73
nous pour essayer de déterminer ensemble les revendications que nous
pourrons proposer.
EXTRAITS DU N° 1 (mai 1954) :
Que voulons-nous ?
Une forte organisation syndicale ou politique peut proposer, donner
des consignes. Une faible minorité d'ouvriers ne peut pas le faire.
Ce que nous voulons, c'est faire cesser la tutelle que depuis plusieurs
année exercent sur nous les grandes organisations dites ouvrières. Nous
voulons que tous les problèmes concernant la classe ouvrière sojent débat-
tus par les ouvriers eux-mêmes. Nous soumettrons ces problèmes à la
discussion la plus large.
Nous pensons que les organisations syndicales et politiques actuelles
trompent les ouvriers, mais que les ouvriers ne sont pas encore capables
de créer d'autres organisations véritablement autonomes. Quant à nous,
il ne nous appartient pas de créer de toutes pièces une organisation
ouvrière qui ne représenterait que nous-mêmes. Une organisation véritable.
ment ouvrière ne pourra être crée qu'avec l'appui et la volonté des
ouvriers. Nous devons en péparer les bases.
Ce que nous proposons, c'est de faire de ce journal une tribune à
laquelle nous vous demandons de participer. Nous voudrions que ce
journal reflète la vie et l'opinion des ouvriers. Il ne tient qu'à vous
qu'il en soit ainsi,
La grève de 24 heures du 29 avril.
La C.G.T. a lancé une grève de 24 heures. Les ouvriers n'ont pas suivi.
Pourquoi ? En août 1953, 4 millions et demi de salariés avaient cessé le
travail. Les syndicats n'ont pas lancé alors le mot d'ordre de grève géné.
rale. Pourquoi ? Pourquoi les ordres de grève ne viennent-ils pas lorsqu'on
les attend et pourquoi viennent-ils lorsque la plupart des ouvriers n'en
veulent pas ?
En fonction de quel critère la bureaucratie syndicale lance-t-elle ses
mots d'ordre ? Coordonne-t-elle la volonté des ouvriers des différents
secteurs ? Certainement pas. La bureaucratie syndicale décide et fait
ensuite exécuter ses ordres par tout son appareil de responsables.
Le syndicat décide du principe de la grève de 24 heures, décide de la
revendication et dit ensuite aux ouvriers : « C'est à vous de discuter ».
Discuter quoi ? Il ne s'agit pas évidemment de discuter ce qui a déjà
été décidé en haut lieu, ni du principe de la grève, ni de la justesse de la
revendication, car si l'on met en doute ces deux décisions on devient
automatiquement un agent du Patronat et un saboteur de la grève. La seule
chose que les ouvriers peuvent discuter c'est la manière de faire exécuter
la grève,
On appelle cela de la démocratie ouvrière. C'est du charlalanisme.
Pour la bureaucratie syndicale, préparer une grève c'est en parler
pendant trois mois sur tous les tons, l'écrire sous toutes les couleurs,
en pensant qu'à force les ouvriers seront convaincus.
Pour la bureaucratie syndicale, préparer une grève c'est affirmer au
départ qu'elle sera un succès.
Pour la bureaucratie syndicale, préparer une grève c'est envoyer régu-
lièrement des lettres d'invitation aux bureaucrates syndicaux des autres
centrales.
74
Et les ouvriers dans tout cela ? Ce sont ceux qui exécuteront les ordres.
Que cette grève ait échoué, nous n'avons pas à nous en réjouir, car de
tels échecs ne font que répandre le désarroi et la confusion parmi les
ouvriers. Il serait trop facile de prétendre que les ouvriers qui ont refusé
de faire grève avaient compris qu'on les trompait. Cela n'a pas été tou-
jours le cas. Mais il est également trop facile de prétendre que c'est par
stupidité ou par manque de conscience que les ouvriers n'ont pas débrayé.
Pour ceux qui raisonnent ainsi, la conscience de classe n'est pas autre
chose que la discipline vis-à-vis du syndicat. La réalité est bien diffé-
rente.
Depuis dix ans, des organisations aussi puissantes que la C.G.T., la
C.F.T.C., et F.O., ont entretenu le proletariat dans des illusions en affir-
mant tantôt que la solution était dans l'accroissement de la production,
tantôt qu'elle pouvait être trouvée par des grèves tournantes et non géné
ralisées. Mais devant ces méthodes de lutte et devant les résultats, qui se
soldent par un accroissement continu de l'exploitation, les ouvriers ont
perdu l'espoir d'attraper la carotte qu'on leur montre. Pendant des années,
ils ont suivi les ordres et ils en sont arrivés à la situation actuelle. Doit-
on s'étonner de ce qu'aujourd'hui ils refusent de continuer avec les
mêmes méthodes ? L'enthousiasme des travailleurs a été usé par des
actions limitées, des petites grèves sans issue.
Aujourd'hui, comme en août 1953, la C.G.T. ne peut pas dépasser ces
formes de lutte qui se limitent à des grèves tournantes. Tout en vou-
lant faire croire aux ouvriers qu'elle les défend, la C.G.T. redoute en
réalité des actions de grande envergure qui la compromettraient vis-à-vis
des bourgeois et des généraux adversaires de la C.E.D, avec lesquels elle
veut s'allier. De plus, des actions plus larges, ne manqueraient pas de
dépasser les objectifs limités qu'elle a établis. Ce n'est pas par hasard
si un responsable cégétiste des P.T.T. déclarait pendant les grèves d'août
qu'il valait mieux 21 grèves de 24 heures qu'une grève de 21 jours.
De cette dernière grève de 24 heures, nous en tirons les conclusions :
1. Sur les méthodes :
Toute revendication et toute action doit être au préalable discutée le
plus largement possible par les ouvriers. Ce n'est que dans cette mesure
qu'elles pourront être défendues efficacement. Ce n'est aussi que par ce
moyen que pourra se réaliser l'unité ouvrière.
2. Sur les revendications :
Il faut qu'elles soient capables d'unir étroitement toute la classe
ouvrière. C'est pourquoi nous défendons les revendications pon hiérar-
chisées : augmentation uniforme pour tous.
3. Sur les formes de lutte :
Des umeliorations appréciables ne pourront être obtenues qu'au prix
de grandes luttes et de gros sacrifices. Il faut le dire. Ceux qui préten-
dent que les grèves de 2 ou de 24 heures peuvent donner des résultats,
trompent les ouvriers. Pour préparer ces grandes luttes, nous aurons à
combattre non seulement le Patronat et le Gouvernement bourgeois, mais
aussi à nous débarrunner de toutes les illusions qu'entretiennent les cen-
trales syndicales.
La préparation de ces luttes ne peut se faire que par un
prise de
conscience des ouvriers et c'est cette conscience de classe que nous voulons
développer à travers l'exposition et la discussion des problèmes que
nous aborderons ensemble dans ce bulletin.
75
EXTRAITS DU N° 2 (juin 1954) :
Aux camarades qui nous lisent.
Nous voulons que ce journal soit l'æuvre non seulement d'ouvriers de
l'usine Renault, mais aussi d'ouvriers d'autres usines. Ces feuilles sont
ouvertes à tous les ouvriers qui ont quelque chose à dire sur les pro-
blèmes qui touchent la classe ouvrière dans son ensemble. Une partie du
journal sera réservée, à chaque parution, à la critique du numéro précé-
dent. Nous vous demandons d'exprimer vos. critiques, de nous écrire ce
que vous pensez des problèmes traités.
Ce journal ne peut vivre que par nos efforts ; il dépend donc de tous
ceux qui y participent ; plus nous aurons de l'argent plus nous éten-
drons sa diffusion. Le dernier numéro revenait à 15 francs l'exem.
plaire. Nous espérons réduire le prix en le tirant nous-mêmes, ce qui nous
permettra aussi d'augmenter le nombre de pages.
Encore la hiérarchie.
On a coutume de justifier la hiérarchie des salaires en rappelant le nom-
bre d'années d'études que doivent faire les ouvriers et les techniciens
pour acquérir leurs connaissances. Nous avons déjà montré que cette
justification n'était bien souvent pas évidente. Avec la division du
travail de plus en plus poussée, les barrières entre les catégories d'ou-
vriers sont de moins en moins nettes. Quelle différence de travail y a-t-il
entre un PI et un P 2 ? Entre un O.S. et un P I? etc...
La division des ouvriers en un grand nombre de catégories a surtout
une justification politique. Si les ouvriers ne touchent pas le même salaire,
ils pourront se jalouser ou rejeter la responsabilité de leur bas salaire
sur celui qui touche 10 ou 15.000 francs de plus pour un travail à peu
près semblable.
Mais une certaine hiérarchie pourrait se justifier dans l'usine capita.
liste dans le sens qu'un travail qui demande plus d'apprentissage doit
être plus payé que celui qui n'exige aucune connaissance particulière. Il
n'en reste pas moins vrai que ceux qui sont les plus payés dans la société
et dans l'usine ne sont pas obligatoirement ceux qui possèdent des con.
naissances plus grandes.
Pourquoi les cadres, la maîtrise, touchent-ils des salaires beaucoup plus
élevés ? Ce n'est pas à cause de la qualité de leur travail qui, le plus sou-
vent, consiste à surveiller, à prendre des mesures disciplinaires, à faire
respecter les lois du travail, choses que beaucoup pourraient faire (il y a
évidemment des exceptions et il arrive que la maîtrise ait des fonctions
de direction et des capacités techniques). Mais si les fonctions de direc-
tion des cadres ne nécessitent pas des connaissances particulières, elles exi-
gent par contre le dévouement le plus absolu à la Direction de l'usine
et aux intérêts de l'entreprise. C'est pour cela qu'ils sont mieux payés
que le reste du personnel.
Il est courant de voir les cadres choisis parmi les adhérents des orga:
nismes confessionnels ou des partis politiques ayant la cote. Leur dévo-
tion au régime et à l'entreprise compte davantage que leurs capacités
techniques ou simplement intellectuelles, car pour faire le travail il y a
les armées d'ouvriers, de techniciens et d'ingénieurs.
La classe dominante de la société, le patron ou le directeur d'une
usine, estime que ceux qui défendent la production et en mênie temps
ses intérêts, doivent être mieux rétribués que ceux qui exécutent et qui
subissent cette production. Plus cette classe dominante voudra exercer
.
76
de pression sur les ouvriers, plus elle augmentera l'écart de salaire entre
les cadres et les ouvriers. C'est un fait connu que l'on augmente les
salaires de la police à l'occasion de grandes grèves.
Le système hiérarchique est dirigé en premier lieu contre l'ouvrier ; il
est la base même de toute société capitaliste et ne peut être détruit
qu'avec la destruction de ce type de société.
Cependant, la hiérarchie des salaires est défendue non seulement par
les patrons mais aussi par les syndicats. Bien entendu, dans des cas parti-
culiers, lorsque les ouvriers s'opposent aux revendications hiérarchisées, les
syndicats consentent à modifier leur position, comme chez Renault par
exemple, mais ce ne sont en réalité que des mesures démagogiques,
« pour avoir la clientèle », qui ne changent pas l'orientation générale. Sur
le plan national, aussi bien la C.G.T. que F.O. et la C.F.T.C. défendent
les augmentations de salaire hiérarchisées.
Nous n'insisterons pas sur la politique suivie par F.O., la C.F.T.C. et
le S.I.R., car ce qui caractérise ces syndicats depuis des années орро-
sition à toute action de classe et soutien de la politique de la bour-
geoisie française – n'a pas changé aujourd'hui,
Nous, nous sommes contre la hiérarchie qui divise les ouvriers. Nous
sommes pour l'unité des ouvriers dans leur lutte contre l'exploitation.
Et la C.G.T.? Elle est aussi pour l'unité, mais pas la même ! Elle est
pour l'unité de « tous les bons français » et ne peut donc qu'être POUR
la hiérarchie des salaires, car elle considère comme bon Français le bon
contremaître, le bon patron, le bon général, le bon policier, le bon minis-
tre qui diront «non» à la C.E.D. par exemple (quant à nous, si nous
disons NON à la C.E.D., c'est pour des raisons tellement différentes que
nous ne nous considérons pas dans le lot des bons Français. D'ailleurs,
la C.G.T, ne s'y trompe pas et préfère de beaucoup tendre la main aux
généraux adversaires de la C.E.D. qu'à ceux qui, comme nous, n'arrêtent
pas leur antimilitarisme uniquement à cette C.E.D.).
C'est l'unité politique des bons Français que veut la C.G.T., mais
cette unité-là s'oppose à l'unité des ouvriers.
Le mot d'ordre de la C.G.T. est « Tout le monde avec nous .
Quand elle s'adresse à la maîtrise et aux cadres, elle dit : «Il faut
relever l'éventail hiérarchique ».
Quand elle s'adresse aux bons capitalistes, en quête de bénéfices, elle
dit : « Il faut que vous commerciez avec l'Est ».
Et la solution à tout cela, c'est de changer de gouvernement et de
laisser tout le reste en place.
Ce que veut la C.G.T., c'est que le gouvernement soit favorable à la
politique internationale qu'elle propose, et pour cela elle est prête à
collaborer avec n'importe qui, à défendre n'importe quoi, sauf, bien
entendu, les intérêts des ouvriers.
Si l'on promet à la maîtrise un relèvement de l'échelle hiérarchique,
nous savons que cela est contre nos intérêts.
Si l'on promet aux capitalistes de faire des bénéfices, nous savons que
ces bénéfices seront faits sur notre dos. Comment pourrait-il en être
autrement ?
On ne peut ménager la chèvre et le chou, dire que l'on est avec les
patrons et avec les ouvriers à la fois. On est pour les uns ou pour les
autres.
Puisqu'il est impossible de concilier des intérêts absolument opposés
et puisque nous appartenons à la classe que l'on exploite, nous devons
répondre NON à tout projet de revendication hiérarchisée, parce que
la hiérarchie agit contre nous et nous lie plus étroitement au système
auquel nous nous opposons sans cesse.
77
Réponse aux lecteurs.
A la lecture de « Tribune Ouvrière », beaucoup de camarades ont dit :
« C'est très bien ce que vous dites-là, mais que faut-il faire ? »
Dans le premier numéro, il était dit qu'une toute petite minorité d'ou-
vriers ne pouvait pas donner de mots d'ordres et ne pouvait pas appeler
à la constitution de nouvelles organisations de masses. Mais cette idée
elle-même demande à être discutée. Il ne suffit pas de dire « Que
faire ? », il faut aussi proposer quelque chose, et à ce sujet, ceux qui ont
quelque chose à dire doivent le faire.
Nous avons été habitués à recevoir des directives et à les appliquer.
Aujourd'hui, il y a bien encore des directives, mais plus personne ne
les suit. Nous nous trouvons donc devant un refus des ouvriers à appli-
quer les ordres des grandes centrales syndicales, et cela parce que la majo-
rité des ouvriers a perdu, d'une manière ou d'une autre, la confiance en ces
centrales.
Est-ce que pour cela notre situation est meilleure? Ne sommes-nous
plus des exploités ? Est-ce que l'avenir nous réserve « des lendemains
qui chantent >> comme on nous le promettait au moment de la recons-
truction de la France ?
Nous pouvons dire que personne ne se fait d'illusions à ce sujet,
Il nous faut donc d'abord bien regarder autour de nous, nous rendre
compte de la situation que nous fait le capital, et réagir, non pas à la
manière de ceux qui nous ont trompés jusqu'à ce jour, mais en repensant
comment dans le passé la classe ouvrière a réagi contre des formes d'ex-
ploitation diverses. Les exploiteurs ont beaucoup appris des luttes ouvriè-
res, aux ouvriers d'apprendre maintenant comment réagir contre le sort
qui nous est fait.
Que constatons-nous ?
1° Que nous travaillons plus d'heures qu'après 1936, pour un pouvoir
d'achat inférieur.
2° Que le travail est devenu plus intense et plus productif chaque
jour. Un seul ouvrier sur machine-transfert fait le travail de 20, 50 et même
100 ouvriers.
3° Que le patronat a perfectionné toutes sortes de formes de division
des travailleurs par la hiérarchie, le travail au rendement, et maintenant le
système des postes de travail.
4° Que la part que prélève l'Etat sur le travail et la production
en général est de plus en plus grande, et que ce prélèvement sert à l'entre-
tien d'une armée (avec ses armements colossaux), de guerres aux quatre
coins de la terre, de la police et d'une bureaucratie toujours plus grande.
15° Que la discipline dans les ateliers devient toujours plus dure et la
répression plus violente contre toute opposition.
6° Que notre travail a perdu petit à petit tout ce qu'il avait de créa.
teur pour ne plus devenir qu'une simple répétition de gestes automatiques.
7° Et enfin que l'avenir, plus que jamais, nous apparaît sombre et ter-
rible, que personne ne peut dire de quoi sera fait le lendemain,
Il y a là, jeté pêle-mêle, un certain nombre de faits réels dont chacun
se rend compte, ils ne sont pas le fruit de l'imagination et c'est à tous ces
problèmes qu'il faut donner une réponse, dire par quels moyens on peut
s'y opposer, les entraver ou les détruire.
Essayons de répondre aux points posés :
1° La durée du travail et le pouvoir d'achat :
Nous constatons que notre salaire n'est pas fonction de la durée et de
l'intensité de notre travail (puisqu'en 1936 nous avons travaillé 40 heures
par semaine avec une moins grande productivité et que notre pouvoir
d'achat était supérieur). Donc, notre pouvoir d'achat est uniquement déter.
78
.
.
miné par notre combativité. Nous devons donc lutter à toutes les époques
pour la diminution de la journée de travail ; le patronat devra tout de
même nous donner notre salaire qui ne peut pas être inférieur à celui
d'aujourd'hui car celui-là représente exactement le minimum en dessous
duquel on ne peut pas descendre.
D'autre part, la diminution du temps de travail est une des revendi-
cations qui doit satisfaire toutes les catégories et par là même unifier la
lutte qui débordera automatiquement ce simple objectif pour reposer
toutes nos autres revendications.
Le passé nous apprend qu'à partir de cette revendication les travail-
leurs de tous les pays se sont unis et ont imposé au patronat la diminutton
successive de la journée de travail jusqu'aux cinq jours de huit heures.
Il a fallu toute la soumission au patronat des dirigeants syndicaux et par-
ticulièrement Croizat pour imposer à nouveau aux travailleurs de France
la semaine de quarante-huit heures.
2° L'intensité du travail doit être combattue sous toutes ses formes,
depuis la lutte contre le travail au rendement en général, à tous les
moyens particuliers contre les cadences.
Nous refusons le travail au rendement par principe, car c'est une mys-
tification qui a pour but de faire croire à l'ouvrier que plus il travaille,
plus il gagne.
Le travail au rendement, tout en étant déjà une méthode ancienne, a
été largement développé depuis la fin de la guerre par les dirigeants de
la C.G.T. Leurs pleurnichements actuels contre les cadences infernales
ne doivent pas nous faire oublier que c'est eux qui ont poussé les ouvriers
à crever systématiquement les plafonds et à porter les coefficients de pro-
duction à 150 % et jusqu'à 200 % dans certains ateliers, tels que le Décol.
letage et les Forges.
Pendant ce temps, des ateliers entiers d'ouvriers et d'ouvrières n'arri.
vent pas à régler et sont payés au mini.
Lutter contre le travail au rendement c'est expliquer à nos compagnons
de travail qu'il ne faut pas s'abrutir pour essayer de réaliser des temps
trop bas, qu'il ne faut pas se laisser couler sans rien dire, ce qui fait
que les temps sont considérés comme faisables. Qu'il ne faut pas essayer
de s'en tirer par des trafics de toutes sortes.
La lutte contre le travail au rendement doit se porter sur le principe
même, à savoir que nous considérons le salaire à 150 % comme un
minimum et que nous n'avons pas à nous laisser tromper par des faux
calculs, mais à exiger ce salaire déjà tellement insuffisant.
3
EXTRAITS DU Nº 3 (juillet-août 1954) :
Quelques vérités sur le comité d'entreprise.
On nous a dit : «Votez au C.E, et vous obtiendrez 40 heures payées
48 ; 3 semaines de congés payés, 25.000 francs de prime pour tous ».
On prend les ouvriers pour des imbéciles. Nous conseillons à ceux qui
croient encore que leur bulletin de vote pour le C.E. peut leur apporter
tout cela, de lire le texte de loi sur le Comité d'Entreprise, dans lequel
il est dit en toutes lettres : «Le C.E. ne saurait avoir aucun caractère
revendicatif » ; pourtant on ne le croirait pas à lire la presse de ceux
qui se présentent aux élections, mais ils mentent pour obtenir leur place.
A quoi donc sert-il ce fameux C.E. A cela, il sert à proposer « toutes
mesures tendant à améliorer le rendement et à accroître la production ».
79
Donc non seulement le C.E. ne sert pas les ouvriers mais il est l'organe
de collaboration, de coopération avec le Patronat. C'est l'union tant
rêvée par beaucoup de gens entre le Travail et le Capital. Au profit de
qui cela ? Au profit de la production, au profit du patron.
On assoie quelques ouvriers syndiqués autour du tapis vert, on leur
demande des suggestions sur les mesures tendant à améliorer la pro-
duction,
Pourquoi cela ? Pour faire croire à leurs camarades qui travaillent à
la machine, qu'autour du tapis vert ils sont représentés et ils gèrent en
collaboration avec le patron. Mais ce qu'ils oublient souvent c'est que
< ces camarades >> du Tapis Vert dès qu'ils demandent ne serait-ce qu'un
sou d'augmentation, le patron ou la direction peut se fâcher tout rouge
et congédier ces gens qui ne respectent pas la loi. Lorsqu'ils demandent
que les bénéfices soient partagés parmi les ouvriers, le patron peut leur
montrer le texte de loi qui leur démontrera qu'ils sont là pour défendre
la production. Et, pour défendre la production il faut de nouvelles
machines, de nouveaux immeubles, etc... Il faut donc investir ces béné-
fices dans d'autres capitaux pour concurrencer les autres entreprises. Le
patron ou la direction peut démontrer fort justement que si les bénéfices
sont répartis parmi les ouvriers cela ne rapportera rien à l'entreprise,
et que ça ne rapportera qu'aux ouvriers. Mais au Comité d'Entreprise il
est bien entendu pour tous, que ce ne sont pas les ouvriers que l'on
défend.
Quand les patrons demandent la collaboration des syndicats c'est bien
pour une chose : c'est pour rouler les ouvriers.
Nous n'avons pas voté pour qui que ce soit au C.E., non pas parce
que nous étions embarrassés pour savoir qui devait s'asseoir devant
Lefaucheux mais parce que s'asseoir devant Lefaucheux pour discuter de
la production sert encore à faire croire aux ouvriers qu'ils gèrent eux
aussi l'Usine et qu'ils partagent les bénéfices.
Nous ne le croyons pas, nous ne voulons pas le faire croire aux autres.
Nous voulons simplement dire la vérité.
Encore les 40 heures.
La revendication des 40 heures paraît pour certains ouvriers une reven.
dication irréalisable.
Le fait est là.
Une des raisons de cet état de choses est incontestablement le système
d'heures supplémentaires qui abolit pratiquement la loi des 40 heures.
On a institué un système de salaire très compliqué qui fait qu'aujourd'hui
les heures dépassant la quarantième sont plus payées. Souvent les ouvriers,
au lieu de réclamer une augmentation de salaire, préfèrent une augmen.
tation d'heures de travail.
Le but que s'était assigné le gouvernement dans ce sens a été atteint.
La deuxième raison est que, depuis dix ans, on a rabâché aux oreilles
des ouvriers que leur salaire est fonction du travail qu'ils donnent. On
a dit, et l'on dit encore : < Produisez plus, vous aurez plus de bien.
être ». Mais là, il suffit de faire remarquer que c'est d'une part en 1936,
c'est-à-dire au moment de la loi des 40 heures, que les ouvriers avaient,
proportionnellement, plus de bien-être et que c'est dans les époques où
ils font 48 heures et plus, qu'ils ont un salaire inférieur à celui de 36.
Il est vrai qu'à chaque occasion l'on ne manque pas d'arguments pour
augmenter la durée et l'intensité du travail.
Hier c'était le « Retrousser Vos Manches » pour reconstruire.
80
Aujourd'hui, c'est pour que la France puisse concurrencer les autres
pays ; demain ce sera pour préparer la prochaine guerre, puis pour la
faire ; ensuite ce sera pour reconstruire ce que l'on aura détruit, et
ainsi de suite...
On n'en finira jamais.
La production capitaliste n'est pas une production qui sert aux ouvriers.
Le produit du travail n'est pas partagé parmi tous les membres de la
société. Une partie de ce travail va dans la poche des capitalistes et de
leurs représentants, une partie est engloutie dans des organismes qui
servent à maintenir l'exploitation des ouvriers (les C.R.S. par ex
exemple).
Une autre partie sert à augmenter l'intensité du travail des ouvriers par
le développement de bureaux de chronométrage, de bureaux d'études
de postes, etc., qui ont pour but de rogner toutes les minutes des ouvriers
pour la production. Ainsi, on se trouve dans ce cas, qu'une partie du
travail de l'ouvrier servira à payer des gens comme les chronos, qui
auront pour fonction d'accélérer les cadences. Enfin une autre partie, et
c'est la plus importante, sert à augmenter la production elle-même, par
l'achat de nouvelles machines, la construction de nouvelles usines. Le
développement de cette production n'a comme aboutissant que la produc-
tion de guerre qui non seulement ne servira pas aux ouvriers, mais qui
se retournera contre eux, puisqu'ils devront utiliser ces armes les uns
contre les autres.
Ce phénomène n'est pas nouveau. Que les ouvriers produisent plus ou
produisent moins, qu'ils fassent 40 heures ou 48, qu'ils aient de gros
salaires ou des petits, le résultat sera le même ; ils produiront toujours
pour les autres.
Ce n'est pas un excédent de produits qui déterminera les capitalistes à
faire des augmentations de salaire ou à diminuer la journée de travail.
Ni ce n'est la fin de la guerre d'Indochine qui pourra y changer quoi
que ce soit.
La journée de travail de 40 heures, l'augmentation des salaires ne
pourront se réaliser que si les ouvriers entrent en lutte et sont les plus
forts. Pour cela il faut qu'ils ne gardent plus d'illusions sur les possibi.
lités des gouvernementi, que ceux-ci soient de droite ou de gauche.
Ces revendications ne pourront être maintenues que si les ouvriers,
se fier aux accords de tous genres, sont continuellement prêts à
défendre ce qu'ils auront acquis. Une chose est certaine, c'est que de
telles revendications accordées par le gouvernement, entraîneraient un
handicap sérieux pour tout le système capitaliste.
Quand on nous dit que les patrons peuvent accorder 40 heures payées
48, cela veut dire que ceux qui ne veulent pas les accorder sont de mau-
vais patrons mais que des bons pourraient le faire.
La réalité est tout autre, le patronat et le gouvernemen n'ont accordé
ces revendications que lorsqu'ils y ont été obligés par les ouvriers comme
On veut nous faire croire aussi que si le capitalisme ne faisait pas la
guerre, les ouvriers pourraient obtenir les richesses qui y sont englouties
mak on oublie de nous dire que s'il y a des guerres c'est justement parce
qu'une grande partie du travail de l'ouvrier lui est extorquée.
De tolles revendications sont très difficiles à obtenir car ce sont des
revendications qui ébranlent le système lui-même. Cela n'a pas à nous
faire peur, e telles revendications ont infiniment plus de valeur que la
lutte individthlle et morcelée contre les cadences de travail par exemple.
Le système travail aux pièces, aux lais, à la chaîne permet un
embrigadement individuel et progressif de tous les ouvriers. Les cadences
ne sont pas les moines pour tous, c'est pourquoi lutter contre elles est
assez difficile.
sans
en 1936.
81
Par contre, la lutte pour une diminution des heures de travail, malgré
que sa réalisation paraisse plus lointaine, est plus réalisable car elle peut
englober la totalité des ouvriers ; elle peut réaliser leur union. Mais là,
il faut bien le dire, cette lutte sera impossible tant que les ouvriers atten-
dront encore les bons patrons, les bons gouvernements et leurs bons
ministres.
C'est dans ce sens, que ceux qui leur font croire cela sont les complices
de leur misère. »
(Socialisme ou Barbarie) à l'étranger
Nous avons pensé qu'il intéresserait les lecteurs de Socialisme ou
Barbarie d’être informés de l'écho que la revue commence à susciter
parmi les milieux révolutionnaires d'autres pays et des commentaires ou
traductions de nos textes publiés par des journaux ou périodiques étran-
gers. Nous n'en parlons pas pour nous décerner des louanges par per-
sonnes interposées nous pensons que les camarades de l'étranger ne
peuvent nous aider qu'en nous critiquant, et pour l'instant ils ne nous
critiquent guère mais à cause de l'importance politique de ce réta-
blissement des contacts internationaux entre groupes et publications
d'avant-garde et de la convergence idéologique qui commence à se des-
siner parmi eux.
Il y a maintenant près de six ans que Socialisme ou Barbarie paraît.
Pendant cette période, les échos de notre effort ont été rares, pour ne
pas dire nuls, aussi bien en France qu'à l'étranger. Nous savions qu'il ne
pouvait en être autrement, et que nous avions à continuer et à attendre.
Nous savions qu'ailleurs des camarades poursuivaient un effort souterrain
qui un jour arriverait à la surface, que d'autres parcouraient une évolu-
tion idéologique qui ne pouvait que les rapprocher de nos positions,
C'est ce qui commence à se produire maintenant, et qui confirme notre
conviction sur la puissance des idées révolutionnaires et la renaissance
inéluctable du mouvement prolétarien international. .
Certes, il ne s'agit pas de crier victoire. Le jour où une organisation
révolutionnaire mondiale pourra naître est encore très loin. Mais il est
essentiel de constater qu'une étape importante est actuellement franchie
et d'en prendre pleinement conscience, car il en découle non seulement
une confirmation de notre perspective révolutionnaire mais aussi et sur-
tout des nouvelles tâches idéologiques et pratiques.
Le journal ouvrier Correspondence, publié aux Etats-Unis (dont nous
avons parlé dans les nº 13 (p. 82) et 14 (p. 74 de cette Revue), publie
dans son n° 21 (10 juillet 1954) une note sur Socialisme ou Barbarie,
dans laquelle il insiste en particulier sur la contribution de notre reywe
pour créer un pont entre la classe ouvrière européenne et américaine »,
en publiant la traduction de l'Ouvrier américain dans ses n 1 à 8, et
en les faisant précéder d'une introduction qui « montre combien profon-
dément le traducteur a compris la contribution spécifiquement américaine
de ce texte aussi bien que sa signification universelle ».
Le groupe « Spartacus » de Hollande, sur lequel nous comptons infor-
mer davantage nos lecteurs dans un prochain numéro 4 qui est proche
des positions de A. Pannekoek) après avoir publié mmé note sur notre
revue et nos positions, présente dans son journal paracus une traduc-
tion du texte «La grève chez Renault », et dans fa revue théorique
OS
82
son
.
Action et pensée une traduction de «La bureaucratie syndicale et les
ouvriers », parus dans le n° 13 de Socialisme ou Barbarie.
En Italie, la revue Prometeo, publiée par les camarades du Parti
Communiste Internationaliste en collaboration avec d'autres 'groupements
de gauche (1), imprime dans numéro de mars une traduction
de larges extraits de l'éditorial « Socialisme ou barbarie > publié dans
notre n' l.
D'autre part, le journal L'Impulso, organe des Groupes Anarchistes
d'Action Prolétarienne d'Italie, a publié un commentaire sur notre n° 14.
Les G.A.A.P. représentent en Italie la tendance nouvelle qui s'est
affirmée depuis quelques années dans l'ancien mouvement anarchiste et
qui a fini par rompre avec les conceptions et les groupes traditionnels
Tout comme la Fédération Communiste Libertaire en France, ils ont une
position internationaliste et révolutionnaire ; leur programme de « con
munisme libertaire » s'appuie sur une analyse matérialiste des rapports
sociaux et de l'évolution du monde moderne. Par ailleurs, ils collaborent
à la revue Prometeo, mentionnée plus haut.
L'Impulso (An. VI, n" 6, 15 juin 54) écrit :
« La l'evue française Socialisme ou Barbarie, dont les positions de
gauche ouvrière sont proches de celles de Prometeo, vient de publier un
numéro extrêmement riche.
Un long texte de Pierre Chaulieu sur la « Situation de l'impérialisme
et perspectives du prolétariat >> trace les lignes du développement impé-
rialiste pendant les cinquante dernières années, en analysant particuliè.
rement la deuxième guerre mondiale et le récent après-guerre. Les traits
communs des impérialismes américain et russe, ainsi que leurs différences
structurelles, les tendances des deux blocs antagoniques vers la guerre,
les tâches de l'avant-garde révolutionnaire sont fermement exposés dans
une analyse complète et convaincante.
D. Mothé publie un article intéressant sur la phase de la dégénéres-
cence des syndicats (« Le problème de l'unité syndicale »). Irrefutable du
point de vue théorique (point de vue adopté par les G.A.A.P. à leur
première Conférence Nationale), il est discutable dans le domaine tactique.
La discussion entre Anton Pannekoek, le dirigeant bien connu des
« tribunistes » hollandais pendant la première guerre mondiale, compa-
gnon de Hermann Görter et sérieux opposant de l'Internationale Commu-
niste après en avoir été un des fondateurs, et Pierre Chaulieu, un des
rédacteurs de la revue, est d'une grande importance au point de vue de
l'élaboration de la théorie révolutionnaire. On ne peut qu'être d'accord
avec la ferme et brillante critique que ce dernier fait de Pannekoek,
dont les positions vis-à-vis de l'I.C. sont, ou plutôt ont été, historiquement
justifiées, mais qui se trouvent aujourd'hui dépassées tout comme les
thèses face auxquelles elles représentaient une saine réaction.
Il y a, enfin, un vivant portrait polémique de Wilhelm Pieck, une tra-
duction du journal de la gauche ouvrière américaine Correspondence et
des documents de la Vie ouvrière ».
(1) Voir dans la n.1 de « Socialisme ou Barbarie », l'article de A. Véga :
« La crise du borúigu me italien », p. 26 à 46, et dans le n° 12, p. 88 à 96,
* La plateforme poftique du PC.I. d'Italie ».
83
AL