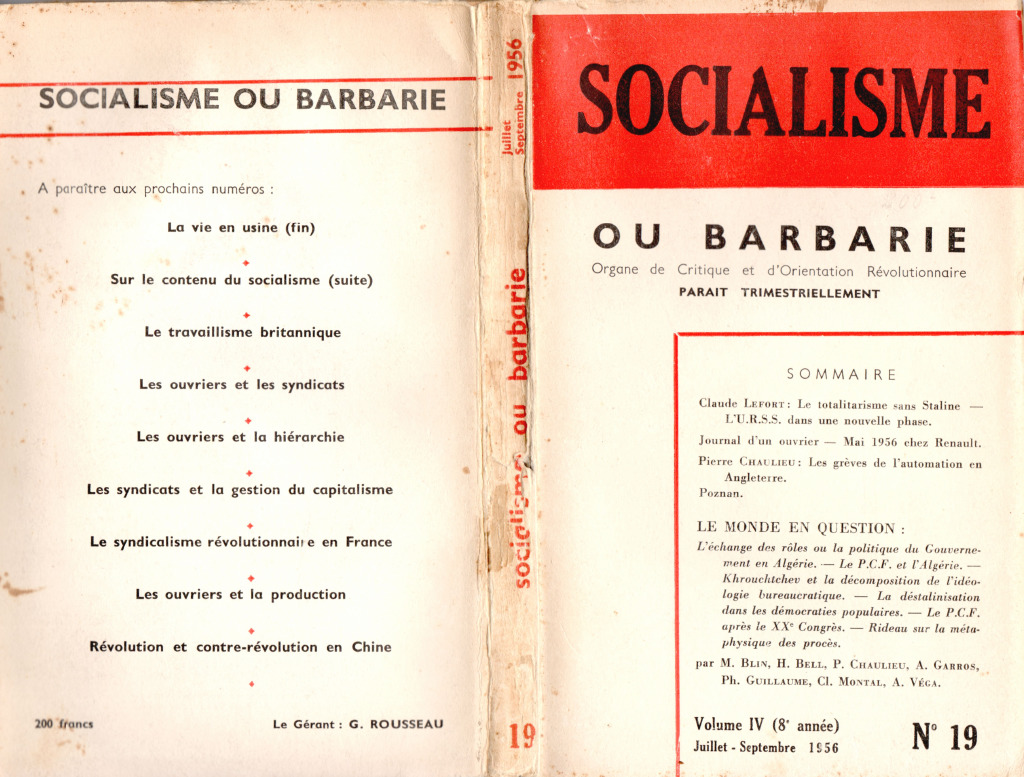LEFORT, Claude: Le totalitarisme sans Staline - L'U.R.S.S. dans une nouvelle phase 19:1-72 = Éléments d'une critique de la bureaucratie
Journal d'un ouvrier: Mai 1956 chez Renault 19:73-100 = Journal d'un ouvrier
CHAULIEU, Pierre: Les grèves de l'automation en Angleterre 19:101-115 = FR1956E*
Poznan 19:116-120
LE MONDE EN QUESTION:
De janvier à juin 19:121
BLIN, M.: L'échange des rôles ou la politique du gouvernement en Algérie 19:122-124
MOLLET, Guy (extrait d'un discours) 19:124
P. L. K.: Le choc psychologique 19:125
L'opposition impossible (avec une déclaration de Pierre Mendès-France) 19:125
La réalité (extraits d'Humanité et du Monde) 19:126
Le commentaire de la réalité (extrait d'un éditorial de L'Express) 19:126-127
GARROS, A.: Le P.C. et l'Algérie 19:127-130
Le P.C.F. vu par le Ministre de l'intérieur (déclaration de Bougès-Maunoury) 19:131
CHAULIEU, P[ierre]: Khrouchtchev et la décomposition de l'idéologie bureaucratique 19:131-138 = FR1956F*
La Pravda s'inquiète des effets de la nouvelle démocratie (cité par Le Monde) 19:139
En Hongrie Rakosi dénonce les abus de la liberté (cité par Le Monde) 19:139
En T[c]hécoslovaquie, Kopecky attaque étudiants et écrivains 19:139-140
...Et Novotny critique les militants (d'après Le Monde) 19:140
Un parti des vieux bureaucrates 19:140 = FR1956G
BELL, H.: La déstalinisation dans les démocraties populaires 19:141-143
Rakosi se déstalinise (cité par Le Monde) 19:143-144
GUILLAUME, Ph.: La déstakhanovisation en Pologne 19:144-145
De l'État de siège à La Nouvelle Critique 19:145-146
Il y a des limites à tout (extraits de Pierre Hervé, Lettre à Sartre et N. Khrouchtchev, Rapport dit "secret" suivi d'un commentaire) 19:146-147
VÉGA, A.: Le P.C.F. après le XXe Congrès 19:147-152
L'ingénuité déconcertante des chefs géniaux (A. Wurmser, L'Huma-Dimanche) 19:153
CHAULIEU, P. Rideau sur la métaphysique des procès 19:153-159 = FR1956H*
Les voix du silence (extraits de L'Express et d'A. Wurmser à Thierry Maulnier, L'Huma-Dimanche suivi d'un commentaire) 19:160
De la justice socialiste considérée comme exercice de tir (A. Wurmser, L'Huma-Dimanche, suivi d'un commentaire) 19:160
Après tout, c'était leur faute (A. Wurmser, L'Huma-Dimanche avec commentaires) 19:160
À PARAÎTRE AUX PROCHAINS NUMÉROS
Socialisme ou Barbarie - NO. 19 (JUILLET-SEPTEMBRE 1956)
Table des matières
SOCIALISME OU BARBARIE
Paraît tous les trois mois
42, rue René-Boulanger, Paris-Xe
C. C. P.; Paris 11987-19
Comité de Rédaction:
P. CHAULIEU - C1. MONTAL
D. MOTHE
A. VEGA
Gérant: G. ROUSSEAU
Le numéro
200 francs
600 francs
Abonnement un an (4 numéros)
Volumes déjà paris I, n°S 1-6, 608 pages; II, nºs 7-12,
464 pages; III, nº$ 13-15, 472 pages) : 500 fr. le volume.
SOCIALISME OU BARBARIE
totalitarisme
Le
L'U.R.S.S. DANS UNE NOUVELLE PHASE
sans Staline
Le nouveau cours de la politique russe inauguré depuis la
mort de Staline et illustré avec éclat par le XX° Congrès a une
extraordinaire portée dont on ne saurait prendre conscience
sans apercevoir le bouleversement social qui en est à l'origine.
En révélant et en consacrant ce bouleversement, il marque un
moment décisif dans l'histoire mondiale. Il a une signification
proprement révolutionnaire car il suppose --- par delà les per-
sonnages qui s'agitent à la tribune du Congrès, inventent de
nouveaux artifices de domination, parlent avec emphase de
l'édification du communisme, maudissent un ancêtre hier en-
core sacré héros civilis ur, décident une à une des tâches de
dizaines de millions d'hommes - les hommes eux-mêmes qui
n'ont pas la parole, mais dont les nouveaux besoins, les nou-
velles activités dans la production ,la nouvelle mentalité ont
provoqué une rupture avec le passé et la liquidation de celui
qui en fut l'incarnation incontestée. Révolutionnaire l'évène-
ment l'est parce qu'il désigne, non pas un changement d'orien-
tation politique de caractère conjoncturel, mais une transfor-
mation totale qui affecte le fonctionnement de la Bureau-
cratie en tant que classe, la marche des institutions essentielles,
l'efficacité de la planification, le rôle du parti totalitaire, les
rapports de l'Etat et de la société, parce qu'il exprime, au plus
profond, un conflit inhérent au système d'exploitation fondé
sur le capitalisme d'Etat.
En URSS comme ailleurs se manifeste le poids décisif
des classes exploitées; comme ailleurs la conduite de la classe
dominante s'avère déterminée par le souci d'assurer par de
nouveaux moyens une domination à laquelle ne suffit plus la
simple coercition et, comme ailleurs, le proletariat se trouve
affronter des tâches dont la formule, inscrite à l'envers de
l'échec capitaliste s'élabore progressivement.
SOCIALISME OU BARBARIE
Parait tous les trois mois
42, rue René-Boulanger, Paris-X€
C. C. P.: Paris 11987-19
Comité de Rédaction:
P. CHAULIEU - C1. MONTAL
D. MOTHE
A. VEGA
Gérant: G. ROUSSEAU
Le numéro
200 francs
600 francs
Abonnement un an 4 numéros)
Volumes déjà parus I, n°S 1-6, 608 pages; II, nºs 7-12,
464 pages; III, nºs 13-IS, 472 pages) : 500 fr. le volume.
SOCIALISME OU BARBARIE
Le
L'U.R.S.S. DANS UNE NOUVELLE PHASE
totalitarisme sans
sans Staline
Le nouveau cours de la politique russe inauguré depuis la
mort de Staline et illustré avec éclat par le XX° Congrès a une
extraordinaire portée dont on ne saurait prendre conscience
sans apercevoir le bouleversement social qui en est à l'origine.
En révélant et en consacrant ce bouleversement, il marque un
moment décisif dans l'histoire mondiale. Il a une signification
proprement révolutionnaire car il suppose --- par delà les per-
sonnages qui s'agitent à la tribune du Congrès, inventent de
nouveaux artifices de domination, parlent avec emphase de
l'édification du communisme, maudissent un ancêtre hier en-
core sacré héros civilisateur, décident une à une des tâches de
dizaines de millions d'hommes — les hommes eux-mêmes qui
n'ont pas la parole, mais dont les nouveaux besoins, les nou-
velles activités dans la production ,la nouvelle mentalité ont
provoqué une rupture avec le passé et la liquidation de celui
qui en fut l'incarnation incontestée. Révolutionnaire l'évène-
ment l'est parce qu'il désigne, non pas un changement d'orien-
tation politique de caractère conjoncturel, mais une transfor-
mation totale qui affecte le fonctionnement de la Bureau-
cratie en tant que classe, la marche des institutions essentielles,
l'efficacité de la planification, le rôle du parti totalitaire, les
rapports de l'Etat et de la société, parce qu'il exprime, au plus
profond, un conflit inhérent au système d'exploitation fondé
sur le capitalisme d'Etat.
En URSS comme ailleurs se manifeste le poids décisif
des classes exploitées; comme ailleurs la conduite de la classe
dominante s'avère déterminée par le souci d'assurer par de
nouveaux moyens une domination à laquelle ne suffit plus la
simple coercition et, comme ailleurs, le proletariat se trouve
affronter des tâches dont la formule, inscrite à l'envers de
l'échec capitaliste s'élabore progressivement.
Le XX° Congrès, par delà toute les significations qu'il
peut revêtir inspire une conclusion inéluctable. L'URSS n'est
pas, ou, disons mieux, l'URSS ne peut plus paraître un
monde « à part », une enclave dans le monde capitaliste, un
système imperméable aux critères forgés à l'approche du
capitalisme. La confiance ou la haine aveugle qu'elle a inspiré
aux uns et aux autres, la paralysie idéologique dont elle a
frappé l'avant-garde révolutionnaire pendant trente ans ne
peuvent indéfiniment résister aux solides discours des nou-
veaux dirigeants qui, poussés par la nécessité, font apercevoir
ia parenté profonde de tout système moderne d'exploitation.
Un rideau de fer autrement important que celui qui empêchait
la circulation des hommes et des marchandises est tombé: c'est
le rideau tissé par l'imagination des hommes, le rideau au tra-
vers duquel l'URSS métamorphosée paraîssait échapper à
toute loi sociale. Société sans corps, toujours confondue avec
la pure Volonté de Staline (infiniment bonne ou méchante), elle
a suscité le plus étrange délire collectif de notre temps. Délire
bourgeois qui convertissait l'URSS en une machine infernale
aux joints parfaitement huilés, broyant toute différence so-
ciale et individuelle et fabriquant sous les ordres d'un Gengis
Khan réincarné un homme robot chargé de l'anéantissement de
l'humanité. Délire « communiste » façonnant l'image idéale
du paradis socialiste, dans laquelle les contrastes les plus gros-
siers de la réalité se changeaient en harmonieux complémen-
taires. On ne l'a pas assez remarqué, ces délires opposés s'en-
trecroisaient curieusement dans le mythe d'un système parfai-
tement cohérent désigné comme totalitarisme absolu ou comme
socialisme mais toujours présenté comme radicalement diffé-
rent des systèmes capitalistes connus de nous. Le trotskysme,
il est vrai, présentait un tableau contrasté, mais se contentant
de greffer l'image du totalitarisme sur celle du socialisme il
accumulait dans son propre mythe les fictions des précédents.
L'URSS avait édifié des bases socialistes qui interdisaient
qu'on la rapprochất d'un système d'exploitation; en même
temps elle portait une dictature et de grossières inégalités so-
ciales qui la défiguraient; le prolétariat était le maître d'un
pouvoir dont il était par aiileurs totalement dépossédé. Comme
dans les rêves où toutes les métomorphoses apparaissent natu-
relles, dans l'utopie trotskyste, le socialisme se changeait en
son contraire sans perdre son identité. Le produit de cet im-
broglio était la prédiction à court terme d'une chute de la
Bureaucratie, petite caste de traîtres, impuissante à empêcher
une restauration capitaliste ou une résurrestion prolétarienne.
Sans doute les évènements sont-ils impuissants par eux-
mêmes à détruire les mythes, mais au moins ces derniers de-
vront-ils se transformer pour s'adapter aux bouleversements
2
survenus depuis la mort de Staline. La pseudo caste des
trotskystes dure et confirme sa solidité, à l'épreuve de la
guerre d'abord, et maintenant à l'épreuve d'une transforma-
tion du gouvernement. Si la Direction révise ses méthodes, ce
n'est ni sous la pression d'éléments capitalistes décidément
invisibles, ni sous la menace de l'impérialisme étranger, ni en
réponse à un soulèvement du prolétariat. Il faut donc com-
prendre l'évolution dans le cadre d'une structure sociale
pro-
pre... Cependant la Bourgeoisie voit disparaître avec son Gen-
gis Khan une merveilleuse clé d'explication. La terreur est
mise hors la loi, la dictature s'assouplit, on déclare garantir
aux citoyens leurs droits individuels; le niveau de vie des
masses est sensiblement amélioré et il s'avère probable qu'il
rejoindra dans quelques années celui des pays capitalistes
avancés; Staline enfin est dénoncé comme un tyran brutal qui
a vicié le développement du régime. Mieux: toute une série
de mesures sont adoptées qui prouvent clairement le désir des
Russes d'éviter la guerre. La bourgeoisie est prise de vertige:
son image de la machine infernale paraît dérisoire. Comment
continuerait-elle de rêver une différence de nature entre les
capitalismes occidentaux et l'URSS? Parallèlement l'imagina-
tion « communiste » se détraque. On avait dit de Staline qu'il
était le phare éclairant la route du socialisme, il paraît que
cette lumière orgueilleuse, à force d'aveugler, en noyait les
lignes; il était le pilote magnifique gouvernant parmi les
écueils semés par les agents impérialistes, il s'avère mainte-
nont qu'il inventait ces agents, transformant à plaisir tout
opposant en bandit; il s'avère qu'il semait lui-même les écueils
et qu'en son absence la marche eût été et plus souple et plus
rapide; il était le stratège génial qui avait su désagréger la
plus puissante armée du monde, le voici devenu dictateur
brouillon dont l'incompétence a failli exposer l'URSS à une
terrible défaite. Sans doute le Régime se prétend-il intact,
une fois débarrassé de son encombrante personnalité. Mais
comment conserver l'image de l'harmonie socialiste ? Le mythe
voulait qu'il y eut parfaite correspondance entre le système
économique et social et la direction politique: le système était
socialiste et Staline était génial, chacun était le reflet de
l'autre. La critique n'était donc pas possible à moins qu'elle ne
visât l'ensemble: toute action politique de Staline était perçue
par les « communistes » du monde entier comme juste pour
l'impérieuse raison qu'elle ne pouvait être fausse, traduisant
à chaque fois les nécessités objectives. Or ce mythe est éventré.
Si la politique de Staline depuis plus de vingt ans comporte,
une série d'ici erreurs » dont certaines colossales c'est
que
l'objectif et le subjectif ne se mirent plus l'un dans l'autre,
c'est que la nécessité historique est brisée, c'est enfin que la
3
critique est possible... Qui fixera ses limites à cette critique?
Staline seul est en cause, insinue Kroushtchev. Mais Staline
a incarné la politique de l'URSS, Qui dira donc où commence
et où finit l'erreur? Et qui dira où commence et où finit la poli-
tique ? Qui déterminera la prétendue frontière de l'objectif et
du subjectif ? Le régime politique et social peut-il se laisser
dissocier du régime économique? Quand l'Etat concentre tous
les pouvoirs entre ses mains, quand il définit l'orientation de
la production et son volume, quand il fixe les normes de tra-
vail, quand il détermine l'échelle des statuts sociaux par les
salaires et les avantages qu'il attribue à chacun, il est rigoureu-
sement absurde de séparer l'activité politique de la vie sociale
totale. En vain Kroushtchev prétend-il circonscrire le terrain
offert à la critique: si la personnalité de Staline n'est plus
sacrée, c'est toute direction d'hier et de demain, c'est le régime
dans son ensemble qui perdent leur droit divin à la vérité
historique. Le système devient objet d'analyse et objet de
critique comme tout système social.
L'effondrement de la mythologie stalinienne, avant même
qu'on en tente une interprétation et qu'on la fonde sur une
analyse de l'URSS, indique l'extraordinaire portée du dernier
tournant russe. Ce tournant ne saurait se comparer à aucun de
ceux qui ont été effectués pendant l'ère stalinienne, pourtant
fertile en zig-zags, pas davantage il ne saurait se réduire au
triomphe d'une fraction sur une autre. Dans le passé, en effet,
les brutaux coups de barre imposés par Staline ont eu toujours
la même fonction. Il s'agissait dans le cadre de l'URSS de
faire prévaloir le primat de la direction étatique aux dépens
de tout groupe social ou de toute fraction de la bureaucratie
qui menaçait la cohésion du régime. A l'échelle internationale
il s'agissait de faire prévaloir les intérêts de l'URSS aux dé-
pens de ceux des bureaucraties locales, en sorte que
les
rap-
ports de force entre les PC nationaux et les bourgeoisies res-
pectives qu'ils affrontaient soient nécessairement subordonnés
à la stratégie propre de l'URSS dans le monde. Trotsky a
suffisamment analysé les zigzags staliniens pour qu'il soit
inutile d'y revenir; les brutales purges opérées dans les cadres
des kolkhosiens, des techniciens, des militaires, des syndica-
listes, les revirements soudains dans la politique chinoise, alle-
mande, espagnole illustrent ce parcours tortueux de la dicta-
ture stalinienne imposé chaque fois sans transition préalable à
la totalité des acteurs « communistes ». Le lecteur franais se
souviendra plus particulièrement des tournants abrupts qui
jalonnent la route du PC et qui l'ont précipité successivement
de la guerre contre les socialistes, avant 34, au front populaire,
de la lutte à outrance contre la bourgeoisie et la guerre impé-
rialiste à la participation à cette guerre sur la base d'un natio-
nalisme effréné, de la collaboration avec la bourgeoisie au sein
du gouvernement issu de la Libération à une opposition vio-
lente contre les alliés de la veille. Mais ce que Trotsky ne pou-
vait expliquer c'est qu'à chaque tournant, et en dépit des
pertes locales subies par les PC, l'unité de la direction bureau-
cratique se trouvait réaffirmée catégoriquement, l'ensemble des
troupes rassemblant sur le nouveau terrain avec la même
cohésion que sur l'ancien. La solidarité du camp stalinien tra-
duisait en effet un trait essentiel des bureaucraties nationales
que ne pouvait voir Trotsky: la subordination rigoureuse de
leur politique à celle de l'URSS ne pouvait s'expliquer par la
trahison des chefs, par les liens personnels qui les unissaient
à la caste dirigeante en URSS ou par quelque autre facteur
accidentel; elle tenait à la nature même des PC qui partici-
paient de celle de la bureaucratie russe, qui cherchaient à
· frayer la voie à une nouvelle couche dominante, à arracher le
pouvoir à la bourgeoisie en même temps qu'à imposer un nou-
veau mode d'exploitation au prolétariat. Soumis aux pres-
sions dans chaque cadre différentes, de la bourgeoisie et du
prolétariat les PC ne pouvaient cristalliser leurs propres élé-
ments et prendre conscience des chances historiques que leur
offrait la concentration croissante du capital qu'en gardant les
yeux constamment fixés sur l'URSS, dont le régime leur
offrait l'image de leur propre avenir. Si les tournants de Sta-
line, quelles que soient leurs effets momentanés sur les PC
nationaux, étaient nécessairement ratifiés par ceux-ci c'est que
l'intérêt de ces derniers était réellement subordonné à celui de
l'organisme-mère seul capable de leur imposer l'unité idéo-
logique que leur propre situation sociale ne faisait qu'esquis-
ser. Et, de même, comme nous aurons l'occasion de le redire,
le totalitarisme en URSS se trouvait justifié par principe aux
yeux-mêmes des fractions qu'il décimait par la fonction qu'il
jouait en sacrifiant impitoyablement leurs intérêts à la cohésion
de la bureaucratie prise dans son ensemble.
Le tournant aujourd'hui effectué par la nouvelle Direc-
tion est radicalement différent, puisqu'il met en question les
principes mêmes dont tous les tournants précédents tiraient
leur origine. On récuse le totalitarisme, on loue la direction
collective, on admet implicitement que la politique de l'URSS
peut être contestée puisqu'on reconnaît explicitement que celle
de Staline était erronée, on désavoue les procédés par lesquels
la dictature a hier anéanti les opposants et s'est subordonné
les intérêts des pays satellites, on fait du passé qui s'était
présenté comme enchaînement inéluctable de vérités historiques
et avait été vécu comme tel un objet d'interrogation.
5
de ce que
Paroles ? Mais la parole est efficace. Et s'il est vrai qu'on
n'agit pas conformément à ce que l'on dit il est non moins
vrai qu'il serait insensé de désigner par la parole le contraire
l'on fait. Au reste des faits attestent le nouveau sens
du langage bureaucratique. Parce que le titisme se trouve offi-
ciellement légitimné par l'URSS, l'affirmation que le socialisme,
peut suivre des voies divergentes a pleine signification; celle
de Thorez, en revanche, que le PC français rappelle bruyam-
ment, n'en avait aucune en 1947 parce qu'elle n'annonçait alors
que Prague, ou la possibilité pour la bureaucratie de s'emparer
de l'appareil d'Etat sans insurrection armée du proletariat. Ce
qui dans le contexte stalinien apparaissait simple ruse verbale
destinée à dissimuler le monolithisme du bloc bureaucratique
est devenue expression réelle de la divergence.
Il est vrai que dans l'immédiat la divergence titiste reste
isolée, que les divers PC dans le monde, s'alignent à un rythme
plus ou moins rapide sur les nouvelles positions de Krous-
htchev, en dépit de leurs réticences et de leurs inquiétudes.
Les contre-épurations se déclanchent en chaîne en Europe
orientale avec la même rigueur que les épurations d'au-
trefois, inspirées par Staline. Mais si le fonctionnement
s'avère dans les conditions présentes inchangé (1), il
est atteint en son principe: les fondements de la discipline
mécanique instituée par la dictature stalinienne sont sapés par
ceux-là mêmes qui continuent d'une certaine manière de
l'exercer. C'est que les rites ne peuvent être bouleversés en un
jour, ils résistent et résisteront d'autant mieux qu'ils conti-
nuent de traduire dans chaque pays une situation sociale,
qu'ils continuent d'être des instruments efficaces de cohésion
pour les bureaucraties montantes. Cependant, à partir du mo-
ment où s'introduit une disjonction entre les rites et les
croyances — entre la discipline de fer et les principes idéolo-
giques ils deviennent de plus en plus vulnérables, de plus
en plus exposés à la cratique de ceux-mêmes qui les pratiquent.
En ce sens le tournant du XXe Congrès a inauguré un
cours nouveau et irréversible; le monopole de la vérité édifié par
1. En fait de nombreux signes indiquent que le tournant a d'impor.
tantes répercussions sur les divers Partis communistes dans le monde.
La Chine ne réagit pas comme la Pologne ; ni Thorez comme Togliatti.
Dans de nombreux cas notamment en Pologne, en Tchécoslovaquie et
en Bulgarie une vive critique de l'Appareil dominant est suscité par
le XXe Congrès et cet appareil est contraint pour se défendre de menacer
ouvertement les nouveaux opposants. En France, l'Humanité fournit
quotidiennement le spectacle du plus grand embarras, cherchant à la
fois à minimiser la critique du stalinisme et à s'aligner sur les nouvelles
directives.
6
le Stalinisme est brisé, quoique fassent les nouveaux diri-
geants pour le restaurer. Pendant des décades, les règles d'or-
ganisation et les règles de pensée de tous les militants com-
munistes ont été règles d'or. Inquiétudes, désarroi, critiques
individuels se résorbaient toujours dans la vision ultime de
l'univers stalinien, univers régi par la nécessité dans lequel
toutes les actions devaient coûte que coûte s'enchaîner méca-
niquement. La politique stalinienne de participation au gou-
vernement paraissait-elle contraire aux intérêts des ouvriers
français, au lendemain de la Libération? Elle ne pouvait l'être.
La conquête de l'Etat par les PC en Europe orientale prouvait
qu'elle était révolutionnaire. Cette conquête de l'Etat, les na-
tionalisations et la collectivisation paraissaient-elles s'effectuer
sans transformation de la situation du prolétariat dans la pro-
duction ? La portée socialiste de ces mesures était garantie par
le soutien que l'URSS leur accordait et l'exemple qu'elle don-
nait d'un régime vers lequel s'orientaient progressivement les
démocraties populaires. En URSS même, les inégalités so-
ciales, les conditions de travail, la répression policière pou-
vaient-elles inquiéter ? Ces traits découlaient, disait-on, de
l'isolement de l'URSS toujours menacée par l'impérialisme et
ses agents. Dans un tel système de pensée, il n'y avait pas de
prise possible sur les événements, la cause se trouvant renvoyée
de proche en proche jusqu'à la politique de Staline et celle-ci se
justifiant à son tour par les conditions objectives auxquelles
elle avait à faire facet qu'elle était seule à pouvoir apprécier
dans leur complexité. On n'avait donc d'autre possibilité (à
moins de tout contester) que de régler son activité sur celle de
la direction: militant, on était stalinien des pieds à la tête,
sans aucune autre référence possible que celle fournie par le
Parti. On était une fois pour toutes muni d'un système de
réflexes permettant d'agir dans toute situation quelle qu'elle
soit, qu'il s'agisse du pacte atlantique, de tactique syndicale,
de biologie, de littérature ou de psychanalyse...
C'esť précisément parce que le stalinisme constituait un
univers aussi mécaniquement réglé, que la critique actuelle ne
peut se laisser limiter à un secteur isolé. Comme à la fin du
Moyen-Age la simple critique des méthodes de l'Eglise a levé
l'hypothèque du sacré et conduit à un effondrement du
totalitarisme religieux, la seule mise en question de la
politique stalinienne appelle de proche en proche un
réexamen de chaque problème et ébranle le totalitarisme
moderne dans fondements. Mais
seulement les militants « communistes » et particulièrement
les intellectuels qui sont arrachés à leur torpeur; le
nouveau cours de la bureaucratie russe ne peut qu'exercer une
ses
ce
ne
sont pas
- 7
influence très forte sur le comportement du prolétariat dans son
ensemble. Car s'il est vrai que l'action du prolétariat est au
plus profond déterminée par les conditions de l'exploitation,
par sa lutte pour arracher au capitalisme, le contrôle de son
travail, cette action dépend aussi de son estimation des forces
sociales contre lesquelles il doit s'exercer, des chances histo-
riques qui lui sont offertes. En ce sens la cohésion du stali-
nisme a longtemps été perçue comme un barrage insurmon-
table. Consciemment ou non les ouvriers se sentaient paralysés
par leur bureaucratie. A la difficulté d'ébranler un appareil
puissant constitué pour les besoins de la lutte contre le Capital
mais rigidifié et de plus en plus distant des masses s'ajoutait
celle de s'attaquer à une force mondiale dont la cohésion histo-
rique apparaissait à tous. Cette cohésion altérée, la bureau-
cratie commence de perdre les dimensions fantastiques qu'elle
avait acquises. Elle n'est plus fatalité. Elle se révèle traversée
par des conflits, exposée à l'erreur, vulnérable. L'autorité
accordée aux dirigeants ertretenait dans le prolétariat un sen-
timent d'impuissance, il est amené à prendre conscience de leur
faiblesse et à scruter ses propres forces. On ne saurait en con-
clure que la crise des PC en elle-même, peut provoquer une
offensive prolétarienne, mais il paraît hors de doute que, placé
dans des conditions de lutte, le prolétariat se situerait dans un
nouveau rapport de forces avec sa bureaucratie.
C'est délibérément que nous avons cherché à souligner les
immenses répercussions possibles de la liquidation du stali-
nisme et de la nouvelle orientation Kroushtchev avant de nous
interroger sur les facteurs qui les ont déterminées. C'est qu'à
nos yeux l'évènement en tant que tel ouvre un champ nouveau
de possibilités. Idéologique, il est plus qu'idéologique, dans
la mesure où le stalinisme est lui-même à la fois phénomène
idéologique et phénomène social, système de pensée et système.
d'action. Nous n'en sommes pas moins conscients est-il
besoin de le répéter que les changements futurs dépendent
en dernier ressort non d'une transformation de mentalité, mais
de nouvelles luttes et de nouvelles formes de luttes de la
classe ouvrière. Déjà nous percevons toutes les ruses par les-
quelles le militant cherche à se dissimuler la rudesse de l'évè-
nement, à dominer son vertige, les yeux détournés obstinément
de la fosse stalinienne. On fait comme s'il ne s'était rien passé;
on répète que l'autocritique est signe de vitalité comme si la
liquidation de Staline n'était pas celle du passé; on se raccro-
che à Lénine comme si l'on pouvait en douceur transférer sa
foi d'un dieu à l'autre; et surtout l'on se félicite bruyamment
de l'assouplissement de 'a dictature, de la libéralisation du
régime, de l'amélioration des conditions de vie comme si la
8
Vérité inchangée avait seulement su devenir aimable. Tous les
« mécanisme de défense », comme dit le psychologue, tendent
à préserver le militant des sollicitations brutales de la réalité.
On ne saurait sans légèreté sous-estimer leur efficacité et les
ressources infinies de l'auto-mystification.
Mais, précisément parce que l'histoire est sociale essentiel-
lement, les péripéties de la pensée stalinienne ne doivent pas
non plus nous obnubiler. Toutes les tentatives destinées à
reconstituer une « bonne conscience » communiste ne peuvent
faire oublier que la nouvelle orientation répond à des pro-
blèmes sociaux surgis en URSS et dans le monde. Compren-
dre le sens de ces problèmes, la porté des solutions qu'on tente
de leur fournir est donc la première des tâches et celle qui
nous permettra de déterminer l'ampleur des répercussions du
tournant dans le monde communiste, sur lesquelles nous avons
d'abord insisté.
On se saurait cacher la difficulté de cette tâche et que,
dans les limites de cet article, on se propose de poser des fon-
dements – qu'on espère solides pour une analyse et une
discussion ultérieures plutôt que de donner une interprétation
exhaustive du nouveau cours. Une telle interprétation exige-
rait en effet qu'on tienne également compte des différents.
facteurs qui sont inextricablement mêlés dans la réalité, et de
la situation intérieure de l'URSS, et des relations entre
l'URSS et les autres pays bureaucratiques (particulièrement la
Chine) et de la concurrence entre le bloc bureaucratique et le
bloc occidental. Or nous comptons nous limiter à l'examen de
la situation en URSS Cette limitation, il est vrai, ne signifie
pas qu'on se préoccupe exclusivement de ce qui se passe à
l'intérieur des frontières géographiques de l'URSS. Si, comme
nous tenterons de le déinontrer, les problèmes qu'affronte la
nouvelle direction concernent le fonctionnement d'une société
hautement industrialisée régie par le totalitarisme, ils ne sont
pas l'apanage de l'URSS. Sans doute se posent-ils différem-
ment en Chine ou en Hongrie, qui demeurent encore au stade
d'une accumulation priroitive et différemment encore aux
Etats-Unis où le développement industriel ne s'accommode
pas d'une planification générale et d'un régime totalitaire.
Mais si diverses que soient les situations elles s'éclairent
l'une par l'autre, car elles connaissent des impératifs similaires
créés par la grande production moderne, l'impératif de nou-
velles relations sociales au sein de la classe dominante, d'un
nouveau mode de domination du prolétariat, d'un nouveau
comportement du prolétariat dans les usines. (2) Ainsi ce que
nous pouvons
dire sur l'URSS renvoie nécessairement à
d'autres cadres sociaux.
Cependant les limites de notre analyse apparaissent au-
trement importantes d'un second point de vue. Il est extrême-
ment difficile en effet d'analyser le nouveau cours en se gui-
dant constamment sur des donnces empiriques pour cette
excellente raison qu'en URSS, bien plus qu'en un régime capi-
taliste bourgeois, ces données sont dérobées à l'observation.
Cette difficulté est manifeste dès qu'on s'interroge sur la si-
gnification des rivalités qui déchirent la direction politique.
La liquidation de Béria, la rétrogradation de Malenkov, le
désaveu de Staline sont sans aucun doute l'expression de con-
flits sociaux mais officiellement ils sont rattachés à des motifs
futils: l'un est un espion, l'autre incompétent, le troisième mé-
galomane. Si l'on recherche une véritable explication, on ne
peut que s'arrêter à des hypothèses plus ou mons vraisembla-
bles. Encore ne s'agit-il dans ce cas que d'un aspect relative-
ment mineur du régime et peut-on rechercher à quels problèmes
sociaux se heurte la Direction sans se préoccuper de savoir
comment ils se traduisent exactement dans la rivalité des
clans politiques. Mais ces problèmes eux-mêmes, il ne nous
est pas permis d'en apercevoir le développement dans la vie
concrète des groupes. Nous ne pouvons par exemple savoir
quelles sont les réactions des ouvriers en face de l'exploitation,
car ces réactions sont soigneusement dissimulées par le régime.
Bien sûr, les grèves le sont, si du moins il y en a eu. Mais le
sont aussi tous les modes de résistance des ouvriers dans les
usines qui sans prendre la forme d'une action violente et pu-
blique exercent une influence considérable sur le développement
de la grande industrie. Dans un pays comme les Etats-Unis
cette résistance n'est certes pas reconnue pour ce qu'elle est (un
refus de l'exploitation capitaliste), elle est au contraire ratta-
chée le plus souvent à des traits psychologiques ou au climat
moral défectueux de l'usine, mais elle n'est pas niée: des mil-
liers de sociologues payés par le patronat, quand ce n'est pas
2. Dans tous les pays hautement industrialisés, l'essor de la techni.
que institue une division radicale entre les dirigeants et les exécutants,
une extrême spécialisation des tâches qui modifie les rapports entre les
individus au sein de la couche dirigeante et il exige une participation
active des producteurs au travail qui appelle un nouveau type de
commandement.
IO
.
par les syndicats, parlent de ce qu'ils appellent le refus de
coopérer des ouvriers, décrivent les procédés par lesquels ceux-
ci ralentissent le travail, sabotent des pièces, s'opposent à
l'application des nouvelles normes, s'arrangent entre eux sans
tenir compte de la hiérarchie que tente d'imposer le capital
par son système de primes. En URSS nous avons seulement
un écho de cette résistance, de loin en loin, dans la presse
syndicale ou dans les discours des dirigeants, mais nous ne
pouvons mesurer l'ampleur du phénomène et encore moins
préciser son évolution exacte. Nous ne pouvons que procéder
par induction, éclairer les quelques renseignements dont nous
disposons par ceux beaucoup plus nombreux qui nous viennent
des pays capitalistes, convaincus que nous sommes que la
situation des ouvriers dans la grande industrie moderne pré-
sente partout des traits similaires, et qu'en conséquence le
comportement du prolétariat russe ne peut être qu'analogue à
celui du prolétariat américain.
Cette méthode, si valable soit elle, ne nous fournit pas
cependant une approche historique suffisamment concrète du
Nouveau Cours russe. Entre les conclusions de portée générale
auxquelles elle nous conduit et les données précises du Nou-
veau Cours manquent, nous le sentons bien, les chaînons inter-
médiaires et ainsi nous manque également la rigueur de l'en-
chaînement total. Or ce que nous venons de dire des rapports
entre la bureaucratie et le prolétariat est aussi vrai des rela-
tions sociales à l'intérieur de la bureaucratie, qui nous parais-
sent avoir une importance décisive mais que nous n'appréhen-
dons qu'au travers de l'image réfractée qu'en fournissent la
presse et les discours officiels. Il faut donc interpréter, pro-
longer sur l'image des traits à peine esquissés, inventer des
transitions pour combler les lacunes, établir finalement une
convergence que brouillait le dessin officiel. Certes toute ana-
lyse sociale appelle ce travail quel que soit son objet puisque
les données sont toujours incomplètes et ambigues, puisqu'il
faut toujours reconstruire en partant d'une idée. Mais dans le
cas de l'URSS la part de l'interprétation est d'autant plus
forte que les données sont plus rares et plus fragmentaires.
Encore doit-on remarquer qu'elles viennent de s'enrichir sin-
gulièrement avec le XX° Congrès: les dirigeants n'en avaient
jamais tant dit... et leurs discours, tout particulièrement celui
de Kroushtchev offrent nouvelle et ample matière à la réflexion.
Cependant ces discours et la politique qu'ils inaugurent posent
précisément par leur nouveauté le problème décisif de l'inter-
prétation. On imagine qu'ils viennent répondre à des pro-
blèmes posés par le développement antérieur de l'URSS. Mais
pour déterminer le sens de la réponse il faut avoir déjà une
II
idée des problèmes posés, les discours noyant constamment
l'analyse de la situation réelle dans une apologie du socialisme.
Le lecteur a donc toujours le droit de répliquer à l'interpré-
tation qu'on lui propose: « ce que vous prétendez découvrir
dans le discours de Kroushtchev, c'est vous qui l'y mettez en
vertu d'une estimation a priori de la réalité russe. »
Si nous avons mentionné ces difficultés c'est qu'elles nous
paraissent inévitables et qu'il serait dangereux de les esca-
moter. Nous les reconnaissons donc explicitement. Nous disons
ouvertement que nous avons une certaine idée du développe-
ment de l'URSS, une certaine idée de la société totalitaire et
des conflits qu'elle engendre et que ces idées nous éclairent les
transformations actuelles; nous disons aussi que l'examen de
la nouvelle politique non seulement nous confirme ces idées
mais les éclaire à son tour. Seule la cohérence de l'analyse
peut garantir sa validité et le passage que nous opérons du
passé au présent, de la théorie aux faits.
1
LA FONCTION HISTORIQUE DU STALINISME
Au reste, qu'on considère la nouvelle politique. C'est elle
qui incite à s'interroger d'abord sur la signification du régime.
C'est elle qui remet le passé en question, et qui prétendant
distinguer ce qui était juste de ce qui ne l'était pas se définit
par rapport à l'ère stalinienne. Seulement ses procédés sont
assez insolites
pour avertir
que
la réalité est dissimulée. Toutes
les erreurs passées sont en effet rattachées à la seule personna-
lité de Staline. S'étant placé au-dessus du Parti par vanité,
ne souffrant plus la critique, pourvu d'un complexe de
persécution que - sa position dominante transformait en
complexe de persécuteur, Staline, dit-on, s'entoura d'intrigants
à son image et, grâce à l'incroyable pouvoir dont il disposait,
accumula les mesures arbitraires qui jetèrent désordre et
confusion dans tous les secteurs de la vie sociale. Comme
on peut le remarquer, la nouvelle Direction, en stigma-
tisant vigoureusement le culte de la personnalité ne
se demande même pas comment il lui fut possible de
se développer; d'ordinaire, un culte est l'euvre de ceux
qui le pratiquent, mais le culte staliniert est présenté
comme l'ouvre le Staline lui-même : IL s'est mis
dessus du Parti, IL a fondé son propre culte. Ainsi peut-on
s'abstenir de rechercher comment on l'a hissé ou laissé se hisser
au sommet de l'Etat, ce qui serait le début d'une analyse
réelle. De toute évidence les dirigents actuels, par ce mode
d'explication, ne se sont pas affranchis du fameux culte, ils
au-
-'12
sont seulement passés, pourrait-on dire du rite positif au rite
négatif: le premier consistant à charger un homme de toutes
les vertus, le second à le charger de tous les vices, l'un et l'autre
lui attribuant la même liberté fantastique de gouverner à son
gré les évènements. Cependant le passage au rite négatif a ceci
de particulier qu'il provoque une rupture ouverte avec l'idéo-
logie marxiste. Le rite positif n'en était certes qu'une pitoya-
ble caricature mais il ne la contredisait pas: Staline génial
était vu comme l'expression de la société socialiste. Comme
nous l'avons déjà dit l'objectif et le subjectif paraissaient coin-
cider bien que la mystification fût partout. En revanche, Sta-
line monstrueux n'a plus aucun répondant dans la société, il
devient un phénomène absurde, dépourvu de toute justifica-
tion historique, et tout recours au marxisme devient impossi-
ble. Un bon stalinien qui a répété pendant des années que les
traits hystériques ou démoniaques d'Hitler n'avaient pu avoir
une fonction sociale que parce qu'ils étaient venus exprimer
la dégénerescence du capitalisme allemand se retrouve seul, si
l'on peut dire, face au phénomène Staline sans autre expli-
cation que son essence de « méchanceté ».
Il faut donc, pour commepcer, poser la question tabou
par excellence et qui est question marxiste type: quelle a été
la fonction historique de Staline? Ou, en d'autres termes,
comment le rôle qu'il a joué est-il venu répondre aux exigen-
ces d'une situation sociale déterminée? Il va de soi qu une telle
question ne saurait porter principalement sur la personnalité
de Staline. Elle vise son rôle politique; elle vise une forme de
pouvoir qu'il a incarné et qu'on peut résumer sommairement
par la concentration de toutes les fonctions, politiques, écono-
miques, judiciaires en une seule autorité, la subordination for-
cée de toutes les activités au modèle imposé par la direction, le
contrôle policier des individus et des groupes et l'élimination
physique de toutes les oppositions (et de toutes les formes
d'opposition). C'est ce complexe de traits qu'on nomme ordi-
nairement terreur dictatoriale. Quant à la personnalité de Sta-
line, on est convaincu qu'elle exprime d'une certaine manière
ces traits et qu'elle est donc symbolique. Mais il n'est pas sûr
qu'elle puisse par elle-même enseigner quoique ce soit. Trotsky
a admirablement montré, dans sa i Révolution russe » qu'il
y avait une sorte de connivence historique entre la situation
des classes et le caractère de leurs représentants, en sorte que
s'imposaient simultanément par exemple un parallèle entre les
situations de la noblesse française et de la noblesse russe res-
pectivement à la veille de la Révolution de 89 et de celle de 17
et un parallèle entre les caractères de Louis XVI et du Tsar.
Mais cette caractérologie historique ne doit pas faire illusion;
13
elle ne prend un sens en effet que dans le cadre d'une interpré-
tation préalable des forces sociales. On ne sélectionne les traits
psychologiques d'un individu et on n'y découvre une finalité
que parce qu'on se guide sur une certaine image du groupe
social que représente cet individu. Aussi, quand Trotsky pré-
tend faire le portrait de Staline dans l'ouvrage qu'il lui a
consacré et dans Ma Vie il ne sélectionne que la médiocrité
intellectuelle du personnage et son tempérament rusé, tout
préoccupé qu'il est de faire concorder ce portrait avec sa défi-
nition de la bureaucratie comme caste parasitaire, comme for-
mation accidentelle dépourvue de toute signification historique.
A l'image de la bureaucratie qui maintient au jour le jour par
une série d'artifices une existence menacée par l'impérialisme
mondial et le prolétariat, Staline se trouverait privé de toute
intelligence de l'histoire et seulement capable de manoeuvrer
pour préserver sa position personnelle. Staline serait un faux
« grand homme » comme le parti qu'il incarne serait un pseudo
parti (3). Toute la construction repose sur une estimation de la
bureaucratie et comme on le voit, l'interprétation du stalinisme
commande celle de Staline. Il serait cependant faux d'en
conclure que l'analyse du personnage historique est finalement
dépourvue d'intérêt puisqu'elle ne fait que répéter l'analyse.
sociale en lui ajoutant un commentaire psychologique. Le rôle
propre de la personnalité se manifeste en effet non seulement
en ce qu'il remplit une fonction sociale mais aussi en ce qu'il
s'en écarte ou crée une perturbation. Dans le cas de Staline,
l'important serait de rechercher en quoi le personnage échappe
au cadre que semble lui fixer son rôle politique, dans quelle
mesure notamment son autoritarisme forcené détourne, à une
époque donnée, la terreur de ses buts primitifs ou en altère
l'efficacité. Mais cette recherche prouve assez qu'il faut com-
mencer par comprendre le rôle politique: Staline ne s'éclairant
que détaché sur le fond du stalinisme.
Il ne saurait être question dans les limites que nous nous
imposons de fournir une description historique du stalinisme,
mais dans la mesure où l'histoire fait éminemment partie de
la définition du phénomène social nous devons comprendre en
quoi à l'origine le stalinisme se distingue de toute formation
antérieure. Or il se confond avec l'avènement du Parti tota-
litaire. Il apparaît, quand le parti concentre entre ses mains
3. Rappelons cette formule de Ma Vie : «Le fait qu'il (Staline) joue
maintenant le premier rôle est caractéristique non pas tant pour lui que
pour la période transitoire du glissement politique. Déjà Helvetius disait :
"Toute époque a ses grands hommes et quand elle ne les a pas, elle les
invente”. Le Stalinisme est avant tout le travail automatique d'un appareil
sans personnalité au déclin de la Révolution ». p. 237 (Rieder, éd.)
14.
tous les pouvoirs, s'identifie avec l'Etat, et, en tant qu'Etat,
se subordonne rigoureusement toutes les autres institutions,
échappe à tout contrôle social, quand, dans le même temps, à
l'intérieur du Parti, la Direction se délivre de toutes les oppo-
sitions et fait prévaloir une autorité incontestée. Assurément
ces traits ne se sont pas dessinés en un jour ; si l'on voulait en
suivre la genèse, il faudrait se situer au lendemain même de
la révolution russe, noter dès 1918 l'effort du Parti pour se
débarrasser des comités d'usine, en les intégrant dans les
syndicats et en leur refusant tout pouvoir réel, il faudrait
suivre pas à pas la politique de Lénine et de Trotsky qui
proclament toujours plus fermement la nécessité d'une rigou-
reuse centralisation de toutes les responsabilités entre les mains
du Parti; il faudrait surtout constater que, dans le grand
débat syndical de 1920 le programme du parti totalitaire était
déjà formulé publiquement par Trotsky. On sait qu'à cette
époque celui qui fut plus tard l'ennemi nº I du Pouvoir affir-
mait qu'une obéissance absolue de tous les groupes sociaux
était dûe à la direction du Parti; postulant qu'en raison du
changement de propriété l'Etat ne pouvait être l'instrument
d'une quelconque domination contre le prolétariat, il affirmait
que l'idée d'une défense des intérêts de la classe ouvrière contre
1'Etat était absurde, et en conséquence préconisait une stricte
subordination des syndicats au Parti; en outre, fort du succès
que lui avait valu son plan de mobilisation des ouvriers dans
les transports il demandait une militarisation complète de la
force de travail (ne reculant devant aucune des mesures de
cærcition qu'elle impliquait); enfin il stigmatisait toutes les
oppositions, considérant que les principes démocratiques rele-
vaient du « fétichisme » quand le sort de la société révolution-
naire était en cause.
Et pourtant l'on ne saurait parler avec rigueur d'un sta-
linisme pré-stalinien. Non seulement Lénine réussit jusqu'à sa
mort à faire prévaloir l'idée, sinon d'un contrôle, du moins
d'une limitation du pouvoir du parti, reconnaissant l'existence
d'une « lutte économique », des ouvriers au sein de la société
post-révolutionnaire, concédant une relative autonomie au
syndicat, mais les fondements de sa politique, comme ceux de
la politique de Trotsky ne sont pas ceux qui s'établiront par
la suite. Pour l'un et l'autre, pour l'immense majorité des diri-
geants de cette époque, toutes les mesures « totalitaires » sont
considérées comme provisoires; elles paraissent à leurs yeux
imposées par la conjoncture, de simples artifices improvisés
pour maintenir l'existence de l'URSS dans l'attente de la révo-
lution mondiale, pour imposer une discipline de production
dans une période où la désorganisation économique engendrée
- 15
de
par la guerre civile est telle que la démocratie paraît incapable
de la résoudre. Sans doute, pour nous qui réfléchissons sur
une expérience historique trente ou trente-cinq ans après qu'elle
s'est développée les arguments des dirigeants bolcheviks ne
peuvent être acceptés tels quels; la dictature du parti si elle
se trouve renforcée sous la pression de facteurs conjoncturels
s'affirme déjà, nous l'avons dit, à l'époque de la révolution
aux dépens du pouvoir soviétique; davantage, elle est dans le
prolongement de l'activité du parti bolchevik avant la
révolution, elle ne fait que développer jusqu'à ses extrêmes
conséquences les traits du parti d'avant-garde, rigoureusement
centralisé, véritable corps spécialisé de professionnels de la
révolution dont la vie se développe largement en marge des
masses ouvrières. Rien ne serait donc plus artificiel
que
réduire l'évolution du parti à celle d'une politique, que d'igno-
rer les processus structurels qui conditionnent cette politique.
Il n'en reste pas moins que dans la période pré-stalinienne une
contradiction fondamentale subsiste au sein du parti, contra-
diction qui sera précisément abolie avec l'avènement du tota-
litarisme. Entre les moyens adoptés qui ne cessent d'accuser
la séparation entre l'Etat et les classes dont il se réclame, qui
ne cessent d'affranchir et l'Etat et, au sein de l'Etat, les diri-
geants bolcheviks de tout contrôle social d'une part et d'autre
part les fins qui ne cessent d'être proclamées, l'instauration
d'une société socialiste, il n'y a pas de choix effectué. Les diri-
geants, c'est l'évidence, ne choisissent pas: la thèse du dépé-
rissement de l'Etat continue d'être affirmée aussi impérati-
vement' tandis que l'Etat concentre tous les pouvoirs. Mais la
société elle-même, pourrait-on dire, ne choisit pas, en ce sens
qu'aucune force sociale n'est à même de faire peser ses intérêts
d'une façon décisive dans la balance. La différenciation des
salaires est si peu accusée qu'elle n'engendre aucune base
sociale matérielle pour une nouvelle couche dominante. Le
stalinisme est le moment du choix. D'un point de vue idéolo-
gique, d'abord: la formule du socialisme dans un seul pays
vient légaliser l'état de fait; la séparation de l'Etat et des
masses, la concentration de toute l'autorité entre les mains.
d'une direction unique. Tous les traits provisoires de la nou-
velle société et qui n'avaient leur sens plein qu'en fonction
d'une politique d'ensemble orientée vers le socialisme sont
ratifiés comme s'ils constituaient en eux-mêmes l'essence du
socialisme. La double conséquence de cette transformation
c'est d'une part que le stalinisme peut se présenter effective-
ment comme le continuateur du leninisme puisqu'il ne fait que
s'approprier certaines positions de celui-ci en les traitant sous
une nouvelle modalité, c'est-à-dire en les érigeant en valeurs
alors qu'elles étaient simples mesures de fait, c'est, d'autre
16
part, qu'il se dispense désormais d'une réflexion théorique sur
le marxisme; les mesures de l'Etat devenant socialistes paur
la seule raison qu'elles étaient léninistes (c'est-à-dire analo-
gues à celles que recommanda Lénine vivant). Tandis qu'avec
Trotsky la contradiction est à son comble et qu'ainsi celui-ci
se trouve obligé d'énoncer dans les termes les plus rudes sa
critique du fétichisme démocratique, avec Staline la mystifi-
cation est complète et l'étcuffement de la démocratie n'a même
plus besoin d'être reconnue, puisque le précédent léniniste de
la suppression des oppositions légitime à lui seul le caractère
socialiste du présent.
En outre, d'un point de vue « matériel », le stalinisme
concretise et cristallise un choix social. En inaugurant une
politique délibérée de différenciation des revenus, il accentue
considérablement les privilèges existants, les multiplie, les nor-
malise; il transforme de simples avantages de fait en statuts
sociaux; des fonctions qui étaient l'enjeu d'une lutte de pres-
tige soutiennent maintenant de puissants intérêts matériels.,
Dans le même temps les anciennes oppositions de mentalité
se muent en oppositions sociales; une fraction de la société
s'enracine dans le nouvea:1 sol fébrilement labouré
par
le Parti
et lie son existence définitivement au régime (4).
En d'autres termes, le totalitarisme stalinien s'affirme
quand l'appareil politique forgé par la Révolution, après avoir
réduit au silence les anciennes couches sociales dominantes,
s'est affranchi de tout contrôle du prolétariat cet appareil
politique se subordonne alors directement l'appareil de pro-
duction.
Une telle formule ne signifie pas qu'on attribue au parti
un rôle démesuré. Si nous nous situions dans une perspective
économique le phénomène central serait, à nos yeux, la con-
centration du capital, l'expulsion des propriétaires et la fusion
4. Il nous est impossible de développer dans le cadre de cette étude
une analyse économique de l’U.R.S.S. et l'on pourrait donc nous repro-
cher de supposer résolu le problème de la nature de classe de l’U.R.S.S.
au lieu d'en discuter. L'inégalité sociale que nous évoquons et la sépa.
ration de fait de l'Etat et du prolétariat ne suffisent pas, par exemple,
aux yeux des « communistes » qui les reconnaissent et à ceux des Trots-
kistes à caractériser l’U.R.S.S. comme une société de classe. Le fondement
socialisme du régime serait assuré par l'abolition de la propriété privée.
Pierre Chaulieu, dans une importante étude, a critiqué amplement
cette dernière thèse. Il a montré de façon péremptoire que les rapports
juridiques de propriété ne fournissaient eux-mêmes qu'une image défor.
mée des rapports de production, qu'à ce dernier niveau l'opposition du
Capital et du Travail est aussi radicale dans la société, russe que dans
la société américaine ou française ; il a montré enfin qu'il serait absurde
de séparer la sphère de la production de celle de la distribution et qu'en
17
des monopoles dans un nouvel ensemble de production, la
subordination du proletariat à une nouvelle direction centra-
lisée de l'économie. Nous soulignerions alors sans peine que
les transformations survenues en URSS ne font qu'amener à
sa dernière phase un processus partout manifeste dans le
monde capitaliste contemporain et qu'illustre la constitution
même des monopoles, les ententes inter-monopolistiques, l'in-
tervention croissante des Etats dans tous les secteurs de la vie
économique, en sorte que l'instauration du nouveau régime
paraîtrait figurer un simple passage d'un type d'appropriation
à un autre au sein de la gestion capitaliste. Dans une telle
perspective le Parti ne saurait plus apparaître comme un deus
ex machina; il se présenterait plutôt comme un instrument
historique celui du capitalisme d'Etat. Mais outre que nous
cherchons pou l'instant à comprendre le stalinisme en tant
que
tel et non la société russe dans son ensemble, si nous épou-
sions la seule perspective économique nous nous laisserions
abuser par l'image d'une pseudo nécessité historique. S'il est
vrai en effet que la concentration du capitalisme est repérable
dans toutes les sociétés contemporaines on n'en peut conclure
qu'elle doive aboutir en raison de quelque loi idéale à son
étape finale. Rien ne nous permet par exemple d'affirmer qu'en
l'absence d'un bouleversement social qui balayerait la couche
capitaliste régnante un pays comme les Etats-Unis cu l’An-
gleterre doive nécessairement subordonner les monopoles à la
direction étatique et supprimer la propriété privée. On en est
d'autant moins sûr, nous aurons l'occasion d'y revenir, que le
marché et la concurrence continuent de jouer un rôle positif
à certains égards dans la vie sociale et que leur éviction par
conséquence l'inégalité des revenus circonscrivait une couche sociale
particulière dont les « privilèges » communs traduisaient une appropria-
tion collective de la plus-value ouvrière et paysanne. En renvoyant le
lecteur à cet article (Les Rapports de Production en Russie », Socia-
lisme ou Barbarie, nº 2, mai-juin 1949), bornons-nous à ajouter que le
socialisme ne saurait se laisser définir « en soi », par la nationalisation
des moyens de production, la collectivisation de l'agriculture et la plani-
fication, soit indépendamment du pouvoir prolétarien. Il y a dans le
capitalisme bourgeois une infrastructure économique qui confère sa véri-
table puissance à la classe dominante, quel que soit le caractère de l'Etat
dans la conjoncture. En revanche, le socialisme ne peut désigner une
infra-structure puisqu'il signifie la prise en main par le proletariat des
moyens de production ou la gestion collective de la production. La
dictature du prolétariat c'est essentiellement ce nouveau mode de ges-
tion. Que celle-ci échappe au prolétariat, qu'il soit ramené au rôle de
simple exécutant qui lui est dévolu dans l'industrie capitaliste il n'y a
plus de trace de socialisme. La Bureaucratie d'Etat planifie alors selon
la perspective et dans l'intérêt de tous ceux qui se partagent les fonc-
tions dirigeantes. Les nationalisations et la collectivisation sont formelle-
ment au service de la société entière, réellement au service d'une classe
particulière.
18
la planification crée pour la classe dominante des difficultés
d'un nouvel ordre. En demeurant dans un cadre strictement
économique il faut, par exemple, se demander si les exigences
d'une intégration harmonieuse des différentes branches de
production ne se trouvent pas contrebalancées par celles de
développer le maximum du productivité du travail grâce à
la relative autonomie de l'entreprise capitaliste. Mais quoiqu'il
en soit, il faut convenir que les tendances de l'économie aussi
déterminantes soient-elles, ne peuvent être séparées de la vie
sociale totale: les « protagonistes » du Capital, comme dit
Marx, sont aussi des groupes sociaux auxquels leur passé, leur
mode de vie, leur idéologie façonnent la conduite économique
elle-même. En ce sens il serait artificiel de ne voir dans les
transformations qu'a connues l'URSS à partir de 1930 que le
passage d'un type de gestion capitaliste à un autre, bref que
i'avènement du capitalisme d'Etat. Ces transformations cons-
tituent une révolution sociale. Il serait donc tout aussi artificiel
de présenter le Parti comme l'instrument de ce capitalisme
d'Etat, en laissant entendre que celui-ci inscrit dans le ciel de
l'Histoire attendait pour s'incarner l'occasion propice que lui
offrit le stalinisme. Ni démiurge, ni instrument le Parti doit
être appréhendé comme réalité sociale, c'est-à-dire comme mi-
lieu au sein duquel simultanément s'imposent les besoins d'une
nouvelle gestion économique et s'élaborent activement les solu-
tions historiques.
Si l'appareil de production ne permettait pas, ne préparait
pas, ne commandait pas son unification, le rôle de l'appareil
politique serait inconcevable. Inversement si les cadres de
l'ancienne société n'étaient pas démantelés par le Parti, si une
nouvelle couche sociale n'était pas promue à des fonctions
dirigeantes dans tous les secteurs la transformation des rap-
ports de production serait impossible. C'est sur la base de ces
constatations que s'éclaire le rôle extraordinaire qu'a joué le
stalinisme. Il a été l'agent inconscient d'abord, puis conscient
et sûr de soi, d'un formidable bouleversement social au terme
duquel une structure entièrement nouvelle a émergé. D'une
part, il a conquis un terrain social nouveau en dépossédant
simultanément les anciens maîtres de la production et le pro-
létariat de tout pouvoir. D'autre part il a aggloméré des élé-
ments arrachés à toutes les classes au sein d'une nouvelle for-
mation et les'a impitoyablement subordonnés à la tâche de
direction
que
leur donnait la nouvelle économie. Dans les deux
cas la terreur dominait nécessairement l'entreprise. Cependant
l'exercice de cette terreur à la fois contre les propriétaires
privés, contre le prolétariat et contre les nouvelles couches
dominantes brouillait apparemment le jeu. Faute de compren-
19
dre que la violence n'avait qu'une seule fonction en dépit de
ses multiples expressions, on s'ingéniait à prouver, selon ses
préférences, qu'elle était au service du prolétariat ou de la
contre-révolution bourgeoise; ou bien l'on tirait argument de
ce qu'elle décimait les rangs de la nouvelle couche dirigeante
pour présenter le stalinisme comme une petite caste, dépourvue
de tout fondement de classe et seulement préoccupée de main-
tenir sa propre existence aux dépens des classes en compétition
dans la société. Le développement de la politique stalinienne
était cependant dès son origine sans ambiguité: la terreur
n'était pas un moyen de défense utilisé par une poignée d'in-
dividus menacés dans leurs prérogatives par les forces socia-
les en présence, elle était constitutive d'une force sociale neuve
dont l'avènement supposait un arrachement par les fers à la
matrice de l'ancienne société et dont la subsistance exigeait le
sacrifice quotidiennement entretenu des nouveaux membres à
l'unité de l'organisme déjà formé. Que le stalinisme se soit
d'abord caractérisé — avant 1929 puis dans la période de la
collectivisation et de la première industrialisation - par sa
lutte contre les propriétaires privés et le prolétariat, et par la
suite par les épurations massives dans les couches dominantes
n'est évidemment pas dû au hasard. La terreur suivait le
chemin de la nouvelle classe qui avait à reconnaître son exis-
tence contre les autres avant de « se reconnaître » elle-même
dans l'image de ses fonctions et de ses aspirations multiples.
Ce chemin fut aussi celui de la conscience bureaucratique.
On ne peut dire qu'avant l'industrialisation le stalinisme se
représente les buts que constituera ensuite la formation d'une
nouvelle société. La crainte d'entreprendre cette industriali-
sation, la résistance au programme trotskiste qui la préconise
témoignent de l'incertitude du stalinisme sur sa propre
fonction. Celui-ci se comporte déjà empiriquement selon le
modèle qui s'imposera par la suite, il renforce fébrilement le
pouvoir de l'Etat, procède à l'anéantissement des opposition-
nels, esquisse, avec prudence encore, une politique de différen-
ciation des revenus. La Bureaucratie se définit par tout
autre chose qu'un complexe de traits psychologiques. Elle
conquiert sa propre existence sociale qui la différencie
radicalement du prolétariat. Mais elle vit encore dans les
horizons de la société présente. C'est une fois lancée dans la
collectivisation et la planification que de nouveau horizons
historiques surgissent, que s'élabore une véritable idéologie
de classe et donc une politique concertée, que se consti-
tuent les bases solides d'une nouvelle puissance matérielle,
d'une puissance qui se crée et se recrée maintenant quo-
tidiennement en pompant les forces
en pompant les forces productives de la
20
société entière. A ce niveau pourtant de nouvelles tâches
naissent et la prise de conscience par le stalinisme de
son rôle historique s'avère alors, d'une nouvelle manière,
un facteur décisif du développement. C'est que l'indus-
trialisation formidable qui s'accomplit ne donne pas seu-
lement ses bases à une bureaucratie déjà constituée, elle
révolutionne cette bureaucratie, elle fait surgir, on ne le dira
jamais assez, une société entièrement nouvelle. En même temps
que se transforme le prclétariat dont en quelques années des
millions de paysans viennent grossir les rangs, se fabriquent
de nouvelles couches sociales arrachées aux anciennes classes,
au mode de vie tradinionnel que leur réservait l'ancienne
division du travail. Techniciens, intellectuels, bourgeois,
militaires, anciens féodaux, paysans, ouvriers aussi sont
brassés au sein d'une nouvelle hiérarchie dont le dénominateur
commun est qu'elle dirige, contrôle, organise à tous les niveaux
de son fonctionnement l'appareil de production et la force de
travail vivante, celles des classes exploitées. Ceux-là même qui
demeurent dans leurs anciennes catégories professionnelles
voient leur mode de vie et leur mentalité bouleversés car ces
anciennes professions sont recentrées en fonction de leur inté-
gration dans la nouvelle division du travail créée par le Plan.
Assurément le mode de travail de ces nouvelles couches, les
statuts qui leur sont accordés en raison de leur position
dominante dans la société ne peuvent que créer à la longue une
véritable communauté de classe. Mais dans le temps où
s'accomplit ce bouleversement, l'action du Parti s'avère déter-
minante. C'est lui qui, par la discipline de fer qu'il instaure,
par l'unité incontestée qu'il incarne, peut seul cimenter ces
éléments hétérogènes. Il anticipe l'avenir, proclame aux yeux
de tous que les intérêts particuliers sont strictement subor-
donnés aux intérêts de la bureaucratie prise dans son ensemble.
Une fonction essentielle du stalinisme, nécessaire dans le
cadre de la nouvelle société apparait ici. La terreur qu'il exerce
şur les couches dominantes n'est pas un trait accidentel: elle
est inscrite dans le développement de la nouvelle classe dont le
mode de domination n'est plus garanti par l'appropriation
privée, qui est contrainte d'accepter ses privilèges par le tru-
chement d'un appareil collectif d'appropriation et dont la
dispersion, à l'origine, ne peut être surmontée que par la
violence.
Certes on peut bien dire que les purges effectuées
par le stalinisme ont été jusqu'à mettre en danger le fonction-
nement de l'appareil de production, on peut mettre en doute
21
l'efficacité de répressions qui à un moment ont anéanti la
moitié des techniciens en place. Ces réserves ne mettent cepen-
dant pas en cause ce que nous appelons la fonction historique
du stalinisme; elles permettraient seulement de déceler, nous
avons déjà mentionné ce point, en quoi le comportement per-
sonnel de Staline s'écarte de la norme qui domine la conduite
du parti (5). Dire en effet, que le stalinisme à une fonction
n'est pas insinuer qu'il est du point de vue de la bureau-
cratie -- « utile » à chaque moment, encore moins que la poli-
tique qu'il suit est à chaque moment la seule possible; c'est
en l'occurence seulement affirmer qu'en l'absence de la terreur
stalinienne le développement de la bureaucratie est inconce-
vable. C'est, en d'autres termes, convenir que par delà les
manoeuvres de Staline, les luttes fractionnelles au sein de
l'équipe dirigeante, les épurations massives pratiquées à tous
les niveaux de la société se profile l'exigence d'une fusion de
toutes les couches de la bureaucratie dans le moule d'une nou-
velle classe dirigeante. Cette exigence est clairement attestée
par le comportement des milieux épurés: si la terreur stali-
nienne a pu se développer dans une société en plein essor éco-
nomique, si les représentants de la bureaucratie ont accepté de
vivre sous la menace permanente de l'extermination ou de la
destitution en dépit de leurs privilèges c'est que prévalait aux
yeux des victimes et aux yeux de tous l'idéal de transforma-
tion sociale qu'incarnait le parti. Le fameux thème du sacrifice
des générations actuelles au bénéfice des générations futures,
présenté par le stalinisme sous le travesti d'un programme de
construction du socialisme reçoit son contenu réel: le Parti exi-
geait le sacrifice des intérêts particuliers et des intérêts immé-
diats des couches montantes à l'intérêt général et historique de
la bureaucratie comme classe.
On ne saurait se borner toutefois à comprendre le rôle
du stalinisme dans le seul cadre de la Bureaucratie. La terreur
qu'il a exercée sur un prolétariat en plein éssor suppose qu'à
certains égards il venait répondre à une situation spécifique de
la classe ouvrière. Il serait en effet vain de nier que la poli-
tique du Parti, si elle a pu rencontrer une résistance de plus
5. Le rôle propre de Staline ne doit pas nous faire oublier qu'il y
a dans la terreur une sorte de logique interne, qui l'amène à se déve-
lopper jusqu'à ses extrêmes conséquences, indépendamment des condi-
tions réelles auxquelles elle est venue répondre à l'origine. Il serait
trop simple qu'un Etat puisse user de la terreur comme d'un instrument
et la rejeter une fois l'objectif atteint. La terreur est un phénomène
social, elle transforme le comportement et la mentalité des individus et
de Staline lui-même sans doute. Ce n'est qu'après coup qu'on peut
dénoncer, comme le fait Khrouchtchev, ses excès. Dans le présent, elle
n'est pas excès, elle constitue la vie sociale.
22
en plus ferme dans les rangs du prolétariat
que le code du
travail enchaînait à la production, que le stakhanovisme en-
traînait dans une course folle d'accroissement de la production
n'ait en même temps suscité une participation à l'idéal du
nouveau régime. Ciliga l'a bien montré dans ses ouvrages sur
I'URSS, par ailleurs durement critiques: d'une part l'exploita-
tion forcenée qui régnait dans les usines allait de pair avec une
énorme prolétarisation de la petite paysannerie; pour celle-ci,
habituée à des conditions de vie très dure, elle n'était pas
aussi sensible que pour la classe ouvrière déjà constituée; bien
plus elle représentait à certains égards un progrès, la vie dans
les villes, la familiarité avec les outils et les produits indus-
triels provoquant un véritable éveil de la mentalité, de nou-
veaux besoins sociaux, une sensibilité au changement. D'autre
part, au sein même du prolétariat une courbe importance d'ou-
vriers se trouvait promue à de nouvelles fonctions grâce au
Parti, aux syndicats, cu au stakhanovisme trouvait ainsi des
voies d'évasion hors de la condition commune inconnues dans
l'ancien régime. Enfin et surtout, aux yeux de tous, l'industria-
lisation, qui faisait surgir des milliers d'usines modernes, dé-
cuplait les effectifs des villes ou en tirait du sol d'entièrement
neuves, multipliait le réseau des communications, apparaissait
sans contestation possible progressive — la misère et la ter-
reur constituant la rançon provisoire d'une formidable accu-
mulation primitive. Assurément le stalinisme construisait
grâce au fouet, il instituait cyniquement une discrimination
sociale inconcevable dans la période post-révolutionnaire, il
subordonnait sans équivoque la production aux besoins de
la classe dominante. Pourtant la tension des énergies qu'il
exigeait dans tous les secteurs, le brassage des conditions
sociales qu'il effectuait, les chances de promotions qu'il offrait
donc aux individus dans toutes les classes, l'accélération de
toutes les forces productives qu'il imposait comme idéal et
qu'il réalisait, tous ces traits fournissaient un alibi à sa puis-
sance démesurée et à son omniprésence policière.
LA CONTRADICTION ESSENTIELLE
DU TOTALITARISME STALINIEN
Si Kroushtchev, fils ingrat s'il en fut, n'avait pas été
obsédé par les avanies que dút lui faire subir Staline dans la
dernière partie de sa vie, n'aurait-il pu considérer plus serei-
nement le chemin parcouru? N'aurait-il pu relire posément le
chapitre du Capital que Marx consacra à l'accumulation pri-
mitive et répéter après lui: « La force est l'accoucheuse de toute
23
vieille société en travail. Elle est elle-même une puissance éco-
nomique » ? N'aurait- il pu expliquer au XX° Congrès, dans
la langue rude qui est la sienne: Staline a fait pour nous le
sale boulot? Ou bien en termes choisis paraphraser Marx:
voilà ce qu'il en a coûté pour dégager les lois naturelles et
éternelles de la production planifiée » ? A lire Isaac Deutz-
cher (6), l'historien anglais bien connu de la société soviétique,
on s'affligerait presque d'une telle ingratitude. Ce n'est pas
que Deutscher porte le stalinisme dans son coeur, mais à ses
yeux les nécessités de l'accumulation primitive s'imposaient au
socialisme comme elles s'étaient imposées au capitalisme: le
purgatoire stalinien était inéluctable. Le malheur est que notre
auteur ne voit pas que l'idée d'une accumulation primitive
socialiste est absurde. I.'accumulation primitive signifie pour
Marx la déportation en masses des paysans dans des lieux de
travail forcé, les usines, l'extorcation par tous les moyens –
le plus souvent illégaux de la plus-value. Elle vise à consti-
tuer une masse de moyens de production telle qu'en lui subot-
donnant la force de travail on puisse par la suite automati-
quement la reproduire et l'accroître d'un profit. Dans son prin-
cipe et dans sa fin elle implique nécessairement la division du
Capital et du Travail: le capitalisme ne peut se livrer à ses
« orgies », selon l'expression de Marx que parce qu'il a en face
de lui des hommes totalement dépossédés et il fait en sorte
que leur dépossession soit quotidiennement reproduite en même
temps que sa puissance est quotidiennement entretenue et
accrue. Certes on peut contester que le socialisme soit réali-
sable dans une société qui n'a pas édifié déjà une infra struc-
ture économique, c'est-à-dire qui n'est pas passée par un stade
d'accumulation mais on ne peut dire que le socialisme en tant
que tel ait à passer par ce stade puisque, quelque soit le niveau .
des forces productives auquel il est lié, il suppose la gestion
collective de la production c'est-à-dire la direction effective
des usines par les ouvriers rassemblés dans leurs comités.
Reconnaître une accumulation primitive en URSS c'est
admettre qu'y règnent des rapports de production de type
capitaliste, c'est admettre encore que ceux-ci tendent à se
reproduire et à approfondir l'opposition qu'ils supposent
la constitution d'un stock de machines et de matières premières
(l'une part et celle d'une force de travail totalement dépos-
sédée de l'autre ne pouvant avoir pour effet qu'une normalisa-
tion de l'exploitation. En ce sens l'obstination de Kroushtchev
jusqu'à maintenant à taire les problèmes de l'accumulation
primitive en URSS paraît fort raisonnable. «Péché originel »,
6. Nous nous rapportons à ses études réunies dans Heretics and
Renegades, notamment à « Mid-Century Russia ». Hamish Hamilton, éd.,
Londres 1955.
24
aux yeux de la bourgeoisie, comme disait encore Marx, l'accu-
mulation primitive l'est bien davantage à ceux de la bureau-
cratie qui doit dissimuler jusqu'à son existence de classe.
En outre il serait artificiel d'expliquer le stalinisme à
partir des seules difficultés économiques auxquelles il a eu à
faire face. Ce que nous avons tenté de faire ressortir c'est le
rôle qu'il a joué dans la cristallisation de la nouvelle classe,
dans la révolution de la société entière. Si l'on veut conserver
l'expression marxiste reprise par Deutscher il faut en renou-
veler le contenu et parler d'une « accumulation sociale », en
entendant par les traits actuels de la Bureaucratie ne
pouvaient advenir que par le truchement du Parti qui les
dégagea et les maintint par la violence jusqu'à ce qu'ils se
stabilisent dans une nouvelle figure historique.
Encore devons-nous comprendre qu'il tient à l'essence de
la bureaucratie de se constituer selon le processus que nous
avons décrit. Car nous comprendrons, du même coup, que
cette classe recèle une contradiction permanente qui évolue
certes avec son histoire mais ne saurait se résoudre avec la
liquidation du stalinisme.
là que
La dictature « terroriste » du Parti n'est pas seulement le
signe du manque de maturité de la nouvelle classe, elle répond,
nous l'avons dit, à son mode de domination dans la société.
Cette classe est d'une autre nature que la bourgeoisie. Elle
n'est pas composée de groupes qui par leur propriété de moyens
de production et leur exploitation privée de la force de tra-
vail détiennent chacun une part de la puissance matérielle, et
nouent les uns avec les autres des relations fondées sur leur
force respective. Elle est un ensemble d'individus qui par leur
fonction et le statut qui y est associé participent en commun
å un bénéfice réalisé par une exploitation collective de la force
de travail. La classe bourgeoise se constitue et se développe en
tant qu'elle résulte des activités des individus capitalistes, elle
est sous-tendue par un déterminisme économique qui en fonde
l'existence, quelle que soit la lutte que se livrent les acteurs
et quelle que soit l'expression politique conjoncturelle à laquelle
celle-ci aboutit. La division du travail inter-capitaliste et le
marché rendent les capitalistes strictement dépendants les uns
des autres et collectivement solidaires en face de la force de
travail. En revanche les bureaucrates ne forment une classe
que parce que leurs fonctions et leurs statuts les différencient
collectivement des classes exploitées, que parce qu'ils les
relient à un foyer de direction qui détermine la production et
dispose librement de la Force de travail. En d'autres termes,
c'est parce qu'il y a des rapports de production dans lesquels
25.-
s'opposent le prolétariat réduit à la fonction de simple exécu.
tant et le Capital incarné par le Personnage de l'Etat, c'est
parce qu'il y a donc un rapport de classe que les activités des
bureaucrates les rattachent à la classe dominante. Intégrées
dans un système de classe leurs fonctions particulières les
constituent comme membres de la classe dominante. Mais, si
l'on peut dire, ce n'est pas en tant qu'individus agissants qu'ils
tissent le réseau des relations de classe; c'est la classe bureau-
cratique dans sa généralité qui, a priori, c'est-à-dire en vertu
de la structure de production existante convertit les activités
particulières des bureaucrates (activités privilégiées parmi
d'utres) en activités de classe. L'unité de la classe bureaucra-
tique est donc immédiatement donnée avec l'appropriation
collective de la plus value et immédiatement dépendante de
l'appareil collectif d'exploitation, l'Etat. En d'autres termes
la communauté bureaucratique n'est pas garantie par le méca-
nisme des activités économiques; elle s'établit dans l'intégra-
tion des bureaucrates autour de l'Etat, dans la discipline abso-
lue à l'égard de l'apparel de direction. Sans cet Etat, sans
cet appareil la bureaucratie n'est rien.
Nous ne voulons pas
dire
que
les bureaucrates en 'tant
qu'individus ne jouissent pas d'une situation stable (bien que
cette stabilité ait effectivement été menacée pendant l'ère sta-
linienne), que leur statut ne leur procure que des avantages
éphémères, bref que leur position dans la société demeure acci-
dentelle. Il n'y a pas de doute que le personnel bureaucratique
se confirme peu à peu dans ses droits, acquiert avec le temps
des traditions, un style d'existence, une mentalité qui font de
lui un « monde » à part. Nous ne voulons pas dire non plus
que les bureaucrates ne se différencient pas au sein de leur
propre classe et n'entretiennent pas entre eux de sévères rela-
tions de concurrence. Tout ce que nous savons de la lutte
entre les clans dans l'Administration prouve au contraire qus
cette concurrence prend la forme d'une lutte de tous contre
tous caractéristique de toute société d'exploitation. Nous affir-
mons seulement que la bureaucratie ne peut se passer d'une
cohésion des individus et des groupes, chacun n'étant rien en
lui-même, et que seul l'Etat apporte un ciment social. Sans
schématiser abusivement le fonctionnement de la société bour-
geoise on doit reconnaître qu'en dépit de l'extension toujours
accrue des fonctions de l'Etat, celui-ci ne s'affranchit jamais
des conflits engendrés par la concurrence des groupes privés.
La société civile (7) ne se résorbe pas dans l'Etat. Alors même
7. Nous reprenons le terme classique de « société civile » pour dési-
gner l'ensemble des classes et des groupes sociaux en tant qu'ils sont
façonnés par la division du travail et se déterminent indépendamment de
l'action politique de l'Etat.
26
qu'il tend à faire prévalcir l'intérêt général de la classe domi-
nante aux dépens des intérêts privés qui s'affrontent, il expri-
me encore les rapports de force inter-capitalistes. C'est que la
propriété privée introduit un divorce de principe' entre les
capitalistes et le Capital --- chacun des termes se posant
successivement comme réalité et excluant l'autre comme ima-
ginaire. Les vicissitudes de l'Etat bourgeois moderne attes-
tent assez cette séparation dont Marx a tant parlé: séparation
entre l'Etat lui-même et la société et au sein de la société entre
toutes les sphères d'activité. Dans le cadre du régime bureau-
cratique une telle séparation est abolie. L'Etat ne peut plus
se définir comme une expression. Il est devenu consubstanciel
à la société civile, nous voulons dire à la classe dominante.
L'est-il cependant? Il l'est et ne l'est pas. Paradoxalement.
se réintroduit une séparation à certains égards plus profonde
qu'elle ne fut en aucune autre société. L'Etat est bien l'âme
de la bureaucratie et celle-ci le sait qui n'est rien sans ce pou-
voir suprême. Mais l'Etat dépossède chaque bureaucrate de
toute puissance effective. Il le nie en tant qu'individu, lui
refuse toute créativité dans son domaine particulier d'activité,
le soumet en tant que membre anonyme aux décrets irrévoca-
bles de l'autorité centrale. L'Esprit bureaucratique plane au-
dessus des bureaucrates, divinité indifférente à la particularité.
Ainsi la planification (cette planification qui prétend attribuer
à chacun sa juste tâche et l'accorder à toutes les autres) se
trouve-t-elle élaborée par un noyau de dirigeants qui décide
de tout; les fonctionnaires ne peuvent que traduire en chiffres
les idées directrices, déduire les conséquences des principes,
transmettre, appliquer. La classe ne perçoit dans son État
que le secret impénétrable de sa propre existence. Chaque
fonctionnaire peut bien dire: l'Etat c'est moi, mais l'Etat est
l'Autre et sa Régle domine comme une Fatalité inintelligible.
Cette distance infinie entre l'Etat et les bureaucrates a
encore une conséquence inattendue: ceux-ci ne sont jamais en
mesure, à moins de se constituer comme opposants, de criti-
quer la Règle instituée. Formellement cette critique est inscrite
dans le mode d'existence de la bureaucratie: puisque chacun
est l'Etat, chacun est invité, en droit, à diriger, c'est-à-dire à
confrontereson activité réelle et les objectifs socialement fixés.
Mais dans la réalité critiquer signifie sa désolidariser de la
communauté bureaucratique. Comme le bureaucrate n'est
membre de sa classe qu'en tant qu'il s'intègre à la politique de
l'Etat, tout écart de sa part est en effet menace pour le
sys-
tème. De là vient que pendant toute l'ère stalinienne la bureau-
cratie se livre à une orgie de criticailleries et dissimule toute
critique véritable. Elle fait solennellement le procès des mé-
27
thodes bureaucratiques mais continue d'appliquer scrupuleu-
sement les règles qui établissent et maintiennent son irrespon-
sabilité. Elle bavarde et se tait. De là vient aussi que tout
malaise sérieux dans le fonctionnement de la production se
traduit nécessairement par une épuration massive des bureau-
crates, techniciens, savants ou cadres syndicaux, dont l'écart
par rapport à la norme (qu'ils l'aient voulu ou non) trahit une
opposition à l'Etat.
La contradiction entre la société civile et l'Etat n'a donc
été surmontée sous une forme que pour réapparaître sous une
autre, aggravée. A l'époque de la bourgeoisie, en effet, l'Etat
se trouve relié à la société civile par les liens mêmes qui l'en
éloignent. Le secret de l'Etat est pour les capitalistes secret
de polichinelle, car malgré tous ses efforts pour incarner la
généralité aux yeux des particuliers, l'Etat s'aligne sur les
positions du particulier le plus puissant. Profite-t-il de
crises pour gouverner entre les courants, sa politique traduit
encore une sorte de regulation naturelle des forces économi-
ques. Dans la société bureaucratique, en revanche, l'Etat est
devenu la société civile, le Capital a chassé les capitalistes,
l'intégration de toutes les sphères d'activités est accomplie,
mais la société a subi une métamorphose imprévisible: elle a
engendré un monstre qu'elle contemple sans reconnaître son
image, la Dictature.
Ce monstre s'est appelé Staline. On veut persuader qu'il
est mort. Peut-être laissera-t-on son cadavre embaumé dans
le mausolée comme témoin du passé révolu. C'est en vain tou-
tefois que la bureaucratie espérerait échapper à sa propre
essence. Elle peut bien enterrer sa peau morte dans les sous-
sols du Kremlin et parer son nouveau corps d'oripeaux agui-
chants: totalitariste elle était, totalitariste elie demeure.
Avant d'envisager les efforts qu'effectue la Nouvelle Di-
rection pour contourner les difficultés inéluctables que suscite
la structure du capitalisme d'Etat, il nous faut mesurer l'am-
pleur de la contradiction qui l'habite. Cette contradiction
n'intéresse pas seulement les rapports interbureaucratiques,
elle se manifeste non moins fortement dans les relations que
la classe dominante entretient avec les classes exploitées.
De nouveau s'impose une comparaison entre le régime
bureaucratique et le régime bourgeois, car les liens de la classe
dominante et du prolétariat sont en URSS d'un type nou-
veau. L'origine historique de la bureaucratie l'atteste déjà;
celle-ci s'est en effet formée à partir d'institutions, le Parti
28
et le Syndicat, forgées par le prolétariat dans sa lutte contre
le capitalisme. Certes, au sein du Parti la proportion d'intel-
lectuels ou d'éléments bourgeois révolutionnaires était sans
doute assez forte pour exercer une influence décisive sur
l'orientation politique et le comportement de l'Organisation.
Il n'en serait pas moins vain de nier que le parti est né dans
le cadre de la classe ouvrière et que, s'il a finalement exclu ses
représentants de tout pouvoir réel, il n'a cessé de se présenter
comme la Direction du proletariat. Au demeurant, la bureau-
cratie continue de s'alimenter d'une fraction de la classe
cuvrière à laquelle elle ouvre les portes (beaucoup plus large-
ment que ne l'a jamais fait la bourgeoisie) des écoles de
cadres, qu'elle détache de la condition commune par les pri-
vilèges qu'elle lui accorde et les chances d'avancement social
qu'elle lui offre. En outre la définition sociologique du prolé-
tariat, si l'on peut dire se trouve transformée. Dans la société
bourgeoise une différence essentielle se trouve énoncée au
niveau des rapports de production entre le propriétaire des
moyens de production et le propriétaire de la force de travail.
L'un et l'autre sont présentés comme partenaires dans un
contrat; formellement ils sont égaux ett cette égalité se trouve
par ailleurs consacrée dans le régime démocratique par le
suffrage universel. Cependant cette égalité est apparemment
fictive: il est clair qu'être propriétaire des moyens de produc-
tion et propriétaire de sa force de travail n'a pas le même
sens. Dans le premier cas, la propriété donne le pouvoir d'uti-
liser le travail d'autrui pour obtenir un profit et cette dispo-
sition du travail implique une liberté réelle. Dans l'autre, la
propriété donne le pouvoir de se soumettre en vue de conserver
et reproduire sa vie. L'égalité des partenaires dans le contrat
ne saurait donc faire illusion: le contrat est asservissement.
Le capitalisme d'Etat en brouille les termes. Le contrat se
présente alors comme rapport entre les individus et la Société.
L'ouvrier ne loue pas sa force de travail au capitaliste, il
n'est plus une marchandise; il est censé être une parcelle d'un
ensemble qu'on appelle les forces productives de la société.
Son nouveau statut ne se distingue donc apparemment en rien
de celui du bureaucrate; il entretient avec la Société totale la
même relation que le Directeur d'usine. Comme lui il reçoit un
salaire en réponse à une fonction qui vient s'intégrer dans la
totalité des fonctions définies par le Plan. Dans la réalité, on
ne le sait que trop, un tel statut qui procure à chacun l'avan-
tage de nommer son supérieur « camarade » est l'envers d'un
nouvel asservissement au Capital et cet asservissement est à
certains égards plus complet puisque l'interdiction des reven-
dications collectives et des grèves, l'enchaînement de l'ouvrier
au lieu de travail peuvent en découler naturellement. Comment
29
le prolétariat pourrait-il lutter contre l'Etat qui le représente?
Aux revendications on peut toujours opposer qu'elles sont liées
à un point de vue particulier, que les intérêts des ouvriers peu-
vent ne pas coïncider avec ceux de la société entière, que leurs
objectifs immédiats doivent être replacés dans le cadre des
objectifs historiques du socialisme. Les procédés de mysti-
fication doni l'Etat dispose sont donc plus subtils et plus effi-
caces dans le nouveau système. Dans le raisonnement social,
que développe la structure en vertu de ses articulations for
melles, des chaînons essentiels sont dissimulés aux yeux du
prolétariat; il rencontre partout les signes de son pouvoir alors
qu'il en est radicalement dépossédé.
Toutefois les classes exploitées ne sont pas seules mysti-
fiées. En raison de cette mystification même les couches domi-
nantes ne sont pas en mesure de se poser comme classe à part
dans la société. Assurément les bureaucrates se distinguent
par leurs privilèges et par leurs statuts. Mais cette situation
exige d'être justifiée aux yeux du proletariat: la bureaucratie
a besoin d'être « reconnue » bien davantage que la bourgeoisie.
Ainsi une importante part de l'activité de la bureaucratie (par
l'intermédiaire du Parti et des Syndicats) est-elle consacrée à
persuader le prolétariat que l'Etat gouverne la société en son
nom. Si, dans une perspective, l'éducation des masses, la
propagande socialiste apparaissent comme de simples ins-
truments de mystificaton des exploités, dans une autre elles
témoignent des illusions que la bureaucratie développe sur
elle-même. Celle-ci ne parvient pas absolument à se penser
comme une classe. Prisonnière de son propre langage elle
s'imagine qu'elle ne l'est pas, qu'elle répond aux besoins de la
collectivité entière. Certes cette imagination cede devant les
exigences de l'exploitation c'est-à-dire devant l'impératif
d'extorquer au prolétariat la plus-value par les moyens les
plus impitoyables. Comme le disait Marx à propos d'une autre
bureaucratie, celle de l'Etat prussien du XIX° siècle, l'hypo-
crisie fait alors place au jésuitisme conscient. Il n'en demeure
pas moins qu'un conflit hante la bureaucratie, qui ne la laisse
jamais en repos et l'expose aux affres permanentes de l'auto-
justification. Il lui faut prouver à ceux qu'elle domine et se
prouver à elle-même que ce qu'elle fait n'est point le contraire
de ce qu'elle dit. Pendant l'ère stalinienne la hiérarchie bru-
tale de la société, la législation implacable du travail, la pour
suite effrénée du rendement aux dépens des masses d'une part
l'affirmation constante que le sacialisme est réalisé de l'autre
forment les deux termes de cette cruelle antinomie. Or celle-c
en même temps génératrice d'une démystification des masses
Tandis que l'Etat appelle le prolétariat à une participatior
30
active à la production, le persuade de son rôle dominant dans
la société, il lui refuse toute responsabilité, toute initiative, et
le maintient dans les conditions de simple servant du machi-
nisme auxquelles le capitalisme l'a voué depuis son origine. La
propagande enseigne donc quotidiennement le contraire de ce
qu'elle est destinée à enseigner.
Nous verrons par la suite que l'évolution du prolétariat
russe, son affranchissement de la gangue paysanne qui l'encer-
clait encore pendant les premiers plans quinquennaux, son
apprentissage de la technique, moderne aggravent considéra-
blement cette contradiction de l'exploitation bureaucratique
et jouent un rôle décisif dans la transformation politique
récente. Ce que nous voulons seulement souligner, c'est qu'une
telle contradiction tient à l'essence du régime bureaucratique;
ses termes peuvent bien évoluer, on peut bien inventer de nou-
veaux artifices pour les rendre « vivables », cependant la
bureaucratie tant qu'elle existe ne peut qu'être déchirée par
une double exigence: intégrer le prolétariat à la vie sociale,
faire « reconnaître » son Etat comme celui de la société entière
et refuser au prolétariat cette intégration en accaparant les
fruits de son travail et en le dépossédant de toute créativité
sociale.
En d'autres termes la mystification est partout, mais elle
engendre pour cette raison les conditions de son renversement,
elle fait partout peser une menace sur le régime. Celui-ci i
certains égards s'avère infiniment plus cohérent que le sys-
tême bourgeois, tandis qu'à d'autres il découvre une vulné-
rabilité nouvelle.
L'IDÉAL DU PARTI ET SA FONCTION RÉELLE
Les problèmes qu'affronte le parti dans la société bureau-
cratique nous introduisent au coeur des contradictions que nous
avons énoncées, et ce n'est pas un hasard s'ils se trouvent,
comme nous le ferons' ressortir au centre des préoccupations
du XX° Congrès.
C'est en vain cependant qu'on chercherait chez les criti-
ques de l'URSS une compréhension de ce problème. L'origi-
nalité du Parti n'est jamais aperçue. Les penseurs bourgeois
sont souvent sensibles à l'entreprise totalitariste qu'incarne le
Parti. Ils dénoncent la. mystique sociale qui le domine, son
effffort d'une intégration de toutes les activités qui les subor-
donne à un idéal unique. Mais cette idée s'affadit dans le
31
thème rebattu de la religion d'Etat. Hanté par les précédents
historiques qui dispensent de penser le Présent en tant que tel,
on compare les règles du Parti à celle des Ordres Conqué-
rants, son idéologie à celle de l'Islam au VII° siècle (8); on
ignore alors la fonction essentielle qu'il joue dans la vie sociale
moderne dans le monde du XXe siècle, unifié par le Capital,
dépendant dans son développement de celui de chacun de ses
secteurs, à la fois désarticulé par la spécialisation technique et
rigoureusement centré sur l'industrie. Par ailleurs le Trots.
kysme s'épuise à comparer au modèle bolchévik le Parti com
muniste actuel comme si celui-ci se définissait par des trait:
tout négatifs, sa déformation de l'idéologie socialiste, sor
absence de démocratie, sa conduite contre-révolutionnaire
Trotsky lui-même, on le sait, hésita longuement avant de
reconnaître la faillite du Parti en URSS et ne put que recom
mander un retour à ses formes primitives. Non seulement i
ne pouvait admettre que les traits du stalinisme fussen
annoncés par le bolchévisme et que l'aventure de l'un fut lié
à celle de l'autre, mais il refusait absolument l'idée
que
1
Parti puisse avoir gagné une fonction nouvelle. Le Parti bol
chevik était le Parti réel, le stalinisme, une fantastique e
monstrueuse projection de celui-ci dans un univers coupé d
la révolution.
(il
Il suffirait cependant d'observer l'étendue des tâches attr
buées au Parti, l'extraordinaire accroissement de ses effectif
comprend aujourd'hui plus de 7 millions de membres) por
se persuader qu'il joue un rôle décisif dans la société. De fai
il est autre chose qu'un appareil de coercition, autre cho:
qu'une caste de bureaucrates, autre chose qu'un mouvemei
idéologique destiné à proclamer la mission historique sacri
de l'Etat, bien qu'il connote aussi tous ces traits. Il est l'age
essentiel clu totalitarisme moderne.
Mais ce terme doit être entendu rigoureusement. Le tot
litarisme n'est pas le régime dictatorial, comme on le lais
entendre chaque fois qu'on désigne sommairement sous ce no
un type de domination absolue dans lequel la séparation d
pouvoirs est abolie. Plus précisément il n'est pas un régii
politique: il est une forme de société cette forme au se
de laquelle toutes les activités sont immédiatement reliées
unes aux autres, délibérément présentées comme modali
d'un univers unique, dans laquelle un système de valei
prédomine absolument en sorte que toutes les entrepri:
individuelles ou collectives doivent de toute nécessité y trouv
(8) MONNEROT: Sociologie du Communisme. N.R.F., 1949.
32
un coefficient de réalité, dans laquelle enfin le modèle dominant
exerce une contrainte totale à la fois physique et spirituelle sur
les conduites des particuliers. En ce sens le totalitarisme pré-
tend nier la séparation caractéristique du capitalisme bourgeois
des divers domaines de la vie sociale; du politique, de l'éco-
nomique, du juridique, de l'idéologique, etc... Il effectue une
identification permanente entre l'un et l'autre. Il n'est donc
pas tant une excroissance monstrueuse du Pouvoir politique
dans la société qu'une métamorphose de la société elle-même
par laquelle le politique cesse d'exister comme sphère séparée.
Tel que nous l'entendons le totalitarisme n'a rien a voir avec
le régime d'un Franco ou d'un Syngman Rhee, en dépit de
leur dictature; il s'annonce en revanche, aux Etats-Unis bien
que les institutions démocratiques n'aient cessé d'y régner.
C'est qu'il est au plus profond lié à la structure de la pro-
duction moderne et aux exigences d'intégration sociale qui
lui correspondent. L'essor de l'industrie, l'envahissement pro-
gressif de tous les domaines par ses méthodes, en même
temps qu'ils créent un isolement croissant des producteurs
dans leur sphère particulière opèrent comme dit Marx une
socialisation de la société, mettent chacun dans la dépendance
de l'autre et de tous, rendent nécessaire la reconnaissance
explicite de l'unité idéale de la société. Que cette participation
sociale soit en même temps qu'exprimée et suscitée réprimée,
que la communauté se brise devant une nouvelle implacable
division de Maîtres et d’Esclaves, que la socialisation se
dégrade en uniformisation des croyances et des activités, la
création collective dans la passivité et le conformisme, que la
recherche de l'universalité s'abîme dans la stéréotypie des
valeurs dominantes, cet immense échec ne saurait dissimuler
les exigences positives auxquelles vient répondre le totalita-
risme. Il est, peut-on dire, l'envers du Communisme. Il est le
travestissement de la totalité effective.
Or le Parti est l'institution type dans laquelle le processus
de socialisation s'effectue et se renverse. Et ce n'est pas un
hasard si, procédant de la lutte pour instaurer le communisme,
il peut sans changer de forme devenir le véhicule du totali-
tarisme. Le Parti incarne dans la société bureaucratique une
fonction historique d'un type absolument nouveau. Il est
l'agent d'une pénétration complète de la société civile par
l'Etat. Plus précisément il est le milieu dans lequel l'Etat se
change en société ou la société en Etat. L'immense réseau de
comités et de cellules qui couvre le pays entier établit une
nouvelle communication entre les villes et les campagnes, entre
toutes les branches de l'activité sociale, entre toutes les entre-
prises de chaque branche. La division du travail qui tend à
33 -
isoler rigoureuèsement les individus se trouve en un sens dé-
passée; dans le Parti, l'ingénieur, le commerçant, l'ouvrier,
l'employé sc trouvent côte à côte et avec eux le philosophe,
le savant et l'artiste. Les uns et les autres se trouvent arrachés
aux cadres étroits de leur spécialité et resitués ensemble dans
celui de la société totale et de ses horizons historiques. La vie
de l'Etat, les objectifs de l'Etat font partie de leur monde
quotidien. Ainsi l'activité la plus modeste comme la plus haute
se trouve valorisée, posée comme moment d'une entreprise
collestive. Non seulement les individus paraissent perdre, dans
le Parti, le statut qui les différencie dans la vie civile pour de-
venir des « camarades », des hommes sociaux, mais ils sont
appelés à échanger leur expérience, à exposer leur activité et
celle de leur milieu à un jugement collectif en regard duquel
elles prennent un sens. Le Parti tend donc à abolir le mystère
de la profession en introduisant dans un nouveau circuit des
milieux réellement séparés. Il fait apparaître qu'il y a une
manière de diriger une usine, de travailler dans une chaîne de
production, de soigner des malades, d'écrire un traité de phi-
losophie, de pratiquer un sport qui concerne tous les individus
s'intègre finalement dans un ensemble dont l'Etat pense
parce qu'elle implique un mode de participaton social et
l'harmonie. C'est dire notamment que le parti transforme
radicalement le sens de la fonction politique. Fonction séparée,
privilège d'une minorité dirigeante dans la société bourgeoise,
elle se diffuse maintenant grâces à lui dans toutes les branches
d'activité.
Tel est Idéal du Parti. Par sa médiation l'Etat tend à
devenir immanent à la Société. Mais par un paradoxe que
nous avons déjà longuement analysé, le Parti s'avère dans la
réalité revêtir une signification toute opposée. Comme la divi-
sion du Travail et du Capital persiste et s'approfondit,
comme l'unification stricte du Capital donne toute puissance
effective à un Appareil dirigeant, subordonne toutes les forces
productives à cet appareil, le Parti ne peut être que le simu-
lacre de la socialisation. Dans la réalité, il se comporte comine
un groupe particulier qui vient s'ajouter aux groupes engen-
drés par la division du travail, un groupe qui a pour fonction
de masquer l'irréductible cloisonnement des activités et des
statuts, cle figurer dans l'imaginaire les transitions que refuse
le réel, un groupe dont la véritable spécialité est de n'avoir
pas de spécialité. Dans la réalité, l'échange des expériences
se dégrade en un contrôle de ceux qui produisent, quel que
soit leur domaine de production par des professionnels de
l'incompétence. A l'idéal de participation active à l'ouvre
sociale vient répondre l'obéissance aveugle à la Norme imposée
34
par les Chefs: la création collective devient inhibition collec-
tive. Ainsi la pénétration par le parti de tous les domaines
signifie seulement que chaque individu productif se trouve
doublé par un fonctionnaire politique dont le rôle est d'attri-
buer à son activité un coefficient idéologique, comme si la
norme officielle définie par l'édification du socialisme et les
règles conjoncturelles qu'on en fait découler pouvaient per-
mettre de mesurer son écart par rapport au réel. Réduit à
commenter les conduites effectives des hommes, le Parti réin-
troduit ainsi une scission radicale au sein de la vie sociale.
Chacun a son double idéologique. Le directeur ou le techni-
cien agit sõus le regard de ce double qui « qualifie » l'accrois-
sement ou la baisse de la production ou tout autre résultat
quantifiable en fonction d'une échelle de valeurs fixe fournie
par l'Appareil dirigeant. Pareillement l'écrivain est jugé selon
les critères du réalisme déterminés par l'Etat, le biologiste
mis en demeure d'adhérer à la génétique de Lyssenko. Peu
importe, au demeurant, que le double soit un Autre. Chacun
peut en jouer le rôle vis-à-vis de soi; le Directeur, l'écrivain,
le savant peuvent être aussi membres du Parti. Mais si proches
qu'on voudra l'un de l'autre, les deux termes n'en figurent pas
moins une contradiction sociale permanente. Tout se passe
comme si la vie sociale toute entière était dominée par un fan-
tastique chronomètrage dont les normes seraient élaborées par
le plus secret des Bureaux d'Etudes.
L'activité du Parti réengendre ainsi une séparation de la
fonction politique, alors qu'elle voulait l'abolir, et en un sens
elle l'accuse. C'est en effet dans chaque domaine concret de
production, aussi particulier soit-il, que se fait sentir l'intru-
sion du politique. La liberté de travail se heurte partout aux
normes du Parti. Partout la « cellule » est le corps étranger;
non l'élément essentiel qui relie l'individu à la vie de l'orga-
nisme, mais le noyau inerte où viennent s'abîmer les forces
productives de la société.
Finalement le Parti est la principale victime de cette
séparation; car dans la société les exigences de la production
créent, dans certaines limites du moins, une indépendance de
fait du travail. Le Parti, en revanche, a pour travail exclusif
de proclamer, de diffuser, d'imposer les normes idéologiques.
Ii se repait de politique. Sa principale fonction devient de
justifier sa fonction, en se mêlant de tout, en niant tout pro-
blème particulier, en affirmant constamment le leit-motiv de
l'idéal officiel. En même temps qu'il se persuade que son acti-
vité est essentielle il se trouve rejeté en vertu de son compor-
tement en dehors de la société réelle. Et cette contradiction
35
accroît son autoritarisme, la revendication de ses prérogatives,
sa prétention à l'universalité. C'est qu'il est efficace là où il ne
sait pas l'être, en tant qu'il travestit la Société en Etat, en tant
qu'il simule une unité sociale et historique par dela les divi-
sions et les conflits du monde réel, ou comme aurait dit Marx,
il est réel en tant qu'imaginaire. A l'inverse il est imaginaire
en tant qu'il est réel, dépourvu de toute efficacité historique
là où il croit l'appliquer, sur le terrain de la vie productive
de la société qu'il hante comme un perpétuel perturbateur.
On ne s'étonnera donc pas qu'on retrouve en définitive au
sein du Parti les tares de la Bureaucratie, que nous relevion's
déjà, poussées à leur paroxysme. Individus i universels», déli-
vrés de l'étroitesse d'une situation ou d'un statut, promus å
la tâche d'édifier le socialisme, multiples incarnations d'une
nouvelle humanité, tels on pourrait définir idéalement les
membres du Parti. Ils sont en fait condamnés à l'abstraction
de la Règle dominante, voués à l'obéissance servile, fixés à la
particularité de leur fonction de militant, entraînés dans une
lutte sans merci à la chasse du plus haut poste, servants d'une
paperasserie d'auto-justification, un groupe particulier parmi
les autres, attaché à conserver et à reproduire les conditions
qui légitiment son existence. Cependant, ils ne sauraient pas
plus renoncer à ce qu'ils devraient être que renoncer à ce qu'ils
sont. Car c'est par cette contradiction que le parti accomplit
l'essence du totalitarisme, foyer de la « socialisation » de la
société et de la subordination des forces productives à la
domination du Capital.
LA RÉFORME DU TOTALITARISME
La dictature stalinienne a joué un rôle historique déter-
minant dans l'édification d'une infra-structure bureaucratique
et dans la cristallisation d'une nouvelle classe dominante; ce
rôle, on ne peut exactement l'apprécier qu'une fois reconnus
les traits spécifiques de la Bureaucratie dont le mode
d'appropriation collectif confère à l'Etat et au Parti une
puissance absolue dans tous les domaines de la vie sociale;
les conditions qui engendrent le système créent à la fois une
identification de l'Etat et de la société civile dans laquelle
tendent à s'abolir toutes distinctions entre le politique, l'éco-
nomique, le juridique, l'idéologique, etc... et un divorce radi-
cal de la société et de l'Etat qui rétablit une contrainte de
l'Appareil dirigeant sur toutes les activités concrètes et une
monstrueuse autonomie du politique. Telles sont les conclu-
sions que nous avons formulées et qui nous permettent d'abor-
- 36 -
der maintenant les transformations du Régime, rendues pu-
bliques par le XX. Congrès, de mesurer l'efficacité des forces
historiques qui les ont déterminées et de nous interroger sur
leur portée. En d'autres termes, nous sommes maintenant en
mesure de poser ces questions dernières: en quoi les change-
ments présents s'intègrent-ils dans la structure bureaucra-
tique, en quoi répondent-ils à des problèmes posés par le passé.
cette réponse apporte-t-elle une « solution », ou ne fait-elle
que changer les termes des contradictions du Régime?
Mais précisons d'abord, pour décourager les accusations
d'objectivisme, que nous ne cherchons nullement à démontrer
la nécessité du Nouveau Cours dans tous les aspects que lui a
donnés le XX Congrès, encore moins qu'il devait s'imposer à
la date à laquelle il est apparu. Peut-être la liquidation des
méthodes staliniennes aurait-elle pu avoir lieu plus tôt, peut-
être le maintien de Staline au pouvoir aurait-il pu prolonger
l'ancien régime, ces questions qui passionnent le journaliste
n'ont aucune portée réelle. Deutscher a montré de façon per-
tinente
que
la guerre et l'étendue de ses destructions avaient
temporairement recréé, de 1946 à 1950 des conditions ana-
logues à celles de la période d'avant-guerre; la réduction de la
production aux deux-tiers de son volume de 1939, l'effon-
drement du niveau de vie (la ration du consommateur ne
dépassait pas le quart de son volume d'avant-guerre) ont jus-
tifié à nouveau des mesures d'exception. En revanche, l'achè-
vement de la Reconstruction en 1950 a pour la première fois
changé le climat de la société, assuré une stabilisation et un
sentiment de sécurité désormais incompatibles avec le maintien
de la terreur stalinienne. Si convaincante que soit cette inter-
prétation (9), elle s'avère cependant irrémédiablement hypo-
thétique et il importe peu qu'elle le soit, car le sens de la
nouvelle politique n'est pas liée à une conjoncture. Il nous
suffit de percevoir que les forces sociales se sont transformées
au point d'exiger une Réforme. De même il nous suffit de
comprendre que cette réforme intéresse le fonctionnement
essentiel du système bureaucratique et il est secondaire, en
définitive, de déterminer si le contenu précis qu'elle revêt est
nécessaire. La nécessité qui nous préoccupe n'est pas celle de
l'enchaînement terme à terme d'événements politiques, c'est
celle qui s'inscrit dans la continuité d'un sens, dans la con-
nexion intime du présent et du passé, le présent ne pouvant
s'interpréter que dans le cadre des problèmes engendrés par
le passé.
9. Cf. Heretics and Renegades, op. cit.
37
Les mesures de libéralisation et de transformation
des classes
Dans cette perspective il faut d'abord reconnaître que la
société de 1956 a une autre physionomie que celle de 1935. Et
la Bureaucratie et le Prolétariat et la Paysannerie ont connu au
travers de l'industrialisation, nous l'avons dit, une révolution.
Celle-ci fut encore accélérée par l'accroissement rapide de la
population. En premier lieu, les anciennes couches sociales
dominantes, une fraction du prolétariat et de la paysannerie
se sont fondues au seiri d'une nouvelle classe. Liés à des
fonctions qui les distinguent des exploités, tirant leurs pri-
vilèges de leur intégration à l'Appareil d'Etat, les voyant
s'accuser avec l'essor de l'industrie, partageant un même mode
d'existence de par leurs revenus communs, leur commune oppo-
sition à l'exploité, leur ambition identique de s'élever dans la
hiérarchie, les Bureaucrates ont composé un milieu de plus en
plus homogène. C'est une évidence que le stade de leur matu-
rité implique un autre mode de commandement que celui de
leur avènement.
Le stalinisme, nous l'avons souligné, a joué à l'origine un
rôle essentiel dans la formation de la classe, il en a incarné
l'unité et anticipé l'avenir alors qu'elle vivait encore dans la
gangue de l'ancienne société. Mais cette action engendra, pour
la Bureaucratie, un paradoxe dont témoigne le long cortège
d'épurations que nous connaissons. En même temps qu'elle
s'affirmait dans la société, conquérait un statut à part, elle
s'exposait à la menace accrue de la Terreur stalinienne. On se
souvient des purges de 1937, à la fin de la seconde période
quinquennale: 42 0/0 des directeurs d'entreprise, 55 0/0 des
présidents de syndicats sont épurés. Il ne s'agit pas d'oppo-
sants, mais bien des cadres du nouveau régime, dont les
prérogatives sont brutalement subordonnées à celles de l'AP-
pareil dirigeant. Sans doute ne procède-t-on plus par la suite
à des épurations d'une pareille ampleur, mais il semble bien
que l'arbitraire, de la dictature ne s'affaiblit pas. Les témoi-
gnages d'un Kravschenko, ceux surtout que nous livrent au-
jourd'hui les nouveau Dirigeants attestent la persistance de la
Terreur ; et de nombreux faits –destitution d'économistes ou
de militaires célèbres, procès des médecins - nous permettent
de suivre la trace du despotisme stalinien jusqu'en 1953. Or,
la Terreur supportée dès l'origine avec impatience par tous
ceux qui risquent d'en être victimes (et d'autant plus inquié-
tante qu'elle crée une perturbation dans la marche de l'éco-
- 38 -
nomie) devient intolérable quand elle n'est plus justifiée par
les conditions sociales, quand elle n'apparaît plus comme la
rançon provisoirement inévitable de la Fondation de la société.
Le divorce entre le statut de fait et le pouvoir réel des mem-
bres de la bureaucratie apparaît sous un jour nouveau, quand
la cohésion absolue de la nouvelle classe cesse d'être l'impé-
ratif premier légitimant l'intervention permanente de l’Appa-
reil dirigeant dans la vie sociale, quand l'industrie crée et
recrée quotidiennement le fondement de la puissance de
classe.
Serait-ce trop de dire que l'idéologie bureaucratique
change alors de sens? Dans la période héroïque des premiers
plans quinquennaux le marxisme, métomorphosé par le stali-
nisme, offre à la bureaucratie une vision tragique du monde:
l'idéal d'un nouvel ordre économique, de la destruction vio-
lente des capitalistes, de la mission historique qui incombe
aux hommes nouveaux domine absolument. Au demeurant
cet idéal n'est pas incompatible avec le profond cynisme de
l'exploiteur qu'a dénoncé Trostky. Mais il le dissimule. Or
l'auto-mystification est essentielle. On peut dire des bureau-
crates ce que Marx disait des bourgeois du XVIIIe siècle, dans
le 18 Brumaire. En utilisant la phraséologie révolutionnaire,
en se drapant dans le « costume » léniniste, ils se mas-
quent les intérêts étroits et particuliers de leur lutte. Ils
réussissent « à maintenir leur passion à la hauteur de la
grande tragédie historique », « ils réalisent la tâche imposée
par leur époque » (10). Comme la bourgeoisie, à son avène-
ment, la bureaucratie s'élève d'abord au-dessus d'elle-même
et est contrainte de massacrer ses propres membres pour impo-
ser l'idéal de la domination nouvelle. Le système affermi, la
passion devient outrance, les exploits de la Révolution
ennuient, le mythe tend à rentrer dans les limites de la prose
quotidienne. Tandis qu'hier encore les procès prenaient les
dimensions fantastiques d'un Jugement dernier devant l'Hu-
manité, qu'hier encore les accusés légitimaient la cause qui les
perdait, s'arrachaient leurs propres aveux et transformaient
10. Rappelons ce texte célèbre de Marx : « La tradition de toutes
les générations pèse comme un cauchemar sur le cerveau des vivants.
Au moment précis où ils paraissent occupés à se transformer eux-
mêmes, à bouleverser toutes choses, à réaliser des créations nouvelles,
ils appellent anxieusement à leur aide les esprits du passé, empruntent
à leurs devanciers, justement dans les périodes de crise révolutionnaire,
leur nom, leur cri de guerre, leur costume pour représenter, dans cet
antique et vénérable travestissement et avec le langage qui n'est pas à
eux, la scène nouvelle de l'histoire universelle ». Le 18 Brumaire de
Napoléon Bonaparte, p. 148. Molitor, éd.
39
leur crime imaginaire en trahison réelle, aujourd'hui le tribunal
n'est plus que l'exécutant sinistre du despotisme, l'accusé, la
simple victime de la Tchéka.
Les mesures attachées au nom de Malenkov viennent
répondre à cette évolution. On formule un « habeas corpus »
bureaucratique, on rétablit une séparation de la police et de
la justice, on déclare les affranchir ensemble de l'appareil
politique, on soustrait ainsi les citoyens à la menace perma-
nente qu'exerçait sur eux l'arbitraire dictatorial; on condamne
des procès anciens et récents, les instigateurs du pseudo com-
plot des médecins, et rétrospectivement Vichinsky le Procu-
reur de la terreur. On proclame les règles démocratiques qui
doivent présider au fonctionnement des institutions officielles
les Soviets, le Parti, le Syndicat, dont les congrès n'étaient
plus même réunis. On procède en même temps à des baisses de
prix spectaculaires sur les objets de consommation et l'on dé-
finit un programme de production de biens de consommation
destiné à satisfaire les besoins nouveaux de la population.
Finalement, et c'est l'ouvre du XX° Congrès, on immole à la
collectivité celui qui incarna la Terreur, Staline lui-même. C'est
que -- dirons-nous en paraphrasant une fois de plus Marx -
le temps des porte-parole réalistes de la nouvelle classe est
venu. Ils s'appellent Malenkov et Kroushtchev, Boulganine et
Mikoian. Ils confèrent aux membres de leur classe le statut
qu'appelait depuis longtemps leur fonction dirigeante.
Pourtant la nouvelle politique ne saurait s'interpréter dans
le seul cadre de l'évolution des Dominants. Celle des exploités
apparaît non moins déterminante et les concessions qui les
visent au centre de la Réforme. C'est que les méthodes qui pré-
valaient avant la guerre ont perdu leur efficacité en 1956 face à
un prolétariat que l'industrialisation a multiplié, dont elle a
transformé les besoins, la mentalité, les modes de résistance
à l'exploitation. Jusqu'à la guerre (11) le prolétariat a reçu
l'afflux régulier d'éléments arrachés aux campagnes, étrangers
donc à la tradition de la classe ouvrière, habitués à un niveau
de vie très bas et à des besoins rudimentaires, dépourvus de
culture technique. La force d'inertie que constitue une telle
couche sociale dans la production a été cent fois soulignée.
Elle est prête à endurer l'exploitation la plus dure et en un
sens elle la provoque, en raison de son ignorance technique;
elle est dépourvue des réflexes de solidarité caractéristiques du
milieu ouvrier. Il n'est pas douteux que l'efficacité de la légis-
11. DEUTSCHER note qu'à partir de 1930, 1,5 à 2 millions de travail.
leurs furent absorbés annuellement par l'industrie. Soviet Unions, p. 84.
40
lation du travail - sans cesse aggravée de 1930 à 1940
ait
dépendu de ce prolétariat arriéré. A cette époque, la coerci-
tion brutale (au reste toujours jointe à la propagande socia-
liste) s'avérait rentable. Mais comme le notait Marx, l'Indus-
trie est le lieu d'une révolution permanente du mode de pro-
duction, du mode de pensée et du mode d'existence des
hommes. S'il faut des générations et quelquefois des siècles
pour que s'effectue une transformation de la mentalité
paysanne dans le cadre de la vie agricole, il ne faut que des
années pour que des hommes s'adaptent à l'idustrie, envisa-
gent les
problèmes sous l'angle nouveau de la « logique » de la
production, découvrent la complémentarité de leurs tâches
particulières, se perçoivent solidaires dans leur condition
d'exploités apprennent à revendiquer, c'est-à-dire à changer
leur sort - instruits qu'ils sont par le progrès insatiable de la
technique -- et, en définitive s'approprient un besoin jusqu'a-
lors inconnu: le besoin social, le besoin d'une existence sociale
telle.
en tant que
Reconnaître que le prolétariat russe a aujourd'hui un
quart de siècle de grande industrie derrière lui, c'est déjà
comprendre alors qu'on ne saurait rien de ses luttes que
ses rapports avec ses dirigeants se posent en termes absolument
nouveaux. Il est évident sauf pour ceux qui n'ont jamais
voulu tourner leurs regards vers la vie des usines et apercevoir
la lutte que se livrent quotidiennement ouvriers et direction
autour du rendement qu'à un certain stade de l'évolution
du prolétariat la force devient un instrument d'exploitation
inefficace. Mais voudrait-on confirmation de cette évidence,
il suffirait de considérer les relations qu'entretiennent bureau-
crates et prolétaires dans un pays ou ces derniers se trouvent
dès l'avènement du nouveau régime enracinés dans l'industrie
et liés à une tradition de lutte. La résistance du prolétariat
d'Allemagne orientale qui a pris la forme aigue d'une grève
générale contre le relèvement des normes et qui a contraint la
bureaucratie à abandonner ses plans témoigne clairement de la
nécessité où se trouvent les dirigeants de composer avec les
exploités quand ceux-ci disposent d'une expérience historique.
Pourtant ces considérations sont encore insuffisantes. On
ne saurait en effet détacher le prolétariat et son évolution du
mode de production; ou, en d'autres termes, négliger que la
transformation de l'industrie affecte elle-même essentiellement
la conduite des hommes qui sont maîtres de sa marche. Or,
sitôt qu'on aperçoit cette liaison entre la vie des hommes et
celle des machines, on doit convenir qu'elle appelle partout à
notre époque, un nouveau type de commandement. Est-ce un
41
-
hasard si dans le pays le plus fortement industrialisé du
monde, les entreprises les plus puissantes et les plus modernes
ont dû l'une après l'autre renoncer à leurs méthodes tradition-
nelles de combat et composer avec les ouvriers, utiliser notam-
ment les syndicats auxquels elles avaient longtemps interdit
toute action publique pour établir une paix sociale dans le
processus de production. Est-ce un hasard si, après avoir
concédé de substantielles augmentations de salaires, depuis la
guerre, le patronat américain cherche par tous les moyens à
obtenir une « participation » effective des ouvriers à la pro-
duction — par des techniques psycho-sociologiques comme par
l'institution du salaire annuel garanti. On connaît la specta-
culaire évolution de Ford qui, après avoir été le bastion du .
travail forcé, après avoir édifié un système totalitaire en mi-
niature (dans lequel toute la vie productive et privée de
l'ouvrier était contrôlé par un appareil policier), après avoir
interdit l'accès de ses usines au syndicat et réprimé les grèves
par la force pure, a soudain changé de méthodes et se situe
aujourd'hui à l'avant-garde de la politique de compromis.
Cette évolution si elle fut dans une large mesure la consé-
quence d'un grand mouvement de lutte ouvrière répondit
à des impératifs de la grande production moderne. Les inves-
tissements dans des machines de plus en plus coûteuses et
délicates, la rationalisation qui fait dépendre rigoureusement
chaque secteur de production de tous les autres mettent au
centre de la vie du Capital le problème de la productivité du
travail, en conséquence celui de la continuité , de la vitesse et
de la qualité de la production, celui du relèvement constant des
normes. Or l'accroissement de la productivité dépend en der-
nier ressort de la conduite des producteurs, de leur aptitude
à la vitesse, de leur adhésion au moins tacite aux normes de
la Direction. Le Capital se heurte donc comme il n s'y est
jamais heurté dans le passé au phénomène humain. Il dispose
certes de la force: la police, l'armée, les lois de l'Etat, les
moyens d'effamer. Mais sa puissance qui s'est considérable-
ment accrue depuis vingt-cinq ans ne lui sert qu'à mater le
prolétariat; elle est absolument inefficace pour le faire pro-
duire. Pour l'amener à produire, il faut composer. Car il ne
suffit
pas
de concentrer des ouvriers dans des usines et de les
y garder huit ou dix heures sous le contrôle d'une police pour
en extorquer une raisonnable plus-value, il faut obtenir le
maximum de leurs gestes, susciter en chacun le rythme le plus
rapide et le plus adéquat à l'opération intéressée, de la combi-
naison de ces milliers de rythmes individuels et de ces milliers
d'inventions corporelles tirer une force qui permette au mo-
nopole de subsister ou de dépasser son concurrent dans le con-
cert capitaliste. Il n'est pas exagéré de dire que dans cette
42
situation le prolétariat devient le maître virtuel de la produc-
tion. Non pour la simple raison qu'il est indispensable à la
production – il le fut toujours ; mais pour cette raison
que toute la production est centrée sur son comportement,
qu'elle se mesure à chaque instant à sa participation au tra-
vail; pour cette raison, en bref, qu'il est reconnu par ceux-
là mêmes qui l'emploient comme le sujet humain du travail.
L'URSS connaît aujourd'hui les impératifs de la grande
production moderne. Elle suit nécessairement l'évolution qu'a
suivie l'usine Ford. Elle abandonne les méthodes de coercition
primitives qui, pendant les premières années de l'industriali-
sation, lui ont permis de faire jaillir du sol un immense sys-
tème industriel. Encore loin derrière les Etats-Unis, l'URSS
doit mobiliser toutes ses forces pour relever la productivité du
travail. C'est que, dans la compétition mondiale, le Maître
sera celui qui disposera de la plus forte productivité. Quel
que soit le volume de sa production, l'URSS n'affirmera sa
supériorité que lorsqu'elle dépensera moins d'heures de « tra-
vail social » que les Etats-Unis pour produire tel ou tel pro-
duit. (12) Cet objectif constitue l'un des thèmes essentiels du
XX° Congrès et revient comme un leit-motiv dans les Discours
de Kroushtchev, Boulganine, Suslov et Malenkov (13). Boulga-
nine, notamment, souligne que les plans de productivité n'ont
pas été remplis dans l'industrie, pas mème dans les entre-
prises qui par ailleurs se félicitent d'avoir largement dépassé
les normes de production fixées; il appelle les travailleurs à
comprendre qu'ils ont « un intérêt vital à élever la productivité
du travail » et souligne que la réorganisation des normes et
des salaires doit jouer un rôle décisif en ce sens.
Mais ces appels ne peuvent être entendus que si le prolé-
une
12. SOUSLOV écrit en ce sens : « Le sixième quinquennat sera
étape importante dans l'émulation pacifique des deux systèmes. La parti.
cularité de cette étape est que désormais le pays des Soviets possède tout
ce qu'il faut pour résoudre, dans le délai historique le plus bref, le pro
blème économique fondamental de l’U.R.S.S. : rattraper et dépasser les
pays capitalistes les plus évolués en ce qui concerne la production par
habitant. Or, pour cela, nous devons assurer le passage de toute notre
économie nationale à un niveau technique nouveau plus élevé, accroître
notablement la productivité du travail. C'est là l'essentiel aujourd'hui
pour assurer la primauté du socialisme dans la compétition avec le
socialisme ». XX® Congrès du Parti Communiste de l'Union Soviétique,
p. 234.
13. Les citations qui suivent sont extraites, en ce qui concerne le
discours de Khrouchtchev, du texte publié par les Cahiers du Communisme,
de mars 1956 ; en ce qui concerne tous les autres discours, du Recueil
édité par les Cahiers du Communisme et intitulé : «XX® Congrès du
Parti Communiste de l'Union Soviétique ». Nous indiquerons les pages
de référence dans le cours de notre exposé.
43
un cer-
tariat est mis en mesure de les entendre. Il faut lui créer des
conditions d'existence nouvelles qui lui permettront de « par-
ticiper » pleinement aux tâches de production. Une réorgani-
sation de la planification s'impose donc. Certes il ne s'agit pas
de renoncer aux objectifs, traditionnels du développement de
l'industrie lourde, mais il s'agit, pour remplir cet objectif,
d'accorder un intérêt nouveau à la production des biens de
consommation. Plus généralement il s'avère que la puissance
réelle de la société ne se définit
pas exclusivement
par
tain volume des forces productives, ou par un certain potentiel
matériel mais qu'elle est fondée sur un potentiel humain et que
ce potentiel humain se mesure à la fois à la culture technique
que possèdent les masses et à leur adhésion à un certain mode
d'existence. On procède donc à des baisses de prix impor-
tantes sur les objets de consommation courante, on revalorise
les salaires; on réduit la semaine de travail et l'on annonce
qu'on réduira bientôt la journée de travail, on aménage plus
souplement les congés payés. Ces concessions matérielles si
importantes qu'elles soient - et il n'est pas douteux qu'elles
ne cesseront de s'amplifier sont encore insuffisantes. On
renonce à certains traits de la législation du travail; l'accusa-
tion de sabotage économique ne sera plus suspendue comme
une menace permanente sur la tête de l'ouvrier; celui-ci ne sera
plus contraint de travailler aussi longuement dans une même
usine sous peine de perdre les avantages sociaux auxquels il
a droit (14). On appelle enfin les ouvriers à participer plus
activement à la vie du Parti et du syndicat en leur offrant
la garantie d'une démocratie véritable.
14. Nous raisonnons comme si les concessions présentes étaient réel.
lement très importantes. En fait il est vraisemblable que K., en bon
chef d'Etat, en amplifie sensiblement la portée. Mais même dans le
meilleur des cas, les mesures présentes ne doivent pas être surestimées.
Replacées dans le cadre du capitalisme mondial, elles sont fort limitées.
Par exemple, l'assouplissement du code du travail qui se dessine ne
maintient pas moins des conditions beaucoup plus rigoureuses qu'aux
Etats-Unis ou en France. Et surtout le relèvement du niveau de vie
laisse encore l’U.R.S.S. loin derrière les pays capitalistes les plus évolués.
Il ne semble pas, en outre, qu'un progrès important sous ce rapport soit
à attendre dans un avenir prochain. K. souligne au contraire dans son
discours que les baisses de prix ne seront plus aussi fréquentes, car les
fonds qui devaient y faire face devront être employés à financer un nou-
veau système de retraite,
44 -
La réforme de l'état, du parti
et de la planification
1
Toutes ces mesures (dont certaines ont été prises du vi-
vant de Staline) ont une portée considérable; elle dévoilent
qu'un certain type de dictature est incompatible avec le
fonctionnement d'une société moderne, elles rapprochent le
régime de l'URSS de celui des grands pays industriels du
monde bourgeois. Mais elles ne prennent tout leur sens que
situées dans le cadre de la structure bureaucratique. Elles
n'affectent pas l'essence du totalitarisme, car celui-ci, comine
nous y avons insisté, ne se réduit par à un mode de gouverne
ment; il est lié à un mode de gestion économique, à une appro-
priation collective de classe qui n'est pas un instant mise en
cause. Le Nouveau Cours se présente plutôt comme une
tentative de réforme du totalitarisme, une tentative pour
dépassser certaines contradictions du passé, pour inventer
certains artifices destinés à assurer un meilleur fonctionnement
de la société. Le problème est donc de rechercher quelle est la
nature de la réforme des institutions, quelles en sont les limites
et quels nouveaux problèmes elle suscite. Les Discours du
XX Congrès nous offrent un guide incomparable dans cette
recherche et, à les suivre, on verra que les questions dominantes
du présent pour les Dirigeants de la bureaucratie sont celles
que nous avons jugées inhérentes au totalitarisme. Assurément
la Bureaucratie enveloppe ses difficultés dans une constante
apologie du régime. Au surplus elle laisse entendre qu'il s'agit
de difficultés techniques, liées à une conjoncture et donc tou-
jours solubles. Ce n'est pas seulement qu'elle mystifie; elle se
mystifie elle-même parce qu'elle est incapable de se représenter
objectivement son propre rôle dans la société, parce qu'elle est
condamnée à envisager tous les problèmes en postulant la
nécessité de sa propre existence. Il n'en reste pas moins
qu'à l'intérieur des horizons étroits que lui circonscrivent ses
intérêts, elle mène la critique aussi loin qu'il est possible. Sur
l’Appareil d'Etat, sur le Parti, sur la Planification, sur le
fonctionnement de l'industrie et de l'agriculture ses propos
visent l'essentiel, mettent à nu les contradictions inhérentes
au système totalitaire d'exploitation.
La critique fondamentale de Kroushtchev, Boulganine et
Souslov porte sur la scission qui s'est établie entre l'Etat et
la Société, entre le Partı et la vie productive, entre l'idéologie
er le travail pratique, entre les normes de la planification et
le fonctionnement réel de la production. L'objectif à chaque
- 45 -
pas réaffirmé est la restauration d'une unité telle que les divers
secteurs de la vie sociale communiquent effectivement, telle
que les membres de la société participent activement à la tâche
commune. Mais cet objectif est, aussitôt formulé, démenti.
La participation des hommes, la communication des activités
est en effet subordonnée, comme on le verra à la Règle imposée
par l'Appareil dirigeant. Qu'il s'adresse aux membres des
classes exploitées ou à ceux mêmes de la classe dominante,
l'appel de la Direction se réduit, en dernier ressort, à cette
formule: « Fais comme si la maxime de ton action pouvait
être érigée en loi universelle de la volonté bureaucratique ».
Ou, en termes plus vulgaires: souhaite du plus profond de
ton cour tout ce que te commande la Direction. K. et B.
affirment que la Bureaucratie est prête à se désarticuler et à
fournir le spectacle d'incroyables contorsions, qui la rendront
heureusement méconnaissable, sans modifier en rien son corps.
Ils ajoutent que le spectacle est gratuit mais qu'il est de l'in-
térêt du public d'y croire.
La critique de l'Etat se présente dans le Discours de K.
sous le titre « Perfectionnement de l’Appareil d'Etat ». Elle
nous apprend que celui-ci a pris des proportions anormales,
(i démesurées », qu'une partie de l'Appareil est purement para-
sitaire, c'est-à-dire vit aux dépens de la société au lieu de diri-
ger effectivement: « Conformément aux principes léninistes
d'organisation du travail de l’Appareil le Comité central du
PCUS et le Conseil des Ministres de l'URSS ont pris au
cours des deux dernières années d'importantes dispositions
pour simplifier la structure, réduire le personnel et améliorer le
fonctionnement de l'appareil administratif. Grâce à ces
mesures le personnel a été réduit, d'après les données dont nous
disposons, de 750.000 hommes. Mais il faut dire que l'appa-
reil administratif est encore démesurément grand, que l'Etat
dépense pour son entretien des ressources énormes. La société
soviétique est intéressée à ce qu'un plus grand nombre de gens
travaille à la production: dans les usines et les fabriques, dans
les mines et sur les chantiers, dans les kolkhoses, SMT et
sovkhoses, là où se crée la richesse nationale. » K. ajoute:
« Notre appareil d'Etat comporte encore beaucoup d'éléments
superflus, accomplissant parallèlement un même travail. Nom-
breux sont les travailleurs des ministères et des administrations
qui, au lieu de travailler à l'organisation des masses labo-
rieuses en vue de l'exécution des décisions du Parti et du Gou-
vernement, continuent à siéger dans les bureaux, passent leur
temps à noircir du papier, à entretenir une correspondance
bureaucratique. Il faut poursuivre une lutte implacable contre
le bureaucratisme, ce mal intolérable qui cause un grand pré-
· 46 -
:
judice à notre cuvre commune. » (p. 334) Il va de soi que
la
critique du bureaucratisme n'est pas nouvelle. Elle était déjà
l'honneur de la vieille école stalinienne: la bureaucratie en-
gendre de toute nécessité le bureaucratisme, elle défend de
toute nécessité son existence en le critiquant. On ne saurait
cependant nier que la critique a pris une extension jusqu'alors
inconnue et qu'elle inspire une véritable refonte de l'Etat. Non
seulement on réduit massivement les effectifs des ministères,
on rationalise leurs activités, mais on menace de supprimer des
secteurs entiers de l'Etat. Comme l'écrit B.: « ... la question
qui se pose n'est sans doute plus uniquement celle d'une réduc-
tion notable de l'appareil central mais en général celle de
l'utilité de l'existence de certains ministères de l'URSS et des
Républiques » (p. 173) Et B., comme K., n'hésite pas affir-
mer l'idée d'une décentralisation: «... la direction centralisée
doit se doubler d'un accroissement d'indépendance et du
développement de l'initiative des organisations locales pour
régler les problèmes du développement économique et
culturel » (p. 172-3). De fait, l'importance de cette décentra-
lisation s'avère décisive dans les relations entre les Républi-
ques. Les dirigeants avouent en effet implicitement que la
question des Nationalités n'a pas été réglée. K. affirme qu'on
a ne saurait exercer une tutelle mesquine sur les républiques
fédérées » (p. 332). B. reconnaît « que les mesures prises
pour éliminer la centralisation excessive dans la gestion de
l'économie rencontrent la résistance de certains dirigeants des
ministères de l'URSS et des républiques qui veulent tout
diriger à partir du centre, comme si, vraiment, placés au
sommet » ils voyaient la situation mieux que ne la voient les
dirigeants des républiques fédérées » (p. 173). La vérité est
que l’Appareil de Moscou a imposé une véritable dictature aux
républiques de l'URSS et que la planification a toujours été
établie par lui, indépendamment des besoins réels des répu-
bliques. L'une des conséquences de cette dictature a été d'en-
gendrer une lutte entre les divers appareils dirigeants (dont
témoignent les constantes épurations dans les directions des
républiques pendant l'ère stalinienne) et une inégalité de déve-
loppement des diverses régions de l'URSS. K. reconnaît à cet
égard que les revenus des kolhoses sont dans certaines répu-
bliques incomparablement supérieurs à ceux des régions voi-
sines (p. 331). Et, tout en admettant que les ressources bud-
gétaires octroyées par l'Etat fédéral sont « pour l'essentiel »
« correctement réparties », il admet encore qu'il y a « parfois
un décalage inexplicable dans le montant des crédits alloués
à certaines républiques (ibid.). Il préconise donc de créer des
conditions d'exploitation rigoureusement égales dans les di-
verses régions et de donner aux directions locales plus de
>>>
47
liberté dans l'application du Plan national. Mais il est signi-
ficatif que cette liberté récemment octroyée ait déjà été à
l'origine d'une nouvelle poussée de bureaucratisme. Comme le
signale B. les républiques se sont empressées de créer des mi-
nistères sans se préoccuper de justifier leur fonction dans la
société: « La création dans les républiques de ministères de
l'Union et des républiques alors que le nombre des entreprises
est insignifiante n'a pas seulement lieu en Kirghisie. Ainsi
dans la république de Tadjikie, il a été créé un ministère de
l'industrie légère avec vingt-sept personnes, ministère qui ne
contrôle que six entreprises, un ministère de l'industrie textile
de la république de Turkménie qui gère dix entreprises. Dans
la république de Moldavie on a créé un ministère de l'industrie
forestière avec une personnel de trente-deux personnes. Ce
ministère ne dirige que huit entreprises, dont quatre exploi-
tations forestières sur lesquelles deux sont situées dans les
territoires de la R.S.F.S.R. et de la R.S.S. d'Ukraine »
(p. 174). C'est que les bureaucrates voient dans la décentrali-
sation le moyen d'affirmer leurs intérêts particuliers. La con-
clusion que B. retire le tels excès est éloquente: on ne peut
s'en remettre aux républiques du soin de décider de l'organi-
sation de leur gouvernement. C'est le Conseil des Ministres de
l'URSS qui doit décider si l'existence d'un ministère est jus-
tifiée ou non.
Sur ce point préc:s les limites de la réforme de l'Etat
apparaissent clairement. La centralisation de toutes les
responsabilités entre les mains de la bureaucratie de Moscou
a créé un malaise, elle a engendré l'hostilité permanente des
bureaucraties régionales, en outre elle a entravé le fonction-
nement de la planification qui ne tenait pas compte des
conditions diverses propres à chaque république. Une décen-
tralisation s'impose donc qui sans altérer le droit absolu de
l'Appareil central de décider de tout donnerait aux autorités
locales une certaine liberté dans l'application des directives.
Cependant cette décentralisation, aussi limitée qu'elle soit,
aboutit dans les faits à renforcer le bureaucratisme des direc-
tions locales qui entendent s'épanouir à leur guise aux dépens
de la direction centrale: elle est donc aussitôt démentie et le
principe de la tutelle de Moscou réaffirmé. En d'autres tremes,
la centralisation n'est pas à l'origine de la Bureaucratie, c'est
la Bureaucratie qui engendre le bureaucratisme à tous les
niveaux et appelle la centralisation.
Ces difficultés se retrouvent, mais considérablement
amplifiées, dans la réforme du Parti. C'est que, nous l'avons
dit, celui-ci est l'institution fondamentale du totalitarisme,
48
Parce qu'il tend à être l'agent essentiel de la « socialisation »,
il est le cadre où l'échec de celle-ci est le plus visible. On ne
s'étonnera donc pas que K. fasse une critique implacable de
son fonctionnement, en dénonçant deux traits que nous avions
jugés inhérents à sa nature: il est séparé de la vie productive;
il se comporte comme un groupe particulier dont l'activité
purement formelle ne vise qu'à justifier sa propre existence.
1
Dès le début du chapitre qu'il consacre à « l'activité d'or-
ganisation du Parti », K. fait ressortir en termes crus la
Scission qui s'est établie entre son activité politique et la pra-
tique économique: « Il faut avouer que de longues années
durant, nos cadres du Parti ont été insuffisamment éduqués
dans un esprit de haute responsabilité envers la solution des
questions pratiques de l'édification économique. Ceci a permis
aux méthodes bureaucratiques de gestion de l'économie de se
répandre largement; beaucoup de travailleurs du Parti ont
négligé le travail d'organisation dans le domaine de l'édifi-
cation économique, ne se sont pas suffisamment intéressés à
l'économie et, souvent, ont remplacé le travail vivant d'orga-
nisation des masses par des conversations oiseuses, l'ont noyé
dans un océan de paperasseries » (p. 344). Et il ajoute un
instant plus tard: « Malheureusement, jusqu'à présent encore,
dans de nombreuses organisations du Parti on oppose, ce qui
est absurde, le travail politique du Parti aux activités écono-
miques. On trouve encore des « militants » du Parti, si l'on
peut les appeler ainsi, qui estiment que le travail du Parti est
une chose et que le travail économique et des Soviets en est
une autre. On peut même entendre ces « militants » se plaindre
d'être arrachés à leur activité « purement politique » et con-
traints d'étudier l'économie, la technique industrielle et agri-
cole, d'étudier la production » (nous soulignons p. 345);
On peut repérer cet isolement du Parti à tous les niveaux
de son fonctionnement. D'abord à propos de la répartition
des militants au sein de la société: « Il est anormal, déclare
encore K., que dans certaines branches de l'économie natio-
nale, une partie considérable des communistes soient occupés
à des travaux qui ne sont pas liés directement aux secteurs
clés de la production i (15). Par ailleurs la formation que
15. K. ajoute : « Ainsi, dans les entreprises de l'industrie houillère,
on compte près de 90.000 communistes, mais dans les travaux du fond
on n'en compte que 38.000. Plus de trois millions de membres et de
candidats au Parti vivent dans les régions rurales, mais moins de la
moitié d'entre eux travaillent directement dans les kolkhoses, les S.M.T.
et les Soykhoses ». P. 350.
SOUslov confirme cette crique en signalant que « dans nombre d'orga-
nisations du Parti, la proportion des ouvriers et des kolkhosiens parmi
les nouveaux adhérents est très faible ». P. 236.
49
reçoivent les cadres les rend incapables de répondre efficace-
ment aux problèmes de la production. « Il suffira de dire par
exemple que nos écoles du Parti forment des travailleurs qui
ignorent les éléments de l'économie concrète » (p. 350). La
conséquence de cette ignorance c'est que les responsables de
district ne sont pas à la hauteur de leurs responsabilités. Dans
l'agriculture notamment, nombreux sont ceux qui dirigent
les kolkhoses « de façon formelle, sans compétence » (p. 346).
Que font donc ces cadres incompétents ? Ils font semblant
d'agir; ils déploient, selon K., une agitation d'autant plus
spectaculaire qu'elle est absolument vaine. Ce sont des
(fainéants occupés ». « A première vue, ils semblent très
actifs et, en effet, ils travaillent beaucoup, mais toute leur
activité est absolument stérile. Ils siègent en réunion jusqu'au
petit jour, après quoi ils galopent dans les kolkhoses, semon-
cent les retardataires, tiennent des conférences et prononcent
des discours pleins de lieux communs et, en règle générale,
rédigés d'avance, appelant à « se montrer à la hauteur », à
«« surmonter toutes les difficultés » à « opérer un tournant », à
<< être dignes de confiance », etc... Mais un dirigeant de ce
genre a beau faire du zèle, à la fin de l'année il n'y aura
aucune amélioration. Comme on dit « il a fait de son mieux,
ce qui ne l'a pas empêché de rester planté comme un pieux »
(p. 346). Inlassablement K, répète le même thème: « le Parti
réclame de ses cadres qu'ils ne séparent le travail du Parti du
travail économique, qu'ils dirigent l'économie concrètement, en
connaissance de cause » (345). L'isolement tient donc aussi
à une dégénérescence de l'idéologie: celle-ci ne répond plus
aux problèmes posés par la vie sociale réelle. « Son principal
défaut aujourd'hui, déclare K., est d'être dans une grande
mesure détachée de la pratique de l'édification communiste »
(p. 353). Et il souligne que « propagandistes et agitateurs
doivent connaître non seulement tel ou tel principe théorique,
mais aussi les choses concrètes de l'économie, ne pas parler
dans le vague mais en connaissance de cause. Là est le fond
du problème » (p. 354). La critique de K. reprise par B. est
développée jusqu'à ses dernières conséquences par Souslov.
Dans le chapitre de son discours intitulé « Mettre fin à la cou-
pure nuisible entre le travail idéologique et la vie », celui-ci
confirme d'abord les réflexions de K.; « notre travail idéolo-
gique, dit-il, ne s'attache que dans une faible mesure à résou-
dre ces importants problèmes (les problèmes pratiques de
l'édification communiste) et est pour une bonne part inutile,
car il se borne à ressasser les mêmes formules et thèses connues
et il éduque parfois des glossateurs et des dogmatiques sépa-
rés de la vie » (p. 239, nous soulignons). En outre, Souslov,
sans apercevoir apparemment l'immense portée de cette idée,
50
affirme la nécessté d'un changement radical de la fonction
idéologique. Elle a été jusqu'alors « dans une grande mesure
orientée vers le passé, vers l'histoire, au détriment des pro-
blèmes d'actualité » (16). Or une telle orientation détournait
les militants des tâches présentes, elle les enfermait dans une
mythologie, dans laquelle les héros bolchéviks luttant contre
les populistes, les économistes, les partisans du Bund figu-
raient des modèles extraordinaires, en dehors de toute réfé-
rence à la réalité présente (17). Sans perdre de vue, affirme
prudemment Souslov, l'étude de l'expérience révolutionnaire
du passé, il faut comprendre que l'URSS est entrée dans une
nouvelle phase de son développement: cette phase « où toute
l'attention doit être portée à l'étude et à l'élaboration de la
science économique » (p. 240). Souslov ne se demande pas un
instant pourquoi le mythe du passé a dominé toute l'activité
du Parti; sans doute n'est-il à ses yeux que le produit de la
routine et du bureaucratisme. L'idée ne l'effleure pas que le
Parti ait pu, grâce à ses récits semi-légendaires, affronter la
tâche de son époque, en un moment où la bureaucratie élevée
au-dessus d'elle-même, devait se dissimuler à tout prix l'image
de sa cupidité. Pas davantage il ne pressent que les mythes
forgés par le stalinisme lui permettent à lui, Souslov, de tenir
à présent le langage réaliste de l' « économie concrète ».
Naivement il fait le portrait d'une société régie par la mysti-
fication où pratique et pensée sont déchirées, ce portrait
dans lequel Marx dénonçait magistralement les traits de
l'aliénation.
16. SOUslov, p. 239. Boulganine déclare dans le même sens :
« Bien
souvent nous avons poussé nos cadres dirigeants, les communistes et les
sans-parti à étudier, dans les écoles, le cercles, les cercles d'étude dirigée
et dans leurs études personnelles, l'histoire du Parti de préférence et
nous avons extrêmement peu attiré leur attention sur l'assimilation de
la théorie économique du marxisme-leninisme, sur la connaissance de
l'économie concrète ». P. 1834.
17. SOUSLOV fait en termes imagés un véritable réquisitoire contre
les dirigeants du Parti qui répètent stérilement les slogans du passé :
« ... notre travail idéologique ne s'attache que dans une faible mesure à
résoudre ces importants problèmes (touchant à l'organisation de la société
dans le présent), et est, pour une bonne part, inutile, car il se borne à
ressasser les mêmes formules et thèses connues et il éduque parfois des
glossateurs et des dogmatiques détachés de la vie ». Il ajoute : « Beau-
coup de militants de base comprennent eux aussi combien cette situation
est anormale. Le camarade Ignatov, mécanicien de moissonneuse-batteuse
do la S.M.T. de Mikhaïlovskoe, région de Stalingrad, a très bien dit à
ce propos : « Depuis treize ans, j'étudie au cercle l'histoire du Parti.
Pour la treizième fois, les propagandistes nous parlent du Bund. N'avons-
nous rien de plus important à faire que de critiquer le Bund ? Ce qui
nous intéresse, ce sont les affaires de notre S.M.T., du district et de la
région. Nous voulons vivre du présent et de l'avenir, mais nos propa-
gandistes se sont à tel point empêtrés dans les affaires des populistes et
du Bund qu'ils n'arrivent pas à en sortir ». P. 239-40.
51
La dégénérescence idéologique et l'isolement du Parti se
traduisent enfin au niveau de la pensée scientifique. K. dit
rudement des économistes qu'« ils ne participent pas à l'exa-
men des questions essentielles du développement de l'indus-
trie et de l'agriculture au cours des conférences réunies par
le CC du PCUS. Cela signifie que nos instituts économiques
et leurs collaborateurs se sont foncièrement détachés de la
pratique de l'édification communiste » (p. 253, nous souli-
gnons). Mikoian, de son côté, après avoir aussi sévèrement
critiqué les économistes et les historiens, qu'il traite de
« barbouilleurs de papier », ajoute à propos des philosophes:
« Il aurait fallu dire deux mots à l'adresse de nos philoso-
phes. Au demeurant ils doivent comprendre eux-mêmes que
leur situation n'est guère plus brillante et qu'ils sont encore
plus en reste devant le Parti que les historiens et les
économistes » (p. 269).
». (
Séparé de la vie productive de la société, voué à line
idéalisation du Régime devenue inefficace, le Parti ne saurait
fonctionner convenablement. Il est, de fait, tel que le décrit
K., un groupe séparé des autres groupes sociaux et qui s'est
pris lui-même pour fin de son activité. Son appareil est
i encombrant », sa conduite « formaliste Le travailleurs
qualifiés qui s'y trouvent, selon K., s'occupent moins d'orga-
niser
que
de collecter toute sorte de renseignements, de statis-
tiques, d'alleurs inutiles dans la plupart des cas. C'est pour-
quoi trop souvent l'appareil du parti tourne à vide » (p. 345,
nous soulignons). Et K. ajoute: « On ne saurait tolérer plus
longtemps que beaucoup de travailleurs de l’Appareil du
Parti, au lieu de se trouver quotidiennement parmi les masses,
se confinent dans leurs bureaux et multiplient les résolutions
tandis que la vie passe à côté » (Ibid.). Souslov, une fois de
plus, se distingue dans la critique du Parti et signale que
malgré les efforts du CC, les dirigeants continuent d'être
étrangers à la vie des entreprises: « Le nombre des réunions
et des conférences a diminué. Les responsables du Parti
visitent plus souvent les entreprises... Mais peu de choses ont
été faites sous ce rapport. Malheureusement dans bien des
organismes du Parti, la manie des réunions et la paperasserie
- et non le travail d'organisation parmi les masses -- absor-
bent encore le temps et les forces des militants. » « La maladie
de la paperasserie, ajoute Souslov, atteint aussi les organi-
sations de base du Parti, souvent même avec le concours des
comités de district du parti qui réclament des procès verbaux
« détaillés » des réunions et des conférences, toutes sortes
de renseignements, etc... Il en résulte parfois que le souci
n'est pas le travail avec les hommes, mais le gribouillage de
52
papier qui absorbe la plus grande partie du temps du secré-
taire de l'organisation de base du Parti » (18).
Il nous fallait multiplier les citations pour montrer que
nous n'exagérions pas l'ampleur de la crise du parti russe,
pour faire ressortir à quels point les termes de notre analyse
précédente étaient proches de ceux employés par les Diri-
geants actuels. Encore faut-il y revenir: le cadre de notre
critique est tout différent du cadre officiel des Discours du
XX° Congrès. Ce que nous avions présenté comme contra-
diction essentielle du totalitarisme, Kroushchev et Souslov
le ramène à un ensemble de défauts d'organisation; ils ne
cessent d'affirmer que des mesures techniques peuvent y pal-
lier. Le parti était mauvais, la Réforme le rendra bon. Il
sera ce qu'il doit être en vertu de sa fonction idéale: le lieu de
rencontre de tous les acteurs sociaux, le lieu de toutes les
initiatives concrètes, la médiation permanente entre l'Etat et
la société entière. C'est que l'Appareil dirigeant ne peut pas
plus se présenter l'absence du Parti que sa propre absence.
Quel qu'il soit, le Parti est le Parti, parce qu'aux yeux de la
Direction 11 est la Société elle-même, son objectivation sensīble.
Et, de fait, dans le cadre du système il est nécessaire. Aussi
parasitaire qu'il soit, sous un certain aspect, il n'en demeure
pas moins qu'il répond à un besoin social, qu'il véhicule la
Règle sans laquelle la Bureaucratie n'existerait pas. Que la
bureaucratie affermie ressente avec plus d'impatience la con-
trainte du Parti, que le développement de la production dé-
nonce plus fortement la perturbation qu'il apporte dans la
vie économique ne saurait signifier qu'il puisse disparaître. La
tête peut bien faire souffrir, on ne peut s'en passer. Plus elle
18. SOUSLOV cite ensuite le cas particulièrement savoureux d'un
Secrétaire d'organisation de kolkhose : « Sa table et tous les rayons sont
encombrés de dossiers et de cahiers. Il tient des registres où il consigne
le travail des groupes du Parti, le travail parmi les femmes, le travail
avec les jeunes communistes, l'aide accordée à l'organisation du komso-
mol, les demandes et les plaintes, les missions confiées aux communistes,
le travail d'éducation du Parti, celui du cercle d'art amateur. Il a des
dossiers portant l'inscription : « Journaux muraux », «Bulletins », «Emu-
lation dans l'élevage », « Emulation dans l'agriculture », «Les Amis des
plantations forestières ». Le travail des propagandistes est consigné dans
trois cahiers : « Registre du travail des propagandistes », « Le travail
politique de masse », « Les missions quotidiennes confiées aux propa-
gandistes ». Représentez-vous combien de temps il faut pour remplir
toutes ces paperasses qui coupent inévitablement du travail d'organisation
vivant. Il est à remarquer en même temps que, dans ce kolkhose, on ne
poursuit aucun travail d'éducation parmi les trayeuses et les bergers.
Les fermes ne sont pas mécanisées, il n'y a pas d'horaire, pas de rations
établies pour le bétail. La productivité de l'élevage est extrêmement
basse. La moyenne de lait fournie anquellement par vache est de 484 litres.
Quant aux dossiers du Secrétaire, ils n'ont pas fourni de lait. Sous ce
rapport, ils se sont avérés absolument stériles ». P. 237-8.
53
fait souffrir, plus on la soigne, plus on la traite avec égard et
respect. Ainsi K. proclame-t-il sans rire l'essor du Parti, après
en avoir fait une impitoyable critique, l'immense tâche histo-
rique qu'il accomplit et le prestige incontesté dont 11 jouit au
sein de la société. « Le rôle de notre parti, déclare-t-il notam-
ment, s'est accentué encore davantage dans l'édification de
l'Etat, dans toute la vie politique, économique et culturelle
du pays ».
Quel est donc le nouveau rôle du Parti? Par quels artifices
sera-t-il rénové? A vouloir les définir on ne peut qu'être frappé
de l'indigence du programme. Le Parti doit être tout, mais il
n'a pas de fonction spécifique. Ainsi, il est entendu que les
cadres du Parti ne doivent pas séparer leur travail du travail
économique, qu'ils doivent « diriger concrètement », « en con-
naissance de cause », mais cette définition est aussitôt corrigée:
« cela ne signifie certes pas que les fonctions des organismes
du Parti doivent être confondues avec celles des organismes
économiques, ni que les organismes du Parti doivent se substi-
tuer aux organismes économiques. Cette situation aurait pour
effet d'effacer les responsabilités personnelles » (p. 345). Bref
le Parti doit diriger, tout en laissant la direction effective
aux intéressés, aux hommes chargés d'une fonction dans le
processus de production. Et il doit respecter l'autorité d'autrui
tout en la subordonnant à ses propres directives. K. ne tente
pas même de réfléchir sur cette « difficulté ». Il se contente
d'ajouter: « Il s'agit de faire en sorte que le travail du parti
soit axé sur l'organisation et sur l'éducation des masses, sur
l'amélioration de la gestion de l'économie, sur le développe-
ment continu de l'économie socialiste, sur l'élévation du bien-
être matériel du peuple soviétique, sur l'élévation de son niveau
culturel » (p. 345). Voila bien le verbiage durement reproché
aux petits bureaucrates, mais dont les gouvernants comptent,
apparemment, se réserver l'usage exclusif. Considérons cepen-
dant deux traits énoncés par K.: l'organisation et Péducation
des masses, l'amélioration de la gestion de l'économie. Dire
que le Parti doit organiser ne peut signifier qu'il doit répartir
les ouvriers dans l'entreprise en fonction des tâches produc-
tives: c'est l'oeuvre d'une catégorie de techniciens. Cela ne
saurait non plus vouloir dire qu'il leur fournit un cadre où
ils puissent émettre des suggestions sur la marche de leur
travail, la vie de l'entreprise ou bien des revendications indi-
viduelles ou collectives: ce cadre, le syndicat est censé le leur
offrir. Qu'organise donc le Parti? Faut-il reconnaître qu'il
n'organise rien, qu'il s'organise, qu'il est l'organisation en tant
que
telle? Il lui est en outre recommandé de faire l'éducation
des masses, mais maintenant qu'il doit oublier ses récits favoris
54
sur les populistes, les économistes et le Bund, maintenant
qu'il doit se détourner du passé pour aborder les problèmes
de l' « économie concrète », quel enseignement spécifique lui
est-il réservė? Les écoles techniques qui se multiplient sur le
territoire de l'URSS n'ont-elles pas la charge d'enseigner aux
masses les meilleures méthodes de travail? Quant à la tâche
d'améliorer la gestion de l'économie, elle risque d'amener au
militant les pires ennuis. Après l'interdiction notifiée de col-
lecter des renseignements et des statistiques « le plus souvent »
inutiles, l'objectif n'est rien moins que de connaître à fond
le secteur auquel on est rattaché; le militant est invité à de-
venir le double effectif du Directeur d'entreprise; mais sous
aucun prétexte il ne doit se substituer à lui. Double al restera
ombre. Et, ombre il lui est strictement interdit de jouer les
fantômes: les Directeurs sont devenus d'autant plus sensibles
qu'ils craignent les revenants. Bref le responsable de district
sent bien, après les sarcasmes de K. qu'il a perđu son âme.
« Tu tiens des réunions jusqu'au petit jour, pour rien, lui dit
en substance K.; tu galopes dans les kolkhoses bruyamment,
tu tiens des conférences pleines de lieux communs, pire, tes
conférences sont rédigées d'avance; tu prends des poses, tu
souscris des engagements solennels... Et, chez toi, poursui
Souslov, tu manies orgueilleusement tes dossiers intitulés
« Journaux muraux », Bulletins
»,
« Emulation dans
l'élevage », « Emulation dans l'agriculture », Les amis
des plantations forestières », Registre de travail du
propadandiste », « Les missions quotidiennes confiées aux
propagandistes »... Imbécile, dit K., tu as fait de ton mieux,
ce qui ne t'a pas empêché de rester planté comme un pieu.
Souslov achève: « quant à tes dossiers, ils n'ont pas fourni
de lait. Absolument stériles tes dossiers ». (19) Le Congrès rit
et applaudit, signale le procès-verbal. Cependant le Secrétaire
de district galope maintenant après son âme. Doublure il
l'était, mais le voici double de lui-même; il consacrera désor-
mais les nuits bureaucratiques dont on lui faisait reproche à
percer son énigme. Démarcheur de la spécialité universelle
auprès des masses ou bonimenteur de l'économie concrète, il
est invité à la fois à tout diriger, en connaissance de cause,
et à ne se faire point trop remarquer.
1
Toutefois comme la magie des mots n'est pas nécessaire-
ment efficace, K. évoque deux remèdes, dont le premier, for-
mulé à propos du bureaucratisme, en général, nous ramène
aux meilleurs jours de l'ère stalinienne: « Il est nécessaire
d'accorder une attention spéciale à la bonne organisation du
19. Nous paraphrasons deux passages des discours de K. et de
Souslov que nous avons déjà cités.
55
contrôle de l'exécution des décisions du Parti et du gouver-
nement. On aurait tort de croire qu'il ne s'agit de contrôler
que
les mauvais travailleurs. Il est nécessaire de contrôler aussi
le travail des honnêtes gens, car le contrôle c'est avant tout
l'ordie » (p. 335, nous soulignons). Le second remède est
incontestablement nouveau: l'émulation socaliste doit être
introduite au sein même du Parti. Entendons
que
le militant
doit faire l'objet d'un salaire au rendement, comme tout autre
travailleur. « Il faut juger l'activité du dirigeant du Parti
tout d'abord par les résultats obtenus dans le développement
de l'économie pour les succès desquels il est responsable... Il
apparaît nécessaire camarades, poursuit K., que nous élevions
aussi la responsabilité matérielle des dirigeants pour le tra-
vail matériel qui leur a été confié, que leur traitement dépende
dans une certaine mesure des résultats obtenus. Si le plan est
dépassé il touchera davantage; dans le cas contraire, son trai-
tement s'en ressentira » (pp. 347-8).
Nulle idée ne donne mieux la mesure du génie bureaucra-
tique, ni du chemin parcouru depuis la période héroïque des
premiers quinquennats. Le temps des porte-parole réalistes de
la bureaucratie, répétons-le, est décidément venu. La mysti-
que autrefois complément indispensable de l'inégalité sociale
et du stakhanovisme se voit étalée sur l'échelle vulgaire de la
vie productive.
is
Avec la critique du Parti et l'Etat, celle de la planifi
.
cation a dominé les Discours du XX° Congrès, quoique moins
explicitement. C'est qu'elle est imbriquée dans les autres
Comme nous l'avons noté, le problème fondamental des
rapports entre les républiques intéresse directement la struc-
ture de la planification. Tout en affirmant « la nécessité d'un
principe de planification centralisée » - et, de fait, ce prin-
cipe ne saurait être mis en cause sans que le soit le système
du capitalisme d'Etat dans son ensemble — K. reconnaît que
la centralisation doit être assouplie, qu'elle a engendré une
disparité inadmissible entre les républiques, que les problèmes
concrets du développement de leur économie respective a
jusqu'alors été négligé. Mais il est clair que les défauts d'une
centralisation excessive ne sont que la conséquence d'un mal
plus profond et moins facile à circonscrire par les dirigeants:
le bureaucratisme. B. note « Dans certaines branches de l'in-
dustrie, le potentiel des entreprises est loin d'être suffisam-
ment utilisé. Beaucoup d'usines atteignent leur plein rende-
ment avec une lenteur extrême, ne tirent pas bien parti de leur
équipement; les temps morts sont notables. Les ministères
industriels et les dirigeants d'entreprises ne prennent pas les
- 56
mesures qui s'imposent pour assurer le fonctionnement régu-
lier des usines, pour liquider les pertes de temps et améliorer
l'utilisation de la main-d'ouvre auxiliaire » (p. 152). Si de
tels vices sont encore à dénoncer, c'est que la bureaucratie
développe une inertie incompatible avec le progrès. Souslov
note, en ce sens, que les économistes ont en quelque sorte
élaboré la théorie de cette inertie en affirmant que le régime
socialiste ne se voyait pas imposer comme le régime capita-
liste l'exigence d'un rapide renouvellement de l'outillage (20).
Comment le bureaucratisme entrave-t-il matériellement le
fonctionnement de la planification? B. souligne justement que
le progrès ne dépend pas seulement de facteurs techniques
le développement de l'électrification, le perfectionnement de
l'outillage, l'utilisation rationnelle des matières premières — il
est lié à un facteur humain, au cadre d'ouvriers qualifiés, de
techniciens, d'ingénieurs et de savants. Or ces hommes ne
sont pas formés et répartis en fonction des tâches qu'ils ont
à remplir dans la production. « Si étrange que cela paraisse,
déclare K., la formation des spécialistes pour diverses bran-
ches de l'économie naticnale est déterminée jusqu'à présent
dans certains cas, non par les perspectives de développement
de ces branches, mais en grande partie par les requêtes injus-
tifiées et souvent changeantes présentées par les ministères
et les Administrations... Un autre défaut grave c'est qu'on
prépare les cadres pour l'industrie et l'agriculture sans tenir
compte des particularités de chaque zone du pays, de la
région, de l'entreprise où ils travailleront » (p. 328). La cri-
tique de K. atteint plus sévèrement la structure et le fonction-
nement des Instituts supérieurs qui assurent la formation des
spécialistes: « au point de vue de la quantité (des spécialistes
formés) nous pouvons être entièrement satisfaits, note K.,
mais nous devons accorder une sérieuse attention à la
formation des spécialistes. Un défaut grave c'est la liaison
insuffisante de l'école supérieure avec la pratique, ovec la pro-
duction. C'est le retard par rapport au niveau de la technique
moderne. Les jeunes ingénieurs et agronomes ne reçoivent pas
encore dans les établissements d'enseignemnt supérieur des
connaissances pratiques suffisantes en matière d'économie con-
crète et d'organisation de la production » (p. 326, nous sou-
lignons). Par ailleurs ces établissements sont mal répartis sur
20. « Le Parti, déclare SOUSLOV, a dû remettre dans le droit chemin
bien de ces piètres économistes qui prônaient le concept anti-marxiste
de la nécessité de freiner le rythme du développement de l'industrie
lourde. La négation par les économistes de la notion « d'usure morale »
de l'outillage en rgime socialiste équivalant à la justification de la
routine et du conservatisme dans le domaine technique nous a causé
beaucoup de tort». P. 24041.
57
le territoire, c'est-à-dire concentrés dans quelques très grandes
villes comme ils le sont dans les pays bourgeois et non
adaptés aux besoins des régions industrielles. K., B. et S.
ironisent sur le nombre des Instituts scientifiques réfugiés à
Moscou et absolument séparés des centres de productions aux-
quels est liée leur recherche. (21) D'une façon générale, les
dirigeants critiquent la mentalité des cadres des entreprises
béatement satisfaits des résultats obtenus, indifférents aux
progrès réalisés à l'étranger, exclusivement préoccupés de rem-
plir les normes officiellement fixées.
La passivité des bureaucrates, leur manque d'initiative et
leur obéissance servile à tous les échelons de la hiérarchie
atteignent enfin la planification en son coeur. De fait, celle-ci
ne peut être efficace que si elle est contrôlée; que s'il est pos-
sible de confronter constamment les moyens mis en oeuvre et
les buts visés. A cette seule condition peut s'opérer une adap-
tation courante des diverses branches aux branches connexes
dont elles dépendent cu qu'elles commandent (cette adapta-
tion se présentant comme une réadaptation constante et réci-
proque des besoins et des activités). Or, il s'avère que les
dirigeants des entreprises sont souvent beaucoup plus soucieux
d'afficher leur respect des consignes du Plan, – quitte à ne
pas réaliser les normes ou à ne les remplir que par des voies
prohibées, par des arrangements bureaucratiques privés
que de faire ressortir des difficultés suscitées par le Plan et
de stimuler ainsi son amélioration. K. note en ce sens: « Si
l'on examine comment tel ou tel région, district, kolkhose et
sovkhose s'acquitte de ses engagements socialistes, on s'aper-
cevra que les paroles ne correspondent pas aux actes. D'ail-
leurs vérifie-t-on en général ces engagements ? Non, le plus
souvent on ne le fait pas. Nul n'est responsable ni moralement,
21. « La répartition des Instituts de Recherches et des Stations
d’Essai ne tient pas compte des consitions économiques et naturelles.
Nombre d'Instituts de recherche et d'Ecoles supérieures sont éloignés des
centres de production correspondants. A Moscou, notamment, se trou.
vent trois établissements scientifiques d'études maritimes et océanogra.
phiques : l'Institut d'Hydrophysique, l'Institut d'Océanologie de l'Aca-
démie des Sciences de l'U.R.S.S. et l'Institut d'Océanographie des Services
Météorologiques, deux instituts de mines : celui de l'Académie des
Sciences de l'U.R.S.S. et celui du Ministère de l'Industrie houillère.
N'est-ce pas beaucoup pour la Mer de Moscou et les Monts aux moi-
neaux ? » Et encore : * On ne saurait tolérer l'absence de coordination
qui règne dans l'activité des établissements scientifiques de l'Académie
des Sciences, des Instituts de recherche affectés aux différentes branches
d'industrie et des établissements d'enseignement supérieur ». P. 328-329.
- 58
ni matériellement de l'inexécution des engagements. (22)
Dans un autre passage de son discours il révèle que les cadres
syndicaux sont surtout préoccupés de camoufler les difficultés
et les échecs de l'entreprise en vue d'afficher un conformisme
rassurant vis-à-vis de l'Appareil dirigeant: « On sait que les
entreprises concluent des contrats collectifs. Souvent ces
contrats ne sont pas exécutés mais les syndicats se taisent
comme si tout allait bien. En général il faut dire que les syn-
dicats ont cessé de discuter avec les dirigeants de l'économie
et qu'ils font excellent ménage avec eux ». K. ajoute: « Et ce
pendant dans l'intérêt de la cause il ne faut pas craindre
de gâter ces relations; une bonne discussion est parfois
utile » (p. 351).
La faille qui risque de s'introduire entre la planification
officielle et le fonctionnement réel de la production ressort en
dernier sur un point précis que K. et B. n'ont pas hésité à
mettre en évidence malgré ses implications essentielles. Comme
nous l'avons signalé, l'exécution du plan de productivité reste
très en deça des résultats obtenus dans la production; des
entreprises qui remplissent les normes à 200 0/0 sont loin
l'atteindre les objectifs fixés en matière de productivité. Or,
une telle disparité a pour origine, nous dit-on, au moins dans
une large mesure, l'anarchie qui règne dans le domaine des
salaires et des normes. « Il faut dire c'est K. qui parle
que l'on constate dans le système des salaires et des tarifs
beaucoup de désordre et de confusion. Les ministères, les
administrations et les syndicats ne se sont pas préoccupés
comme il convenait de ces questions et les ont délaissées. Il
arrive fréquemment que les salaires soient uniformisés. Mais il
arrive aussi que le mêrne travail dans différentes entreprises et
même dans le cadre d'une seule soit payé différemment. Paral-
lèlement aux travaux peu rémunérés, il existe une catégorie de
travailleurs dont la rémunération est inexplicablement exa-
gérée. Une importante tâche politique et économique se trouve
ainsi devant nous: réglementer la rémunération du travail »
(p. 318, nous soulignons). Ces remarques de K. ne font certes
que porter au grand jour une situation connue depuis long-
temps, mais sur laquelle le stalinisme a jeté le voile, d'autant
plus obstinément qu'il avait contribué sciemment à l'engen-
drer avec le stakhanovisme. Quelle est en effet la première
cause de l'incroyable désordre des salaires qui règne en
22. K. poursuit : « Il faut dire que notre presse et notre radio font
l'éloge de ceux qui contractent des engagements considérables, mais ne
disent rien quand ils échouent, bien que toutes les conditions existent
pour la mise en æuvre de ces engagements. Il faut inculquer aux gens
le sens de la responsabilité pour leurs enseignements >. P. 347.
59 -
un
URSS? Elle est, on le sait, d'ordre politique. Le Régime,
certes, a cherché à stimuler la production par l'action
exemplaire de travailleurs, mais il a surtout fabriqué »
dans les entreprises une couche sociale privilégiée, grâce à
laquelle il a assuré son pouvoir sur les masses. Cette couche
a joué en Russie un rôle analogue à celui qu'avait joué à
une époque l'aristocratie ouvrière dans le régime bourgeois.
Cependant la fonction « sociale » attribuée à cette couche a
très vite débordée sa fonction économique, au moins en deux
sens. D'une part, comme l'a noté très tôt Trotsky, le travail
de stakhanovistes risquait d'apporter une perturbation dans
processus où prédomine l'exigence d'une production
collective. D'autre part, et c'est ce qui retient à présent notre
attention, l'extrême diversité des salaires introduisait une
irrationalité imprévue dans la planification.
Il ne saurait en effet exister une planification réelle à
l'échelle de la société entière tant que le coût du travail socia-
lement nécessaire à telle ou telle catégorie de produits ne peut
être évalué. Dans la phase de maturité où est entrée la Bu-
reaucratie l'impératif qui légitimait la formation d'une aris-
tocratie ouvrière perd de son importance (sans pour autant
disparaître) tandis que la perturbation que celle-ci apporte
dans la production s'avère de plus en plus sensible. On
comprend donc toute la portée de la critique de K. Dénoncer
l'existence d'une catégorie de travailleurs « dont la rémuné-
ration est inexplicablement exagérée », c'est tenter de maî-
triser l'irrationalité qu'introduit la politique d'exploitation
au sein du processus économique.
On se leurrerait cependant si l'on pensait qu'une telle irra-
tionalité puisse être surmontée par des mesures de détail. Le
stalinisme n'a fait que l'accuser, il ne l'a pas engendrée. Il
est frappant qu'elle caractérise tous les systèmes d'exploita-
tion dans le monde contemporain. L'ouvrier américain, anglais
ou français n'est pas plus capable que l'ouvrier russe de
reconnaître les éléments exacts de son salaire sur son bulletin
de paye; le système de primes se superpose pareillement au
salaire de base (23) et engendre pareillement une disparité telle
que les individus accomplissant un même travail se voient
rétribués différemment. C'est que le Capital américain, anglais
ou russe se trouve confronté à une même exigence: stimuler,
par des artifices, la productivité. On comprend donc que K.
dans le passage où il critique une différenciation exagérée des
salaires dénonce systématiquement la tendance à l'uniformi-
23. « On ne saurait considérer comme normal, note B., que le salaire
de base des ouvriers ne représente que 40 à 60% de leur rémunération et
que dans certaines entreprises il soit encore moindre ». P. 165.
60
sation. Il n'est pas question en effet de reconnaître cette ten-
tance. L'admettre serait céder aux ouvriers. Ce serait leur
donner le pouvoir de contrôler la production, puisque le relè-
vement des normes risquerait alors de dépendre de leur con-
sentement collectif. De fait, l'individu sur lequel s'exerce la
pression du Capital n'est pas en mesure de décider du rythme
de son travail, il est prisonnier d'un système dans lequel
refuser la vitesse signifie soit s'exposer à une expulsion
du processus de production, soit tout au moins accepter une
perte de salaire. En revanche la collectivité, unifiée par
l'égalité du salaire a le pouvoir de confronter l'accroissement
des normes à l'évolution de sa rémunération, et de choisir; un
tel pouvoir de choix est incompatible avec l'autorité du
Capital.
Les nouveaux dirigeants russes peuvent bien éliminer une
irrationalité spécifiquement stalinienne mais leur rationalisa-
tion ne leur permet que de rétablir l'irrationalité « normale »
de la gestion capitaliste. La planification se heurte donc sur
ce point aux limites imposées par un mode d'exploitation qui,
en séparant le Capital et le Travail interdit une représentation
exacte du fonctionnement de la société. Non seulement elle
vise à satisfaire les intérêts d'une minorité sociale et elle
échappe au contrôle des masses, comme on l'a souvent dit,
mais elle ne peut se développer et maîtriser les forces produc-
tives de la société. Le coût réel de la production et donc les
fondements de sa propre puissance lui restent partiellement
dissimulés.
Encore devons-nous mettre en évidence la lutte ouvrière
que dévoile le désordre des salaires, et la tendance à l'unifor-
misation signalée par K. Cette tendance et la disparité du
salaire de base et du salaire réel dénoncée par B. traduisent
dans les deux cas la nécessité dans laquelle se trouvent les
dirigeants d'entreprises de composer evec le prolétariat.
Comme nous l'avons noté, les conditions de la production
moderne tendent à uniformiser les fonctions des ouvrers et les
mettent en mesure de s'opposer à la hiérarchie artificiellement
imposée par le patronat. Déjà, avant la guerre, la presse russe
se faisait l'écho, en ce sens, pour s'en indigner, de l'opposi-
tion d'un grand nombre d'ouvriers à l'introduction du stakha-
novisme. Elle relevait que dans des brigades de travail les
primes octroyées se trouvaient réparties par les intéressés selon
un principe égalitaire. Des faits du même ordre se trouvaient
récemment signalés en Allemagne orientale: il n'y a pas de
doute qu'ils n'ont cessé de se multiplier en URSS. Mais ce que
dévoile K. c'est que les dirigeants des entreprises sont obligés
61
dicéder partiellement à ce courant. Si les salaires sont « fré-
quemment » uniformisés, c'est que les dirigeants acquièrent à
prix la participation des ouvriers à la production. Malgré
les consignes étatiques, ils cèdent parce que les exigences
concrètes de la production ne leur permettent pas de s'opposer
de front à la résistance ouvrière.
Mais paradoxalement l'inflation des primes, engendrée
par le stalinisme en est venue elle-même à alimenter cette
résistance du prolétariat. Le salaire de base se trouve en effet
correspondre à des normes fictives, largement en deça du tra-
vail moyen de l'ouvrier et les primes qui s'y ajoutent sont
censées désigner un dépassement de ces normes. Le relèvement
des normes par
la direction est donc d'autant plus chèrement
payé, passé un certain niveau de production et toute accélé-
ration de la vitesse est explicitement présentée comme exploi-
tation supplémentaire. B. définit très exactement cette situation
et s'en indigne: « La fixation de normes réduites, et, par voie
de conséquence, leur dépassement notable est à l'origine d'une
apparence trompeuse de prospérité dans les entreprises et rend
ouvriers, personnel de maîtrise et ingénieurs moins attentifs
à une augmentation réelle de la productivité du travail. Au
fond les normes sont actuellement définies non par le niveau
technique et d'organisation du travail mais par le désir de les
adapter à un niveau de salaire déterminé » (p. 164, nous sou-
lignons). On ne saurait mieux dire que l'action du prolétariat..
contraint les chefs d'entreprises à subordonner les impératifs
de production à l'accord au moins tacite des ouvriers. On ne
saurait mieux faire entendre que la réorganisation des salaires,
préconisée devant le XX Congrès, vise à durcir l'attitude des
dirigeants, et à imposer un relèvement massif des normes.
Qu'il s'agisse de l'Etat, du Parti, ou de la planification,
les réformes avancées au XX° Congrès ont à nos yeux une
portée commune: elles visent à aménager le totalitarisme. Les
dirigeants dévoilent et combattent l'inertie de l'appareil
administratif, l'impotence du Parti, la dégénérescence de
l'idéologie, la centralisation excessive du Plan, les inégalités
criantes de salaire. Ce faisant, ils parviendront, ce n'est pas
douteux, à éliminer des abus. On ne songe pas à nier que cer-
taines mesures sont dans le cadre du système progressives;
telles sont celles qui préconisent une répartition plus judicieuse
des spécalistes, une réorganisation des instituts d'enseigne-
ments techniques et scientifiques ou bien encore la réforme des
ministères ou la refonte des salaires. On ne conteste pas
davantage que le relèvement du niveau de vie et l'élimination
de la terreur policière n'aient un effffet positif sur la vie
62
sociale. Il demeure que toutes ces réformes sont subordonnées
à un objectif essentiel: susciter une adhésion nouvelle au
régime, éveiller l'initiative créatrice de la population, stimuler
une « participation » active à la production. Or cet objectif
est, en dernier ressort, incompatible avec la structure du sys-
tème qui maintient une division radicale entre les classes
exploitées et la Bureaucratie, d'une part, et d'autre part im-
plique une subordination rigoureuse de tous les membres de la
société à l'Appareil d'Etat. En ce qui concerne le prolétariat
il est clair que toutes les concessions accordées par les Diri-
geants se heurtent au cadre imposé par l'exploitation. On
appelle les masses à entrer beaucoup plus largement dans le
Parti et à s'y exprimer, mais il va de soi qu'elles ne sauraient
contester la validité des règles officielles; le relèvement des
normes prêché par Boulganine est la condition de la partici-
pation; de même la différenciation des salaires est un prin-
cipe qui ne saurait être mis en cause. Kroushchev raille et
menace des « fanfarons incorrigibles » qui se sont mis en tête
d'appliquer dès maintenant une politique communiste (p. 343).
En d'autres termes les masses sont invitées à agir et à s'ex-
primer en toute liberté dans les limites du rôle que leur for-
gent les Dominants. Pas plus aujourd'hui qu'hier leur action
et leurs revendications propres ne sont reconnues. Mais à
l'échelle de la population entière le problème reste posé dans les
mêmes termes. Nous avons déjà noté que pour K. le fin mot
de la lutte contre le bureaucratisme est le contrôle de chacun,
des bons travailleurs comme des mauvais. Sans doute la prise
de conscience par chacun de ses responsabilités est-elle bien
nécessaire, mais le seul moyen pour l'Etat de s'assurer que les
individus ont une juste conscience de leur rôle est de ne pas
les quitter du regard. Comme le dit K., reprenant une formule
que ne désavouerait pas le conservatisme international: « le
contrôle c'est l'ordre. » Aussi après avoir souligné le rétablis-
sement de la légalité socialiste, le leader du Congrès n'hésite
pas à donner un avertissement sévère à tous ceux qui atten-
draient une diminution des pouvoirs de la Tchéka: le pays
est parsemé d'espions et de saboteurs et il convient tout au
contraire « de renforcer les organismes de la Sécurité d'Etat >>
(p. 336). Finalement l'on pourrait mettre en exergue de la nou-
velle politique cette formule que K. applique à la littérature
et à l'art: « le Parti a combattu et continuera de combattre
toute représentation non conforme à la réalité » (p. 357), étant
lentendu
que
la réalité selon K., c'est l'ordre bureaucratique.
De fait, pour avoir risqué de présenter une image en désac-
cord avec la représentation officielle de la réalité de nombreux
bléments se sont déjà, on le sait, fait durement rappelés à
l'ordre par la Pravda. Il n'est donc pas douteux que les oppo-
63
sitions soient étouffées ou réprimées aussi fermement que par
le passé: le régime ne les tolère pas.
Si l'on considère dans son ensemble la nouvelle politique
du XX' Congrès il faut ainsi reconnaître que la lébéralisation
du régime n'en offre qu'un seul aspect. Cette libéralisation est
elle-même un moyen pour aménager le totalitarisme, elle n'est
pas incompatible avec un renforcement de la discipline
bureaucratique dans le même temps, elle l'appelle au contraire
car en son absence elle risquerait d'atteindre la cohésion du
régime. Quiconque a lu le Discours de K. conviendra que tous
les moyens sont simultanément évoqués et la démocratie
et contrainte brutale pour faire face à la situation actuelle.
La crise de l'agriculture
Les problèmes posés par le développement de l'agriculture
révèlent au mieux le caractère des solutions de Kroushchev.
A les envisager sommairement, pour terminer, nous éclaire-
rons sous un nouveau jour les contradictions du totalitarisme
et les conditions concrètes qui ont déterminé la nouvelle orien-
tation politique.
La crise de l'agriculture a dominé les débats des orga-
nismes dirigeants depuis de nombreuses années. Aucun dis-
cours ne l'a évoquée devant le Congrès sans souligner son
caractère prioritaire. De fait, comment les diverses réformes
sociales pourraient-elles être efficaces si subsistait l'ancienne
disparité entre le développement de l'Agriculture et celui de
l'Industrie? K. signale par exemple qu'ne 1953 les cultures
céréalières n'étaient pas plus étendues qu'en 1913; la situation
de l'élevage était aussi retardataire. Pourtant, dès cette
époque, toutes les énergies avaient été mobilisées en direction
de l'agriculture. C'est en effet au lendemain de la guerre que
la crise atteignit son point culminant: la récolte des céréales
en 1946 ne représentait pas la moitié de son volume de 1940.
Les immenses destructions engendrées par la guerre la
réduction considérable du parc des machines agricoles la
surexploitation bureaucratique qui avait sévi durant la période
précédente avaient suscité des forces centrifuges dans l'éco-
nomie kolkhosienne (24). Le paysan réduisait au minimum
sa participation à la production collective et consacrait une
partie toujours plus importante de son temps à la culture de la
a parcelle » dont l'Etat l'avait laissé propriétaire. Malgré les
24. Nous renvoyons le lecteur à la très intéressante étude de PERE-
GRINUS : « Les Kolkhoses pendant la guerre », publiée par Socialisme
ou Barbarie, n° 4, oct.-nov. 1949.
64
mesures draconiennes prises en 1947 pour assurer le recou-
vrement des récoltes et pour élever les normes de rendement,
la production ne cessa de stagner. C'est en 1950 qu'une impor-
tante réforme tenta de transformer les conditions de l'expiati-
tation. Deutscher dit justement qu'on opéra alors une seconde
collectivisation (25). Tandis qu'au début de 1950 il existait
environ 250.000 fermes collectives d'une superficie moyenne de
400 hectares, il ne restait plus à la fin de l'année que 120.000
fermes d'une superficie de 1.000 hectares. Alors que les pre-
mières s'étaient développées dans le cadre de l'antique com-
munauté rurale, ces dernières constituaient des unités d'un
type nouveau. La Réforme en brisant les frontières de la com-
munauté traditionnelle visait à détruire l'indépendance du
kolkhose, a le soumettre plus directement à l'emprise di-
recte de l'Etat. Le débat politique dont quelques échos reten-
tirent dans la presse de cette époque révèle bien l'alternative à
laquelle la Direction cherchait à faire face. Ou bien il fallait
tenter d'intéresser les kolkhosiens à l'accroissement de la
production collective, en abaissant les taxes agricoles, en
fournissant en abondance et à bon marché des produits manu-
facturés, en relevant enfin les prix des produits agricoles. Ou
bien il fallait étatiser l'économie agricole, c'est-à-dire suppri-
mer les parcelles individuelles, abolir le marché et, en noyant
les anciens kolkhoses dans de nouvelles unités géantes, sou-
mettre les paysans à un contrôle rigoureux analogue à celui
que subissent les ouvriers dans l'industrie. Bref, ou il fallait
s'en remettre en la facilitant à une régulation naturelle, ou il
fallait imposer une réglementation autoritaire. On sait que
Kroushchev fut alors partisan de la seconde solution et qu'il
proposa en conséquence la construction d'agrovilles dans les-
quels seraient regroupés les paysans, arrachés à leurs anciennes
conditions d'existence.
Bien que les mesures préconisées par K. n'aient pas été
adoptées et qu'ait alors prévalu un compromis entre ces deux
tendances, le débat de 1950 éclaire singulièrement la politique
actuelle. En premier lieu on peut présumer raisonnablement
que la lutte entre les dirigeants, après la mort de Staline, fut
largement déterminée par la question agricole. Il n'est pas
invraisemblable de supposer que Malenkov — accusé, on s'en
souvient, d'avoir commis des fautes graves en matière d'agri-
culture ait été éliminé pour avoir recommandé des mesures
trop pacifiques à l'égard des kolkhosiens. En second lieu, il
apparaît que la politique sanctionnée par le XX® Congrès
reflète d'une manière nouvelle les deux préoccupations
précédentes.
25. Isaac DEUTSCHER : Heretics and Renegades, p. 122.
65
Apparemment K. a abandonné le projet des agrovilles.
Il préconise lui-même des mesures destinées à améliorer la
situation des kolkhosiens: les prix de stockage des céréales
et des produits de l'élevage ont été relevés, et les revenus des
kolkhosiens ont, dit-il, augmenté depuis deux ans de 20 mil-
liards de roubles. Mais c'est que sa réforme essentielle ne vise
plus les régions agricoles déjà exploitées. Un plan formidable
de mise en valeur des territoires de Sibérie et du Kazakhstan
a été élaboré. 28 à 30 millions d'hectares de terres vierges doi-
vent être défrichés en 1956; au moins autant l'ont déjà été
depuis 1953. 200.000 tracteurs et des milliers de machines et
d'instruments ont été envoyés dans ces régions. Or l'exploita-
tion sibérienne est directement impulsée par l'Etat; elle est
dans la ligne de la politique autoritaire recommandée par K.,
C'est une population nouvelle qui est importée dans les terri-
toires vierges. 350.000 travailleurs sont déjà partis, déclare
K.; et il ajoute: « Au cours du nouveau quinquennat le Parti
devra sans doute adresser plus d'une fois des appels sembla-
bles à la jeunesse » (p. 303). Les paysans de Sibérie seront
donc dans une large mesure des hommes nouveaux; ils ne
travailleront pas un sol auquel ils sont attachés depuis leur
enfance et que souvent leurs ancêtres ont labouré, ils ne seront
pas liés les uns aux autres par les liens qu'établit la longue
proximité dans le cadre du village, ils seront des individus
directement soumis à l'emprise étatique. N'est-ce pas dans
ces régions nouvelles que les agrovilles de K. pourront se
développer sans rencontrer l'opposition de populations enra:
cinées dans leur sol?
Le problème agricole tel que nous les révèle le débat de
1950 et la politique actuelle met met en lumière les difficultés
du Régime. Une fois de plus nous sommes en mesure d'aper-
cevoir le dilemne qu'affronte la Direction: susciter l'adhésion
des masses, en accordant d'importantes concessions, en rele-
vant le niveau de vie, en assouplissant les méthodes d'exploi-
tation; contrôler plus que jamais l'activité de chacun, imposer
et faire respecter à tous les échelons les consignes de l'Etat.
Mais ce dilemne revet, dans le cadre de la production agri-
cole, un aspect particulier. Le travail de la terre se dérobe
en effet, partiellement au contrôle de l’Appareil dirigeant. La
dispersion des producteurs, l'étendue des espaces qu'ils culti-
vent, le rythme du travail dont les résultats n'aparaissent que
de loin en loin au moment des récoltes, l'instabilité des
facteurs naturels dont dépend en dernier ressort le succès des
opérations, tendent à ruiner les procédés de contrôle et de
surveillance que facilite au contraire l'industrie (26). Dans de
26. Toutes ces remarques ont déjà été formulées par P. CHAULIEU
66 -
telles conditions, la coopération des producteurs s'avère indis-
pensable. Mais cette coopération n'est possible que si les
kolkhosiens ont conscience de bénéficier du système existant,
que si le service collectif qu'ils accomplissent leur apparaît
clairement indissociable de leur propre avantage personnel.
Dans la réalité ils ont au contraire conscience que les fruits
de leur travail sont accaparés par la Bureaucratie et cette
réflexion est quotidiennement confirmée par la présence et le
comportement de la bureaucratie locale qui s'épanouit à leurs
dépens. Ils résistent donc à l'exploitation, comme le font les
ouvriers dans l'industrie en limitant la production, mais dans
des conditions incomparablement plus favorables. L'Appareil
dirigeant ne peut pour sa part qu'osciller entre deux modes
de réponse. Ou bien il cherche à intéresser les kolkhosiens à
la production, il renonce, au moins partiellement aux méthodes
de coercition brutale, mais, comme ses exigences ne sauraient
se restreindre, il risque de voir les paysans profiter de ces
concessions pour se préoccuper davantage de leur parcelle et
se détourner de la production collective. Ou bien il renforce
son contrôle sur le travail, établit des normes sévères de ren-
dement, punit durement toute dérogation aux consignes du
Plan, multiplie à cette fin les appareils locaux de surveillance,
mais il exaspère l'opposition des paysans, rend plus sensibles
les exactions de la bureaucratie locale et ruine les chances d'une
coopération des producteurs. La période de l'avant-guerre
révèle déjà clairement cette oscillation. Après la collectivisa-
tion, une politique de concessions est pratiquée entre 1935 et
1938; après l'échec de cette tentative (appelée NEP des kol-
khoses) une législation sévère est de nouveau appliquée et le
travail forcé est légalisé et étendu. A chaque fois les mesures
prises engendrent de nouvelles difficultés dont témoigne la
stagnation de la production.
Les immenses progrès réalisés dans la mécanisation de
l'agriculture depuis quelques années ne peuvent qu'améliorer
ia situation agricole, mais les débats de 1950 et du XXe Con-
grès attestent que la crise ne peut être résolue par les seuls
facteurs techniques: elle est essentiellement sociale.
Dans cette perspective on peut à bon droit se demander
si les réformes préconisées par K. sont susceptibles de trans-
former les données du problème agricole. L'exploitation des
territoires vierges de Sibérie et du Kazakhstan ne constitue en
effet qu'un détour dans le processus des relations de la paysan-
ukrainien.
2
dans
l'article qu'il consacré à « L'exploitation des paysans
sous le capitalisme bureaucratique ». Socialisme ou Bærbarie, n° 4, oct.-
nov. 1949.
67
1
nerie et de la Bureaucratie. K. a renoncé à démanteler les
kolkhoses existants et à les refondre dans de nouvelles unités
sous le contrôle de l'Etat; sans préjuger de l'efficacité de
cette réforme, faut avouer qu'elle aurait sans doute suscité
une formidable opposition dans une période où la liquidation
du stalinisme apportait àtous les signes d'un climat nouveau
de paix sociale. Mais en l'absence de cette solution de force
aucune mesure positive ne paraît intervenir dans le cadre des
régions déjà exploitées. La Direction se propose plutôt
d'appliquer les méthodes étatiques dans un cadre neuf ou l'on
pourra faire surgir les agrovilles ex nihilo. Mais dans ce but
elle est amenée, dès le début, à imposer à certaines catégories
de la société un travail forcé: des centaines de milliers
d'hommes sont et seront envoyés dans de lointains territoires,
où les conditions de vie et le climat sont particulièrement
arides, pour construire une nouvelle agriculture. Que ceux-ci
soient salués par K. « travailleurs d'élite » et « dignes bâtis-
seurs du communisme » ne saurait dissimuler qu'il s'agit d'une
sinistre déportation analogue à celles qui ont eu lieu pendant
l'ère stalinienne. Au reste, la Pravda admoneste déjà la jeu-
nesse qui méconnaît les bienfaits du travail forcé et cherche
à se dérober à ses nouveaux devoirs. En outre, la mise en
valeur de la Sibérie peut-elle ne pas réengendrer les difficultés
rencontrées sur les anciens territoires? Si comme nous l'ensei-
gnent les vicissitudes de l'histoire de l'Agriculture depuis la
collectivisation, la résistance paysanne découle au plus pro-
fond de l'exploitation bureaucratique et se développe « natu-
rellement » grâce aux conditions propres du travail agricole
l'avenir sibérien ne peut que reproduire les difficultés du passé
CONCLUSION
Crise ou stabilisation? On aimerait pouvoir désigner par
une formule simple la période inaugurée par le XX° Congrès.
Mais toute notre analyse récuse un mode de définition qui
prétend résumer la connaissance de l'URSS dans une courbe
de santé.
Il n'est pas contestable que d'immenses progrès techni-
ques ont été réalisés en URSS depuis la guerre. Et, pour avoir
souligné les difficultés du régime nous avons fourni une
image nécessairement incomplète de l'évolution. Il est de fait
que les destructions engendrées par la guerre ont été comblées
en un temps record, que les prévisions les plus optimistes ont
été rapidement dépassées par le rythme de la reconstruction,
que l'URSS se situe aujourd'hui dans certains domaines à
68
un niveau très supérieur à celui de l'avant-guerre. Sans aucun
doute, le formidable progrès technologique qui s'est produit,
dans le monde entier, à la suite de la guerre a été un facteur
décisif dans la reconstruction. Le fait que la France, malgré
la crise sociale et politique permanente qu'elle entretient et
les traits archaïques de son appareil économique, ait été capa-
ble de rejoindre assez rapidement son niveau de production
de 1939 atteste assez cette accélération générale du progrès
technique; celle-ci a déterminé partout un essor sans précé-
dent de la productivité et a fourni un champ de possibilités
imprévu. Il n'en reste pas moins que les différents pays n'ont
bénéficié de ce progrès qu'en raison de leur structure propre.
Le capitalisme d'Etat en URSS et la planification qu'il impli-
que se sont avérés capables, du moins à un certain niveau de
développement des forces productives, d'utiliser plus effica-
cement que le capital privé les ressources offertes par la
technique (27). Dans ce cadre, nous l'avons amplement sou-
ligné, s'est opérée une transformation des forces sociales en
présence, un épanouissement de la Bureaucratie et un essor de
la classe ouvrière que son nombre et sa culture désignent main-
tenant comme un grand prolétariat moderne; les réformes
politiques récentes sont venues sanctionner cette évolution,
répondre aux conditions nouvelles créées par la maturité de
la société.
Mais ce que nous avons tenté de montrer c'est qu'en raison
même de ce changement — de l'expansion économique et de
l'affermissement des classes – de nouveaux problèmes sont
nés qui rendent le fonctionnement des institutions plus pré-
caires, qui compliquent les relations entre les dominants et
davantage encore les relations entre dominants et exploités.
Ces problèmes tiennent à l'essence du totalitarisme, mais tout
autant à l'essence de système d'exploitation moderne. En fait
ils composent les expressions diverses d'une contradiction
fondamentale, car le totalitarisme n'est pas une forme acci-
dentelle qui viendrait s'ajouter à la structure sociale capita-
liste; il en est à nos yeux la forme achevée.
Pour mieux dire, le capitalisme bureaucratique n'a éliminé
certains vices du capitaliste bourgeois que pour réintroduire
27. Il est douteux qu'une comparaison objective des mérites respec-
tifs des régimes économiques de l’U.R.S.S. et des U.S.A. soit possible.
Si l’U.R.S.S. témoigne dans la période récente d'un développement ful.
gurant, il reste qu'elle bénéficie, d'une part, de l'étendue des territoires
inexploités dont elle dispose, d'autre part, et surtout, de son retard
par rapport aux U.S.A. Au lieu d'avoir à passer par les étapes que par.
court le capitalisme bourgeois, elle utilise les dernières découvertes tech.
nologiques du pays le plus avancé..
69
une autre série de vices qui témoignent de la contradiction
permanente de la société d'exploitation et la dénoncent avec
une force accrue à tous les niveaux de la vie sociale. Par
exemple, la planification a permis de supprimer un certain
type d'anarchie dans la production et la concurrence aveugle
des intérêts privés, mais elle a réengendré un nouveau mode
de rivalité entre les bureaucrates, une inertie des cadres diri-
geants; elle s'est réduit à une coordination superficielle des
branches d'activité, à une détermination globale du niveau
de la production, elle s'est révélée incapable de mesurer les
efforts de la collectivité à la dépense réelle du travail humain
et a interdit en conséquence de contrôler son fonctionnement
concret. Elle propose un modèle d'intégration de la production
et de participation sociale, inconſues dans les autres sociétés,
mais elle est condamriée à le contređire pour maintenir la
domination du Capital sur le Travail. Par ailleurs, l'idéologie
totalitaire possède une efficacité nouvelle; elle rend l'individu.
sensible, dans chaque domaine d'activité, aux impératifs de
la société entière et de son avenir historique, mais elle le prive
en même temps de toutes possibilité d'adhésion réelle à ces
impératifs en imposant, par contrainte la Norme de l’Appa-
reil dominant. En regard des idéologies bourgeoises, elle est
en un certain sens progressive puisqu'elle vise l'ouvrier en tant
qu'être social et non, comme dans le cadre de l'industrie amé-
ricaine en tant qu'individu parmi d'autres. Mais, ce faisant,
elle développe, en le reconnaissant, un besoin social qui se
heurte plus fortement qu'en tout autre cadre aux besoins
particuliers de l'exploiteur. Bref tous les efforts que déploie
l'Etat totalitaire pour assurer un fonctionnement harmonieux
de la société, pour susciter la créativité des hommes se retour-
nent contre lui, engendrent un péril parce qu'ils font dépendre
toujours davantage de l'accord des producteurs l'effiacité des
règles de l'Appareil dirigeant. Mais le paradoxe est qu'il ne
peut se priver de ces efforts. Tout au contraire, l'évolution
de la production la recherche d'une productivité accrue dans
tous les secteurs, le contraignent de plus en plus à obtenir la
participation des honımes à la planification. Déchiré entre
cette exigence et celle d'une Direction autoritaire, le régime est
alors condamné à susciter la critique de ses propres méthodes,
à dénoncer les principes de son fonctionnement. Ainsi le voit-
on se débattre dans un interminable procès: la Bureaucratie
s'accuse de bureaucratisme, combat les méfaits de la centra-
lisation, juge le Parti séparé de la vie productive, incapable
qu'elle est de reconnaître dans le développement concret de
ses activités le reflet fidèle de sa propre nature. C'est dire que
le régime, plus que tout autre, rend possible une expérience
révolutionnaire des masses, fondée sur la critique interne du
totalitarisme.
70 -
Le retour au leninisme prêché par Kroushchev offre peut-
être le meilleur exemple de ce développement paradoxal. Il
introduit à première vue une note discordante dans le langage
réaliste des nouveaux Dirigeants. Ceux-ci, nous avons insisté
sur ce point, dénoncent la « mystification » du passé dont le
Parti faisait sa principale activité; ils engagent les militants
à se tourner résolument vers les problèmes que pose la marche
de la production dans le présent; au surplus, ils critiquent si
sévèrement le fonctionnement du Parti que celui-ci ne semble
plus chargé d'aucune tâche spécifique dans la société. Alors
qu'aux yeux de Lénine, le Parti préfigurait en quelque sorte
la Société communiste à venir, qu'il dépassait la lutte écono-
mique subsistant dans la période post-révolutionnaire, il est
maintenant considéré comme un groupe parmi les autres,
aligné sur le barême capitaliste de la productivité, dont les
militants sont rémunérés en proportion du rendement de leur
travail. Mais le langage réaliste ne peut suffire. L'appel à
la coopération des masses exige un nouveau mode d'idéalı-
sation de la réalité, que peut offrir la participation au Parti
et le mythe rénové de is. Révolution. Symbole de la démocratie
révolutionnaire, Lénine se trouve investi d'un pouvoir neuf;
sa légende doit cristalliser l'action collective, susciter une
houvelle adhésion à la tâche commune, promouvoir un mili-
tantisme enthousiaste analogue à celui qui dans le passé permit
de soulever les montagnes (28). Ainsi, dans le temps même où
a
28. Ce paradoxe échappe complètement à nos intellectuels progres-
sistes. K. parle-t-il d'un retour au leninisme ? C'est donc qu'on y revient.
BARTRE approuve. Il se rengorge même. « Le XXe Congrès du P. C. de
l'U.R.S.S. lit-on dans Les Temps Modernes de mai 1956, p. 1619
marqué la fin de l'époque stalinienne et le retour du communisme à ses
principes. Il justifie tous ceux qui comme nous, sans rien tolérer des
déviations du stalinisme, refusaient de rompre avec l'U.R.S.S. et le mou-
Sement communiste ».
Décidément l'imbécillité aux allures tranquilles est rarement exempte
de jésuitisme. Dans le XX® Congrès, le progressiste pourrait au moins
percevoir quelques questions. Point. «Il a marqué la fin de l'époque
stalinienne », nous dit-il avec le sens sociologique aigu qui le caractérise,
et, n'est-ce pas tout un, « le retour du communisme a ses principes ».
Ruel retour ? On mangera mieux en U.R.S.S. (et d'ailleurs pour long-
emps encore moins qu'en un pays capitaliste moyen) ; les classes aisées
yont acquérir plus largement voitures, frigidaires et télévisions (dont
jouit depuis longtemps la bourgeoisie) ; certains droits démocratiques
seront dorénavant respectés (dans les limites restreintes que nous avons
soulignées) ; la police ne tiendra plus le citoyen à sa merci (bien que
les services de la Tchéka soient renforcés) ; un accusé pourra choisir
librement son avocat (mais ses droits exacts sont encore à définir) ; ces
progrès sont incontestablement importants. Mais s'ils témoignaient d'un
principe communiste, il faudrait tout simplement conclure que le régime
communiste est encore loin en deça du régime bourgeois. Par ailleurs,
l'abandon de plus en plus explicite d'une perspective révolutionnaire à
l'échelle mondiale et l'idéal d'une société hiérarchisée clairement affirmé
71
la Bureaucratie s'efforce de consolider ses conquêtes, de dé-
finiri sen termes neufs ses objectifs de classe, elle est encore
contrainte de se placer sous le signe de la Révolution, d'invo-
quer celui qui incarna la lutte contre l'exploitation et contre
l'Etati despotique. Elle doit se dénoncer elle-même et déve-
lopper contre elle, par le mythe, une formidable puissance
critique.
Ces contradictions ne signifient pas que le Totalitarisme
en URSS soit nécessairement inviable. Des artifices comme
ceux qu'improvise la Direction du XX° Congrès permettent
précisément de masquer les incompatibilités, de changer les
termes des problèmes affrontés, d'assurer la vie et le déve-
loppement du système. Ce qu'il faut toutefois reconnaître c'est
que ce système ne peut vivre que dans la contradiction, que
centré en permanence sur le débat social. L'URSS, disions-
nous en commençant ne peut plus apparaître comme un monde
à part, elle présente une figure particulière du capitalisme.
Nous pouvons ajouter maintenant que les traits qui la singu-
larisent sont aussi ceux qui l'exposent plus que tout autre pays
à la critique et à l'action des masses.
Claude LEFORT.
dénoncent une rupture avec le leninisme plus complète qu'elle ne le
fût du temps de Staline, i toujours préoccupé de dissimuler son nouveau
visage sous les traits de l'idéologie révolutionnaire.
Mais de cette rupture le progressiste des Temps Modernes n'a cure.
Il a décidé une fois pour toutes qu'il fallait en U.R.S.S. croire, les gens
sur: parolei -Il eroit: dono K. avec ila même persévérance qu'il ne croit
pas, Eisenhower. On c'est ici que l'imbécillité fait place au jésuitisme.
Les . Feńps Modernés në/peuvent se contenter d'approuver K., ils leur
faut inbinuer qu'ils pensaient la veille ce que celui-ci a proclamé le
lendemain. Ka justifie «tous ceux qui sans rien tolérer des déviations
du stalinisme refusaient. de rompre avec l’U.R.S.S. et le mouvement
communiste ». Quelle belle enseigne pour la Revue, en vérité : Sartre ou
les Récompenses de la vertu ! Le communisme rejoint notre philosophe
qui l'avait heureusement attendu sur le terrain du leninisme sans rien
tolérer de ses écarts. Mais: si - le lecteur se demande comment s'est
manifestée i cette intolérance, s'il recherche les textes dans lesquels
Sartre aurait pu glisser depuiši) 1953 : une critique de la déviation stali-
nienne, que découvrira-t-il ? Rien. Le régime de l'U.R.S.S. a été propre-
ment « néantisé », déviations.comprises... En revanche, le lecteur trouvera
un article de Marcel Pejus qüia ile mérite de juger invraisemblable
l'accusation montée contre Slánisky mais qui s'emploie surtout à démon-
trer que celui-ci s'est fait le complice valontaire de son procès. Depuis
Ki a expliqué autrement la technique des ayeux : « battre, battre, encore
battre ». Sans attendre une autocritique de Peju sur ce point, on s'étonne
de l'insolente hypocrisie avec laquelle: ları rédaction des Temps Modernes
se fabrique après coup de faux titres de résistance anti-stalinienne, alors
qu'elle s'est distinguée depuis trois ans par sa parfaite platitude l'égard
de la politique communiste 1:
2. Da silence igêné de la veille sur le régime de IU.R.S.S. à l'appro-
bation maise de Khrouchtchev, chacun jugera da chemin parcouru dans
Havibissement.in. odota
72
Journal d'un ouvrier
(MAI 1956 CHEZ RENAULT)
Un ouvrier de chez Renault nous adresse le manuscrit que
nous publions ci-dessous.
1
Le matin vers 10 heures J. fut appelé au bureau. On lui
téléphonait pour le prévenir qu'il était rappelé pour le len-
demain. Il devait se présenter à 7 heures du matin à la
caserne. Nous savions tous que J. serait rappelé très prochai-
nement, lui-même s'était préparé à partir, mais ce coup de
téléphone nous surprit tout de même. C'était vrai, tout ce que
nous avions pu dire sur son départ se concrétisait, et nous
étions étonnés de la correspondance qu'il pouvait y avoir entre
les écrits, les paroles et la réalité. J. partait, et après lui, d'au-
tres, pour on ne sait combien de temps. Peut-être J. ne revien-
drait-il jamais ? L'appel des disponibles ne commençait vrai-
ment pour nous qu'à partir du coup de téléphone qui nous
enlevait notre camarade. Nous plaisantions souvent J., mais
aujourd'hui nous étions consternés, et nous nous demandions
que faire pour éviter ce départ. Que faire, pour retenir J.
parmi nous, ou du moins pour manifester notre indignation
et notre solidarité? Le « que faire » devenait tout à coup la
préoccupation essentielle de tous. Toutes les réponses que
nous pouvions donner à cette question restaient dans le condi-
tionnel. Elles commençaient toutes par: « il faudrait que...
si tous les gars... si les syndicats... »
Quant à nous, que pouvions-nous faire, les 180 de l'ate-
lier ? 180 pour s'opposer à une décision gouvernementale, pour
s'opposer à un gouvernement soutenu par l'ensemble des
députés, des députés élus par la nation, 180 devant un édi-
fice de lois, devant ine constitution, devant une police, une
armée et une nation de plus de 40 millions d'habitants qui
restait pour nous un point d'interrogation. Y avait-il ailleurs
d'autres ouvriers mécontents ? D'autres ouvriers qui, eux aussi,
se sentaient isolés, impuissants, mais qui seraient prêts à faire
quelque chose ? Oui, ils devaient exister, ces autres, nous en
étion's persuadés, mais où les trouver ? Comment les contacter?
73
Comment s'adresser à eux? Rien que pour aller d'un atelier à
un autre cela suppose des tas de difficultés. Comment
s'adresser aux autres ouvriers qui travaillent? Dès que l'agi-
tation a commencé, dès que des groupes se sont formés, la
maîtrise est sortie de son repaire vitré; les « blouses » passent,
repassent, nous regardent à la dérobée. Nos discussicns les
inquiètent, ils se montrent, pour que nous cessions, pour que
nous reprenions le travail. Mais leur passage n'a aucun effet.
Le contremaître n'ose pas intervenir, nous nous observons
comme dans une corrida. Lui est en train d'évaluer en silence
notre mécontentement. Nous devons avoir l'air assez décidés,
car il n'ose pas intervenir. La tactique de la maîtrise est main-
tenant arrêtée; elle n'interviendra pas, de peur d'envenimer
les choses, mais elle se manifestera par sa présence, pour
intimider les plus faibles. Elle surveillera les va-et-vient, les
groupes de discussions, comme un paysan qui interroge le
ciel avant la tempête.
A qui s'adresser? A côté de nous il y a les syndicats; il
y a dans tous les ateliers des syndiqués, des responsables syn-
dicaux, des délégués qui peuvent se déplacer. Eux peuvent,
en quelques minutes, s'adresser à tous les ouvriers de l'usine.
Dans le même moment, ils peuvent s'exprimer, non seulement
dans 30 ou 50 ateliers, mais ils peuvent exprimer la même
idée dans toutes les usines, et dans toute la France. Mais eux
ne disent rien, ils s'ır: dignent quand nous nous indignons.
Lorsque l'un de nous dit: « Il faut faire quelque chose », le
responsable syndical lui répète comme un écho: « il faut faire
quelque chose ».
Et lorsque l'un de nous dit au syndicat: « Et vous, qu'est-
ce que vous faites? » Le syndicat répond: « Nous ferons ce
que vous ferez, nous vous suivrons. »
Nous voici donc, nous, quelques ouvriers de cet atelier,
avec la possibilité de promouvoir un mouvement. Mais si on
nous laisse cette possibilité, on nous laisse aussi sans aucun
moyen. Les moyens du syndicat, du Parti communiste, ne
sont pas à notre disposition. Nous ne pouvons pas nous servir
de leur appareil, de leurs liaisons. On nous dit: « Vous êtes
majeurs ». Mais notre majorité nous surprend, comme si nous
avions grandi trop vite. Comme si rien ne s'était passé depuis
le temps où nous n'étions que des ouvriers inconscients de
nos intérêts, le temps où pour faire un pas il fallait un mot
d'ordre du syndicat, le temps où nous n'avions comme choix
que de suivre le mot d'ordre de grève du syndicat, ou de
passer pour un jaune.
Mon camarade M. qui travaille à côté de J. emploie tout
son dynamisme pour agiter les autres ouvriers. Il revient
chaque fois plus découragé, et en même temps plus décidé. Il
va voir les responsables syndicaux à leur machine, les cama-
74
rades du Parti, puis il va voir les autres ouvriers: « Il faut
faire quelque chose; nous n'allons pas laisser partir J. sans
rien faire; nous n'allons pas nous conduire comme des
salauds. »
« Oui, d'accord, mais à nous seuls nous ne changerons
rien
»), telle est la réponse, qui est d'autant plus cruelle qu'elle
est vraie. A nous seuls, nous ne changerons rien, il faudrait
tous s'y mettre. C'est l'argumentation du bon sens. C'est
l'argument de la majorité des ouvriers. L'argument des res-
ponsables syndicaux et du Parti est tout autre. Eux préten-
dent qu'une petite grève est suffisante pour montrer l'exemple,
pour faire boule de neige. Il suffit de faire un mouvement
NOUS, et petit à petit, comme ça, dans toute l'usine, dans
tout le pays, les mouvements iront en s'accentuant. C'est
comme ça que l'on eripêchera le rappel des disponibles. Un
autre membre du syndicat nous répond: « D'ailleurs, il n'est
pas dit que la grève soit le meilleur moyen de s'opposer au
rappel. » M. éclate. Et quel autre moyen y a-t-il ? Les péti-
tions peut-être ? Nous ne changerons rien si on ne se bagarre
pas. M. est traité ironiquement d'esprit « Nanar » (anar-
chiste) par ses anciens camarades. M. est syndiqué, M. à tou-
jours suivi le syndicat et le Parti. Aujourd'hui son dynamisme
et ses initiatives le font condamner par ceux qui suivent doci-
lement l'organisation.
Nous tournons en rond. Oui, il faudrait tous s'y mettre,
mais ni les syndicats, ni le Parti communiste ne le souhaitent,
alors nous nous apercevons de notre faiblesse, sans organisa-
tion et sans moyens.
Nous discutons encore longtemps; le travail est pratique-
ment interrompu autour de la machine de J. depuis le coup de
téléphone. Nous pensons qu'il faut faire quelque chose de
symbolique.
Une petite grève, aussi petite soit-elle, mais quelque chose
qui sera un espèce de salut à J., un témoignage de notre soli-
darité. Les responsables du syndicat C.G.T. et du Parti com-
muniste, qui étaient restés à leur machine, sont en train de
discuter entre eux. Tout d'un coup ils viennent; l'u d'eux
s'adresse à nous: « Nous sommes d'accord pour un débrayage
demi-heure de grève par exemple êtes-vous
d'accord ? »
Nous retenons notre colère à leur égard, nous savons que
s'ils peuvent saboter le mouvement, ils peuvent aussi par leur
appui décider les hésitants. Leur appui est décisif. Si nous les
engueulons il n'y aura pas de grève. Ceux qui ne savent que
faire, profiteront de nos discordes pour ne pas débrayer.
Le va-et-vient de la maîtrise nous décide à nous taire et
à débrayer. Nous devons choisir nos ennemis: le syndicat, ou
les autorités officielles. La blouse blanche est l'ennemi tradi-
une
75
tionnel et quotidien, la grève était le but. Alors les respon-
sables syndicaux et les militants du P.C. se mettent à faire
leur agitation, ils se décident enfin à aller de machine en
machine, en présentant la grève d'une demi-heure, et la péti-
tion, comme le plus sûr moyen d'arrêter la guerre. Leur entrée
en action nous écoeure un peu, ils vont passer ainsi
pour
les
grands défenseurs de la paix en Algérie.
B. ne cesse de s'engueuler avec ses anciens camarades; il
se rend compte de la supercherie, il refusera de faire grève, et
ne tolèrera pas qu'un communiste vienne le lui reprocher.
Notre haine envers le gouvernement et la guerre d'Algé-
rie n'est pas à la mesure de cette grève, ce que nous voudrions,
du moins quelques-uns d'entre nous, c'est faire une démons-
tration qui soit vraiment à l'échelle de notre rancoeur: mani-
festations dans la rue, grands débrayages, bagarres...
Non, il faudra encore contenir cette haine. Jusqu'à
quand ?
Les responsables C.G.T. et communistes se pavanent et
gonflent cette demi-heure de grève comme si nous avions fait
un acte réellement héroïque. Nous sommes dépités. Même
comme hommage à J., nous le sentons misérable. Et puis
il y a toujours le revers de la médaille: il y a ceux qui ont
refusé de faire grève; il y a ceux qui se sont laissés. intimider
par la maîtrise; il y a ceux qui ont fait semblant de travailler
devant les chefs et semblant de faire grève devant les gré-
vistes; il y a ceux qui se font passer pour des héros parce
qu'ils ont débrayé pendant une demi-heure et parmi ceux-là
il y a les communistes. Il y a aussi la minorité des syndiqués
F.O. qui, à part une ou deux exceptions, ont continué leur
tradition de jaunes. Ils n'ont pas fait grève car ils sont
opposés au principe cic la grève; c'est sur cette base qu'ils se
sont regroupés autour de F.O.
Ainsi nous nous sommes retrouvés dans l'allée centrale
une bonne majorité de grévistes; nous sommes restés pendant
une demi-heure à la fois vainqueurs et vaincus, à la fois heu-
reux de nous libérer de notre mécontentement et à la fois
comme des misérables qu'une demi-heure de grève ne peut
pas satisfaire.
Non, un tel, un tel, un autre et puis un autre ne pour-
ront pas satisfaire leur haine pendant cette démonstration;
seuls peut-être les « robots » du parti et du syndicat iront
glaner des louanges à leur organisation pour avoir su faire
quelque chose qui se trouve dans la bonne ligne, c'est-à-dire
quelque chose qui ne puisse pas mettre trop en cause la poli-
tique de soutien du Gouvernement.
« Ils se moquent tous de nous », disent beaucoup d'entre
nous. Qui tous? Tous les responsables, tous les députés.
Mais ce sont ces mêmes députés que vous avez élus,
76
non? Pourquoi les avez-vous élus alors ?
On espérait... Eh bien, oui, en espérait. Au moindre
petit espoir on se raccroche. On vote sans y croire, mais on
vote. On fait cela avec le même esprit que le mourant qui,
malgré son athéisme, veut bien recevoir les derniers sacre-
ments. Après tout, qu'est-ce qu'on risque ?
Un bon gros qui vient de dire qu'il faudrait se battre
ajoute: il faut être révolutionnaire. Lui qui pourtant, ne ferait
rien qui le distingue de ses camarades d'atelier, serait-il
devenu assoiffé de sang?
Je surprends des sourires -- « il est une bonne pâte ».
Oui, mais il se libère avec des mots. D'autres prévoient tous
les détails de leur verigeance; là ce sont encore des mots, des
excès d'imagination. Mais pourquoi ces mots, ces images
sanglantes ? C'est la façon d'étancher sa haine, la façon la
plus facile, la plus gratuite.
Un tract a été distribué place Nationale. Un comité s'est
créé il s'appelle « Comité d'Entente pour le cessez le feu en
Algérie ». Des meetings sont organisés contre le colonialisme
par celui-ci. Les discours contre le colonialisme laissent froids.
Nous savons tout ce qu'on nous dit, mais que faire contre
la guerre?
La conclusion de ces discours: « Pour arrêter la guerre,
signez des pétitions.
On se met en colère, dans mon atelier. Je propose qu'on
essaye de parler dans un de ces meetings, pour donner notre
opinion.
- « Qui parlera ? »
« Je parlerai, mais venez me soutenir. »
On y va. Nous demandons la parole mais en vain. On
nous promet enfin, que nous pourrons nous exprimer le len-
demain, dans la salle du comité d'entreprise.
Je rédige mon intervention, que je soumets à mes cama-
rades. Certaines phrases sont modifiées après discussion, puis
on se fait passer le papier. Ceux qui sont d'accord avec le
texte de l'intervention signent pour que je puisse parler au
groupe
d'ouvriers.
Voici le texte de cette intervention:
nom d'un
Nous devons dénoncer les colonialistes qui sont responsa-
bles des massacies en Algérie. Mais se contenter de cela n'est
pas suffisant et ne peut avoir aucune répercussion. Nous de-
vons faire plus. Nous devons dénoncer leurs valets, ceux qui
les défendent, car si nous ne faisons pas cela, nous entretien-
drons la confusion qui règne chez les ouvriers.
77
-
Les colonialistes sont défendus aujourd'hui par un Gou-
vernement soutenu par une large majorité de députés dont une
partie a la confiance de la classe ouvrière. C'est pour cela
d'ailleurs qu'il est plus facile à ce Gouvernement, qui béné-
ficie de la confiance des ouvriers, de faire la sale ibesogne
des colonialistes.
C'est sur le programme de paix en Algérie que se sont
présentés les partis de gauche aux élections.
C'est sur le programme de paix en Algérie que le Gou-
vernement s'est présenté à l'Assemblée Nationale...
Et c'est sur le programme de GUERRE EN ALGERIE
que le Gouvernement fonde sa politique.
Le Gouvernement a ainsi profité de la confiance des ou-
vriers pour les trahîr et faire le contraire de ce qu'il promettait.
L'arrêt de la guerre ne peut donc pas venir de ces traitres et
de ces menteurs.
Sans condamner les petites actions exemplaires, nous pen-
sons que pour l'arrêt de la guerre en Algérie, il faut lancer
des actions générales et coordonnées. L'arrêt de la guerre en
Algérie ne peut pas être remis entre les mains du Gouverne-
ment. Il faut le forcer. C'est pourquoi nous condamnons ce
système d'action qui consiste à envoyer des pétitions à ces
mêmes traitres, à continuer à leur faire confiance, à larmoyer
parce qu'ils nous enlèvent des jeunes pour les faire massacret.
Ce n'est pas par des pétitions larmoyantes, mais par des
actions énergiques que nous dirons au Gouvernement:
Non, vous n'avez pas la confiance des ouvriers !
Non, nous ne vous croyons plus!
Vous nous avez trahis... eh bien! nous lutterons contre
vous car vous êtes les suppôts des colonialistes et les fos-
soyeurs de la jeunesse!
Nous devons nous adresser à tous les ouvriers de toute la
France pour un appel et leur proposer un débrayage général
contre la guerre, contre le rappel des disponibles. Des dé-
brayages de lutte et non pas des pétitions de confiance.
Ch. n'aime pas les histoires. Il dit: « Tu vas mettre le
bordel avec ton intervention. »
C'est vrai, la pagaïe ne tarde pas. Les durs du syndicat
et du Parti sont furieux, car ils sont obligés de ne pas signer,
et les militants qui ne sont pas ou qui ne sont plus des
durs, signent et font signer.
Des groupes se forment, il y a les pour et les contre.
Mais les discussions débordent cette controverse, tout est mis
en cause, et la politique du P.C. en particulier.
Il y a un jeune ouvrier, que nous n'avons jamais vu. Il
semble se disputer avec un autre. Je m'approche, c'est un com-
-- 78 –
muniste acharné, j'interviens, cinq minutes après il m'insulte
et me traite de flic. Je ne peux pas garder mon sang-froid, je
m'emporte, j'imagine la joie que j'aurai à lui casser la tête.
Je le traite d'imbécile et d'irresponsable, mais ce n'est pas
assez fort comme injure, et je suis furieux de m'en rendre
compte. Les autres nous ont abandonnés, nous parlons trop
fort, et souvent en même temps. Le jeune s'en va. Les discus-
sions reprennent de plus belle ailleurs.
Les colonialistes, les indifférents et les communistes de
choc refusent de signer. Ces derniers préviennent leurs mili-
tants contre nous. Ils sont parfois reçus vertement. Un cégé-
tiste présente la motion au délégué du comité d'entreprise.
Ce dernier explique qu'il est d'accord avec la déclaration mais
qu'il respecte la discipline du parti. Il est ennuyé et n'inter-
vient que rarement dans la discussion. Un ancien délégué
refuse de discuter. Un jeune cégétiste est contre l'idée de grève
générale; il dira aussi que Messalli Hadj est un suppôt de
l'Amérique.
C'est l'intellectuel du groupe; il explique calmement que
notre critique des pouvoirs spéciaux est basée sur des concep-
tions réformistes et, bien sûr, anti-leninistes.
Un surfaceur, vieux communiste avec qui nous sommes
en bons termes, ne signe pas et se refuse à toute explication.
Que pense-t-il? Il ne le dira pas. Il est gêné, il voudrait
bien que de telles querelles ne nous divisent pas. Il évite les
discussions politiques et le seul ressentiment qu'il a à mon
égard est celui de me voir les provoquer. Pour cette fois nous
n'avons
pas
le temps
de le tourmenter avec nos polémiques.
Un autre communiste, après avoir lu la déclaration, nous
dit que ce que nous faisons doit être déjà fait - Par qui?
Par le parti, évidemment. Alors, tranquillisé par cette idée, il
signe, bien que je me sois évertué à l'avertir que la politique
du parti n'était pas orientée dans ce sens.
Il y a aussi un cuvrier espagnol, sympathisant commu-
niste, qui signera. Lui aussi est gêné, mais pour des raisons
différentes. Aujourd'hui il pense que nous avons raison, mais
il est honteux de l'avouer. Depuis plusieurs années nous nous
engueulons sur les problèmes politiques de telle façon qu'il en
fait aujourd'hui une question personnelle. Depuis le vote des
pouvoirs spéciaux il mène la bagarre contre la CGT et les
communistes. Quand nous sommes présents il évite de s'en-
gueuler avec ses camarades, et dès que nous partons il reprend
la discussion en essayant de ne pas se servir des mêmes argu-
ments que nous. Mais il est terriblement marqué par le manque
de confiance. C'est ce que lui a légué le Parti Communiste, et
de cet héritage, il n'est pas près de se débarrasser.
Certains se déclarent d'accord avec la motion, et pourtant,
ce ne sont pas des chauds partisans de l'action, au contraire.
79
Ils sont de ceux que l'on appelle les « Morts ». Pourtant ils
signent et quelques-uns sont enthousiastes. Pourquoi?
Est-ce parce que les communistes sont hostiles à la mo-
tion ? Est-ce une façon de manifester leur anti-communisme?
Même en se mouillant, même en soutenant au besoin une grève?
De toute façon, même si c'est là l'explication, leur adhésion
est positive, car elle se situe sur le plan de l'action, et tout à
coup se trouvent renversées les barrières classiques qui sépa-
raient d'un côté les communistes, qui sont pour la grève, et
les non-communistes, qui sont des jaunes.
Mais il y a plus, ce sont ces mêmes éléments anti-com-
munistes qui, en 1953, lorsque les cheminots et les postiers
étaient en grève, furent les plus enthousiastes pour faire la
grève chez Renault. Ils voyaient tout à coup s'ouvrir devant
eux des perspectives grandioses. Ils furent déçus et leur anti-
communisme ne fit que se renforcer. C'est eux surtout, qui
déclarèrent: « Maintenant, c'est fini, je ne fais plus grève. »
Leur anti-communisme, est surtout basé sur leur opposition à
la bureaucratie politique et syndicale, et ils sont anti-commu-
nistes parce que dans l'atelier c'est la CGT et le PC qui ont
la plus grande influence.
Nous sommes arrivés tout d'un coup, à une nouvelle
division de l'atelier ; l'un côté, ceux qui voulaient faire quel-
que chose, qui étaient prêts à l'action contre le rappel des dis-
ponibles et ceux qui ne voulaient rien faire - parmi ceux-ci,
les communistes qui affirmaient qu'il fallait agir mais qui
condamnaient ceux qui proposaient précisément une action.
Les jugements étaient renversés, les anciennes valeurs
bousculées, un vent nouveau soufflait dans l'atelier.
Le soir, je vais présenter la motion à d'autres; un cégé-
tiste signe, puis deux communistes me tombent sur le paletot.
L'un d'eux, militant convaincu, mais qui refuse de se mouiller
dans la plupart des grèves, et qui est un chaud partisan des
heures supplémentaires, me reproche d'être un jaune. Une telle
provocation de sa part envenime sérieusement la discussion;
il invente sur mon compte des saletés... Les deux chefs
d'équipe viennent nous séparer. Ils ne veulent pas d'histoires,
et craignent la bagarre.
Le lendemain, samedi, nous avons été nous asseoir, trois
camarades et moi, sur les bancs du comité d'entreprise. Nous
étions délégués pour présenter notre motion sur la guerre
d'Algérie.
Nous sommes arrivés, nous quatre, et ceux qui nous con-
naissent nous ont tourné le dos, ceux qui nous saluent dans
l'usine nous ont évité, on s'est éloigné de nous comme des
pestiférés.
Nous sommes entrés dans la salle où aucun enthousiasme
ne régnait sur les bancs. De temps à autre un visage s'éclairait
·
80
d'un sourire mais l'attitude était différente, inquiète; les gens
regardaient entrer ies autres avec ennui, avec angoisse peut-
être. Ceux qui arrivaient étaient des gens connus, ou bien alors
des indésirables comme nous.
Sur les bancs, des petits groupes s'ennuyaient, et nous
mêmes avions peine à réprimer quelques bâillements, bier. que
nous soyions légèrement excités par ce qui allait se produire.
Tout à coup, par la porte, surgit notre délégué, qui s'agite
toujours, et qui cherche les gens, parce qu'il est myope. Il a
tourné autour de la salle, et nous a fui dès qu'il nous a vu,
puis d'un air affairé, comme un éclaireur qui vient apporter
une nouvelle importante, il s'est adressé à une organisatrice
de la réunion; il lui a parlé avec des gestes autoritaires et
décidés. La femme s'est tournée ers nous aussitôt. Oui, c'est
bien de nous qu'on parle. Nous essayons de deviner ce qu'on
dit à notre sujet. Mais nous sommes entrés dans notre rôle de
pestiférés, nous nous y ancrons.
M. qui est à l'UJRF et à la CGT, prêche le calme, et me
recommande de ne pas m'emporter. Je lui réponds que c'est
eux qui risquent bien plutôt de s'emporter. B. qui a quitté
le PC après de sombres histoires, me montre un de ses anciens
camarades de cellule, qui fait semblant de ne plus le recon-
naître. Le Comité est ce que nous avions prédit, un comité
fantoche: un groupe de communistes, qui ont récolté un so-
cialiste Nord Africain et un chrétien. Cela ne suffit-il pas,
pour créer un comité?
Puis voici que parmi la trentaine que nous nous comptons
environ, nous reconnaissons l'ancien député communiste
Linet, secrétaire du syndicat CGT Renault.
J'exprime mon inquiétude sur les discours qui sont inter-
minables. Je sais que Linet est capable de parler pendant des
heures sans se fatiguer, calmement. Les paroles lui sortent
de la bouche comme sa propre respiration. Mon inquiétude
amuse mes camarades, qui sont décidément prêts à tout en-
durer aujourd'hui.
Nous prenons place, les orateurs se disposent à la tri-
bune. Le socialiste Nord Africain, prend place au centre, se
lève, les flash fusent: Une, deux, trois quatre photos sont
prises dans toutes les poses. L'orateur n'a pas encore parlé. Il
s'est tourné vers l'objectif, puis il a regardé son papier. Nous
apprenons enfin qu'il préside, et qu'il donne la parole au
chrétien, qui lui, mènera pour ainsi dire les débats. Ces deux
éléments nouveaux, sont les deux trouvailles des communistes:
les individus « idéaux ». La politique d'unité se concrétise
sur ces deux personnes. Ils seront choyés, chouchoutés pen-
dant toute la réunion, où presque tous les autres orateurs,
communistes, bien entendu, approuveront et défendront les
phrases de ces deux camarades.
81
Le chrétien est un bon orateur. Il parle contre le colonia-
lisme. C'est un employé, certainement, qui aime étaler son éru-
dition. Il se lance dans l'histoire, parle du coup d'éventail, qui
sera repris par cinq uu six orateurs. Il parle des fautes du
colonialisme et le condamne. Il s'appuie sur l'histoire et les
savants, pour étayer son argumentation, qui semble se résou-
dre à ceci: Seule une poignée de colons et de capitalistes, est
pour le colonialisme. Les hommes intelligents, les savants, le
condamnent. Il cite des noms d'historiens, une dizaine de
noms, parle de sa bibliothèque en passant, puis de l'Indonésie,
de l'Inde, du Pakistan, de la Syrie. Il veut décidément mon-
trer tout ce qu'il sait. Puis il énumère les journaux colonia-
listes: France-soir, le Parisien, l'Aurore, le Figaro et Combat
(depuis qu'il a tourné casaque). Il propose comme action
contre le colonialisme, deux choses: Signature de pétitions
à porter à l'Assemblée Nationale et grande campagne d'édu-
cation des ouvriers sur la colonisation.
Il est bien applaudi... On sollicite les questions; je me
nomme, et je lis ma déclaration lentement, en appuyant sur
les mots de traitres et de menteurs. Linet est dans la salle, il
est de ceux-là. Je m'arrête, mais il n'y a aucun murmure, tout
le monde est silencieux, sans réaction. Celui qui m'a traité de
salaud, de flic, de provocateur, m'écoute, lui aussi avec le
même visage fermé. Je ne peux hélas m'écarter du texte, pour-
tant je me sens tout à coup des talents d'orateur, ou plutôt, un
désir de vider mon sac. Je termine dans le même silence, je
suis le seul à ne pas être applaudi; c'est au moins un réconfort.
Après moi, d'autres orateurs prennent la parole, pour
répéter l'idée du chrétien, et pour me critiquer. Un repré-
sentant de l'UJRF, un communiste, un autre comrauniste,
ami du Nord-Africain, une représentante des jeunes filles de
France, un autre représentant de l'UJRF, Roger Linet, le
chrétien, qui parle deux fois...
On offre toujours la parole, mais il n'y a plus d'orateurs.
Le chrétien conclut en proposant des pétitions et des meetings
explicatifs. La réunion se termine une heure trop tôt. Nous
quittons la salle, sans vouloir polémiquer avec des gens que
nous jugeons sans intérêt. En partant nous essayons de mar-
quer notre dédain pour cette assemblée fantoche, mais au
fond, nous sommes heureux de revoir l'air libre.
Aucun d'eux, à part le chrétien, n'a exprimé ses idées
avec la moindre conviction. Chacun n'a fait que réciter, sans
aucune foi. On a parlé comme une corvée. Pas un rire, pas un
murmure, pas une manifestation d'éloquence. Des discours
sans enthousiasme, des discours de professionnels. Quelle
différence avec notre atelier, où tout est dit avec tellement de
passion. Combien de pièces j'ai raté dans les discussions. Hier
82
encore, E. a fait éclater sa meule parce qu'il avait oublié
sa machine dans le feu de la discussion... Nous sommes obligés
de gueuler pour couvrir le bruit des machines, mais les dis-
cussions restent humaines, mêlées de rires et d'injures. Dans
cet arsenal mécanique, il y a des hommes qui vivent. Et puis
il y a eu cette grève d'une demi-heure qu'on a .offert à J. où
100 à 200 ouvriers ont consenti à arrêter le travail pour
saluer le départ de J. Lui qui n'est pourtant par un partisan
des grèves, a eu du mal à cacher son émotion. De toute cette
passion nous n'avons trouvé aucun écho dans cette réunion.
Discours ennuyeux, des hommes robots, qui récitaient sans
art, sans talent, devant un auditoire fatigué.
De vieux ouvriers communistes étaient venus, quelques-
uns avec leurs femmes et leurs enfants, pour passer le samedi
après-midi. Eux non plus, ne manifestèrent aucune passion
dans les débats, et se contentèrent d'applaudir. Il y avait
aussi des jeunes sur lesquels le Parti peut compter, mais
qui sont plus dévoués à la discipline. qu'à la cause.
Leur intervention fut le plus souvent limitée à la lecture de
motions. Aucune initiative ne fut exprimée par eux, aucune
originalité, même dans l'argumentation. Ce ne furent que les
inlassables répétitions du même thème. Entre ces feunes et ces
vieux militants, il n'y a pas de différence. La discipline du
Parti a tout aplani, tout rationalisé, enlevé toute personnalité
à ces individus. Elle leur a enlevé leur âge, leur physionomie.
Ce n'est plus un tel ou un tel, mais c'est un type du Parti.
Cette standardisation de l'auditoire nous surprend, nous
écaure et nous amuse à la fois. Le chrétien, lui, à qui l'on a
donné tout à coup la possibilité de s'exprimer, ne voit pas à
qui il parle. Cet homme a l'air intelligent, on lui a donné la
• possibilité de s'extérioriser, il en est ravi. Enfin il va pouvoir
donner libre cours à sa passion, qui semble être portée sur le
besoin de s'exprimer, et de s'exprimer avec application. Les
communistes lui ont donné cette possibilité, il leur en est cer.
tainement infiniment reconnaissant. Mais si on lui donne la
parole, comment ne pas s'apercevoir qu'on lui donne aussi
un auditoire de figurants, et qu'il est lui-même un figurant
d'orateur.
Le socialiste Nord-Africain est, d'après son aspect, un
Nord-Africain installé en France depuis très longtemps. Il
ne s'exprime que très peu. Il se contente de présider.
Derrière ses lunettes, il a l'air tourmenté et à en juger par
son aspect c'est un homme qui ne doit jamais rire, Les
seuls moments où il semble s'éclairer, c'est quand on le
photographie. C'est un ouvrier d'une tenue soignée. Šes lu-
nettes, sa façon de s'exprimer, malgré ses hésitations, le font
plutôt ressembler à un intellectuel. Lui, comme le chrétien,
semble avoir horreur d'une chose, c'est de la controverse. J'ai
83 -
essayé de causer avec eux, mais ils m'ont regardé avec un air
ennuyé. Le socialiste a laissé un communiste répondre à sa
place; le chrétien était pressé.
Serais-je médisant en concluant, qu'une place de prési-
dent pour l'un, et un micro pour l'autre, sont deux facteurs
importants, qui déterminent leur comportement? Je l'affirme
sans crainte, pourtant. Evidemment, il y a un facteur poli-
tique, et celui-là, il est clair: Les traditions politiques qu'ont pu
assimiler le socialiste au chrétien dans leur organisation se
recoupent avec la politique présente des communistes. Aujour-
d'hui, il ne s'agit pas de lutter contre le gouvernement, mais de
lutter à la fois pour soutenir le gouvernement et le conseiller.
Ce système de lutte est évidemment idéal pour les bavards et
pour les conformistes. Ces militants veulent être les éducateurs
des masses, ils veulent expliquer, sans plus, et ne pas se
lancer dans des actions inconsidérées. Si les communistes ont
l'impression d'avoir noyauté deux éléments, ces deux éléments
peuvent faire le raisonnement inverse, et penser qu'enfin le
Parti Communiste se range à leur propre tradition politique.
Et le raisonnement est logique, dans les deux sens.
Le dimanche, nous rédigeons le compte rendu que nous
faisons circuler dans l'atelier... En voici le texte:
Un représentant de la CFTC nous a répondu que parler
de grève générale était une énormité.
Pourquoi?
Parce que d'après lui les ouvriers ne sont pas capables de
faire de tels mouvements en ce moment.
Que faut-il faire?
Il répond: des pétitions à l'Assemblée et des meetings
pour expliquer ce qu'est le colonialisme.
Dans notre intervention nous avions expliqué que l'im-
mense majorité des ouvriers étaient contre la guerre, contre le
rappel des disponibles et que c'est sur cela que pourrait se
créer un mouvement d'ensemble.
Mais au lieu d'envisager cette perspective, les orateurs se
sont contentés de parler longuement contre le colonialisme,
Or, s'il est vrai que certains ouvriers n'ont pas encore compris
ce qu'est le colonialisme, par contre 'ils sont tous violemment
hostiles à la mobilisation et à la poursuite de la guerre en
Algérie.
Pour nous la question était de transformer cette hostilité,
gésiérale en une action efficace.
Pour les orateurs de ce Comité il s'agissait de faire des
meetings, non pas pour coordonner la lutte, pour appeler à
des manifestations de niasse, mais pour critiquer les colons.
Dans notre proposition nous avions été plus loin. Nous
disions qu'il fallait condamner les suppôts du colonialisme,
donc en premier lieu le Gouvernement et ceux qui le soute-
84
naient. A cela les orateurs du Comité n'ont pas répondu. Deux
d'entre eux (un communiste et un chrétien) ont expliqué, au
contraire, qu'il ne fallzit par GENER GUY MOLLET afin
qu'il puisse réaliser sa politique de gauche. Il va de soi que
les pétitions ne peuvent pas gêner le Gouvernement dans sa
politique. Mais ce n'est pas ce que nous voulions, nous. Nous
voulions, au contraire, le gêner ,c'est-à-dire l'empêcher de réa-
liser ses plans de mobilisation.
Ces orateurs n'étaien donc d'accord avec nous ni sur
l'explication qu'il faut donner ni sur les méthodes d'action.
Il n'a pas été dit un mot contre la politique des partis qui sou-
tiennent Guy Mollet, pas un mot contre les méthodes poli-
cières du Gouvernement. Un orateur a même eu le culot de
parler des bagarres de Wagram en cachant soigneusement le
rôle qu'avait joué la police du Gouvernement dans ces
bagarres.
On cachait des faits, on cachait la réalité!
Nous, nous étions là, au contraire, pour dire la vérité
Pourquoi les orateurs de ce Comité cachaient-ils ces faits?
Si on nous a reproché que la forme d'action que nous
proposions était une énormité, quelques orateurs, par contre,
ont parlé de leur action.
Un jeune ouvrier de l'Artillerie a ainsi énuméré ce que
PUJRF a fait dans son coin:
1) Une délégation à l'Assemblée Nationale en septembre
1955 qui a recueilli 400 signatures.
2) Une délégation à l'Assemblée Nationale en janvier
1956 qui a recueilli 400 signatures.
3) Une réunion entre des ouvriers et un député commu-
niste.
4) Un essai d'entrevue avec le Ministre socialiste Gazier
qui a refusé de recevoir les pétitionnaires.
5) Une grève d'une demi-heure à l'Artillerie qui, d'après
cet ouvrier, serait le résultat des pétitions et des
délégations qui avaient précédé.
Un autre orateur explique que « c'est réconfortant de
voir toutes les délégations qui vont faire la queue id
l'Assemblée. »
On nous a donc dit que les pétitions et les petits dé-
brayages d'un quart d'heure et d'une demi-heure sont des
bonnes formes d'action et que les formes que nous proposions
grève générale, manifestations de masse - sont mauvaises
parce qu'elles sont irréalisables.
Mais si elles étaient réalisables elles seraient aussi mar-
vaises pour ces orateurs puisqu'elles gêneraient le Gou-
vernement !
Qu'a rapporté l'action faite par l'UJRF de l'Artillerie de-
puis plus de six mois?
85
Nous sommes en droit de répondre: :RIEN.
Si l'UJRF de l'Artillerie continue encore pendant six mois
ou pendant six ans, qu'est-ce que cela changera?
Nous répondons encore: RIEN.
Mais veut-on réellement que cela change si par ailleurs
on dit qu'il ne faut pas gêner le Gouvernement?
Roget Linet a aussi parlé. Il a retracé tout le travail fait
par la CGT contre la guerre d'Algérie. La CGT a expliqué ---
dit-il mais il faut expliquer encore davantage. D'après cet
orateur, ce qui décourage les ouvriers ce serait des grandes
actions qui, d'après lui, échoueraient; par contre, les petites
grèves d'un quart d'heure, d'une demi-heure et les pétitions
sont considérées par lui comme des actions qui encouragent les
ouvriers à faire plus.
Qu'en pensent les ouvriers de l'Annexe AOC?
Quant à nous, nous pensons exactement le contraire de
ce que pense Roget Linet.
QUE FAIRE MAINTENANT?
Nous ne pouvons pas compter sur ceux qui, après avoir
voté les pleins pouvoirs au Gouvernement, font semblant de ne
pas croire à la force de la classe ouvrière pour arrêter cette
guette.
01, cette force est immense et si elle se manifestait le
Gouvernement serait forcé de reculer.
Mais le mécontentement ne se limite plus aujourd'hui aux
mobilisables et aux ouvriers en général. Au sein de la bour-
geoisie elle-même, du Conseil des Ministres, le désarroi est
grand, les divergences profondes en ce qui concerne les possi-
bilités de succès en Algérie.
Il suffirait maintenant d'une ferme poussée des ouvriers
pour faire éclater le front bourgeois.
Pour cela il ne faut pas attendre des ordres de ceux qui
veulent nous endormir aujourd'hui avec des pétitions et autres
baratins.
Nous ne sommes aujourd'hui qu'un petit groupe d'ouvriers
de cet atelier à dire cela tout haut. Mais nous sommes con-
vaincus que bien d'autres camarades le pensent aussi.
Partout où nous le pourrons non seulement nous protes-
terons contre le rappel des disponibles, mais dénoncerons les
organisations qui s'en font les complices, partout nous expli-
querons que seule la grève générale, l'action de masse, est la
voie efficace.
Entre temps les communistes ont fait leur travail. Ils
font circuler le bruit que nous nous serions mal conduits lors
de cette réunion. Nous nous serions conduits comme des per-
turbateurs, provoquant des bruits de pieds et de chaises pen-
dant que les orateurs parlaient; nous aurions refusé la discus-
86
ne
sion, etc., etc... Les communistes se dérobent à la discussion
franche, et préfèrent leur travail de sape. Ils vont parler aux
ouvriers qui travaillent et quand nous nous approchons ils
se taisent. Je questionne le délégué. Il ne sait rien, n'est au
courant de rien, ne sait pas de quoi il s'agit, n'a pas d'opinion.
Le plus affligeant n'est pas là. Ils vont, semant le découra-
gement: « La force des ouvriers ? Allons donc ! Les ouvriers
sont incapables de faire
faire un mouvement général ».
« Oui, surtout si vous êtes contre ce mouvement » répond D.
Le paradoxal, c'est que les communistes ont l'air d'être attristés
de cette opinion. Pour eux, les ouvriers sont incapables d'agir,
et ils ajoutent : « Les organisations ouvrières peu-
vent rien faire dans cette situation. » Ce ne sont plus les Orga-
nisations qui ne veulent rien faire, ce sont les ouvriers. Ils
persuadent sournoisement : « Vous êtes sans force, sans
conscience ». Ainsi dans les moments où ils se parent des ori-
peaux les plus démocratiques, dans les périodes où ils disent
aux ouvriers: « Décidez, et nous vous suivrons » c'est pour
chuchoter: « Vous êtes incapables de faire quoi que ce soit. »
Et en réalité, si les cuvriers disent quelque chose qui ne cor-
respond pas à leur ligne, ils sont traités d'utopistes, puis de
« Nanars », puis de flics...
La bureaucratie politique de l'usine tient donc toujours
les ouvriers. Nous assistons à des sursauts et chaque fois ces
sursauts se brisent, mais chaque foi qu'il se brisent, ils laissent
quelque chose. Un tel déchire sa carte syndicale, un autre dit:
k le jour où ils voudront leur grève, ils ne m'y verront pas. »
Que laissent ces maneuvres derrière elles?
Beaucoup de découragement et de dépit. Personne n'est
assez convaincu encore, pour croire qu'il a raison, pour le
croire vraiment, et pour se lancer à fond dans une lutte qui
semble inégale: la lutte contre la bureaucratie syndicale et
politique.
« Mais, si tout le monde est contre nous, qui donc est avec
nous? » Personne, dis-je, et je me fais engueuler: la chose est
trop monstrueuse pour être acceptée.
Une discussion s'est engagée entre D. et L.
D.-- « Tu critiques le syndicat mais n'empêche que tu
paies ton timbre. »
« Oui. C'est la Politique qui tue le syndicat. Mais
je ne lui cache pas ce que je pense. Je ne suis pas un dingue
comme certains. »
D. « La belle blague, tu les critiques, n'empêche que
tu paies ton timbre, et que c'est tout ce qu'ils demandent. »
L.
« Toi, tu achètes bien la V.0. »
D. « C'est pour la lire, mais je n'approuve pas. »
L. - « Eh bien, moi, c'est pareil, je paie mon timbre
et je n'approuve pas. »
L.
87
Enfin, agacé, L. conclut:
« Et puis tu m'emmerdes après tout, c'est mon car-
bure, que j'allonge, ce n'est pas le tien. »
Nous éclatons de rire. L. peut aussi bien dire: Je paie
pour tranquilliser ma conscience. Je suis ouvrier et je dois être
dans un organisme qui défend les ouvriers... Même s'il ne
les défend pas toujours, même si parfois il les enterre... Oui,
je paie toujours pour tranquilliser ma conscience. Jusqu'à
quand ? D. croit avoir trouvé la clef de l'énigme: il paie, parce
que lorsque les autres viennent lui présenter son timbre, il n'a
pas le courage de le leur refuser.
Oui, il y a un manque de conviction dans la plupart des
esprits. Mais il y a aussi un doute, un doute qui s'agrandit.
Après le doute, qu'est-ce qu'il y a? Un grand trou vide,
le néant. Alors on s'accroche au syndicat.
Quand sera-t-on capable de combler ce vide?
J'attends le retour de la vague.
Il ne tarde pas.
Les discussions ont changé, aujour-
d'hui; on ne parle presque plus des disponibles, il semble que
rien ne se soit passé dans l'atelier. Nous avons renoué avec nos
camarades de travail qui étaient en désaccord avec nous. Nous
ne pouvons pas vivre en nous engueulant continuellement. Le
travail est là, comme un troisième ennemi, mais l'ennemi
commun à tous. Nous avons besoin de nous détendre, de
chercher un peu d'humanité en dehors de la machine. Et puis
pour certains d'entre nous, la 'divergence politique crée d'au-
tres obstacles beaucoup plus sérieux.
M. a tous ses amis communistes, il a vécu dans ce milieu,
il est à l’UJRF. Ses amitiés valent-elles d'être sacrifiées à une
idée qui est plutôt une réaction qu'une élaboration ? M. a des
doutes. Il doute que tous ses amis se trompent. Il doute, mais
chaque fois qu'il se trouve en face du problème, il réagit tou-
jours de même. Il est contre ses anciens amis. Alors il trouve
la solution, il évite un peu de se trouver en face du problème.
I., ancien militant UJRF, nous raconte que maintenant,
il ne peut plus discuter avec son père. Si je critique le parti, ça
tourne mal. Il ajoute en riant: -«il me foutrait presque sur la
gueule. » Pourtant, I. affirme convaincu: « Ce sont tous les
partis) les mêmes salauds. » Puis, mi-ironique, mi-sérieux, il
parodie un chef imaginaire: « Tous à pendre, pas de
quartier ».
B. est fatigué, il pense que nous avons raison. C. aussi le
pense, mais quelle énergie faut-il pour lutter contre tous !
Le monde est contre nous: le monde officiel, les bureaux, les
chefs des organisations, et les militants disciplinés.
Le monde est contre nous, et pourtant, le monde est avec
nous: Parle à un tel, un tel, puis à l'autre, et lui, qui pourtant
n'est pas bien malin, même lui, même l'autre, te diront: Jo
:
88
suis avec toi, tu as raison. C'est cela que nous devrions faire.
Mais pourquoi ce conditionnel? Pourquoi pas ce que nous
allons faire?
C'est
que le monde officiel qui est contre nous n'a pas
perdu tout son prestige, il a l'apparence de la force et de
la raison. Non, ce n'est pas par lâcheté, que M., B. ou C. ne
voudront pas sacrifier leur amitié, qu'ils refuseront de donner
leur temps, leur force, pour lutter contre l'absurde. Non, ce
n'est pas par manque de caractère, c'est par marque
de conviction. C'est parce qu'ils doutent d'avoir raison, et qu'il
leur est difficile de croire que la raison officielle a tort. C'est
parce qu'ils sont engagés dans tout un ensemble de liens.
Parce qu'il y a six mois encore, M. devenait rouge de colère
quand on attaquait le Parti. Les veaux d'or ne se détruisent
pas en une nuit. L'absurdité devra se manifester encore long-
temps, pour effacer derrière elle tous les liens qui unissent les
ouvriers aux organisations.
1
Des ouvriers d'un atelier se sont réunis. Ils sont décidés à
faire quelque chose, contre le rappel des disponibles. Ils se
sont réunis, avec des ouvriers d'autres ateliers. Et pour se
donner un nom, il se sont nommés: « Comité de jeunes ».
Ils sont peu rombreux, mais expriment réellement
l'opinion de leur atelier.
Je suis invité à l'une de leur réunions.
Un jeune de 18 ans ne veut s'opposer ni aux syndicats,
ni au P.C.
Il veut faire quelque chose contre le rappel des dispo-
nobles, il veut manifester contre le Gouvernement, il se battra
contre la police, mais s'opposer du Syndicat et au Parti,
s'opposer à eux, tout seul, il ne s'en sent pas la force, pas le
courage. L'autorité de ces organisations lui paraît plus grande
que toutes les autres autorités. Leur prestige est plus grand
que celui du Gouvernement et de la police. Il se sent lié à
ces organisations par un lien familial. Il ne veut pas être un
parricide. Pourtant il les critique bien. Il ressemble à un
enfant qui veut bien faire des remontrances à son père, mais
qui a toujours peur de son autorité, et qui craint ses sévices.
Une telle attitude ne fait évidemment que renforcer l'arro-
gance des leaders syndicalistes et du Parti. Cette attitude si
réservée, si timide, de ce jeune, n'est pour eux qu'un gage
de plus de leur supériorité. Comment ne pas croire qu'ils sont
de véritables chefs?
Ce jeune exprime sa crainte de se voir traité de trots-
kyste par ses camarades. Cette chose lui paraît insupportable.
Pourtant, il sera très capable de rentrer dans une mêlée avec
la police, et de se faire congédier par la Direction. Il se trouve
89
plus aliéné par ses organismes de classe que par les organi:
mes de l'état. Il s'indignera contre les vexations de la ma
trise, mais il fermera les yeux lorsque les communistes crieror
les calomnies et casseront la figure à d'autres ouvriers, qui le
auront critiqués. La politisation des ouvriers, leur séjour dar.
ces organisations leur a fait perdre leur simple bon sen:
l'élémentaire réaction spontanée de n'importe quel révolte
Pour lutter contre la discipline de la société, ils accepten
la discipline de leur ciganisation. Et lorsque la discipline d
leur organisation leur impose de respecter la discipline d
la société, ils respectent à la fois, la discipline de l'organisa
tion et celle de la société.
Leur faible protestation, les premiers pas qu'ils font dan
la vie sans le soutien de leur organisation, sont vacillants
indécis, pleins de remords.
Ces révoltés, lorsqu'ils sont seuls, apparaissent tout à cou
comme des conformistes, désespérés de se trouver seuls, san:
vouloir admettre ce fait qu'il n'y a plus d'organisation pour
nous défendre, qu'il faut briser les forces qui prétendent nou:
défendre et en réalité nous oppriment. Mais ces forces sont
colossales. Que sommes-nous ? Une poignée. Hier encore sui
la Place Nationale, lorsque nos amis essayèrent d'intervenir,
ils furent pris à parti par les communistes et il y eut un début
de bagarre, des coups furent échangés. Et là, encore une fois,
le syndicat et le Parti qui paraissaient s'endormir, n'être
qu'un poids mort porté par les ouvriers, le syndicat et le Parti,
se sont subitement métamorphosés, ils sont devenus une force
réelle, organisée, avec ses commandos. Ils ont sorti leurs
griffes. Et pourtant, ils semblaient encourager les ouvriers à
s'exprimer:
« Faites des actions pour le cessez le feu en Algérie » ont
clamé tous les orateurs à leur micro. Plusieurs ouvriers sont
intervenus pour dire que l'action devait être énergique et coor-
donnée. En réponse, ils ont été traité de trotskystes, de pro-
vocateurs, de colonialistes.
« Vous nous avez mal compris », ont-ils répondu, « nous
luttons ensemble, nous sommes aussi contre la guerre d'Algé-
rie, mais nous sommes pour des manifestations générales. »
« Comme à Grenoble », dit l'un. Et comme un écho, plusieurs
répètent: « comme à Grenoble. »
Revenus à nos machines, nous épiloguons encore et
encore.
C'était un mercredi. La veille, par un tract ronéotypé, le
Comité des jeunes expliquait que les ouvriers qui avaient pris
l'initiative de ce comité, en avaient assez d'attendre. Ils vou-:
laient de l'action, et pour cela, invitaient les ouvriers à se
réunir Place Nationale, pour décider ensemble ce qu'il y avait
90
lieu de faire.
Ce comité, bien que reflétant incontestablement l'opinion
de certains ouvriers, pour ne pas dire d'une bonne partie de
l'usine, était marqué par l'empreinte de la politique trotskyste.
Ce tract, en effet, s'il s'adressait aux ouvriers, ne pouvait
s'empêcher de terminer en demandant aux organisations « ou-
vrières » de prendre leurs responsabilités. En réalité, il s'agis-
sait comme toujours, de s'adresser aux ouvriers, pour qu'ils
fassent pression sur leurs organisations syndicales et poli-
tiques, et pour que celles-ci, en dernier lieu, décident de l'action
à mener.
Le ton même du tract et des discours qu'on entendit
étaient touchants de bonne foi, d'humanité et de naïveté. Ce
comité s'excusait même de comprendre des trotskystes.
Les jeunes voulaient l'union de tous les ouvriers, et sur-
tout de toutes les organisations syndicales et politiques. La
plus grande partie du meeting fut consacrée à expliquer et à
prouver leur bonne foi, tandis que quelques communistes
excités les injuriaient. La situation se trouvait ainsi paradoxa-
lement renversée. C'étaient ceux qui essayaient de faire une
action, ceux qui avaient réussi, et avec quel mal, quels sacri-
fices, à faire un débrayage aux culasses, ceux qui avaient passé
la nuit à tirer un tract et à le distribuer, å organiser sans
micro, sans estrade, un pauvre meeting, eux, les Lilliputs,
qui s'excusaient devant les géantes organisations syndicales,
d'avoir fait ce qu'ils avaient fait, en spécifiant bien qu'ils vou-
draient voir ces géants prendre la tête de ces actions.
A 12 heures 30, les ouvriers commencent à affluer Place
Nationale.' Les organisateurs du meeting sont une poignée, la
plupart de moins de 30 ans, et visiblement angoissés par ce qui
va se passer. Chacun craint que l'hostilité des communistes ne
se traduise par des coups de poings, comme la dernière fois.
Deux maigres pancartes sont dépliées. Sur l'une est inscrite:
« Paix en Algérie ». Sur l'autre: « Tous comme à Grenoble ».
Mais les ouvriers sur la place restent muets et étonnés de voir
un si petit cortège. Ici, l'habitude veut, que chaque manifes-
tation ait une ampleur beaucoup plus vaste. Les meetings,
lorsequ'ils sont organisés par les syndicats, sont orchestrés
par
de bons tenors et soutenus par un choeur plus imposant, parce
que plus discipliné. Personne ne fait écho à ces slogans, et.
l'ardeur avec laquelle ils sont clamés tranche avec la réserve
du reste des ouvriers.
Cette minorité de manifestants, tranche pourtant aussi
avec les manifestations du syndicat: Ils sont jeunes, ils pa-
raissent tout à fait inexpérimentés dans ce genre de choses,
et manquent totalement d'assurance. Mais toutes leurs hésita-
tions sont compensées par une marque indéniable de sincérité.
Leurs visages, à part trois ou quatre trotskystes, sont in-
91
connus. Ce ne sont plus les mêmes qui manifestent. Les piliers
des manifestations communistes, sont là, eux aussi, mais ils
boudent ostensiblement cette réunion.
Les orateurs sont peu applaudis, malgré les camarades
qui essaient de provoquer par des slogans l'enthousiasme de la
foule. Les ouvriers des organisations syndicales et politiques
sont invités à prendre la parole à plusieurs reprises. Seul,
Blanc, le responsable de FÒ, prend la parole et, avec beau-
coup d'éloquence, démontre que son syndicat fait quelque
chose contre le rappel des disponibles puisque, au cours de son
congrès, il a adopté une résolution. Les communistes l'écou-
tent religieusement et l'applaudissent. Le temps n'est-il
pas
à
l'amitié en ce moment?
On offre encore la parole et un ouvrier d'une cinquantaine
d'années, bien planté sur ses jambes, monte sur le camion qui
sert d'estrade. Il est calme. Il dit qu'il a fait la guerre de 14,
et que son fils est en Algérie. Puis il approuve l'initiative du
Comité des jeunes.
Un communiste essaie de l'interrompre. Il se tourne vers
le perturbateur et l'invite à se taire ou à monter sur l'estrade
improvisée. Il obtient ainsi le silence. Il peut continuer. Il dit,
entre autre: « Ce n'est pas parce qu'on a une carte syndicale
ou politique dans sa poche, qu'on fait quelque chose. » A un
passage de son intervention, un jeune l'applaudit bruyam-
ment. Il s'arrête, se tourne vers l'auditeur enthousiaste: « Ce
n'est pas des applaudissements que je demande. » Il toise tout
l'auditoire, les deux bras en avant. « Ce qu'il faut, c'est em-
pêcher de partir les jeunes, les empêcher d'aller se faire tuer. »
C'est un ouvrier qui parle avec beaucoup de bon sens. Il est
applaudi.
« Un comité de paix a été créé dans l'usine », dit un
communiste, « qu'est-ce que vous venez nous emmerder, avec
votre comité de jeunes? »
Un orateur qui semble présider s'excuse alors de ne pas
en avoir eu connaissance. Et la réunion se termine par une
résolution de ce comité de jeunes qui décide de prendre
contact avec ce comité de la paix.
Il reste deux minutes avant que le deuxième coup de
klaxon annonce la reprise du travail. Chacun regagne son
atelier en méditant peut être sur ce que fera ce comité de paix.
C., que je rencontre, n'a pas d'illusions. Il dit: « Il fera
comme les autres: Rien », puis il se met à rire. Il n'est plus
indigné. Il en rit, tellement la chose lui paraît grotesque.
Combién font comme C. quand ils apprennent qu'un comité a
été fait pour ceci ou cela ? Combien savent que ces comités
sont des organismes fantoches, qui regroupent les militants
actifs du PC et qui n'ont d'autre politique que celle du Parti.
Ils savent à quoi s'en tenir, mais ils n'ont plus la force de
92
s'indigner. Ils ne se dérangent pas pour aller écouter un mee-
ting organisé par le comité qu'ils approuvent. Ils trouvent
plus commode d'approuver par un vote ou par un oui de la
tête, un comité qui les dispense de se déranger.
Lorsque ces jeunes ont traversé la place pour faire leur
meeting, lorsque même la passivité des ouvriers ne faisait pas
baisser leur enthousiasme, où croyaient-ils aller ?
Dénoncer les organisations syndicales leur semblait un
sacrilège, bien qu'au fond d'eux-mêmes ils étaient conscients
que ces organisations sont un poids mort sur la classe ouvrière.
Et pourtant, il aurait fallu s'adresser aux ouvriers et leur
montrer que tant qu'ils remettraient leur sort entre les mains
de ces organismes, ils seraient encore, une fois de plus
trompés.
Ils n'ont pas voulu cela, ils ont voulu mettre les organisa-
tions au pied du mur. Et les voilà, encore une fois de plus,
dans le giron traditionnel. Ils attendent encore que ces orga-
nismes décident, perpétuels exploités, même lorsqu'ils veulent
résister à l'exploitation.
Le comité de jeunes est parti de presque rien; des mécon-
tents d'un atelier se sont intitulés « Comité de jeunes » pour
se donner un nom. Mais au fond personne ne se considère,
au début, comme faisant partie d'un organisme qui n'a pas de
programme défini, à part l'opposition à l'appel des disponi-
bles. Il n'a pas de bureau élu. Ce n'est qu'une réunion d'ou-
vriers. Mais peu à peu, ce comité prend vie.
Après le meeting, les ouvriers s'aperçoivent que les autres,
les considèrent réellement comme un comité. Des ouvriers d'au-
tres ateliers viennent s'adresser à eux, témoignent leur con-
fiance ou leur approbation. Les ouvriers qui constituent ce
noyau voient, tout à coup, que les autres les considèrent plus
comme un comité, qu'eux-mêmes ne le font. Cette nouvelle
situation les enhardit davantage. Eux qui prétendaient que
sans les organisations traditionnelles, il est impossible de faire
quoi que ce soit, commencent à en douter. Eux qui croyaient
n'obtenir que méfiance sont étonnés des preuves de sympathie
qu'on leur témoigne. Eux qui n'étaient que de simples ouvriers,
seraient-ils quelque chose ?
Le comité de la paix a convoqué le comité de jeunes.
Nous nous réunissons un soir, avant l'entrevue. Les ou-
vriers qui vont parlementer avec les représentants des forces
officielles sont inquiets. Ils ne se sentent pas à la hauteur pour
discuter avec des gens qui sont des professionnels de la dis-
cussion et des meetings. Mais ce sentiment d'infériorité ne
fait qu'augmenter leur méfiance:
« Ils vont essayer de nous rouler, méfiez-vous. >>
- « Oui, on le sait bien, mais on a des positions
fermes. »
!
- 93 -
Quelles sont ces positions ?
Faire une action. Laquelle? N'importe. Tout ce qu'on
peut. Mais pas de délégation, ni de pétition.
A part ça ?
A part ça, il s'agit de s'adresser à tout le monde, et le
comité de jeunes ira avec toute sa bonne foi s'adresser aux
organisations, comme aux ouvriers. Aucune force ne doit être
oubliée. Ils sont encore pleins de dynamisme une quinzaine
de têtes nouvelles; tous s'expriment.
Enfin, ils vont rejoindre la salle de séance. Ils partent,
toujours décidés, et inquiets à la fois.
Les voilà qui rentrent dans la salle. Ils tranchent, même
par leur allure.
Ils se trouvent avec des ouvriers, et des membres du co-
mité d'entreprise, dont la plupart ne se séparent jamais de
leur serviette de cuir. Pendant plus de deux heures les ora-
teurs du comité de la paix, répètent pour Ta nième fois les
discours qu'ils prononcent à chaque occasion. Ils parleront de
Bugeot, Blachette et du fatidique coup d'éventail. Chacıın
ira de son laïus, pour conclure quoi? Conclure qu'il faut faire
quelque chose contre la guerre d'Algérie.
Un incident se produit pourtant. Le président s'adresse
au comité de jeunes, en leur disant que le comité de la paix
veut bien discuter avec eux, mais pas avec les trotskystes.
Les jeunes, tout en s'excusant d'avoir des trotskystes
parmi eux, disent que si on refuse les trotskystes, ils partiront
eux aussi .Un FO et un chrétien font la même menace. Les
trotskystes sont acceptés.
Un jeune se lève et exprime son indignation: « Vous me
dégoûtez tous, dit-il, en s'adressant aux membres du comité
de la paix. Vous parlez de faire quelque chose. Avec des gens
comme vous ! Vous n'êtes que des baratineurs, il n'y a rien à
foutre avec vous. »
Il se lève, suivi de deux autres ouvriers, et prend la porte.
En sortant, ils ont encore le temps d'insulter Linet, secrétaire
de la CGT, ancien député communiste: « Et toi, avec ta
grosse bedaine, c'est pas toi, qui ira te faire casser la figure,
tu t'en fous, salaud ! »
Les jeunes proposent de débrayer mardi et de faire
une manifestation. Le comité de la paix repousse la propo-
sition.
La séance se termine, les jeunes sont accablés. Quel-
ques-uns ont la migraine. Ils ont parlé, ils ont écouté, et rien
ne s'est décidé.
Certains sont décidés à tout laisser tomber. Le lundi
matin, un tract du Comité de la Paix, demande aux ouvriers.
94
de faire une action pour le mardi:
« Organisez vous-mêmes des débrayages.
Assistez à un meeting, à 12 h. 30, Place Nationale.
Portez une pétition à la mairie de Boulogne, tous, le
soir, à la sortie du travail. »
Les membres du comité de jeunes reprennent un peu con-
fiance. N'est-ce pas leur proposition, que le Comité de la Paix
est en train de faire sienne?
Demain, il y aura une manifestation. N'est-ce pas cela
même qu'ils désiraient?
Dans mon atelier, les responsables communistes et cégé-
tistes, ne bougent pas de leur machine. Ils font, comme s'ils
ignoraient la manifestation. Ils restent silencieux et n'invi-
tent par leurs adhérents à les suivre.
Le mardi, deux tracts sont distribués le matin, à la
porte, émanant du Comité de la Paix, mettant en garde les
ouvriers contre les trotskystes, dans une mise au point placée
à la fin )
Le comité des jeunes. lance un tract pour inviter les ou-
vriers à suivre la manifestation, le mardi à 12 h. 30.
Le meeting est dépourvu d'intérêt. Les orateurs sont: un
FO, un communiste, un socialiste. A part le FO les autres
orateurs sont connus. Ce sont les mêmes.
A part le FO, tous ont leur discours écrit. Ils lisent, et
parfois se trompent dans la lecture. Il semble que le discours
n'a pas été rédigé par eux, et qu'ils n'ont pas eu le temps de
l'étudier. D'ailleurs
nous savons que tous leurs discours sont
les mêmes. Les idées exprimées sont toutes limitées aux mots
d'ordre du Parti communiste.
C'est morne, et sans intérêt.
A deux minutes de la reprise, une résolution est lue, et on
demande à la cantonade: « Que les ouvriers qui votent pour,
lèvent la main. »
(1) En voici le texte (Tract de la CGT du 5 juin 1956):
Le Syndicat CGT informe les travailleurs de l'usine
que
la participation à ses côtés d'éléments trotskystes introduits
au sein du Comité d'Entente pour le cessez-le-feu en Algérie
sur l'insistance de militants FO et CFTC ne change absolu-
ment rien au jugement que le Syndicat CGT a déjà porté sur
eux en de nombreuses circonstances.
Le Syndicat CGT est conscient de la grande responsabi-
lité qu'il assume devant les travailleurs de l'usine, c'est pour-
quoi, en cette occasion, il renouvelle les mises en garde, ré-
sultats de l'expérience des nombreuses luttes passées, contre
ces éléments trotskystes qui, en lançant des mots d'ordre
aventuriers, contribuent toujours à l'affaiblissement de la
lutte et à la division des travailleurs.
95
Quelques mains se lèvent.
Ceux qui sont contre ?'
Pas une main.
Les abstentions ?
Personne. On ne pense plus qu'à rejoindre rapidement
sa machine.
« La résolution est adoptée à l'unanimité, nous la porte-
rons ce soir ensemble à la mairie de Boulogne. »
Nous sommes quelques-uns à regretter d'être venus. Cha-
que réunion de ce genre nous décourage, et nous écoure encore
plus.
La manifestation n'aura lieu, en réalité, que parce que le
PC l'a voulue. Et le PC ne l'a voulue que parce que les ouvriers
commençaient à s'indigner qu'il ne la voulût point.
Mais maintenant que le PC marche, ils ont peur qu'on leur
demande d'y participer.
Un raboteur me dit que ça va barder: Il faudra mettre
des souliers « pour courir, car il y aura de la bagarre. »
Le croit-il vraiment?
Son regard évite le mien. Je sais qu'il ne viendra pas.
Un autre, très enthousiaste auparavant, a perdu subitement
son dynamisme.
Le soir nous nous réunissons Place Nationale.
La grande majorité des ouvriers passe à côté des bande-
rolles, et rentre chez soi. Ils sont presses. Ils jettent un coup
d'ail timide sur le groupe que nous sommes, et s'en vont en
baissant la tête.
Deux inspecteurs de police en civil viennent prévenir les
porteurs de banderolles que le maire les attend, et reconman-
dent aux organisateurs de faire en sorte que la manifestation
soit faite dans le plus grand calme.
Les organisateurs promettent, et les deux inspecteurs se
joignent au cortège.
En passant à côté, mon camarade peut entendre distincte-
ment l'un d'eux dire à son collègue: « j'en ai repéré deux. »
Nous somines 1.200 au départ. Mais, dépassé la bouche
du métro Billancourt, le monde baisse. Il baisse encore à Mar-
cel Sembat.
J'aperçois un ancien prolétaire qui est reporter à l'Agence
France-Presse. Il regarde la manifestation. Pour lui aussi nous
voici des choses, nous allons sans doute lui donner l'occa-
sion de faire quelques lignes, de justifier sa fonction. Il se
mêle à nous. C'est son boulot. C'est peut être pour lui un
rajeunissement. J'ai peur qu'il ne dise que ça lui rappelle sa
jeunesse et le temps où lui aussi manifestait. Non, c'est devenu
un journaliste consciencieux. Il nous étudie sérieusement.
Nous crions:.«. Pas de soldats pour l'Algérie ». Les com-
munistes lancent: « Négociez » et « Paix en Algérie. »
96
La porte de la mairie est gardée par des agents. A quel-
ques centaines de mètres, dans les rues avoisinantes, les cars
de CRS stationnent.
Linet qui conduit le cortège, demande le silence aux mani-
festants.
Nous sommes alors un peu plus de 500 et le dialogue entre
représentants de la manifestation et représentants de la mairie
commence:
Il est répondu que le maire est absent.
Son adjoint, alors.
Le premier adjoint fait savoir qu'il recevra une déléga-
tion de trente à quarante personnes seulement.
Linet demande que le premier adjoint se dérange et
qu'il descende lui-même.
Discussions.
Enfin l'adjoint descend ; il lui est demandé de faire par-
venir la pétition à l'Assemblée et d'en donner lecture à une
réunion du Conseil Municipal.
Réticences de la part de l'adjoint, qui finit par accepter.
Le socialiste Nord-Africain parle avec difficulté
Au meeting de midi, il nous a parlé du XVIsiècle et des
livraisons de blé de l'Algérie à la France, au XIXe siècle. Il
intervient, dans la discussion avec l'adjoint et parle de
Robespierre.
Qu'est-ce qu'il dit?
Il dit à l'adjoint que s'il refuse de transmettre la pétition
il sera indigne du pays de Robespierre.
«« C'est un historien. »
Un vieil ouvrier se tourne vers nous:
« Il a raison.»
Croit-il que l'on se moque, parce qu'il est Nord-Africain?
On se moque, parce qu'il s'empêtre dans de grands dis-
cours, et que pour nous, la réalité nous paraît simple.
Linet fait un bref discours et demande pour finir aux
ouvriers de se disperser. Nous sommes alors un peu plus de
trois cents.
Nous apprenons quil y a eu dans la journée, à 15 heures,
une autre délégation du département 14 qui est venu remettre
une pétition. Nous apprenons aussi que certains ouvriers ont
débrayé à 7 heures et sont partis chez eux.
Les organisateurs de ces pétitions et débrayages sont
toujours les communistes.
Le lendemain nous nous retrouvons dans nos ateliers. La
manifestation a-t-elle encouragé les ouvriers? Non, au con-
traire l'impression générale est plutôt pessimiste. Nous nous
comptons dans l'atelier. A part trois ou quatre communistes
- 97
et nous, personne n'est venu à la manifestation.
Ni le délégué CGT, ni l'ancien délégué. Quant aux mili-
tants syndiqués de base, n'en parlons pas. Ils évitent de nous
demander des détails sur la manifestation et détournent les
conversations qui ont trait à la guerre d'Algérie. Pourtant
combien de fois n'ont-ils pas reproché aux inorganisés de ne
rien faire ? Combien de fois se sont-ils montres comme l'avant-
garde ouvrière de l'usine. La carte syndicale qu'ils remplissent
soigneusement tous les mois, ou bien leur vote annuel aux
élections des délégués, sont les seuls actes qui servent à dé-
penser leur combativité. Aux élections du comité d'entreprise
l'autre jour, lorsque nous expliquions les raisons de notre
abstention, nous avons choqué, plus, indigné, beaucoup d'en-
tre-eux. Ne nous ont-ils pas reproché de nous désintéresser du
sort de la classe ouvrière. Nous nous sommes moqués de l'air
tellement digne que prenaient les électeurs. Que croyaient-ils
avoir fait en jetant leur bulletin dans l'urne? Et aujourd'hui,
que pensent-ils de leur abstention à l'égard d'une manifesta-
tion patronnée par ceux qu'ils ont élus ?
Nous évitons de leur reprocher de ne pas être venus, car
nous ne tirons de cette manifestation aucune fierté.
Pouvons-nous décidément dire que le fait d'avoir passé
une demi-heure dans la rue, d'avoir porté une pétition au
maire de Boulogne était une action efficace contre le rappel
des disponibles ? Nous l'avons toujours nié. Nous nous sommes
éreintés à dire qu'il fallait d'autres actions plus généralisées.
Nous nous sommes pourtant associés à l'action décidée, mais
encore une fois les cadres communistes ont eu le dernier mot.
Encore une fois les communistes ont dévié le sens des
actions de masse. L'action des ouvriers pour eux, ne peut être
que de demander aux députés de changer leur politique. Quoi
d'étonnant, si les militants de base ne se sont pas dérangés ?
Si les yeux sont fixés sur le parlement, sur les combines, sur
les alliances entre les députés de gauche, quoi d'étonnant que
la politisation fasse perdre aux militants l'élément essentiel de
la politique: la lutte de classe ?
La lutte de classe, l'action de masse, est devenue quelque
chose qui fait double emploi avec l'action des députés. Elle
est une action parallèle, elle n'est pas le facteur déterminant.
Cette idée, développée par les organisations politiques et syn-
dicales, est-elle vraiment ancrée chez les ouvriers ? Non, cer-
tainement pas, mais cette idée sert de prétexte à quiconque n'a
pas le courage de débrayer, de manifester. Cette idée peut
tranquilliser l'ouvrier qui ne fait que voter, ou peut-être seule-
ment payer son timbre. Ces deux actions, à elles seules, lui
donnent le titre de « militant ».
- 98 -
Les journaux viennent d'annoncer en gros titres les
résultats du vote sur la question de confiance. Un commu-
niste brandit son journal:
« Tu vois, ils se sont abstenus, cette fois. »
( Et alors?
--« Eh bien, ce sont les seuls », dit-il d'un air supérieur.
« Et qu'est-ce que ça peut bien foutre qu'ils votent
pour ou contre, ou qu'ils s'abstiennent ? »
Lui, il lira tous les détails des interventions et répétera
les arguments exprimés par le député en qui il a confiance. .
La vague s'est retirée, il reste le découragement, dans
l'atelier.
Quatre jours après, un jeune de l'atelier voisin, que je
connais vaguement vient me trouver:
« Un de nos copains est rappelé, il part jeudi, à la
gare de Lyon, il faut l'empêcher de partir, en allant tous à
la gare. »
Pourquoi s'adresse-t-il à moi? Il me connaît à peine.
« Comment, veux-tu faire débrayer toute l'usine pour
jeudi ? »
Oui, il n'y a que ça à faire. » Il est très excité.
« Par quel moyen veux-tu t'adresser à toute l'usine? »
« Par ccpinage: Moi, je contacte tous les copains que
je connais, et tous ceux que je contacte, contactent à leur tour
les autres copains qu'ils connaissent et ainsi de suite... »
Puis il ajoute: « Il n'est pas question de politique ni
d'organisations. Il faut faire quelque chose. »
Pourtant, il m'a expliqué qu'il votait CGT. Mais il pense
qu'aussi bien le Comité de la Paix que les organisations poli-
tiques ne prendront pas leurs responsabilités.
Je ne voudrais pas le décourager, mais le mettre en garde.
« Toutes les organisations seront contre nous; elles saboteront
l'initiative de toutes les façons. »
Il n'en est pas sûr. Il s'en va.
Encore une nouvelle vague qui s'élance. Quand je passe le
voir à son atelier, je le vois gesticuler au milieu d'un groupe.
Il s'en prend au responsable de l'UJRF.
Ce dernier explique qu'il ne faut pas se lancer dans des
actions aventuristes et dit qu'il faudrait demander aux
autres organisations syndicales de prendre leurs responsa-
bilités. Il ajoute: «la CGT a pris les siennes, il faut que FO,
la CFTC et le SIR prennent les leurs, et alors, tous, dans
l'unité, nous pourrcns faire des actions. »
Nous discutons. Il dit que FO a évolué et que, peu à
peu,
elle évoluera davantage.
Nous parlons un langage différent: Nous, nous parlons
des rappelés, de l'action des ouvriers, lui ne voit que les orga-
nisations syndicales et les partis politiques. Pour lui les
99
ouvriers ne sont rien sans leur étiquette. C'est la politique
des partis qui détermine les événements.
Deux jeunes essaient de se faire comprendre: Ils veulent
empêcher leur camarade de partir. Ils ne comprennent visi-
blement pas pourquoi le responsable de l'UJRF ne parle pas le
même langage. Ils s'énervent de ne pas pouvoir se faire en-
tendre. Certains regagnent leur place, découragés. Celui qui
est venu me trouver semble étonné de rencontrer tellement
d'incompréhension.
Quand je le reverrai, lui aussi peut-être, aura perdu tout
espoir de faire quelque chose. Son dynamisme se sera heurté
au mur du parti et des syndicats. La vague sera brisée.
Le mur du Parti et de la CGT avec son organisation dans
l'usine, ses cadres groupés dans le personnel du comité d'en-
treprise, tout cela pèse d'un poids énorme sur toute la classe
ouvrière. Les initiatives spontanées des ouvriers sont bafouées
et les organisations contribuent ainsi, comme l'appareil de
direction, à aliéner l'ouvrier, à le laisser à son rôle d'exécutant
docile.
Pour secouer le poids de ces organisations, la sponta-
néité des ouvriers n'est pas assez forte, pas assez coordonnée.
De tous ces efforts, que reste-t-il? Le plus souvent un amer
découragement. Et dès que nous parlons de coordonner cette
spontanéité dans une organisation, nous nous retrouvons tou-
jours aussi seuls.
L'hostilité à la guerre d'Algérie n'est pas assez forte
pour faire naître une telle organisation.
100
1
Les grèves de l'automation
en Angleterre
Il y a un an et demi que l'équilibre précaire sur lequel
vit depuis la guerre le capitalisme britannique menace à nou
veau de se rompre. Les prix montent, les importations
augmentent, les exportations, sous la pression croissante de la
concurrence internationale, en particulier allemande et japo-
naise, stagnent. Considérant que les racines du mal se
trouvent dans une demande intérieure excessive, qui absorbe
une part trop grande de la production et n'en laisse pas assez
pour l'exportation, le gouvernement conservateur d’Eden a
essayé de combattre les «pressions inflationnistes » par des
augmentations d'impôts et des restrictions au crédit, en parti-
culier au crédit à la vente des automobiles ; il visait aussi,
par ces mesures, d'amener une certaine augmentation du
chômage, que les capitalistes anglais considèrent comme un
excellent moyen de discipliner les ouvriers et de les obliger
à « modérer leurs revendications ». Les mesures gouverne-
mentales n'ont eu jusqu'ici qu'un effet tardif, limité et incer-
tain sur la balance extérieure ; en revanche, elles ont réussi
à provoquer un arrêt de l'augmentation de la production,
pratiquement stagnante depuis un an, et à frapper sérieuse-
ment l'industrie automobile, où la durée du travail a été
réduite à plusieurs reprises depuis le début de cette année.
C'est dans ce climat que se situe la grève d'avril-mai des
ouvriers de la Standard Motor Company Ltd à Coventry.
Déjà au mois de mars un conflit avait éclaté, les ouvriers
n'acceptant pas la mise au chômage à tour de rôle de
250 ouvriers par jour décidée par la Compagnie. Mais lorsque,
le 27 avril, les 11.000 ouvriers de la Standard se mirent en
grève, refusant le licenciement de 3.000 d'entre eux, l'événe-
ment avait une portée infiniment plus grande. La Standard,
un des «cinq grands » de l'industrie automobile anglaise,
possède à Coventry l'usine de Canley, où 6.000 ouvriers fabri-
quent des automobiles, et l'usine de Banner Lane, où 5.000
ouvriers produisent 70.000 tracteurs par an (la moitié environ
de la production anglaise). Le licenciement de 3.000 ouvriers
était le résultat de la réorganisation et du rééquipement
IOI
complet de l'usine de tracteurs ; l'introduction de méthodes
* automatisées » dans celle-ci permettra d'élever la produc-
tion annuelle à 100.000 tracteurs, en réduisant de moitié le
personnel employé. La réduction du personnel a été présentée
par la Compagnie comme « temporaire », accompagnée de
promesses de réembauche une fois le rééquipement terminé.
Les ouvriers refusèrent de l'accepter, et leurs délégués pré-
sentèrent des contre-propositions visant une réduction du
temps de travail pour tout le personnel et une réorganisation
des plans de production de la Compagnie. Ces propositions
ont été repoussées par la direction. La grève dura quinze
jours. Elle a pris fin le 11 mai sur un recul partiel de la direc-
tion et sa promesse de réexaminer le problème en consul-
tation avec les délégués des ouvriers. Le 25 mai la direction
acceptait une partie des propositions ouvrières, mais le 31 mai
elle rejetait les autres et déclarait qu'elle allait licencier
2.600 ouvriers. Depuis, un conflit est en train de se dévelop-
per entre les hommes et leurs délégués d'atelier, d'un côté,
qui veulent se mettre en grève, et les syndicats officiels qui
essaient par des manoeuvres de toutes sortes d'éviter la lutte.
La grève des ouvriers de la Standard a eu un immense
retentissement en Angleterre. Il n'est pas exagéré de dire que
depuis le 26 avril, l' « automation » est devenue une préoccu-
pation majeure des ouvriers, des syndicats, des capitalistes et
du gouvernement anglais. Ce qui n'était pendant longtemps
qu'utopie et « science-fiction », ce qui était la veille encore
objet des calculs des ingénieurs et des grands comptables de
l'industrie, est devenu dans quelques jours un facteur domi-
nant de l'histoire sociale de notre temps et thème d'énormes
titres à la « une » des journaux à grande circulation. C'est
que les problèmes soulevés par l'automation touchent à la fois
la structure « libérale » du capitalisme occidental et la struc-
ture de l'usine capitaliste. En même temps, certains des
aspects les plus profonds des relations existant dans l'usine
moderne entre les ouvriers, les syndicats et la direction étaient
brutalement mis en lumière : le degré d'organisation sponta-
née des ouvriers, leur attitude face à l'organisation de la
production, l'incapacité de la direction de contrôler effecti.
vement l'usine apparaissent clairement dans la grève de la
Standard.
Le rôle des délégués d'atelier
Le rôle joué par les délégués d'atelier (shop stewards)
pendant la grève de la Standard rend nécessaires quelques
explications sur cette forme d'organisation des ouvriers
anglais, qui n'a pas d'équivalent en France (où les délégués
102
d'atelier ont été à la fin entièrement intégrés dans l'appareil
syndical).
Les délégués d'atelier anglais sont en fait indépendants
des syndicats. Ils sont élus par chaque département de
l'usine ; ils peuvent être révoqués par une simple assemblée
dis ouvriers du département, par un vote de « non-confiance »,
auquel cas un nouveau délégué est immédiatement élu. Ce
sont les délégués qui mènent la plupart des négociations avec
la direction sur les conflits qui surgissent quotidiennement à
propos de la production, des normes, des taux, etc. En fait,
le rôle des syndicats tend à être réduit à la formulation, une
fois par an, de revendications sur les taux des salaires de
base qui, en Angleterre comme partout ailleurs, n'ont qu'une
relation de plus en plus lointaine avec les salaires effectifs
des ouvriers.
Le mouvement des délégués d'atelier est apparu en
Angleterre vers la fin de la première guerre mondiale. Entre
les deux guerres, il a été constamment l'enjeu d'une lutte
entre ouvriers et capitalistes, ceux-ci refusant de reconnaître
les délégués et les licenciant dès qu'ils le pouvaient ; obligés
souvent de les recevoir, ils profitaient du premier relâche
ment de la pression ouvrière pour les attaquer de nouveau.
Mais pendant la deuxième guerre mondiale, les capitalistes
ont été contraints de comprendre que le développement de la
production dont dépendait le sort de l'Angleterre, serait
impossible s'ils ne reconnaissaient pas les délégués d'atelier.
Ainsi ceux-ci ont accédé à un statut semi-légal. Actuellement,
les ouvriers considéreraient toute attaque contre les délégués
comme une attaque contre le mouvement syndical et les
droits démocratiques élémentaires.
Les syndicats contrôlent théoriquement le mouvement
des délégués d'atelier car ils délivrent à ceux-ci l'attestation
certifiant leur qualité. Mais en fait il n'y a pas un seul
exemple où le syndicat ait refusé de reconnaître un délégué
élu par les ouvriers (en France, comme on sait, les délégués
sont pratiquement désignés par les syndicats, et c'est pour
tel ou tel autre syndicat que les ouvriers sont en fait appelés
à voter). L'indépendance de fait des délégués d'atelier s'ex-
prime clairement lors des grèves. Comme la plupart du temps
les syndicats s'opposent à la grève, les délégués commencent
par déclencher la grève que demandent les hommes ; ils se
rendent ensuite au syndicat, et demandent que la grève soit
< reconnue » (ce qui permettrait aux ouvriers de recevoir une
allocation de grève sur les fonds importants dont disposent
les syndicats). Le syndicat dira alors presque toujours que
cela est impossible et demandera au délégué de persuader les
hommes à reprendre le travail. Le délégué convoquera une
réunion des hommes, pour la forme, puis retournera au syn-
103
dicat pour expliquer qu'il n'y a rien à faire. La plupart du
temps, le syndicat cédera et reconnaîtra la grève. S'il ne cède
pas, les délégués poursuivront en règle générale leur action
en les ignorant (1).
Mais l'aspect le plus caractéristique du mouvement des
délégués d'atelier est qu'il tend à dépasser le niveau de l'ate-
lier ou de l'usine et à s'organiser sur une échelle beaucoup
plus vaste, au niveau de l'industrie et au niveau de la région.
Des réunions régulières, totalement inofficielles, de délégués
d'atelier représentant des usines des quatre coins du pays,
ont lieu dans le cas de la plupart des grandes branches de
l'industrie ; à l'occasion, les délégués de toutes les branches
d'industrie d'une région donnée se réunissent. Après avoir
pendant des années ignoré ou prétendu ignorer ce fait, la
presse bourgeoise est amenée maintenant à en rendre compte.
On pouvait lire dans les journaux anglais du 5 mars que le
samedi 3 mars avait eu lieu à Birmingham une réunion du
comité (non-officiel) des délégués d'atelier de l'industrie auto-
mobile qui avait voté une résolution blâmant le Gouverne-
ment comme directement responsable de la situation de crise
dans l'industrie automobile, appelant les ouvriers de l'auto-
mobile à tenir des meetings et des démonstrations de masse
le 26 mars, invitant les représentants des ouvriers des autres
industries affectées par la politique économique du Gouver-
nement à se joindre à eux, et qui avait décidé de convoquer
une conférence spéciale des délégués d'atelier de l'industrie
automobile à Birmingham le 22 avril. De même, dès que le
problème de l'automation a été posé dans la pratique, igno-
rant les résolutions grandiloquentes et platoniques votées par
les syndicats, les délégués d'atelier organisaient leurs contacts
à l'échelle nationale. Les journaux du 28 mai rendaient
compte d'une conférence nationale des délégués d'atelier des
industries mécaniques et assimilées qui s'est tenue à Londres
le dimanche 27 mai. Cette conférence a demandé « qu'une
consultation complète avec les ouvriers à la base (at shopfloor
level) ait lieu avant l'introduction de nouvelles méthodes de
production... que l'accroissement de la production se reflète
dans l'accroissement de la paye... Les employeurs ont été
avertis que s'ils ne tenaient pas compte de ces revendications,
ils pouvaient s'attendre à une résistance jusqu'au bout ». La
motion unanimement votée déclare : « Nous ne nous oppo-
sons pas à l'introduction des nouveaux progrès techniques,
mais nous insistons sur ce qu'une consultation complète avec
les ouvriers à la base doit avoir lieu avant cette introduction.
1. C'est ce qui s'est passé pour plusieurs grèves importantes en 1954
et 1955 ; v. le n° 17 de cette revue, Les grèves des dockers anglais, en
particulier pp. 62, 69, 73.
104
Nous sommes décidés à sauvegarder les intérêts des ouvriers
et à lutter pour l'élévation du niveau de vie à la suite de
l'automation, la pleine consultation, l'élimination du chô
mage, la paye complète des ouvriers en attendant la solution
satisfaisante des problèmes surgissant dans une entreprise, la
réduction de la semaine du travail et les trois semaines de
congé annuel » (2).
Sans doute il serait faux de penser que le mouvement
des délégués d'atelier est entièrement indépendant de la
bureaucratie syndicale ; certains parmi les délégués seront en
même temps des syndicalistes actifs, et parmi ceux-ci, il y en
aura qui tendront à faire prévaloir auprès des ouvriers la
ligne du syndicat. Mais leur révocabilité permanente empêche
qu'ils puissent le faire de façon systématique ou sur des sujets
considérés par les ouvriers comme importants. Au demeurant,
il suffit de comparer la ligne d'action effective des délégués
dans la grande majorité des cas, ou la résolution sur l'auto-
mation citée plus haut, avec l'attitude et le bavardage des
syndicats pour comprendre que le mouvement des délégués
d'atelier et la bureaucratie syndicale sont en fait divisés par
une ligne de classe.
Le pouvoir effectif dans l'usine et l'attitude gestionnaire
des ouvriers.
Dès qu'une telle forme d'organisation existe, malgré son
caractère partiel et non-formel, les manœuvres de la bureau-
cratie syndicale, le poids énorme des moyens dont dispose le
capitalisme dans l'usine et dans la société, la puissance du
prolétariat moderne apparaît dans le fait que la direction
capitaliste n'est plus le maître sans partage dans « sa propre
maison ». Les ouvriers, unifiés, autour des délégués d'atelier,
refuseront dans beaucoup de cas d'exécuter purement et sim-
plement les directives des bureaux ; dans les conflits qui
naissent quotidiennement au sein de la production, un
compromis perpétuellement instable et mouvant est réalisé à
tout instant entre la ligne de la direction et la résistance
collective des ouvriers. Les deux exemples qui suivent mon-
trent qu'à un certain niveau d'organisation et de combativité
des ouvriers, sans barricades ni soviets, ce qui est plus ou
moins en question, c'est le pouvoir même des capitalistes
dans l'usine.
En 1954, la direction de la Standard a édicté une régle-
mentation de l'activité et des droits des délégués d'atelier
ce qui montre déjà le degré de tension permanente existant
dans l'entreprise. Les délégués n'en ont tenu compte que pour
2. Manchester Guardian, 28 mai 1956.
105
autant qu'ils le trouvaient bon. En décembre 1954 la direa
tion licenciait trois délégués pour inobservation du règlement
en question. Les 11.000 ouvriers de l'usine se mirent en grève,
et, après quelques jours la direction capitulait et réembau-
chait les délégués.
Le deuxième exemple est fourni par la série de mouve-
ments qui ont commencé chez la Standard depuis le mois de
mars. Au début mars, avant tout conflit relatif à l'automation,
la Standard décidait de réduire sa production d'automobiles,
qui avait dépassé la demande, et d'introduire un système de
rotation comportant la mise à pied de 250 ouvriers chaque
jour à tour de rôle. Les ouvriers ont répondu, par la voix des
délégués, en proposant une autre manière d'aboutir à la
réduction voulue de la production : la semaine de travail de
36 heures avec la même paye. Sous la menace de la grève, un
compromis a été réalisé avec la direction.
Encore plus caractéristique a été l'attitude des ouvriers
et des délégués lorsque le problème des licenciements consé.
cutifs à l'introduction de l'automation dans l'usine de trac-
teurs de Banner Lane a été posé fin avril. La direction avait
annoncé au départ son intention de licencier temporairement
2.500 ouvriers pendant la réorganisation de l'usine affectée
par l'automation ; par la suite, elle a porté ce chiffre à 2.900
et en même temps annonçait qu'elle refusait toute réduction
äe la durée de travail pour les autres ouvriers. Les 11.000
ouvriers de la firme se sont alors mis en grève et les délégués
ont présenté un plan visant à éviter le licenciement des
ouvriers, équivalant en fait à un plan de réorganisation de
la production de l'usine. Ils ont proposé : qu'une partie des
ouvriers fût occupée à la production de pièces communes au
vieux et au nouveau modèle, qui serviraient en partie pour
les stocks de pièces de rechange du vieux modèle, et en partie
pour la fabrication ultérieure du nouveau ; que la produc-
tion commençât tout de suite au rythme maximum sur les
parties de la fabrication déjà rééquipées et sur celles qui
pouvaient l'être rapidement ; que le restant des ouvriers
déplacés de l'usine des tracteurs fût absorbé par l'usine
d'automobiles, en organisant dans celle-ci le travail sur trois
équipes brèves, au lieu d'une longue équipe de jour et d'une
brève équipe de nuit comme auparavant. A l'argument de la
direction, que cela nécessiterait de tripler les contremaîtres
et le reste du personnel non-productif, le comité de grève a
répondu que les contremaîtres pourraient travailler sur deux
équipes longues correspondant aux trois équipes brèves des
hommes ; et qu'en tout cas, « que les contremaîtres soient là
106
ou non, n'a aucune importance réelle, parce que c'est le boni
qui stimule le travail » (3).
Ce qui est important ici, au-delà de ces propositions
concrètes, c'est l'attitude gestionnaire des ouvriers et des
délégués, le fait qu'ils se placent au point de vue de l'orga-
nisation d'ensemble de la production de l'usine et qu'ils sont
obligatoirement amenés à le faire, pour répondre concrète-
ment à l'organisation capitaliste de l'usine et parer aux méfaits
qu'elle entraîne pour eux.
L'attitude des syndicats
Depuis le mois d'avril de cette année, les résolutions des
Conférences annuelles de divers syndicats ou de leurs organes
directeurs se succèdent, « félicitant » la résistance des ouvriers
aux licenciements (4), menaçant les employeurs de grève (5),
etc. En fait, les syndicats les directions officielles ont
fait tout ce qu'ils ont pu pour éviter que le problème ne se
place sur le terrain de la lutte réelle des ouvriers contre
les capitalistes. Après une série de déclarations contradictoires
et de faux-fuyants, leur attitude a été enfin clairement expri-
mée par M. J. Crawford, membre du Conseil Général des
Trade-Unions :
« Lorsqu'il s'agit de formuler la politique syndicale rela-
tivement à l'automation, les discussions doivent être menées
par des gens du niveau le plus élevé (men at the top level),
non pas par des délégués d'atelier... Autrement, l'anarchie
pénétrera parmi nous... » (6).
Pendant la grève d'avril-mai, les syndicats avaient réussi,
par une série de manoeuvres dilatoires, d'éviter de prendre
position sur la grève. Mais ils n'ont pas pu s'en tirer aussi
commodément par la suite.
Lorsque, le 31 mai, la direction de la Standard a annoncé
le licenciement définitif de 2.600 ouvriers, le secrétaire syndi-
cal du district de Coventry déclara que son syndicat était
« grandement choqué » par la nouvelle. Le même jour, les
délégués d'atelier de l'usine décidaient de demander aux syn
dicats d'appeler officiellement les ouvriers à la grève.
L'attitude prudente des délégués s'explique par le changement
de la situation depuis le mois d'avril : la Standard était en
train de réduire sa production d'automobiles, une partie des
licenciés appartenait à l'usine d'automobiles de la Compa.
gnie ; la grève pourrait être longue, les ouvriers ne pourraient
3. The Times, 3 mai 1955.
4. Amalagamated Engineering Union · Manchester Guardian, 25-4-56.
5. Electrical Trades Union - Manchester Guardian, 16 mai 1956.
6. Manchester Guardian, 18 mai 1956.
107
pas tenir sans le soutien financier des syndicats. Les directions
syndicales devaient se réunir le 3 juin pour décider de leur
attitude. Cette réunion a été par la suite ajournée au 6 juin.
Lorsqu'elle a eu lieu, les dirigeants syndicaux se prononcèrent
unanimement contre la grève. «A la place de la grève, note
innocemment le Manchester Guardian du 7 juin, ils deman-
deront au Ministre du Travail, Mr. Macleod, de convoquer
une réunion de toutes les parties intéressées pour discuter la
situation. » Le Ministre du Travail a effectivement reçu les
dirigeants syndicaux le 7 juin, pour leur déclarer que « la
question de savoir si telle firme avait suffisamment de travail
pour garder tous ses ouvriers ne pouvait être décidée que par
la firme elle-même... »
Nul doute que les ouvriers de la Standard et d'ailleurs
apprécient à sa juste valeur ce résultat palpable des « dis-
cussions au niveau le plus élevé ».
L'automation et l'économie capitaliste
Qu'est-ce que l'automation, et en quoi consiste-t-elle dans
le cas de la Standard ? Le mot est vague, et recouvre une
réalité complexe et confuse. Les techniques introduites par la
Standard n'ont rien de révolutionnaire, lorsqu'on les prend
séparément. Pour autant qu'on puisse savoir, elles représen-
tent une combinaison de « machines-transfert » (en usage
chez Renault depuis des années) et d'un certain degré de
contrôle automatique de la production par des procédés élec-
troniques. Il n'y a pas d'invention absolument nouvelle à la
base de la nouvelle organisation de l'usine de Banner Lane.
Il y a eu, pendant des années, la recherche et l'application
partielle de nouveaux procédés « automatiques » dans une
foule de branches de l'industrie. Puis, soudain, la réorgani-
sation totale d'une usine sur la base de ces procédés, en en
poussant l'application dans chaque secteur particulier le plus
loin possible et en en repensant l'intégration dans
ensemble productif par des méthodes elles-mêmes « automa-
tisées », devient techniquement possible et économique-
ment rentable. L'aspect révolutionnaire de « l'automation »
actuelle consiste en ce qu'on est devenu capable de faire table
rase de l'organisation précédente de l'usine et d'appliquer en
masse dans tous les départements les procédés et les machines
qui n'étaient jusqu'alors utilisés que de façon partielle et
sporadique.
Mais l'application des nouveaux procédés à une échelle
inconnue auparavant non seulement donne à l'usine « auto-
matisée » une structure qualitative nouvelle, mais pose à
l'échelle de la société entière des problèmes énormes qui dès
le départ mettent en question l'organisation pseudo-libérale
du capitalisme occidental.
un
108
Le premier de ces problèmes est évidemment celui du
chômage technologique des ouvriers expulsés des usines
« automatisées ». L'économie de force de travail résultant de
l' « automation » paraît énorme. Dans le cas de la Standard,
il semble qu'il y aura une augmentation de la production de
plus de 40 % avec une réduction du personnel de l'ordre de
50 %. Ceci équivaut à une augmentation de la productivité
du travail de plus de 180 %, et signifie que le niveau de pro-
duction antérieur pourrait être désormais atteint avec le tiers
de la main-d'oeuvre précédemment employée.
Cela ne veut évidemment pas dire que le chômage total
augmentera exactement du nombre des ouvriers licenciés.
D'un côté, l'emploi doit augmenter dans les usines qui fabri-
quent le nouvel équipement, qui l'entretiennent, le remplacent
à la fin de sa vie productive, etc. — et cette augmentation
de l'emploi aura des répercussions secondaires sur les indus-
tries qui produisent des biens de consommation pour ces
ouvriers. D'un autre côté, l'accumulation capitaliste ne prend
pas tout de suite et intégralement la forme d'investissements
dans des usines « automatisées » ; elle continue, pour la plus
grande part, à avoir lieu sous forme d'investissements du type
courant, où chaque milliard de francs de nouvel équipement
crée, disons, une demande de mille nouveaux ouvriers. On
ne peut pas entrer ici dans les problèmes complexes qui se
posent à ce propos. Le résultat final net dépendra d'une quan-
tité de facteurs concernant non seulement le degré d'économie
de force de travail réalisée par les nouvelles inventions, l'éten.
due des investissements nécessaires, le rythme de l'accumula-
tion et sa répartition entre investissements traditionnels et
nouveaux, mais en fin de compte tous les aspects importants
de l'économie capitaliste. Autant il serait faux de penser que
le chômage résultant de l'automation sera exactement équiva-
lent au nombre d'ouvriers licenciés au départ (7), autant il
est faux de dire que la production capitaliste créera automa-
tiquement un nombre équivalent de nouveaux emplois (8).
7. S'il en était ainsi, le chômage depuis un siècle et demi aurait
atteint des proportions inimaginables.
8. Ainsi The Economist du 12 mai (p. 592), après avoir repoussé l'idée
« généralement avancée aujourd'hui » par les capitalistes et leurs porta
parole - suivant laquelle « les effets à court terme de l'automation seront
inévitablement douloureux, mais qu'à long terme l'automation créera de
façon également inévitable davantage d'emplois », propose de la rempla.
cer par une
« version reyisée honnête » (!) qui serait : « ... Une chose
est certaine, et doit nous réconforter : l’automation ne peut avoir lieu
sans une demande effective probablement largement distribuée
capable d'acheter les biens additionnels qu'elle créera ». La seule justi.
fication de cette idée donnée par l'Economist est qu'une compagnie ne
procèdera aux investissements coûteux qu'implique l'automation que dans
la mesure où elle s'attend à une augmentation de ses ventes. Mais cette
attente ne se vérifiera pas obligatoirement ; et elle est loin d'être la
109
Mais même abstraction faite de la question : quel sera
le chômage global qui résultera de l'automation ? une chose
est certaine : le chômage des ouvriers directement touchés.
Du point de vue économique abstrait, il se peut qu'il y ait
égalité entre le nombre d'ouvriers licenciés par la Standard
et de ceux qui sont au même moment absorbés par l'indus-
trie de l'équipement électronique, des machines-outils ou
même des produits chimiques. Du point de vue réel, il n'en
est nullement ainsi. Les nouveaux emplois créés ailleurs du
fait même de l'automation ou par l'expansion générale du
capitalisme ne se trouveront pas dans la même localité, ni
n'exigent les mêmes qualifications. Plus même : les emplois
qui subsisteront dans l'usine « automatisée » ne pourront que
dans une faible proportion être ocupés par les ouvriers qui
s'y trouvaient, car ils sont d'une autre nature. Comme l'a dit
le Manchester Guardian paraphrasant, probablement sans le
savoir, Marx « à quoi cela aide un mécano licencié de
Coventry de savoir qu'il y a des emplois vacants dans les
autobus d'Edimbourg ? »
Les problèmes qui en résultent pour l'ouvrier sont prati-
quement insurmontables. L'exploit qu'implique pour l'ouvrier
individuel le fait d'acquérir une qualification, de trouver un
logement et de s'y installer peut difficilement être répété
deux fois dans une vie. Du point de vue capitaliste, ces
aspects ne peuvent pas être pris en considération ; une firme
ne peut pas régler son équipement et sa production sur le
principe du maintien de l'emploi de ses ouvriers actuels. Il
est dans la logique absolue de la production capitaliste de
traiter l'ouvrier comme n'importe quelle autre marchandise,
qui doit se déplacer pour aller rencontrer la demande, se trans-
former pour répondre à ses exigences. Le fait que l'objet de
ce déplacement ou de cette transformation est la personne
même de l'ouvrier ne change rien à l'affaire. A la limite si
l'ouvrier ne peut pas être transformé pour répondre aux exi.
gences de l'univers mécanique en perpétuelle révolution, son
sort ne peut et ne doit pas être différent de ceħui de n'importe
quel autre instrument de production qui s'est démodé avant
son usure complète : le rebut.
seule raison poussant à l'automation. La plupart du temps, il y aura à
la fois augmentation de la production et réduction du personnel ; il se
peut même que l'introduction de l'automation ait lieu face à une
demande stagnante, pour réduire simplement les coûts. Par-dessus tout,
dans le cadre d'une révolution technologique, l'augmentation de la
demande effective n'a pas de lien nécessaire avec une augmentation de
l'emploi; celle-là peut augmenter, et celui-ci décliner précisément parce
que la nouvelle technique signifie qu'un niveau donné de production
peut être atteint et un niveau correspondant de demande satisfait
avec une quantité différente (moindre) de travail. Il est difficile de dire
dans quelle mesure l'Economist veut tromper les autres et dans quelle
mesure il se trompe lui-même.
IIO
C'est en effet ainsi que le capitalisme a « réglé » le pro-
blème du chômage technologique par le passé. Mais ce qui
avait été possible au XIXe siècle, ne l'est plus avec le proléta-
riat contemporain. Sa puissance effective au sein de la société
interdit qu'on puisse prétendre laisser les ouvriers mourir de
faim ou se tirer d'affaire aux-mêmes ; les capitalistes savent
que les ouvriers pourraient dans ce cas se tirer d'affaire d'une
façon tout à fait différente. Les problèmes posés par
le
« reclassement » des ouvriers licenciés logement dans une
autre localité, nouvel apprentissage, dépenses relatives à tout
cela - ne peuvent être envisagés que sur le plan national,
et appellent l'action de l'Etat. Ce facteur ne peut, dans les
sociétés capitalistes occidentales, que donner une nouvelle
impulsion à l'intervention concrète et spécifique de la bureau-
cratie étatique et syndicale dans l'organisation de l'économie.
Il n'est que trop naturel que le quotidien du parti travail-
liste, le Daily Mirror, publie sur plusieurs colonnes et en
première page, le 8 mai, un « plan en dix points pour la
deuxième révolution industrielle ». Partant du principe
qu'« à défaut d'un plan gouvernemental, l'industrie sera
plongée dans le chaos », le journal travailliste demande que
le Gouvernement fournisse les fonds pour le déménagement
dans d'autres localités des ouvriers licenciés, qu'il fournisse à
ceux-ci les logements nécessaires, qu'il prenne à sa charge les
frais d'apprentissage des ouvriers qui doivent changer de qua-
lification, qu'il constitue des « équipes mobiles d'experts » qui
s'attaqueront aux problèmes créés dans les diverses régions
par l'introduction de l'automation (9), etc. Mais il est beau-
coup plus caractéristique que le grand quotidien libéral
Manchester Guardian non seulement adopte complètement ce
point de vue, et insiste sur le fait que seul l'Etat peut asi vrer
la solution des problèmes créés par l'introduction de l'auto-
mation, mais aille jusqu'à écrire : « Nous pouvons dans ce
problème adopter certaines des méthodes des Soviets. Hier,
dans une discussion sur la manière dont les Russes ont traité
le problème de l'automation, M. S. Babayants, leader des
syndicats russes de l'industrie mécanique, actuellement en
visite dans ce pays, disait que les nouvelles machines n'entraî-
nent pas des pertes pour les ouvriers, car ceux qui sont rempla-
cés sont rééduqués en vue d'autres travaux, à pays complète,
avant tout changement ». « Les directions des firmes indivi-
duelles », poursuit le journal, « ont une responsabilité évi-
9. « Chaque équipe devrait comprendre un expert syndical... » pour
s'occuper des aspects plus spécifiquement ouvriers des problèmes, peut-
être ? Pas du tout : ... qui puisse aplanir les difficultés qui pourraient
surgir si un homme devait changer de syndicat». La bureaucratie du
Labour Party ne perd pas le nord et n'oublie pas le besoin de protéger ·
ses chasses gardées.
- III
dente dans ce domaine, mais il est clair qu'on ne peut
s'attendre à ce qu'elles assument la responsabilité entière de
la solution. Si nous avions un plan national de ce type, la
peur du chômage existerait beaucoup moins... Voici le genre
d'aide que les syndicats devraient demander au Gouverne-
ment, et le genre d'aide qui devrait être accordé. »
Pour l'instant, le Gouvernement conservateur se borne à
lancer des appels au calme et à déclarer que « la dimension
de la force de travail est essentiellement un sujet qui ne
devrait
pas
être déterminé
par
le Gouvernement ». Mais cette
attitude ne pourra être maintenue qu'aussi longtemps que
l'introduction des nouvelles méthodes de production restera
limitée. L'extension fatale de l'automation obligera les Tories
à jeter par-dessus bord leur « idéologie » (ce ne sera pas la
première fois) ou de passer la main.
L'automation et l'usine capitaliste
Mais les effets de l'automation sur la structure de l'usine
capitaliste, sur les rapports concrets de production et l'activité
quotidienne des ouvriers ont une portée encore plus profonde.
Du 14 au 17 mai a eu lieu à Londres une conférence
internationale des syndicats sur l'automation, organisée par
l'Agence Européenne de Productivité. Voici les déclarations
d'un des participants, M. Serge Colomb, technicien chez
Renault à Paris, telles qu'elles ont été rapportées par les
journaux anglais (10). Elles prennent toute leur signification
si l'on pense que les syndicats réunis par l'A.E.P. sont rien
moins que « subversifs ».
Après avoir rappelé que Renault avait lancé son pro-
gramme d'automation dès 1947, et que depuis cette année la
force de travail de l'usine s'était accrue de 15% et la pro-
duction de 300 %, M. Colomb a continué en disant :
« Il n'a pas été possible d'atteindre un état d'équilibre
dans le re-déploiement de la force de travail. Le nombre
d'ouvriers qui ont été placés à des travaux de qualification
inférieure par suite de l'introduction de l'automation est plus
élevé que celui des nouveaux postes créés, et, souvent, la
nature de ces derniers est telle que les nouveaux ouvriers
doivent être recrutés dans d'autres catégories.
« L'hiatus entre la production et la formation profes-
sionnelle est un autre problème fondamental de l'automation.
Le plan de formation professionnelle de l'usine... a été inca-
pable de prévoir trois années à l'avance ce dont la produc-
tion aurait besoin. Il y a quelques années, on avait besoin de
fraiseurs, d'ajusteurs et de tourneurs. Maintenant on a sur-
tout besoin d'outilleurs et d'autres catégories d'ouvriers.
10. Manchester Guardian, 18 mai 1956.
II2
« Les heures de travail n'ont pas été réduites, et, bien
que payés un peu mieux, les ouvriers des départements qui
ont été automatisés n'ont pas eu les avantages annoncés par
les prophètes de l'automation. L'isolement de l'ouvrier au
milieu d'un ensemble complexe de machines peut avoir des
répercussions très sérieuses et accentuer la déshumanisa-
tion » du travail, qui n'en est que plus durement ressentie en
l'absence d'un travail physique pénible. »
Pour ce qui est des salaires, M. Colomb a dit qu'évidem-
ment il n'était plus posible d'utiliser le paiement aux pièces
ou les bonis, puisque la machine détermine le rythme du
travail. Il a été nécessaire de procéder à une réévaluation
étendue des divers travaux et de définir une grande gamme
de nouveaux barèmes.
Cette déclaration étonnante n'a pas besoin de longs
commentaires. C'est un technicien d'une usine capitaliste, à
l'honnêteté de qui il faut rendre hommage, qui démolit dans
dix lignes sobres toute la mythologie du « progrès » capita-
liste. Il faut seulement souligner la signification des indica-
tions qu'il fournit sur les salaires. L'automation enlève une
base
des divers travaux »,
c'est l' « étude des postes », de plus
en plus répandue qui de toute évidence ne peut être
qu'arbitraire et ne vise qu'une chose : maintenir la division
entre les ouvriers.
Pour comprendre les effets de l'automation sur la struc-
ture concrète de l'usine capitaliste, il faut saisir la fonction
sociale qu'elle est appelée à remplir dans la société d'exploi-
tation et sa place dans l'histoire des rapports entre le capital
et le travail.
Considérées abstraitement, les grandes modifications de
la technique productive dans la société capitaliste se préseni-
tent comme le résultat 'une évolution technologique relati-
vement « autonome », et leur emploi dans la production
comme le résultat de l'application d'un principe de rentabilité
également « autonome », c'est-à-dire indépendant de toutes
considérations sociales. En fait, l'application en masse de ces
modifications dans l'industrie prend un contenu social extrê-
mement précis ; brutalement parlant, elle constitue presque
toujours un moment de la lutte des classes, une offensive du
capital contre le travail considéré comme force productive
concrète, en définitive, comme la seule force productive origi-
naire. Dans la société capitaliste, qui commence par pervertir
tout et amener tout à la servir, les modifications techniques
sont à chaque étape le seul moyen apparemment définitif de
a discipliner » les ouvriers ; cela se fait par une attaque
113
contre les forces productives vives de l'ouvrier, dont chaque
fois une faculté est arrachée et incorporée à la machine. Ne
pouvant pas supporter la résistance permanente des ouvriers,
le capital estropie l'application de la technique à la produc-
tion et la subordonne à la poursuite de son but utopique :
l'élimination de la sphère de la production de l'homme
en tant qu'homme. Mais à chaque étape cette élimination
s'avère à nouveau impossible : la nouvelle technique ne peut
être appliquée en masse que si des millions d'ouvriers se
l'approprient, elle ouvre elle-même des nouvelles possibilités
qui ne peuvent être exploitées si ces ouvriers n'y collaborent
pas. Tôt ou tard, la dialectique concrète de l'action humaine
dans la production - de la technique et de la lutte de
classe fait resurgir au premier plan l'élément dominant du
processus de production moderne : le prolétariat.
C'est ainsi que la révolution technologique qui a eu lieu
aux alentours de la première guerre mondiale, l'introduction
des machines semi-automatiques et de la chaîne d'assemblage,
est apparue au capital comme devant le débarrasser définiti-
vement des ouvriers professionnels et le laisser face à une
masse de « manovres abrutis », qu'il pourrait manier à sa
guise. Vingt ans plus tard, il lui fallait déchanter : l'appli-
cation universelle des nouveaux procédés avait abouti à la
création d'une masse d'ouvriers semi-qualifiés, homogène et
disciplinée pour son propre compte et qui, du fait de la dis-
parition des étroites qualifications professionnelles, n'en était
pas moins décisive pour la marche de la production, tout en
étant beaucoup plus plus prête à résoudre le problème de la
gestion ouvrière de la production. En fait, le capitalisme
s'avère beaucoup moins capable de discipliner dans la pro-
duction comme dans la société le prolétariat de 1955 que
celui de 1905. Il n'y parvient que grâce à la bureaucratie
syndicale et politique.
C'est dans ce contexte que l'application des techniques
de l'automation va prendre son sens. On pourrait facilement
rétablir les chaînons qui conduisent des impératifs « écono
miques » « techniques » des firmes, à la signification
historique du mouvement ; mais c'est cette dernière qui nous
importe ici. Ce que vise objectivement l'application de l'auto-
mation dans la période actuelle est ceci : remplacer chaque
centaine d'ouvriers semi-qualifiés par une vingtaine de
« manoeuvres abrutis » et une vingtaine de « professionnels
achetés ». Mais ce qu'on sait dès maintenant sur les appli-
cations de l'automation (chez Renault, par exemple) montre
que les manquvres au contact des machines-transfert et des
professionnels, tendent à s'approprier le « savoir-faire » rela-
et
I:14
tif aux nouvelles méthodes (11). Ensuite et surtout, ce qui
paraît avoir un sens pour la firme individuelle devient
absurdité à l'échelle du capitalisme tout entier.
Appliquée à l'ensemble de la production, cette transfor-
mation entraînerait l'acquisition d'une culture technologique
supérieure par la majorité des ouvriers. Faute de pouvoir
réduire soixante pour cent de la population au chômage, le
capitalisme aurait alors à faire face à une masse prolétarienne
encore plus qualifiée, consciente et intraitable qu'actuelle-
ment.
Pierre CHAULIEU.
11. Cela apparaît clairement dans le récent livre de A. TOURAINE,
«L'évolution du travail chez Renault », sur lequel un article sera publié
dans le prochain numéro de Socialisme ou Barbarie.
115
Poznan
Les ouvriers polonais viennent de répondre à leur manière
au XXe Congrès. Tandis que dans le monde entier les diri.
geants communistes rusent pour contenir les formidables re.
mous que propage la déstalinisation, à Poznan, métallos et
cheminots ont formulé sans qu'on les y convie leur propre
critique qui est celle des armes : les ouvriers de l'usine Staline
ont débrayé le 28 au matin, tenu un meeting monstre, appelé
à leur aide les travailleurs des autres entreprises, et, après
avoir défilé en scandant « c'est notre révolution. Du Pain.
Démocratie. Liberté. A bas les bonzes » ils ont attaqué la pri.
son et les Bureaux des services de sécurité. Le très libéral
Cyrankiewicz peut bien insinuer que les révoltés sont des
ouvriers arriérés et le sinistre Courtade les traiter de chouans,
l'explosion de Poznan est trop forte pour qu'on puisse en
dissimuler le sens : les ouvriers ne s'accomodent pas de la
destalinisation ; il ne leur suffit pas que les dirigeants sacrifient
un ou deux de leurs anciens collègues terroristes et qu'ils
affichent une soudaine horreur de la dictature stalinienne, ils
veulent du pain, la liberté, la démocratie - bref ce qu'
toujours voulu les ouvriers dans tous les régimes d'exploita-
tion dès qu'ils sont entrés en lutte.
L'évènement de Poznan, que nous apprenons alors que
ce numéro de Socialisme ou Barbarie est en cours d'impres-
sion, confirme avec éclat les analyses qu'il consacre par ailleurs
au tournant russe. La déstalinisation constitue un effort pour
adapter les dictatures du bloc oriental aux conditions de la
production moderne, elle cherche à susciter une nouvelle adhé-
sion des masses aux régimes existants, elle cherche à com.
bler le fossé qui s'est creusé entre l'ensemble de la population
exploitée et la bureaucratie dominante mais dans le mène
temps elle rend ces régimes plus vulnérables, en exposant à
la critique des masses toutes les mesures totalitaires qui les
asservissent au nouvel Etat exploiteur. Tous les pays « com-
munistes » sont pris dans la même contradiction: ils ne peu-
vent connaître un développement positif qu'en associant lar-
gement les travailleurs à l'entreprise commune, qu'en obte.
nant leur coopération, mais les mesures prises en ce sens se
retournent contre leurs inspirateurs car les travailleurs uti-
lisent la parole qu'on leur accorde pour contester l'exploita-
116
.
tion, ils profitent des concessions qu'on leur fait pour fermuler
des revendications radicales. Depuis le XXe Congrès la presse
russe, hongroise, bulgare, tchèque et surtout polonaise s'est
faite l'écho de ces revendications pour les condamner: il est
apparu que pour beoucoup la déstalinisation devait signifier
la fin du stakhanovisme, une égalisation des salaires, une dé-
mocratie complète dans le Parti et les syndicats; et dans cha-
que pays les dirigeants ont du menacer les éléments « irres.
ponsables » qui protitaient de la situation pour mettre en
question la discipline officielle. Aujourd'hui ce sont des
dizaines de milliers d'ouvriers polonais qui disent ce qu'ils
pensent de la discipline en attaquant la police avec des mi-
trailleuses.
Comme nous l'indiquons également par ailleurs, l'oppo-
sition que risque de susciter le tournant russe peut être rapi.
dement beaucoup plus forte dans les démocraties populaires
qu'en U.R.S.S. même. Krouchtchev est en effet capable
d'accorder certaines concessions matérielles car le niveau de
la production russe lui permet d'améliorer les conditions de
vie des travailleurs et d'assouplir le régime du travail tout en
maintenant et en développant les privilèges de la classe domi.
nante. En Pologne, en revanche, comme dans les autres démo.
craties populaires, les exigences de l'industrialisation ne
permettent à la Bureaucratie que de faire des concessions
idéologiques et le nouveau cours ne se traduit par aucune
mesure économique effective.
L'écart entre les mesures politiques de déstalinisation et
l'aggravation des conditions économiques est sans nul doute à
l'origine des troubles de Poznan. On sait en effet que le P.C.
polonais a été le plus prompt i suivre la voie ouverte par le
XXe Congrès, qu'il a désavoué en termes violents la période
de la dictature stalinienne et procédé à une importante épu-
ration des cadres supérieurs. Le renvoi de Radkiewicz, sur-
nommé le Beria polonais, celui du ministre de la Justice,
Swiatkowski, celui du ministre de la Culture et des Arts So-
korski, celui des deux procureurs généraux; l'amnistie qui
comporte la libération immédiate de 30.000 prisonniers politi.
ques et la réduction de peine de 70.000 autres, la réhabilitation
de Gomulka et de Spychalski ont été de pair avec une série de
discussions publiques dans le Parti largement rapportées par
les divers organes de presse, Dans de nombreuses lettres ou
articles (dont France-Observateur citait le 3 mai d'intéressants
extraits), des militants n'hésitaient pas à comparer Staline et
Hitler, parlaient des années sinistres qui venaient de s'écouler,
faisaient une critique implacable du stakhanovisme et préco-
nisaient une gestion de la production par les syndicats, etc...
Mais, tandis que s'étalait au grand jour la critique des an.
ciennes méthodes de direction, l'absence de toute mesure en
117
faveur d'une amélioration du sort matériel des travailleurs ne
pouvait que devenir plus sensible. Comme le reconnaît aujour-
d'hui le président du Conseil sous la pression de l'insurrection,
les conditions de vie des ouvriers sont loin d'être satisfaisantes
et les revendications des ouvriers de Poznan hier rejetées par
le ministre de l'Industrie sont légitimes. De fait, le niveau
très bas des salaires et les prix élevés des denrées de base
mettent l'ouvrier polonais en mesure d'apprécier concrète-
ment la valeur des déclarations nouvelles des dirigeants sur
l'édification du socialisme.
On ne peut, à cet égard, que constater l'extraordinaire
similitude entre les évènements de Poznan et ceux de Berlin,
trois ans plus tôt. Dans les deux cas il y a eu à la fois une
tentative du gouvernement pour améliorer le climat psycholo-
gique et une aggravation de la situation pour les ouvriers. A
Berlin, l'on s'en souvient, la révolte avait été immédiatement
précédée de mesures de détente destinées à faire écho à
l'offensive de paix lancée par les russes et qui visaient à rassu-
rer les paysans, les catholiques et les commerçants et indus-
triels ; ces mesures avaient été accompagnées de la suppression
de certains avantages procurés jusque-là par la Sécurité sociale
et d'un relèvement des normes du travail de 10 %. A Poznan
la campagne gouvernementale de libéralisation va de pair
également avec un relèvement des normes et pour les ouvriers
de l'usine Staline avec une baisse de 30 % sur les salaires (1)
octroyés jusqu'à présent. Dans les deux cas la manifestation se
fonde au départ sur des revendications immédiates et les
transforme en insurrection contre le régime. Une catégorie
d'ouvriers plus directement visée par les mesures économiques
appelle les autres groupes de travailleurs à faire grève, trouve
un écho immédiat à sa protestation et prend la tête d'un
mouvement qui devient révolutionnaire. Dans les deux cas les
services de sécurité qui incarnent la puissance du régime sont
attaqués et les ouvriers brûlent les archives sur lesquelles ils
peuvent mettre la main. « C'est notre révolution... A bas les
bonzes », crient les Polonais selon les témoignages cités par
la presse, tandis que les Berlinois répondaient à Selbman,
ministre du gouvernement: « tu n'es plus un ouvrier, les vrais
communistes c'est nous ». Et comme si l'histoire voulait sou-
ligner symboliquement et ironiquement l'unité de la lutte des
ouvriers allemands et polonais contre le régime établi, c'est
de la Stalinallée dans un cas et des usines Staline dans l'autre
que part le mouvement insurrectionnel.
(1) La production des usines Staline, qui emploient trente mille
ouvriers, était jusqu'à ces temps derniers en grande partie réservée aux
besoins inilitaires, assurant ainsi des salaires supérieurs de 30 % à ceux
qui étaient octroyés dans le secteur civil. L'abandon des fabrications mili-
taires a entraîné un alignement des salaires sur les tarifs des autres
entreprises.
118
F
On ne saurait s'étonner que Cyrankiewicz forge le même
roman qu'Ulbricht pour expliquer le soulèvement ouvrier.
I.'insurrection ne serait que l'oeuvre des commandos de Foster
Dulles qui auraient été d'usine en usine pousser les ouvriers
à débrayer et les exciter contre le gouvernement en répandant
de fausses nouvelles. Il y a dans cette présentation des faits
un tel cynisme des dirigeants qu'on éprouve de la répugnance
à en discuter la vraisemblance. Il vaut seulement la peine de
remarquer que les dirigeants communistes révèlent dans leur
mensonge leur parenté véritable avec les dirigeants bourgeois,
car pour les uns comme pour les autres il ne saurait exister
une manifestation ouvrière contre le régime, qui ne soit artifi.
ciellement provoquée par des meneurs à la solde de l'étranger:
à Nantes la main de Moscou, à Poznan ou Berlin la main de
l'Amérique est censée bouleverser les situations. Mais les com-
munistes qui savent si bien démontrer, dans le cadre de la
France, qu'un mouvement d'une réelle ampleur ne peut
s'effectuer sans la volonté des masses, ne peuvent faire croire
impunément que des dizaines de milliers d'ouvriers se sont
battus pendant un jour entier (et sans doute plus) contre la
police, par la seule force magique qu'exerçaient sur eux d'ex-
membres de l'armée Anders.
Au reste, si l'on sait lire la langue stalinienne, on ne peut
se méprendre sur le caractère du mouvement. Quand Cyran-
kiewicz déclare que le gouvernement s'est appuyé dans sa
répression sur « la partie consciente de la classe ouvrière » on
comprend fort bien que la majorité « inconsciente » l'a com-
battu les armes à la main; quand il indique que les responsa-
bles sont des noyaux réactionnaires à la solde de l'étranger
et qu'il ajoute aussitôt que la déstalinisation va se poursuivre
et que le gouvernement doit tout faire pour améliorer les
conditions de vie des travailleurs, on comprend non moins
clairement que le gouvernement adjure le prolétariat de
renoncer à la lutte et de croire aux concessions qu'il lui
annonce (et de fait, en quoi la déstalinisation concerne-t-elle
les commandos étranger's?); de même quand le président du
Conseil assure que les ouvriers des usines Staline de Poznan
n'ont pas su, au dernier moment, que le gouvernement avait
donné satisfaction à leurs revendications, entend que celui-ci
n'a cédé que trop tard en présence de l'insurrection, ou bien
quand le communiqué affirme le lendemain des troubles que
« la plupart » des ouvriers ont repris le travail on conclut que
la grève se poursuit dans certains secteurs. L'évènement est là,
massif, qu'on peut bien enrober dans des commentaires jésui-
tiques mais qu'on ne peut dissimuler: il y a eu un soulève-
ment ouvrier d'une violence extrême et qui a été dirigé contre
le régime. Alors même qu'on prouverait que des éléments
réactionnaires organisés ont distribué des armes aux ouvriers
.
119
et tiré profit de leur lutte, on n'apporterait pas la moindre
explication des motifs pour lesquels le prolétariat s'insurge
contre un Etat qui prétend le représenter.
Que le P.C. polonais mente, ainsi que tous les P.C. d'Eu.
rope orientale qui reprennent sa version, que l'Humanité
mente encore un peu plus, par habitude et par vocation, on ne
saurait s'en étonner. Mais on peut considérer avec plus de
curiosité certaines réactions étrangères. Celle de la Yougosla-
vie d'abord, dont an admirera à cette occasion la brillante réin-
tégration dans le camp stalinien. Après avoir salué la lutte
des ouvriers allemands en 1953 pour la simple raison qu'elle
affaiblissait une démocratie populaire alors rivale, Tito
révèle maintenant son vrai visage (pour le plus grand malheur
de trotskistes ou gauchistes stupidement accrochés à ses bas-
ques depuis sa rupture avec Staline) en condamnant, comme
il convient à un chef d'Etat de le faire, une lutte purement
ouvrière : ainsi est-il précisé devant le monde entier que le
titisme est un mode de gouvernement parmi différents autres
possibles au sein du totalitarisme neo-stalinien et aussi étran-
ger que tout autre aux intérêts du proletariat. Certaines
réactions de la bourgeoisie sont également significatives ; tandis
qu'en France, par exemple, la droite salue encore dans les
ouvriers de Poznan conime elle saluait dans ceux de Berlin
des martyrs de l'anti-communisme, des éléments plus raison-
nables de la bourgeoisie anglaise - le député travailliste
Crossman, dans le Daily Mirror ou l'organe conservateur Daily
Mail considérent que les Polonais auraient mieux fait de
s'abstenir et de ne pas venir déranger inopinément le nouvel
ordre avec lequel la bourgeoisie peut s'entendre : ainsi com-
mence de s'affirmer une solidarité qui ne fera sans doute que
s'accroître par la suite entre les dirigeants de l'Est et de
l'Ouest également préoccupés de préserver l'ordre dominant
de toute menace du prolétariat.
De la révolie de Berlin à celle de Poznan un important
chemin a été parcouru. Si les deux évènements sont éminem.
ment comparables, leur signification n'en est pas moins sensi-
blement différente et l'on peut attendre du second des réper-
cussions encore plus importantes que celles que déclancha le
premier. C'est qu'entre juin 1953 et juin 1956 il y a eu le
tournant russe, la tentative d'obtenir un nouvel équilibre social
par un assouplissement de la dictature et celle de
celle de promouvoir
des relations pacifiques fondées sur le statu quo à l'échelle
mondiale. On peut penser que Berlin a, dans une certaine
mesure, contribué à imposer cette nouvelle politique. Poznan,
en pleine période de déstalinisation, en consacre les contra-
dictions et dévoile que l'hostilité des ouvriers à la Bureau-
cratie est renforcée et multipliée par les mesures qui visent
à la désarmer.
120
LE MONDE EN QUESTION
DE JANVIER A JUIN
Mollet fait la guerre après avoir dit qu'il ne le ferait pas
et tout en réaffirmant qu'il envoie les rappelés sur un front
de paix, réduit comme le parti socialiste le fut dix fois dans
l'histoire, à fournir une politique de secours quand la droite
ne peut, sans mettre le feu aux poudres, appliquer en personne
la sienne propre.
Le Gouvernement avance dans les ténè.
bres, sans chance que la guerre aboutisse, suscitant à chaque
pas une résistance plus étendue d'un peuple entier qui n'a rien
à perdre, tant il fut dépouillé. - Chaque jour s'accroît l'hos-
tilité de ceux qui tirent la sonnette d'alarme dont on loue dans
les discours du dimanche le sens du devoir et l'émouvante
gravité comme si la tragédie se dénonce par la farce.
Seul réconfort du Gouvernement, l'embarras des autres, non
moins grand que le sien, et qui s'accroît aussi au point que
chacun crie de plus en plus fort, tient congrès et vit seulement
des erreurs du voisin. La droite condamnée à voter l'impôt,
enchaînée au Gouvernement qui la sert, reste incapable de
regarder en face l'avenir interminable de la mobilisation.
Mendès France voué à l'opposition impossible après avoir été
l'impossible complice, souhaite la bonne chance à la calas-
trophe qu'il prévoit et son parti d'une seule voix le félicite de
quitter son poste et ses autres ministres de rester au leur.
Thorez ruse, quête les pétitions, mobilise les porte-plumes
contre les armes, proteste mais ne veut rien faire qui compro-
mette la chaâce de l'alliance socialiste, la grande chance du
réformisme national. - Le formidable choc donné par la dé-
stalinisation n'en finit pas de se propager, ébranlant le mythe
sacré de l'U.R.S.S. et du génie des dirigeants, bousculant les
Staline en herbe des Démocraties populaires, invertissant la
vérité d'hier, obligeant dans le même temps à relâcher la disci.
pline et à menacer les douteurs, déchaînant le premier scan.
dale d'une divergence publique entre l'U.R.S.S. et les partis
nationaux et remettant le monde en question.
121
I'ECHANGE DES ROLES
OU LA POLITIQUE DU GOUVERNEMENT EN ALGERIE
Guy Mollet a obtenu de l'Assemblée sa « seconde investiture ».
Devant l'urgence du problème algérien, une majorité hétéroclite a
prétendu faire silence sur ses divergences, ignorer les critiques qu'appe.
laient, à ses yeux, les autres aspects de la politique du gouvernement
pour permettre au président du conseil, en fait à son ministre résidant,
de poursuivre leur action. Si le gouvernement n'a pas « sauté », c'est à
la politique qu'il mène en Algérie qu'il le doit. Et pourtant, à la lecture,
au jour le jour, des journaux, on pourrait douter qu'il ait, en ce domaine,
une ligne de conduite définie, une « politique » véritable. Ce n'est là
qu'une illusion, que l'attitude équivoque, puis la démission qui ne le
fut pas moins de Mendès-France ont renforcée, mais que chaque jour
dissipe un peu plus : le gouvernement de Front Républicain, dirigé par
le secrétaire général (en congé) du Parti Socialiste, applique aujourd'hui
en Algérie la politique que la Droite eût été dans l'incapacité de mener
et dont jamais elle n'eût osé espérer que des socialistes se chargeraient.
Lorsque Guy Mollet constitua son gouvernement, nul ne doutait,
même en Algérie, que celui-ci allait s'engager dans la voie des négo-
ciations, en vue non pas, certes, de « régler » le problème algérien mais,
simplement, de faire la trève. A cela la Droite française était presque
résignée ; davantage : consentante. Huit jours suffirent pour que l'homme
se révélât tout entier. « Je ne suis pas un lâche, c'est moi le patron»,
déclarait-il fièrement, le 2 février, aux membres de la délégation du
« Comité directeur des élus 'd'Algérie ». Le Figaro lui-même attendait
qu'il imposât sa loi aux Français d’Algérie. Vinrent les tomates et les
pierres du 6 février, et sa lamentable capitulation. Il ne nous fut rien
épargné de ses plaintes, de son étonnement attristé, ni, un peu plus tard,
de son amertume et de ce découragement dont L'Express dit joliment
qu'il le différencie des hommes de droite (que la perspective d'une
guerre surtout si d'autres la font pour eux n'effraie pas). Le choc
ait été trop rude pour cet homme qui s'employa, dès lors, à nier
obstinément la réalité. Tandis que Lacoste faisait le nécessaire c'est-
à-dire la guerre pour s'assurer l'indulgence de la population euro-
péenne, Guy Mollet s'abandonnait à un intense bavardage mystificateur,
multipliant de pseudo-appels en vue d'un cessez-le-feu et affirmant qu'il
était inutile de procéder à des rappels de disponibles. Lors du débat
sur les pouvoirs spéciaux qui ne furent votés par la droite que parce
que celle-ci savait que seuls des socialistes pouvaient les obtenir, et
qu'elle espérait bien, comme le laissa entendre assez cyniquement Kenig,
pouvoir un jour en user elle-même, le président du conseil eut
quelques expressions heureuses qui révélèrent qu'il était assez conscient,
somme toute, de la fiction. Mais il persistait encore à vouloir élever
celle-ci au rang de politique et s'efforçait d'y entraîner les interlocuteurs
dont il rêvait : « Notre solution, déclara-t-il le 9 mars, peu avant le
vote, repose sur la reconnaissance et le respect de la “personnalité algé.
rienne”... Quant au contenu de ce terme, ce n'est pas à moi de le fixer :
il sera arrêté d'un commun accord ». Et cette autre phrase, où déjà
s'annonçait la politique dont nous verrons qu'elle est aujourd'hui celle
de son gouvernement : « Nous maintiendrons des liens indissolubles,
mais ils seront librement négociés et acceptés ». L'équivoque n'était
donc pas encore levée : de même qu'à Alger, Lacoste croyait impres.
sionner les colons en jouant les Bugeaud, Mollet, à Paris, cherchait à
répondre aux critiques dont il était l'objet au sein de son propre parti,
à surmonter la résistance que devaient susciter les décisions militaires
qu'il savait proches, en mimant une politique de paix, simulacre auquel
il demandait de masquer la réalité. « Dire la vérité au pays, telle est
ma préoccupation constante », déclarait-il le 14 avril, à quelques jours
122
1
+
+
à peine du décret de rappel des disponibles dont il prétendit jusqu'au
dernier jour qu'il n'était sans doute pas nécessaire. Il y avait là double
jeu bien sûr, mais aussi incapacité réelle de jouer le rôle qu'ils avaient
eux-mêmes choisi sans que personne ait songé à le leur proposer. Ce rôle,
ils ne pouvaient sinon à leurs propres yeux, du moins à ceux de leurs
amis accepter de l'assumer qu'en s'accrochant désespérément à certains
mythes dont la Droite, elle, n'était point dupe : ainsi des « réformes
profondes » annoncées, des « élections » qui devaient suivre le retour au
calme. Mais les critiques de Mendès-France dont l'échec (définitif ?)
est aujourd'hui celui de la bourgeoisie « intelligente »
si elles ne
rencontraient guère d'écho au sein du parti dont celui-ci se dit le chef,
traduisaient les inquiétudes de nombreux députés socialistes et même de
certains milieux de droite que l'aggravation de la situation en Algérie
et les conséquences du rappel de trois classes effrayaient. Exfroi sans
doute partagé par Guy Mollet lui-même. Celui-ci choisit alors, pour un
temps, de ne plus « dire la vérité ». Il se réfugia dans l'énigme, et son
tiède bavardage, toujours aussi abondant, se fit plein de sous-entendus.
A. ceux qui, dans son propre parti, réclamaient l'ouverture immédiate
de négociations, et dont il ne pouvait en dépit des astuces de procédure
ignorer l'opposition, il répliquait le 25 avril : « Dans moins de trois
semaines, je vous infligerai peut-être l'affront d'un cessez-le-feu ». Etait-ce
là la preuve, comme on feignit à l'époque de le croire, que des négocia-
tions secrètes étaient en cours, que Ferhat Abbas était parti au Caire
avec l'accord du gouvernement, et que Gorse, conseiller socialiste de
l'Union française, qui s'était rendu deux fois en Egypte au mois d'avril,
avait été chargé de prendre des contacts ? Il semble bien aujourd'hui
qu'il n'en ait rien été, et que Lacoste avait le droit de déclarer, le
28 ayril : « Si on a parlé d'éventuelles négociations, cela ne vient pas
de chez nous. Ces bruits sont lancés par les rebelles et par ceux qui
les soutiennent. Comme moi-même, le président du conseil a compris
qu'il ne peut être question de négociations qui feraient des Français
vivant sur cette terre des étrangers. Pareille idée ne peut exister ».
Non, l'important M. Gorse n'avait pas pour mission de négocier, mais
seulement d'aller « flairer » les dirigeants du F.L.N. De même que les
appels solennels en vue d'un cessez-le-feu, ses voyages étaient destinés
avant tout à camoufler l'absence de négociations véritables, à gagner du
temps jusqu'à ce que la politique de force « réussisse » et le découra-
gament gagne les musulmans. Mais Guy Mollet jouait encore au « poli-
tique », à celui qui dans les coulisses tire les ficelles. Ce que la Droite,
à laquelle il donnait à part cela toutes satisfactions, ne pouvait tolérer.
Les modérés s'interrogèrent : le Parti Socialiste n'était-il pas en train de
leur jouer une « fable de Pénélope », « détruisant dans les coulisses la
politique nationale qu'il faisait au grand jour ? » Ce n'était certes pas
le cas : mais on pouvait encore prétendre que la Pénélope socialiste
attendait le retour d'Ulysse, et quelle croyait même le hâter par la
pratique de cette « politique nationale ». «M. Robert Lacoste pense que
dans deux semaines
au 15 mai
les dispositifs militaires seront en
place. Il considère que les rebelles ont été surpris par l'énergie de la
réaction métropolitaine et qu'ils sont prêts à négocier » (L'Express, 4 mai).
Si donc vers le 15 mai, en position de force » sur le plan militaire,
le gouvernement décidait d'ouvrir des pourparlers pour un cessez-le-feu,
on considère qu'il n'y aurait pas de refus de la part des « rebelles ».
Ulysse plus simplement l'interlocuteur se trouvait, selon L'Express,
au Caire. Tel n'était pas l'avis de Mollet et Lacoste lesquels, selon
Le Monde du 27 avril, étaient tombés d'accord pour « considérer que
le ralliement du leader nationaliste Fehrat. Abbas au Front National
de Libération levait l'équivoque qu'il entretenait lui-même sur sa posi.
tion à l'égard de la France : moralement prisonnier du F.L.N., il perdait
tout droit à parler au nom des musulmans d’Algérie ». Ceux-là espéraient
donc un tout autre Ulysse et le fameux « interlocuteur valable » devait
-
123
n'avoir jamais quitté sa maison. En attendant qu'il se manifeste, et pour
y aider, il fallait multiplier les effectifs (« Plus ils seront importants,
moins il y aura d'effusion de sang »), jeter en prison les libéraux, et
séduire davantage encore les Français d’Algérie.
Ainsi, tout doucement, s'acheminait-on vers l'abandon des fictions
développées jusque là par Guy Mollet. Si celui-ci avait longtemps cru
possible de camoufler l'action réelle de Lacoste, et d'attendre, fasciné,
cette attente avait entraîné les conséquences les plus graves, celles-là
mêmes que les « ultras » n'osaient espérer, et la situation devint d'un
mot qu'affectionne particulièrement le président du conseil < irré-
versible ». Cependant, loin que la rivalité entre les différentes tendances
de la résistance algérienne ait entraîné la désagrégation de celle-ci,
l'attitude dų gouvernement eut pour résultat l'unification du mouvement,
et, comme le souligna le Dr Ahmed Francis, membre du comité direc-
teur de l'U.D.M.A., la disparition de toute possibilité de médiation de
la part d'un groupe modéré. « Les choses, déclara celui-ci lors de l'arrivée
au Caire de Fehrat Abbas, sont aujourd'hui sorties de nos mains ». A
force de déclarer qu'il n'existait en Algérie aucun porte-parole autorisé,
on avait réussi à faire apparaître un front unifié : «Valables ou non,
titre L'Express, les interlocuteurs sont là ». Cela, chacun le sait, et c'est
bien pourquoi plus personne aujourd'hui, sauf Mollet, n'envisage de
dialogue. Nul ne l'écoute plus lorsqu'il parle d'élections générales qui
permettraient aux « interlocuteurs valables » de se révéler, avec lesquels
serait discuter le statut futur. Lacoste rassure la Droite : « Les Français
régleront eux-mêmes le problème algérien ». Nous voici donc revenus
au stade qu'en janvier chacun jugeait dépassé : on envisage d'octroyer
des réformes, de définir un statut « original » qui sera ensuite soumis
à l'assentiment des Algériens. On sait ce que cela signifie et quelle sera
l'alternative proposée imposée aux musulmans. Un pas, pourtant,
a été effectué que seuls des socialistes pouvaient accomplir, et qui
donne aux projets de Lacoste tout leur sens : on s'est enfin décidé à
faire la guerre. Il se trouve tant pis pour les secrets espoirs do
Mollet que les « rebelles » ne semblent guère disposés à se plier à
ce chantage : chaque jour la résistance se fait plus acharnée, chaque
jour, pour reprendre les termes de la Commission de la Défense Natio.
nale, l'armée s'installe davantage dans la guerre. Le « socialiste » Lacoste,
citant Gallieni et Bugeaud, aftirme qu'il balaiera tous ceux, quels qu'ils
soient, qui s'opposeront à son action. Mieux : il s'en prend à la droite
elle-même, à Pinay, à Faure, qui, effrayés sans doute par son zèle, ont
l'aplomb d'envisager une approche politique du problème. Il gagne
précipitamment Paris et leur impose de solennelles rétractations Il ne
manquerait plus que l'échange des rôles aille jusqu'au bout, et que
Pinay prône la négociation... Robert Lacoste tient à ce que les choses
soient parfaitement claires ; accordons que sur ce point il å gagné : les
masques sont tombés, et chacun sait à présent de quoi lui et quelques
autres sont capables. On s'attendait au pire... une fois de plus, la réalité
dépasse la fiction.
M. BLIN.
« Certes, nous aurions pu recourir à des gestes ostenta.
toires, comme le rappel de classes. Je tiens à dire que les
ressources présentes de la France en hommes sont large.
ment suffisantes, dans l'état actuel des choses, pour répon.
dre aux besoins. »
(Guy MOLLET : Discours au déjeuner offert par le
Syndicat des Quotidiens Régionaux, 16 mars.)
124
LE CHOC PSYCHOLOGIQUE
Lorsqu'après la démission de Mendès-France le groupe radical de
l'Assemblée trouva moyen de voter une résolution dans laquelle il «ren.
dait hommage » au démissionnaire et « faisait confiance » au gouverno-
ment et aux ministres radicaux qui y sont restés, il n'y avait pas de
quoi s'étonner. Pouvoir être dans le plus grand nombre de combines
possible à la fois a été traditionnellement le capital politique principal
du radicalisme.
Mendès-France avait-il, a-t-il une politique algérienne différente de
celle de Mollet · Lacoste ? On svait qu'il avait approuvé et soutenu ce
qui constitue l'essence de cette dernière : le rappel des disponibles et
l'intensification des opérations militaires. Ce qui l'en différenciait, était,
disait-il, l'idée d'une « concomitance » entre l'action militaire et l'action
politique. Sur le contenu de cette « action politique », on nous laissait
sur notre faim.
Huit pages de L'Express du 15 juin 1956 sont consacrées au « docu.
ment attendu Mendès-France : on peut sauver l'Afrique ». Mais le
lecteur qui aura cru que Mendès-France a démissionné du gouvernement
pour être libre d'exprimer son opinion sur les erreurs de la politique
actuelle, comme le lui apprend ce même Express, et qui cherchera la
définition d'une politique, risque d'être déçu. Il ne trouvera qu'un résumé
de l'habituelle critique de la presse libérale sur la politique coloniale
de la France : les promesses qui n'ont pas été tenues, « un dialogue :
avec qui ? », le « ressort comprimé jusqu'à ce qu'il fasse tout sauter »,
« les mêmes policiers... les mêmes caïds corrompus maintenus en fonc.
tion », « la leçon d’Indochine », etc. Il y trouvera des pudeurs exquises :
« On parle aussi souvent d'une réforme agraire. Je n'entrerai pas dans
le détail », et des impudeurs grossières : « Mais avant tout je veux évo.
quer cette jeunesse française, une fois encore appelée au combat, et qui
répond avec un magnifique sens du devoir, avec une émouvante gravité,
à l'appel qui lui est adressé ».
Il y trouvera aussi le secret du mendessisme : « Créer là-bas le choc
psychologique indispensable pour rétablir le dialogue interrompu ». La
formule éculée essaie en vain de masquer le vide des velléités réfor.
matrices de Mendès-France et les contradictions insurmontables qui le
rendent incapable de définir une politique réelle quelconque. Face
aux problèmes qui mettent à feu et à sang un pays de dix millions
d'habitants, le laborieux pensum de Mendès France n'apporte qu'un
choc celui du dérisoire.
P. L. K.
L'OPPOSITION IMPOSSIBLE
« Nous avons eu (a déclaré le leader radical après avoir
remis sa démission) une explication très franche et très
loyale, dont je me réjouis, à l'issue de laquelle j'ai dit
au président du conseil que je considérais que le gouver.
nement qu'il préside représente à l'heure actuelle la meil.
leure formation politique possible. De tout cour,
je
souhaite son succès. »
(Déclaration de Mendès-France à la presse, reproduite
par Le Monde, le 24 mai.)
C'est Gilbert Jules, c'est Bourgès-Maunoury, c'est Max Lejeune,
c'est Tinguy du Pouet, c'est aussi Mendès-France, et dix autres qui,
dans les discours du dimanche, louent les jeunes rappelés et se félicitent
de leur moral excellent.
125 -
LA REALITE
Venant de Vannes, les rappelés du 117° RI.C. en route
pour l’Algérie arrêtent en gare de La Rochelle le train
qui les transportait... En gare de Villeneuve-Saint-Georges,
le train partant en direction de Marseille a été arrêté pen-
dant une heure... Une manifestation s'est déroulée en gare
de Tours où devaient partir des rappelés de la base 109
(L'Humanité, 3 mai). De la gare de Valdahou à la
gare de Besançon, le convoi a été stoppé plusieurs fois, les
soldats ayant tiré les signaux d'alarme... A Beaurepaire
(Isère), dans la nuit de mardi à mercredi, un train de
rappelés a été stoppé pendant une heure par 500 personnes...
En gare de Lézignan (Aude), un train qui transportait vers
Marseille des militaires a été stoppé pendant vingt minutes
par des manifestants... Pendant plus de deux heures,
1.200 travailleurs de La Rochelle et 900 soldats du 117° R.I.C.
ont manifesté (L'Humanité, 4 mai). 500 soldats manifes.
tent près de Limoges (L'Humanité, 8 mai). En gare de
Grenoble, pendant six heures, de 18 h. à minuit, débordant
le service d'ordre, plusieurs centaines de personnes ont blo-
qué la gare, puis les différents passages à niveau... une
cinquantaine de blessés, 51 arrestations (Le Monde, 20 mai).
Un train spécial de rappelés a été immobilisé pendant
plusieurs heures la nuit dernière à Bar-le-Duc... On s'aper.
çut que profitant de l'arrêt les militaires avaient dételé
plusieurs wagons (Le Monde, 24 mai). A Questembert,
dans le Morbihan, l'express Quimper-Paris a été bloqué par
des rappelés qui avaient tiré le signal d'alarme... A Greno
ble, le train 4326 venant de Chambéry est entré en gare
avec plus d'une heure de retard. D'autres incidents sans
gravité sont survenus à Ambérieu (Ain), à Domeney et
Voiron (Isère), au Fayet à Cluses (Haute-Savoie), à Blesle
(Haute-Loire), à Lyon, à Vendôme et à Nice. Entre Carcas-
et Narbonne, de jeunes rappelés ont provoqué à
dix-sept reprises l'arrêt du train Bordeaux-Lyon (Le Monde,
30 mai). Un nouvel incident a été provoqué hier en gare
de Dijon Porte-Neuve au passage du train de rappelés (Le
Monde, 24 mai). Le départ du rapide Paris-Vintimille a
été retardé de trois heures samedi soir en gare de Lyon...
A Villeneuve-Saint-Georges, des rappelés de l'armée de læir
descendus d'un train se sont dispersés samedi soir sur les
voies de la gare de triage (Le Monde, 5 juin). Des
permissionnaires et des rappelés ont retardé hier soir mardi,
à la gare d'Austerlitz, le départ du train de Bordeaux (Le
Monde, 7 juin). 2.000 personnes ont manifesté hier au
Havre contre le départ de jeunes pour l'Algérie (Franc-
Tireur, 8 juin). 400 rappelés manifestent au camp de
Mourmelon... 1.200 rappelés manifestent à Libourne (L'Hu-
manité, 11 juin), etc.
sonne
LE COMMENTAIRE DE LA REALITE
« Le gouvernement, qui se plaint si souvent des journaux,
a de bonnes raisons, hélas ! de savoir combien il doit leur
être reconnaissant, au contraire, de cacher la partie la plus
douloureuse, la plus angoissante des informations qui leur
parviennent.
126
« La presse de droite parce qu'elle a le plus grand intérêt
à mentir par omission, la presse de gauche à l'exception
des communistes, et encore... parce qu'elle a un réflexe
de pudeur et de profond patriotisme, l'une et l'autre mini-
misent, cachent le plus possible, et taisent le plus souvent
les manifestations auxquelles donnę lieu le départ des jeu-
nes rappelés, et surtout les difficultés individuelles crois-
santes auxquelles se heurte cette mobilisation.
« Le gouvernement, lui, qui doit être parfaitement informé
sur la nature et l'étendue du sentiment de révolte qui se
développe, et sur les conséquences infiniment graves qu'il
entraîne dans certaines régions, en plein coeur du pays,
ne peut pas manquer d'être impressionné. »
(Editorial de L'Express du 8 juin, le jour même où
Mendès-France évoque en termes nobles le moral de
la jeunesse.)
LE P.C. ET L'ALGERIE
nement
L'attitude du P. C. français en ce qui concerne la guerre d'Algérie
a remué l'opinion et tous les courants politiques. Elle a frappé d'éton-
une bonne partie de la droite classique. Quant à la classe
ouvrière dans son ensemble, elle a réagi par une opposition sourde.
Et pour une fraction plus restreinte de cette dernière, le vote des pou-
voirs spéciaux et la suite des positions prises par les staliniens ajoute
à la colère et à l'indignation la nette compréhension que la manouvre
et la tactique tortueuse remplacent la défense des principes révolution.
naires élémentaires.
La lutte spontanée qui se développe contre les rappels de contingents
et la guerre elle-même est un retour à l'esprit de classe qui pousse les
ouvriers à s'exprimer à leur façon dans les grands problèmes politiques
de l'heure. Qu'on songe au poids énorme de l'appareil bureaucratique
syndical et politique dont disposent les « Communistes français » et l'on
comprend pourquoi les débrayages ne sont restés que des arrêts très
limités dans la plupart des cas et que la volonté de grève a souvent
été canalisée vers des moyens anodins et inefficaces tels que les délé-
gations à la Présidence du Conseil. Le freinage habile et constant de
toute les réactions des ouvriers a fait le pendant à la casuistique et à
l'utilisation des arguments subtils du double jeu dans lesquels sont passés
maîtres les Thorez, Duclos et consorts depuis quelques lustres.
Ce jésuitisme vise à donner des explications aux militants et aux
ouvriers sur la juste ligne du Parti. En votant les pouvoirs au gouverne-
ment Guy Mollet, le P.C. préserve celui-ci, assure-t-il, de la tentation de
faire une politique de droite et en ne compromettant pas l'unité d'action
des communistes et socialistes il parviendra à imposer rapidement le
cessez-le-feu et l'ouverture des négociations sans lesquelles le problème
algérien ne pourra être réglé. (J. Duclos, à l'Assemblée Nationale, le
13 mars.) Il faut rappeler les positions de principe qu'ont toujours eues
les staliniens sur le problème depuis au moins vingt ans pour compren-
dre celles qu'ils affichent aujourd'hui.
Déjà en 1939, lorsque Thorez coiffé d'une superbe casquette revint
d'une tournée de propagande auprès du squelettique P.C.A., il souligna
les liens qui unissent l'Algérie et la France et sans mettre le moins du
monde l'accent sur les spoliations, l'oppression et l'arbitraire qui est la
règle impérative du fonctionnement de tout système colonial, il souhaita
par une formule vague l'indépendance de l'Algérie dans une alliance
étroite avec la France. Au lendemain de la deuxième guerre mondiale,
le P.C. participant au gouvernement tripartite à la suite de tous les
abandons successifs de ce qui restait en lui de parti ouvrier fut bel et
bien complice, pour ne pas dire exécutant, du massacre de Sétif. L'illus-
127
nous
tre Tillon, rejeté depuis hors de « l'Eglise » commo hérétiquo, était
ministre de l'Air du gouvernement de Gaulle et représentait le parti.
Nulle protestation, nulle démission lors des bombardements du Cons.
tantinois qui firent 45.000 victimes. Les Algériens avaient eu la naïveté
de croire aux promesses « démocratiques » faites au moment où, se
trouvant dans une « sale passe », l'impérialisme français avait besoin de
convaincre les troupes coloniales leur intérêt à défendre la démo.
cratie et les principes républicains contre le nazisme. Au lieu de faire
comme par le passé, à l'aide de menaces et de violences, des prélève-
ments massifs de contingents «bicots », les déclarations sur le nouveau
statut de l'Algérie furent largement prodiguées pour arriver au même but.
Cette suite de positions éclaire mieux la déclaration du Bureau Poli-
tique du P.C.F. du 3 mars 1956 qui dit : « Nous sommes pour l'existence
et pour la permanence de liens politiques, économiques et culturels
particuliers entre la France et l'Algérie. Nous pensons que c'est à tout
point de vue, l'intérêt des deux pays, l'intérêt du peuple de France et
du peuple d'Algérie, y compris l'immense majorité de ses habitants
d'origine européenne. Mais le maintien des liens souhaitables entre la
France et l'Algérie n'est possible que si le peuple algérien peut en
décider librement ».
En assortissant les deux premiers paragraphes, on ne peut plus
clairs, au troisième, on pratique le double jeu. Voyons, dit le P.C., en
se tournant vers la bourgeoisie : nous voulons que l'Algérie reste fran-
çaise, c'est l'intérêt national, « nos intérêts économiques sont en jeu »
et, se retournant hypocritement vers les Algériens, et la classe ouvrière :
sommes fidèles au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et
nous demandons que vous puissiez décider librement de ces liens solides
qui vous attachent à la France.
La crainte du P.C. de se voir traité de séparatiste et de parti anti-
national est si forte qu'elle lui fait dire :
«La poursuite de la guerre en Algérie, non seulement ne peut rien
régler, mais elle fera tout perdre à la France. Une telle politique ruine
les positions de la France... La tradition séparatiste des colonialistes
témoigne d'ailleurs que pour eux le patriotisme n'est qu'un mot dont
ils se servent pour masquer leurs intérêts de caste ».
On ne peut s'empêcher de rappeler, car la presse n'est évidemment
pas disposée à attaquer le P.C. sur ce terrain, que les staliniens parti.
cipaient au gouvernement au début de la guerre d'Indochine et que
leur départ de celui-ci n'a pas été, loin de là, causé par leur opposition
à ce que ils ont appelé par la suite la « sale guerre » ; il l'a surtout
été par le durcissement des rapports internationaux et la nécessité
pour le P.C. français de quitter la machine gouvernementale sous peine
de risquer la perte de son influence sur les masses.
De toute façon, dans les sept années qui suivirent, leur lutte contre
la guerre coloniale d’Indochine n'a jamais été qu'une suite d'escarmou.
ches plus ou moins violentes et non pas un combat sur le fond dressant
résolument la classe ouvrière contre la guerre elle-même et surtout contre
le régime qui la faisait. Il est clair que l'activité considérable déployée
pour les pétitions de Stockholm et pour les innombrables délégations
au gouvernement n'a servi qu'à dériver l'énergie des militants et sympa.
thisants.
En rappelant ces diverses attitudes du passé face au probleme
colonial, notre propos est de souligner la contradiction dans laquelle
se meut le P.C.F.: apparaître, d'une part, comme un parti national,
* raisonnable », ne désirant pas bouleverser les structures fondamentales
de l'exploitation traditionnelle de manière à obtenir la collaborathon
d'une fraction de la bourgeoisie ; d'autre part, se donner l'allure d'un
parti ouvrier défendant des positions révolutionnaires en vue de conser-
ver l'appui indispensable du prolétariat.
C'est à l'occasion des derniers événements et notamment du vote
128
des pouvoirs spéciaux que se manifeste au mieux cette contradiction.
La plate-forme électorale du P.C. pour les élections du 2 janvier avait
été, commo on sait, axée presque essentiellement sur le thème du Front
Populaire. Les staliniens prétendent croire qu'une réédition de 1936 est
possible et préconisent à cet effet l'unité d'action avec les socialistes et
les « républicains » dans un style encore plus opportuniste et réfor-
miste qu'il y a vingt ans. Abandonnant de nouveau leurs critiques sur
la social démocratie dans son ensemble, ils édulcorent leur programme
en y enlevant tout ce qui pourrait chóquer leurs partenaires éventuels.
Dès la constitution du nouveau gouvernement, le P.C. « colle » à
la politique menée par Guy Mollet. Et Martinet, dans France-Observa-
teur, donne la formule de leur politique : « le P.C. veut se faire admet-
tre par ses partenaires parlementaires ».
Les communistes ne peuvent cependant être dupes des affirmations
de Mollet qui accepte de constituer un gouvernement dont la politique,
dès le début, et surtout depuis le 6 février, n'est que l'application de
plus en plus ouverte de la ligne des colonialistes.
Leur tactique soutenir le gouvernement pour qu'il traduise « ses
promesses en actes » ou qu'il ne soit pas « prisonnier de la réaction >
se heurte aux faits : le gouvernement multiplie les déclarations équi-
voques et donne des gages à la droite sur la nécessité de la répression.
Les travailleurs sont rapidement mis à même de s'apercevoir que les
slogans pacifiques du Front Républicain ne valaient que pour la période
électorale. Toutefois l'indignation vise en premier lieu l'attitude des
socialistes. Il s'avère une fois de plus qu'à l'instar de Noske ils ne sont
bons qu'à exécuter la besogne que la réaction n'est pas capable de faire
elle-même. Le P.C. qui les aide objectivement à accomplir cette tâche
se justifie plus aisément en affirmant qu'il empêche Mollet d'être l'otage
de la droite. En outre, il explique quotidiennement que sa position lui
permet seule de réaliser une unité d'action à la base avec les inilitants
socialistes. Comme cette unité, dit-il, n'est possible que s'il s'abstient
de, critiquer les dirigeants du P.S., il recommande une opposition pru.
dente à la guerre.
Cette dialectique subtile culmine avec le vote des pouvoirs spéciaux
que Duclos commente en ces termes : « Pour éviter que le gouvernement
soit prisonnier de la réaction, nous votons les pouvoirs spéciaux et
notre vote préservera les possibilités d'action et permettra d'aboutir au
cessez-le-feu et à la négociation pour faire du peuple algérien un ami et
allié de la France ». Mais la situation créée par ce vote devient de plus
en plus embarassante pour le P.C. La distance qu'il a parcourue depuis
janvier l'expose lui aussi au mécontentement des masses. A cette époque,
il déclarait (le 6 janvier) : « Alors que Edgar Faure s'apprête à envoyer
140.000 hommes en Algérie, nous devons empêcher ce crime et nous le
pouvons... il existe à l'Assemblée une majorité de députés capables de
une base d'accord pour arrêter les opérations militaires en
Algérie. Il serait scandaleux que dans de telles conditions le gouverne-
ment Ed. Faure achemine en Algérie de nouveaux renforts. Il est pos-
sible de le lui interdire ». Maintenant que Mollet approuvé par l'Assem.
blée et les communistes mobilise des classes, le P.C. est fortement attaqué
par les sympathisants et les militants de base qui ne comprennent pas
ses acrobaties. Thorez doit reconnaître ce mécontentement dans son inter-
vention au Comité central du 9 mai : « Naturellement quelque émotion
s'est manifestée dans le parti à la suite de ce vote », déclare-t-il. Le
Parti ne
cesse de multiplier les explications sur le soutien donné à
Mollet et fournit des gages de son opposition à la guerre en faisant une
place plus large dans L'Humanité aux manifestations contre la mobili.
"sation et aux débrayages. Mais sur le fond, sa position demeure inchan.
gée. Il s'agit de faire signer des pétitions, d'envoyer des délégations au
Palais Bourbon, de faire des arrêts de travail d'un quart d'heure dans
les usines. Rien de plus. Il ne faut à aucun prix organiser et développer
trouver
129
la lutte. Cette prudence apparaît bien par exemple à l'occasion du
meeting anti-colonialiste de Wagram, le 25 avril, que L'Humorité mini-
mise le lendemain dans ses colonnes ; elle apparaît surtout à l'occasion
des manifestations de rappelés. Dans la plupart des cas en effet, notam-
ment à Grenoble et à Saint-Nazaire, où de violentes bagarres ont éclaté
entre manifestants et C.R.S., le P.C. n'est en rien l'organisateur du
mouvement. Les militants « responsables » ont la seule charge de freiner
l'ardeur de ceux qui veulent agir et, selon la formule consacrée, de les
« mettre en garde contre les provocations ». On peut croire sur parole
Duclos quand il affirme à la Chambre, le 16 mai, que le parti n'est pas
responsable des troubles : « Les réactionnaires tentent de faire croire
que ces manifestations sont artificiellement suscitées. A la vérité, si on
assiste à la généralisation de telles manifestations, c'est parce que le
peuple désapprouve la guerre d'Algérie et personne ne peut rien contre
un tel mouvement de masse ». Personne ne peut en effet persuader que
la guerre est la paix et que les dirigeants socialistes doivent être ména-
gés tandis qu'ils mobilisent. Duclos est le premier à le savoir.
L'embarras du P.C. s'accroît quand la politique gouvernementale est
de nouveau soumise à l'Assemblée au début juin. Leur chance serait
que l'ordre du jour accepte de dissocier la question algérienne des
autres aspects du programme de manière à témoigner de leur soutien
au gouvernement en se désolidarisant seulement de la guerre. Mais la
résolution de Guy Mollet de ne rien dissocier, qui prouve bien le peu
de cas qu'il fait de l'unité d'action prônée par le P.C., rejette celui-ci
dans une abstention volontaire, une fois de plus destinée à ménager et
les masses qui ne comprendraient pas un ralliement et la bourgeoisie
qui dénoncerait aussitôt le séparatisme du P.C. L'abstention ne fait
donc que prolonger le jeu équivoque du P.C. qui se poursuit pendant
des mois, mais sans faire autre chose qu'aggraver les difficultés du P.C.
Quelles que soient les explications qu'il fournit aux massës, il ne parvient
pas à ranimer leur confiance par cette demi-mesure ; quelle que soit la
servilité dont il témoigne envers le gouvernement, il est traité en oppo-
sant. Il est vrai cependant que cette contradiction, aussi périlleuse qu'elle
soit, est encore utilisée par lui. Quand le gouvernement attaque le P.C.,
quand il saisit L'Humanité par exemple, il lui redonne une allure
combattante ; il apparaît aux yeux de l'opinion comme le Parti victime
de la Répression, comme la seule grande force qui résiste à la politique
de guerre. Quand les ouvriers manifestent, quand le Parti est fortement
critiqué pour son opportunisme, il figure aux yeux de la bourgeoisie
un rempart en l'absence duquel les troubles pourraient bien
davantage s'aggraver...
Dans la perspective d'une négociation pacifique en Algérie, le double
jeu stalinien aurait été fructueux : le P.C. aurait pu se présenter aux
yeux de l'opinion publique comme le Parti qui avait fait triomphé-la
trève par des moyens
« raisonnables ». Mais dans la perspective du
pourrissement du conflit, la crise s'approfondit inéluctablement.
Même si le P.C. est contraint par les événements de « décrocher »,
c'est-à-dire de passer à l'opposition pure et simple, il ne peut changer
fondamentalement de comportement. Tout conspire dans la conjoncture
actuelle à lui imposer une tactique de prudence. La situation interna-
tionale, d'abord, c'est l'évidence : l’U.R.S.S. cherche à imposer un
compromis pacifique et veut pas que le P.C. vienne le troubler
Khrouchtchev, a rapporté Pineau, souhaite un arrangement libéral en
Algérie qui maintienne la présence de la France) ; le cas algérien ensuite,
très différent du cas indochipois, car en l'absence d'un parti local impor-
tant, le P.C. craint la vacance du pouvoir et l'implantation de l'impéria-
lisme américain dans cette région ; la situation française enfin qui fait
espérer au P.C. une réintégration dans la « communauté >> nationale par
le truchement d'une alliance avec les socialistes.
A. GARROS.
comme
ne
130
LE P.C.F. VU PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR
Pourquoi n'agit-on pas aussi contre les « écrits » commu-
nistes ? interrogea M. Arrighi. Mais le ministre souligna
l'extrême prudence de l'Humanité, qui nuance avec habileté
ses prises de position, comme si ses collaborateurs écrivaient
« avec le concours d'un avocat ».
(Déclaration de Bougès-Maunoury devant le Groupe
radical de l'Assemblée Nationale. Reproduite par Le
Monde du 24 avril 1956.)
KROUCHTCHEV ET LA DÉCOMPOSITION
DE L'IDÉOLOGIE BUREAUCRATIQUE.
:
Sur le plan idéologique, Khrouchtchev a placé le XX° Congrès sous
le signe du « retour à Lénine ». Par un de ces paradoxes de l'histoire,
qui ne le sont que pour l'observateur superficiel, cette « orientation)
(prise au pied de la lettre par la presse bourgeoise) accompagne une
répudiation effective du marxisme et du leninisme qui est, d'une certaine
façon, beaucoup plus profonde que celle accomplie jadis par Staline.
Certes, ce dernier et l'ensemble des P.C. des divers pays · avait depuis
longtemps rompu avec le véritable marxisme. Ce qui était présenté sous
ce nom depuis trente ans par la bureaucratie stalinienne était, comme
théorie, un matérialisme vulgaire, mécaniste et primitif; comme politique,
l'opportunisme au sens le plus large, passant suivant les circonstances de
l'aventurisme extrême à la collaboration étroite avec la bourgeoisie.
Dans les deux cas, l'analyse dialectique ou simplement le raisonnement
étaient remplacés par la répétition scolaire d'un nombre de formules et
de citations apprises par cour, dont on sortait tel ou tel échantillon
d'après les besoins du moment. La pensée apparente de la bureaucratie,
son idéologie, n'était rien d'autre que cette ronde rituelle de citations.
Sa pensée réelle, celle qui la guidait dans ses actions, était l'empirisme
cynique et à courte vue en quoi elle avait organiquement transformé
d'après sa propre nature le réalisme politique du marxisme révo-
lutionnaire.
Mais si cette idéologie devenue rituel n'avait plus de rapport avec
la réalité autre que celui du masque elle présentait au moins une
certaine cohérence formelle. Lorsque Staline était forcé à effectuer un
« tournant », ses valets cherchaient une citation, la délayaient, l'estro-
piaient, lui faisaient dire le contraire de ce qu'effectivement elle disait
mais essayaient de se créer une couverture idéologique « marxiste ». C'est
que la bureaucratie sentait encore le besoin de se justifier à la fois à ses
propres yeux et à ceux du prolétariat en invoquant le marxisme. Plus
même: l'invocation commune de cette scolastique, à la fois monstrueuse-
ment rigide dans son tout et entièrement arbitraire dans n'importe quelle
de ses parties, accomplissait une fonction sociale réelle; elle était un des
facteurs de cohésion entre les diverses couches fraîchement privilégiées en
Russie, comme aussi entre ces dernières et les directions bureaucratiques
des P.C. à l'étranger, insuffisamment ancrées dans leurs sociétés
respectives.
Ce à quoi on assiste avec le XX° Congrès, c'est le début de la décom-
position de ce rituel lui-même. Les éléments de l'amalgame théorique
fabriqué par Staline en combinant l'invocation de certaines autorités
dont Staline lui-même et un contenu, variable selon les circonstances,
se séparent. La bouillie idéologique de la bureaucratie a tourné.
131
D'un côté, se succèdent les incantations obsessionnelles autour du nom
de Lénine, nécessaires sans doute pour cautionner la répudiation de
Staline, mais aussi pour masquer et compenser l'absence de texte vie
réelle des idées. On est frappé de voir ces hommes qui « construisent
le communisme », qui ont gravi une montagne » et voient « les vastes
horizons de la société communiste » (Khrouchtchev) ne pas pouvoir
se passer de l'invocation d'une autorité mythique celle de Staline hier,
celle de Lénine aujourd'hui. Evidemment, les litanies autour de Lénine
visent à camoufler la trahison des véritables idées de celui-ci; elles ont
aussi pour but de couvrir le vide idéologique de la bureaucratie installée.
Mais leur effet réel est le contraire: elles créent avec une force rarement
égalée une impression de stérilité totale. Il est caractéristique non seule-
ment que le nom de Lénine ouvre et clot tous les discours prononcés au
Congrès, niais que Lénine n'est effectivement cité que pour ce qu'il a pu
dire en passant de plus banal: que « l'économiste doit toujours regarder
en avant » (1), que l'élévation de la productivité du travail dépend de
la spécialisation qui à son tour dépend de l'emploi de machines (2), que
la politique du Parti ne peut aboutir au succès que si elle tient compte
des exigences du moment (3), etc...
D'un autre côté, le contenu politique disparaît (4). Dans sa plus
grande partie, le rapport de Khrouchtchev ressemble à s'y méprendre à
un compte rendu d'un président de conseil d'administration devant une
assemblée d'actionnaires. De ce point de vue, même l'hystérie rituelle des
congrès staliniens avec la dénonciation des « trotskystes, zinoviévistes,
boukhariniens » et des « fauteurs de guerre impérialistes » avait un
caractère politique; c'était la politique de l'assassinat, et l'assassinat de la
politique, mais le cadavre était toujours dans la salle. Le XX* Congrès
s'en est débarrassé; se voulant placide, la bureaucratie installée a pré-
tendu expédier ses affaires courantes.
Dira-t-on que le nombre des vaches qui préoccupe particulièrement
Khrouchtchev est une question politique, ou qu'il n'y a plus d'adver.
saires à combattre? Mais on les combat entre les lignes, ou en séance
secrète; le fait est qu'on les escamote. Ceux qu'on ne peut pas escamoter
les Américains -, la vaseline de la coexistence pacifique les recouvre.
Il y a certes toujours des méchants trusts outre Atlantique, mais la « force
du camp socialiste la « puissance du mouvement démocratique » leur
imposeront en apparence indéfiniment
de se tenir tranquilles.
(1) Discours de N. Boulganine, p. 148 de l'édition des Cahiers du
Communisme.
(2) Ibid., p. 152.
(3) Souslov, p. 226. Il est tout autant caractéristique que imitant
en ceci Staline) les orateurs baptisent « loi » le simple énoncé de faits.
Staline avait découvert, en l'attribuant d'ailleurs à Lénine, la « loi du
développement inégal du capitalisme » pompeuse tautologie signifiant
siraplement que les choses diffèrent entre elles. Khrouchtchev et les autres
parlent de la « loi » de la priorité de l'industrie lourde sur l'industrie
légère, de la « loi » de la diversité des formes de passage des divers pays
au socialisme, etc... Chaque fois qu'on tourne une page du compte-rendu
du XXCongrès, on s'attend à tomber sur une « loi de la lactation des
vaches » ou une « loi de la dureté du fer
(4) Le contenu politique explicite, bien entendu. Claude Lefort
montre dans son article publié par ailleurs le contenu politique effectif *
du discours de Khrouchtchev sa signification comme moment de la
lutte de la bureaucratie contre le prolétariat et contre elle-même.
132
L'escamotage de la politique et de la lutte dépasse 'les frontières 'de
I'Union, il concerne la planète entière. (5)
Pour ce qui est des vaches, leur nombre est certes une question poli-
tique non pas en lui-même, mais en tant qu'il se rapporte aux hommes
qui les élèvent, les exploitent, les consomment; autrement dit, en tant
qu'il se rapporte aux rapports réels de production et de consommation
dans la société. Ceux-ci sont également et nécessairement escamotés dans
le rapport de K.; les hommes n'y apparaissent qu'en tant que bureau-
crates chargés de contrôler l'exécution du Plan, et exerçant ce contrôle
mal, à la fois trop et pas assez (que ce soit là la contradiction fondamen-
tale du régime et de la classe qu'il représente, K. ne peut le voir sans
cesser d'exister).
Que l'idéologie stalinienne, de même que le type extrême de terreur
caractéristique du règne de Staline, étaient devenus un frein insuppor-
table s'opposant au développement de la société russe et de la bureaucratie
elle-même, est évident; tout le « tournant » russe actuel en témoigne. Au
moment où elle sent sa cohésion réelle comme classe exploiteuse assurée,
la bureaucratie a beaucoup moins besoin d'une cohésion idéologique pour
elle-même. Elle ressent le marxisme pour séminaristes arriérés de Staline
comme un carcan, et essaie de s'en débarrasser. Le malheur veut que le
même processus qui a abouti à la consolidation et l'unification de la
bureaucratie a en même temps consacré sa rupture totale avec le prolé-
tariat russe, qu'au même moment où celle-là s'affirme celle-ci éclate, que
la liberté acquise d'un côté est trois fois perdue de l'autre. La répudiation
du monolithisme idéologique s'avère désirable et indispensable, mais la
contradiction de classe qui déchire la société russe empêche que rien soit
mis à la place.
Autant
que la critique des défauts économiques, la dénonciation de la
stérilité idéologique est partout présente dans les discours du XX° Con-
grès. Khrouchtchev et les autres membres de la direction multiplient les
appels aux intellectuels, aux économistes, aux historiens, aux philosophes,
aux artistes, critiquant leur « dogmatisme », leur « manie des citations »,
leur « rupture avec la vie », les invitant à regarder le présent et:
l'avenir, en un mot, leur intimant l'ordre de créer spontanément et
authentiquement.
Que ne donnent-ils donc l'exemple?
Khrouchtchev et les autres dirigeants critiquent les économistes
russes, les accusent de stérilité, de répétition mécanique, etc... Ils leur
reprochent de s'en tenir, en matière d'analyse de l'économie capitaliste,
à quelques schémas traditionnels. Mais quelle est l' « analyse » de l'éco-
nomie capitaliste fournie par K. dans son rapport? Une comparaison du
rythme de développement de l'industrie des pays bourgeois et de l'in-
dustrie russe, d'où il ressort que celle-ci se développe beaucoup plus
rapidement que celle-là; quelques chiffres sur les salaires réels dans les
pays capitalistes, montrant leur augmentation nulle ou lente au total,
la description la plus superficielle et la plus schématique; en guise
d'analyse économique réelle, la version la plus crue de la théorie dite de
la « sous-consommation • (explicitement répudiée par ce même Lénine
qu'il ne cesse d'invoquer), à savoir, l'explication de la crise du capita-
lisme par la stagnation des salaires ouvriers et la limitation des débou-
chés qui en, résulte.
(5) Certes, K. parle à propos de divers pays des partis communistes,
d'alliance avec les socialistes, etc... Mais à aucun moment les classes, les
partis, les tendances, les orientations des camps en présence ne sont
définis; la plupart du temps, ils ne sont même pas nommés.
133
Khrouchtchev n'est pas, dira-t-on, ni n'est obligé d'être un écono.
miste. Mais les économistes russes, eux, sont obligés de l'être; tout au
moins K. veut les obliger à le devenir. Que doivent-ils, que peuvent-ils
dire sur le capitalisme? Khrouchtchev répudie le « schématisme » des
soi-disantes analyses de Staline et invoque Lénine pour prouver que la
production capitaliste peut encore progresser. Ainsi il enlève aux écono-
mistes la possibilité de présenter l'un des systèmes comme stagnation
absolue, l'autre comme progrès absolu. Doivent-ils comparer les rythmes
relatifs de développement? Mais pendant combien de temps? Des chiffres
cités par K. lui-même, il résulte que le taux annuel d'expansion de la
production industrielle en Russie a été de 20% de 1929 à 1937, de 18 %
de 1946 à 1950, de 13 % de 1950 à 1955 et qu'il sera de 10,5 % de
1955 à 1960. Ce ralentissenient prouve ce que nous en avons toujours dit,
à savoir que, dans la mesure où les chiffres russes ne sont pas en partie
gonflés, ils traduisent l'avance rapide d'un pays où des masses énormes
sont transférées de l'agriculture vers l'industrie, où le niveau bas de la
technique permet de s'assimiler d'emblée des méthodes productives per-
fectionnées mises au point ailleurs, où un taux inoui d'exploitation
permet une accumulation très rapide du capital, où la direction de l'in-
vestissement par l'Etat élimine le sous-emploi des hommes et des ma-
chines dû aux fluctuations du marché (6). Mais il montre en même temps
que la différence des rythmes d'expansion devient de moins en moins
in:pressionnante. De fait, l'augmentation annuelle de la production indus-
trielle dans les pays capitalistes a déjà connu des rythmes analogues et
parfois supérieurs à ceux réalisés en Russie: 22 % aux Etats-Unis de
1939 à 1943, 11 % en Allemagne occidentale de 1951 à 1955, 10 % en
Italie de 1948 à 1955. On peut symboliser l'opposition du Bien et du
Mal par celle du zéro et du quelque chose, mais il est difficile de l'incar-
ner dans la différence entre 8 et 10 pour cent.
L'analyse comparée des deux systèmes économiques montre en fait
que l'économie bureaucratique n'augmente pas la productivité du travail
plus rapidement que l'économie capitaliste; en fin de compte, son avantage
se réduit à l'élimination des crises de surproduction.
Et c'est en effet aux « crises » que reviennent les contradictions du
capitalisme pour K. Que peuvent en dire les économistes russes
évidemment il est impossible de parler de la contradiction fondamentale
de l'économie capitaliste, privée ou bureaucratique, qui consiste à traiter
le sujet de la production comme objet? Qu'elles sont dues, leur ensei.
gne K., à ce que les salaires n'augmentent pas. Cette conception, soit dit
en passant, a été traditionnellement une des bases idéologiques du réfor-
misme; elle mène à la conclusion que si les ouvriers arrachent suffisam.
ment d'augmentations, ils aideront le capitalisme à surmonter ses crises.
Indépendamment de cela, elle est fausse théoriquement; si l'accumulation
se fait à un rythme suffisamment rapide, il n'est point nécessaire que les
salaires augmentent pour que l'expansion capitaliste puisse continuer. Et
dire que l'économie capitaliste privée ne peut pas assurer la stabilité du
rythme de l'accumulation n'appelle pas le socialisme, mais l'étatisme,
tout simplement. La « nationalisation de l'investissement », sous
forme ou une autre, a été le drapeau des néo-capitalistes kéynesiens et le
demeure. Enfin, la conception de K. est fausse matériellement; si les
économistes russes se débarrassent du « schématisme », il faudra bien
qu'ils découvrent que les salaires ont augmenté depuis un siècle,
Les ouvriers n'ont pas pour autant cessé de poser des revendications,
et de le faire de façon de plus en plus pressante, obligeant la plupart
du temps les capitalistes à reculer, de sorte que, en gros, la répartition
à qui
une
U
(6) Le sous-emploi résultant de l'anarchie bureaucratique est
autre problème.
134
du produit entre salaires et profits est restée à peu près constante à
travers l'histoire du capitalisme. La même chose, sous une autre forme,
est en train de se passer en Russie. Mais cela n'a pas diminué la tension
dans l'usine capitaliste de même que les baisses de prix en Russie
n'ont pas diminué les tensions dans l'usine russe, comme en témoigne
d'un bout à l'autre le XX° Congrès lui-même; ce qui prouve que le véri.
table problème est ailleurs, dans le refus par les ouvriers des rapports
de production capitalistes au sein desquels ils sont dominés par une
couche de dirigeants personnifiant le capital. C'est là, l'origine de la crise
de la productivité du travail dans l'usine moderne à Detroit comme à
Coventry, à Billancourt comme à Stalingrad. Les économistes russes
peuvent-ils en parler?
Peuvent-ils parler de l'économie russe véritablement? Certes, ils
peuvent continuer à accumuler les chiffres sans signification à longueur
de pages, à décrire l'appareil administratif de l'économie, en somme,
comme M. `Bettelheim en France, bavarder pour ne rien dire. Souslov,
dans son excitation, leur demande de parler de la loi de la valeur
pour ajouter immédiatement qu'il s'agit de réduire les coûts de production.
Mais la loi de la valeur conduit à la question de la plus-value de la
répartition du produit social entre les diverses catégories. Même si les
économistes continuent à noyer les revenus de la bureaucratie dans la
masse des « salaires », une analyse tant soit peu précise de l'économie
russe sous l'angle de la valeur ne manquerait pas de faire apparaître
l'énorme spoliation de la paysannerie par l'Etat c'est-à-dire la bureau.
cratie. Comment est déterminée la répartition du revenu social? Comment
est déterminée la répartition des investissements? Qui la détermine? Avant
d'être répartie, la valeur doit être produite; comment l'est-elle autre-
ment dit, comment est organisée l'usine russe? Qui la dirige? Ses lois
diffèrent-elles de celles décrites par Marx à propos de l'usine capitaliste?
Poser la moindre de ces questions, c'est faire voler en éclats toute la
mystification « socialiste » de la bureaucratie. Les économistes russes ne
sont pas à la veille de le faire.
Si Khrquchtchev n'est pas économiste, il est, par profession, poli-
ticien ; c'est comme tel qu'il a mis en avant la conception de la « diver-
sité des formes de passage au socialisme », saluée par les « communistes »
comme une importante contribution à l'analyse politique marxiste. La
signification politique immédiate de cette orientation est certes claire:
il s'agit de consacrer une liberté de manoeuvre élargie pour les P.C.,
leur permettant d'adapter tant bien que mal leur ligne aux nécessités
de la « coexistence pacifique », en même temps, que de créer l'apparence
d'une autonomie plus grande des pays satellites. De ce point de vue,
elle a incontestablement une valeur du point de vue de la bureaucratie.
Mais quelle est la conception théorique qui la sous-tend, la valeur de
l'argumentation qui la justifie? K. commence par dire en substance que
les conditions dans les différents pays sont différentes tautologie en
apparence innocente, sous laquelle se cache, comme d'habitude, un
sophisme. Car la question n'est pas de savoir si l'existence de pays dif-
férents signifie l'existence de conditions différentes, mais si ces conditions
sont différentes au point de rendre une révolution nécessaire ici est
superflue ailleurs. Les pays sont différents, mais en même temps sont
tous des pays capitalistes. Les passages seront incontestablement diffé-
mais ce seront tous des passages au socialisme. Si ces passages
sont des passages du capitalisme au socialisme, des conséquences valables
dans tous les cas en découlent; quelles sont-elles ? Pour un marxiste, ce
a passage » signifiait essentiellement une chose: la destruction du pouvoir
et de l'appareil d'Etat existant, son remplacement par un Etat qui n'en
était déjà plus un, car il n'était que la population travailleuse en armes.
Lénine a écrit des centaines de pages pour montrer que l'essence du pas-
sage du capitalisme au socialisme était la suppression de l'Etat en tant
rents
135
qu'organisme séparé de la masse du prolétariat. Sur cette identité fonda-
mentale des « formes de passage », qui est en même temps l'identité du
contenu du socialisme où qu'il se réalise, K. se tait avec soin.
A la place, il invoque Lénine qui admettait la possibilité d'une évo-
lution pacifique de la révolution russe... en avril 1917, c'est-à-dire après
une première insurrection victorieuse et en fonction de l'existence des
Soviets, organismes du pouvoir de la classe ouvrière. Il escamote en même
temps le fait que Lénine lui-même a rapidement tiré les leçons de la
situation qui se développa alors et s'orienta vers une deuxième insurrec.
tion prolétarienne. Il escamote le fait que Lénine, écrivant à la même
époque l' « Etat et la Révolution », et citant Marx qui parlait de la
nécessité pour toute révolution sur le Continent de briser l'appareil
d'Etat, prenait soin d'expliquer que l'exception faite par Marx dans le
cas de l'Angleterre s'appuyait sur le fait que dans ce pays, en 1871, le
militarisme et « à un degré considérable, même la bureaucratie » n'exis-
taient pas; et qu'il ajoutait qu' « aujourd'hui » (en 1917) à la fois
l'Angleterre et l'Amérique sont caractérisées par l'existence d'Etats mili-
taristes-bureaucratiques, dont la « destruction », la « mise en pièces »
sera la « chose essentielle » de toute « révolution réelle ». Inutile d'indi.
quer combien plus forte est devenue cette idée aujourd'hui, avec la
croissance inonstrueuse de l'appareil de l'Etat et son identification pro-
gressive avec l'appareil d'exploitation.
Khrouchtchev, supprimant toute analyse de la structure et du rôle
de l'Etat dans les sociétés contemporaines, invoque des « changements »
intervenus dans la situation historique; la modification du rapport des
forces en faveur de la classe ouvrière « de différents pays capitalistes » (?)
permettrait à celle-ci de « conquérir une solide majorité du Parlement »
et de transformer celui-ci « en instrument de la véritable volonté popu.
laire ». Mais lorsque Lénine traitait de social-traîtres ceux qui avant K.
avaient soutenu cette « orientation », ce n'était pas parce qu'ils avaient
prétendu qu'ils pourraient instaurer par voie parlementaire le socialisme...
en étant minoritaires au Parlement. Les réformistes que Lénine qualifiait
de « laquais léchant les bottes des impérialistes » prétendaient précisé.
ment que le « rapport des forces » allait permettre un jour le passage
pacifique au socialisme par conquête de la majorité parlementaire. A
cela, Lénine ne se bornait pas à opposer des arguments « conjoncturels »,
montrant qu'il est impossible que le Parlement reflète la volonté de la
majorité de la population dans un pays bourgeois (à quoi on pourrait
ajouter, avec l'expérience historique des trente dernières années, que là
où une majorité parlementaire « socialiste » ou « socialiste-communiste »
a été réunie, elle n'a fait que préserver l'ordre bourgeois). Il démontrait,
par une analyse sociologique de la nature de l'Etat et du Parlement, que
celui-ci ne pouvait pas être l'instrument du passage au socialisme, qu'il
s'appuyait sur une séparation radicale entre peuple et ses « repré-
sentants » consubstantielle au régime d'exploitation, que le socialisme ne
peut commencer qu'avec la destruction total de l'appareil d'Etat existant
et l'institution du pouvoir des organismes des masses armées. Mais
Khrouchtchev ne peut pas dire que la nature de l'Etat capitaliste et du
Parlement a changé depuis Lénine, et ne veut pas dire que ce qui a
changé, c'est la nature du socialisme que ce qu'il entend par socialisme
n'est que le pouvoir des bureaucrates des P.C., dont à la limite il est effet
concevable qu'il puisse s'instaurer le poids du « camp puissant des
pays du socialisme et de leurs 900 millions d'habitants » aidant
par
voie parlementaire.
Enfin, en même temps qu'il tance sévèrement la stérilité des histo-
riens, Khrouchtchev leur offre sans le vouloir un exemple de comment
il ne faut pas écrire l'histoire: ce sont ses « explications » sur le culte
de la personnalité et en particulier son « rapport secret », imputant à
Staline, et à Staline seul, tout le passif du bilan bureaucratique.
136
Claude Lefort, dans son article publié par ailleurs, dit ce qu'il faut
penser de ce monstrueux « culte de la personnalité à l'envers », qui con-
siste à charger un seul individu de toutes les fautes » et les « crimes »
d'une période historique. Mais on n'insistera jamais assez sur ce point:
le niveau de méthodologie historique de ce rapport est inconnu en Occi-
dent depuis vingt-cinq siècles. Ramené à sa substance, le rapport affirme
ceci: depuis un quart de siècle l'histoire d'une nation de deux cents mil-
lions d'individus et par là même de l'ensemble de l'humanité a été déter-
minée pour une part essentielle par la « folie des grandeurs », la « mé-
fiance maladive » et la « manie de la persécution » d'un individu. Les
rédacteurs de « Match » hésiteraient avant d'offrir à leurs lecteurs une
telle conception.
Nous n'allons pas, bien entendu, adopter nous-mêmes la méthodologie
de Khrouchtchev et expliquer la qualité de son rapport par sa stupidité,
son ingnorance ou sa superficialité. Khrouchtchev eut-il été Thucydide,
son rapport n'aurait pas pu être différent. Placé devant la tâche impos-
sible qui consistait à répudier certains des traits du système qui en
ont été et pour une bonne partie continuent à en être les produits orga-
niques et nécessaires pour mieux sauver le système lui-même, il ne
pouvait s'en tirer autrement qu'en les présentant comme accidentels. Et
l'accident dans l'histoire a nom individu.
Mais, dira-t-on, vous prenez ce rapport pour ce qu'il n'est pas; vous
jugez sur le plan théorique un discours qui n'était qu’une opération poli-
tique, visant pour telles ou telles raisons, à démolir le mythe de Stalinc,
Nous disons précisément cela: que la bureaucratie ne peut plus maintenir
la cohérence entre ses opérations politiques et un système théorique.
Staline traitant tout opposant d'agent d'Hitler voulait imposer à l'univers
un délire, sans rapport avec la réalité dans son ensemble et dans ses
moindres détails; mais ce délire était cohérent. Khrouchtchev démolissant
Staline ne peut démystifier qu'en mystifiant, ne peut faire passer une
ligne politique qu'en détruisant presqu'ouvertement la conception du
monde que cette ligne prétend servir par ailleurs. Une fois sortie de la
· chape de plomb stalinienne, la bureaucratie ne peut revêtir que l'habit
d'arlequin.
Habit dont il suffit le tirer un fil pour le voir en lambeaux. Il est
à peine nécessaire d'égrener le chapelet interminable de questions que
fait surgir l'explication de l'histoire par les vices de l'individu Staline.
Staline étant ce que Khrouchtchev dit qu'il était, que faisait le Bureau
Politique ? Le Comité Central? Les Congrès du Parti? Le peuple, dans la
démocratie « la plus parfaite » de la terre? Qu'est-ce que ce régime dans
lequel un individu peut agir de cette façon? Pourquoi Khrouchtchev ne
fera-t-il pas demain sa propre crise de folie? Qu'est-ce qui est changé
réellement? Quel est ce XX* Congrès de 1.355 marionnettes délibératives
et de 81 marionnettes consultatives où personne ne pose ces questions?
Pourquoi, si ces choses sont importantes, ne doivent-elles pas être discutées
en public? Qui croit que Béria était un agent des impérialistes ? Quelles
formes de la « légalité socialiste » ont été observées par Khrouchtchev et
sa clique lorsque, le lendemain du Congrès, il faisait fusiller Baguirov et
son équipe? Qui peut croire que la direction actuelle n'a pas été la com-
plice de Staline dans l'essentiel de sa ligne ? Quelle est cette direction
communiste qui traite les partis « communistes » de l'étranger comme
des quantités négligeables (d'après l'aveu des staliniens américains, anglais,
italiens et français)? Qu'est-ce que cette folie étrangement sélective de
Staline, s'exprimant uniquement par les fusillades, les statues et les
mappemondes? Staline ne dirigeait-il pas l'économie? Qui avait le der-
nier mot sur les plans? Ces membres du Bureau Politique qui, d'après
Khrouschtchev, tremblaient chaque fois que Staline les invitait chez lui,
retrouvaient leur courage s'il s'agissait de discuter économie, salaires
ouvriers, par exemple? ou conditions de vie de la paysannerie? Ce régime
de terreur et d'arbitraire, prévalait-il seulement entre Staline et son
137
entourage immédiat? Chacun des membres de la direction du P.C. n'était-il
pas un Staline pour son propre milieu ? Et aux échelons les plus bas? Dans
les usines ? Les ouvriers avaient-ils un seul mot à dire? Ont-ils un seul mot
à dire?
Toutes ces questions ont été en fait posées en Russie, dans les
pays satellites, au sein des partis communistes des pays occidentaux.
Togliatti, même Thorez, ont été à leur tour obligés à en poser quelques-
unes. Khrouchtchev apprenait ainsi à ses dépens qu'on ne peut jouer
impunément avec le culte de la personnalité ni dans un sens, ni dans
l'autre. A la fin, la révolte de Poznan lui enseignait brutalement que la
réalité a sa logique,
si les discours des bureaucrates n'en ont pas. La réso-
lution du Comité Central du P.C.U.S. du 2 juillet, dont on peut dire
qu'elle a été imposée au Kremlin par les ouvriers polonais (même si la
crise ouverte par le XX° Congrès la rendait chaque jour plus nécessaire)
revient largement en-deçà du « rapport secret » et traduit un nouveau
durcissement. L'efficacité politique de ce nouveau coup de barre, qui
sera sans doute suivi de plusieurs autres, ne peut pas être grande. Mais
ce qu'il «lémontre clairement, c'est que la bureaucratie est obligée de tuer
dans l'auf la critique à laquelle elle s'imaginait pouvoir laisser quelque
latitude; qu'elle est forcée d'interrompre en juillet une discussion qu'elle
a elle-même ouverte en février. L'idéologie se répercute à un tel point
sur la réalité, et cette réalité est à son tour tellement explosive, que la
marge de liberté que la bureaucratie peut s'accorder, à elle-même et à ses
« penseurs », s'évanouit à l'instant même où elle semble naître.
Le lecteur aura compris que notre propos n'était pas de polémiquer
avec Khrouchtchev et ses collègues comme s'ils se plaçaient sur le terrain
da marxisme, encore moins d'apprécier leurs mérites de théoriciens, mais
de comprendre les facteurs objectifs qui d'ores et déjà obligent la bureau.
cratie à abandonner l'idéologie stalinienne et en même temps l'empê.
chent de la remplacer par une autre.
C'est que la bureaucratie ne peut penser véritablement ni son propre
système, car son essence est l'exploitation qu'elle est obligée de présenter
comme « socialisme », ni le capitalisme traditionnel, car cela ne peut être
fait sans poser la perspective d'une révolution fondamentale des rapports
sociaux non pas des simples formes de propriété -, perspective qui,
du fait de l'identification croissante du capitalisme privé de l'Ouest et
du capitalisme bureaucratique de l'Est, les englobe tous les deux et donc
met en question la bureaucratie elle-même.
Nous n'avons voulu insister que sur les contradictions profondes
qui interdisent de plus en plus à la bureaucratie de se constituer une
idéologie cohérente. Ces contradictions devraient naturellement porter la
bureaucratie vers cet éclectisme qui caractérise depuis longtemps la culture
bourgeoise, et qui faisait timidement son apparition dans le XX° Congrès.
Mais ces facteurs ne sont évidemment pas les seuls. La structure totali-
taire du système fait que non seulement, d'une façon mécanique, l'expres-
sion tant soit peu indépendante est empêchée, mais aussi que (avec
l'exception relative des sciences exactes et des arts les plus abstraits) tout
ce qui est dit ou fait dans un domaine affecte les autres. Encore une
fois, Poznan en témoigne.
Ne pouvant ni maintenir le monolithisme idéologique de Staline, que
la structure de la société russe moderne repousse, ni s'adonner à l'éclec-
tisme, que
son organisation nécessairement totalitaire contredit, la
bureaucratie voit s'approcher le jour où elle sera réduite au silence.
P. CHAULIEU.
138
LA PRAVDA S'INQUIETE DES EFFETS
DE LA NOUVELLE DEMOCRATIE
« Certains éléments pourris, sous couvert de la condam-
nation du culte de la personnalité, tentent de mettre en
doute la justice de la politique du parti. Des affirmations
calomnieuses et antiparti, dirigées contre la politique du
parti et ses bases leninistes, affirmations démagogiques et
petites-bourgeoises, ont été faites par certains. »
La Pravda s'élève contre toute tentative de mettre en
doute la justesse de la politique du parti. « Tout le déve-
loppement historique du pays des soviets, écrit le journal,
dément de telles inventions et détruit de fond en comble
les tentatives d'employer des moyens indignes. La politique
du parti à toutes les périodes de son histoire a été et reste
celle de Lénine, élaborée par le parti, par son comité cen.
tral en lutte pour la victoire du socialisme, et elle incarne
la sagesse collective du parti. Elle a reçu sa confirmation
dans l'expérience des dizaines d'années d'activité de notre
peuple. Aujourd'hui, le parti communiste est plus uni que
jamais, et il resserre ses rangs autour du comité central. »
(Cité par Le Monde, 5 avril.)
EN HONGRIE RAKOSI DENONCE LES ABUS
DE LA LIBERTE
M. Rakosi s'en prend aux « éléments pourris qui abu-
sent des libertés démocratiques » et demande la liquidation
des « opinions hostiles, propagées en vue de créer la confu.
sion dans nos rangs, par ceux qui abusent de la démocratie
interne du parti ». « Des ennemis de la société, ajoute-t-il,
essayent de se servir de chacune des mesures que nous pre-
nons pour atteindre leurs objectifs ». Le premier secrétaire
du parti communiste hongrois affirme que « le but de ceux
qui ont organisé cette campagne antisoviétique était d'encou-
rager les ennemis de l'unité d'action et de la coopération
internationale de la classe ouvrière ».
(Cité par Le Monde, 4 mai.)
EN THECOSLOVAQUIE, KOPECKY ATTAQUE
ETUDIANTS ET ECRIVAINS ...
M. Kopecky a sévèrement critiqué les écrivains qui, a-t-il
dit au cours du dernier congrès (au mois d'avril), « au lieu
de discuter les problèmes de la création artistique ont atta-
qué publiquement le parti et le régime en général ».
M. Kopecky a, ďautre part, directement mis en cause les
étudiants de Prague et de Bratislava qui, au
cours de
réunions dans leurs facultés, ont adopté des résolutions
139
« contenant des revendications provocatrices hostiles au
parti et au régime » ; leur manière de comprendre la liberté
signifie qu'on devrait permettre aux facultés de répandre
sans contrôle n'importe quelle opinion ou théorie idéaliste
et réactionnaire contredisant le marxisme-leninisme. La
classe ouvrière, a conclu le vice-président du conseil, n'ac-
ceptera janais une telle façon de voir. »
... ET NOVOTNY CRITIQUE LES MILITANTS
M. Novotny a dénoncé, en outre, des signes de « propa-
gande bourgeoise » dans la demande formulée récemment
par cinquante mille membres du parti (pour la plupart de
la capitale) pour une réunion extraordinaire du congrès du
parti afin d'étudier « la possibilité d'introduire la démo-
cratie dans la vie publique » du pays. Certains ont « même
préconisé de revenir à la situation telle qu'elle existait en
1948 avant que nous prenions pouvoir », a ajouté M. No-
votny. — (D'après Le Monde).
UN PARTI DE VIEUX BUREAUCRATES
D'après le rapport de la Commission des Mandats du XX° Congrès
du P.C.U.S. (pp. 218-225 du recueil publié par les « Cahiers du Commu-
nisme »), assistaient à ce Congrès 1.355 délégués avec voix délibérative.
Contrairement à la tradition des congrès bolchéviks, l'origine sociale des
délégués (encore moins la composition sociale du parti "lui-même) n'est
pas indiquée. On dit seulement que parmi les délégués il y avait 2,7 fois
plus d'ouvriers et 2 fois plus de kolkhoziens qu'au XIXe Congrès, ce
qui ne veut rien dire.
Cependant, si les chiffres cités par la Commission sont exacts, on
peut reconstituer approximativement la composition sociale du Congrès.
Suivant le rapport de la Commission, « sur le nombre global des délé-
gués avec voix délibérative, 438 travaillent directement dans la produc-
tion : 251 dans l'industrie et les transports, et 187 dans l'agriculture ».
Cela signifie : moins de 20 % des délégués proviennent de l'industrie,
moins de 15:% de l'agriculture, et, si l'arithmétique couranta s'appliquo
à la Russie « socialiste », 65 % sont des intellectuels et des bureaucrates
de tout acabit.
Il serait faux d'ailleurs de penser que les 251 délégués « travaillant
directement dans l'industrie » soient tous, ou même en majorité, des
ouvriers, et les 187 « travaillant directement dans l'agriculture » des
paysans. Le rapport indique, en effet, que « sur 1.355 délégués ayant voix
délibérative, 758 ont une instruction supérieure, 116 une instruction
supérieure incomplète, et 169 une instruction secondaire ». Comme cela
fait au total 80 % des délégués, il faut admettre que la moitié environ
des délégués « travaillant directement dans la production » le font en
qualité de directeurs, techniciens, agronomes ou, à la rigueur, contre-
maîtres. Ainsi le prolétariat russe est représenté au Congrès de « son »
parti par un dixième des voix et la paysannerie par un peu moins encore.
Quant à l'âge des délégués, le Rapport indique triomphalement que
«plus du cinquième des délégués avec voix délibérative (20,3 %) ont
moins de 40 ans ! ».
Si le communisme est la jeunesse du monde, de quoi le krouchtche-
visme est-il la vieillesse ?
140
LA DESTALINISATION DANS LES DEMOCRATIES
POPULAIRES
un
La déstalinisation semble rencontrer dans les démocraties populaires
un écho aussi profond qu'en U.R.S.S. Il est probable que les répercus.
sions les plus importantes du XXe Congrès sont encore du domaine de
l'avenir. Peu de nouvelles jusqu'à présent nous apprennent ce que « la
libéralisation » signifie pour les ouvriers, sur le lieu de travail et, en
général, dans la vie sociale concrète. Mais sans aucun doute les mesures
gouvernementales, depuis l'amnistie des prisonniers politiques jusqu'à
l'étonnante liberté d'expression accordée parfois aux écrivains, traduisent
comme en U.R.S.S., la nécessité de liberté de la société et, en même
temps, la volonté de la classe dirigeante de s'adapter à une situation
nouvelle.
Ce qui frappe le plus, lorsqu'on se rappelle l'orchestration des
tournants staliniens, c'est la diversité des réactions actuelles des démo.
craties populaires. La Bulgarie, la Hongrie, la Pologne réhabilitent les
grands condamnés (respectivement : Kostov, Rajk, Gomulka), mais non
la Roumanie, la Tchécoslovaquie et l'Albanie. D'autre part, en Hongrie,
le Staline local, Rakosi, a pris lui-même la tête du mouvement de déstali-
nisation tandis qu'en Bulgarie son homologue, Tchervenkoff, a été limogé
et remplacé par Jougov : ce dernier, comme son ancien ami Kostov, est
* communiste national » ayant passé le temps de guerre au maquis,
tandis que le premier est réputé pour être inféodé au Kremlin d'où, pen-
dant des années, il a fait la pluie et le beau temps dans les milieux
d'émigrés. Quant à la Pologne, le limogeage récent du N" 2 du régime,
Bermann, a été précédé d'un an par la libération du « martyr » national
du stalinisme Gomulka (1).
Dans le domaine des révisions de procès encore : Prague, « après un
examen approfondi des documents », refuse de réhabiliter Slansky. Mer-
veilleusement, cependant, sa culpabilité subit une mutation :
on pro-
clame maintenant le condamné ennemi acharné de Tito et, d'ailleurs, ami
de Béria ! Mais cette position nouvelle peut-elle être tenue ? Un peu de
logique est indispensable, surtout à une dictature qui se « libéralise ».
Slansky a été exécuté comme agent de Tito et comme sioniste. Sa con-
damnation était basée en grande partie sur les dires de Rajk au procès
de Budapest et sur ceux de Oren, sioniste de gauche israélien arrêté à
Prague. Mais l'un et l'autre sont maintenant réhabilités et il est reconnu
qu'ils ont été forcés de mentir. D'autre part, les trois seuls non-pendus
du procès Slansky (sur quatorze condamnés) ont été eux aussi réhabilités
et libérés.
- Nous touchons avec cette contradiction à l'un des points les plus
faibles des régimes démocratiques populaires : nécessité de continuité,
de stabilité du personnel dirigeant et nécessité en même temps de faire
peau neuve... Les solutions différentes adoptées dans la question des réha-
bilitations, à Prague, Sofia, Bucarest et Budapest, correspondent sans
aucun doute à la diversité des conditions locales. Un autre élément encore
semble pourtant entrer en jeu qui complique étrangement les choses.
Belgrade, tout en restant hors du système, a son mot à dire : il suffirait
au parti communiste yougoslave de déclarer que la déstalinisation à
Prague n'est qu'un trompe-l'oeil pour qu'il jette le gouvernement tchéco-
slovaque dans les pires difficultés. Ajoutons à ceci, à l'autre extrémité de
l'espace soviétique, la froideur relative de Mao-Tsé-Tung face à la déstali.
nisation, et l'on comprendra l'importance des changements qui se produi.
sent actuellement à l'Est. Le monde. soviétique sans doute restera-t-il uni,
(1) Nouvelle non officielle.
141
mais dans son sein une certaine diversité remplacera l'unité stalinienne
maintenue à coups de pendaisons. Les relations concrètes de pays à pays,
au sein de cette diversité, sont difficiles à prévoir : il s'agit d'une situa-
tion en développement qu'il faut suivre.
Tous les gouvernements démocratiques populaires ont procédé à des
libérations de détenus politiques, mais la diversité règne dans ce domaine
également. En Pologne qui semble avoir pris la tête du mouvement
de déstalinisation une amnistie très large a été décidée : trente mille
détenus ont été libérés ; soixante-dix mille autres ont vu leurs peines
abrégées. Dans tous les autres pays, des mesures d'amnistie ont également
été prises, sauf en Bulgarie, où les libérations, assez nombreuses, de
dirigeants' agrariens, ont toutes été soumises à la condition préalable
d'une déclaration de ralliement au régime.
Mais le record de ces libérations avec contrepartie est battu par la
Roumanie. Les trois chefs des trois anciens partis d'opposition (libéral,
paysan, socialiste) sont sortis de prison en louant les réalisations du
régime. Sans doute faut-il tenir compte de l'opportunisme remarquable
des hommes politiques roumains (« Plus on avance vers l'Orient et plus
les classes dirigeantes sont corrompues », disait Trotsky). Mais, malgré
tout, ce seul élément ne semble pas pouvoir tout expliquer. Il s'agit
d'hommes politiques (parmi lesquels l'ultra-réactionnaire, pro-nazi, Tata-
rescu) qui ont contribué, de 1944 à 1947, à mettre le nouveau régime en
selle, qui ensuite, pendant la période « dure », ont été jetés en prison,
et qui, maintenant, trouvent des points communs avec le régime consolidé.
Ce qu'ils vantent en premier lieu, dans leurs déclarations, ce sont les
succès économiques de la Roumanie nouvelle, incontestables si l'on se
rapporte aux tonnes de charbon et d'acier. L'on n'a sans doute pas permis
à ces hommes politiques de faire dans leurs déclarations un retour favo.
rable sur leur propre passé. Chacun d'eux aurait pu dire pourtant qu'il
a plus ou moins été, lui aussi, partisan de la planification, de l'indus-
trialisation, de la réforme agraire. Nous ne voulons pas dire qu'il n'y a
pas de différence importante entre l'ancien et le nouvaeu régime, mais
ces ralliements n'auraient pas été concevables si la classe ouvrière gérait
l'économie et l'Etat, s'il n'y avait pas eu des traits communs entre les
modes de gestion stalinien et capitaliste classique.
Dans le cadre de la « libéralisation » actuelle, l'on s'évertue égale.
ment à redonner un peu de vie aux anciennes institutions parlementaires.
On sait, en effet, que les régimes de démocratie populaire ont une dou-
ble structure : de république bourgeoise et d'Etat totalitaire, la seconde
ayant intégré la première. Des parlements basés sur la pluralité de partis
existent dans toutes les capitales européennes satellites de Moscou. Mais
il s'agit de partis et de parlements destinés dans la mesure où ils n'ont
pas une existence purement fantômatique à intégrer au régime cer.
taines couches paysannes et petit-bourgeoises. Les votes des parlements
ont été jusqu'à présent toujours unanimés. Or Varsovie innove dans ce
domaine. Dernièrement les députés catholiques ont pu voter contre une
loi permettant dans certaines conditions l'avortement. De même à Tirana,
en Albanie, une loi sur la sécurité sociale présentée personnellement par
le chef du gouvernement Mehmet Chehu, a été repoussée à la majorité,
d'abord au vote secret, ensuite au vote à main levée. Mais il semble qu'il
s'agit dans ce cas d'une lutte de tendances entre le chef du gouvernement
et le chef de l'Etat Enver Hodja.
Quoiqu'il en soit, il ne faut pas accorder trop d'importance au renou-
veau de vie bien limité des parlemenst de l'Est. Vieilles institu-
tions et vieux partis sont bien tenus en main par le régime. Cependant,
en dehors de leur utilisation intérieure (très restreinte), ces manifesta-
tions démocratiques bourgeoises peuvent être également utilisées à l'Ouest
par la propagande des partis communistes.
-
142
Il est difficile de dire pourquoi c'est la Pologne qui est allée le plus
loin dans la critique du culte de Staline et, notamment, pourquoi les
écrivains polonais se sont exprimés plus librement que les écrivains des
autres démocraties populaires. Toujours est-il qu'un jeune écrivain,
Witold Wirpsza, met en parallèle les crimes staliniens et les crimes nazis
(« Przeglad Kulturalny », 114-56) ; que le poète Slonismky déclare :
« Les persécutions de la pensée... au début de la Renaissance... apparais-
sent comme un âge d'or comparées à la période que nous avons vécue »
(id.) et que l'écrivain Jan Kott proclame dans le rapport qu'il présenta
à la XIXe Session du Conseil de la Culture et des Arts : « Comme dans
le bon vieux temps, nous étions tous prêts à répéter, après le pope, que
tout ce qui est bon est juste et nécessaire... Sous nos yeux l'histoire con-
temporaine devenait mythologie... La mythologie produit l'Inquisition.
Chaque procès politique devenait un procés de sorcières » (id.).
L'exemple polonais est typique. On permet à certains élémenis d'aller
assez loin dans la critique du régime. Et pourtant celui-ci intègre cette
critique, essaie de la tourner à son profit, referme le cercle du totalita-
risme. Le secrétaire du parti communiste polonais, Moraswski, montre
en effet, dans la revue théorique « Nowe Droji » (mars 1956), que les
militants avaient eu raison de ne pas combattre le culte de Staline car
ils auraient plongé ainsi le pays « dans les flots furieux d'une tempête » ;
que, par contre, ils ont eu confiance « dans la résistance du socialisme,
capable de percer toutes les tumeurs, de surmonter toutes les perver-
sions ». Actuellement, en effet, « la justesse de leur position est confirmée
et leurs espoirs sont réalisés. »...
La contre-épuration est allée le moins loin en Tchécoslovaquie et en
Allemagne Orientale. Simple hasard, ou bien faut-il mettre cette modé.
ration en rapport avec le fait que ces deux pays sont les plus industria-
lisés du bloc oriental, qu'ils renferment la classe ouvrière la plus mûre
et la plus combative ? En tous cas, il apparaît que le souvenir de juin
1953, lorsque les ouvriers de Berlin-Est avaient profité d'unc faille au
sein de la classe dominante, est resté : les dirigeants d'Allemagne Orien-
tale défendent leur unité comme la prunelle de leurs yeux. A peine
a-t-on esquissé à Berlin une critique contre « Hilda-la-Rouge » (Hilde
Benjamin), l'implacable ministre de la Justice, qui conserve sa place.
Otto Grotewohl, président du Conseil, réputé comme homme habile et
souple, a pris avec acharnement la défense de Walter Ulbricht, le Staline
du pays. Car les étudiants et les travailleurs semblent avoir eux aussi
tiré des enseignements de la révolte d'il y a trois ans. Des informations
de la presse allemande orientale il ressort, en effct, que dans les asseri-
blées, dans le parti, on attaque W. Ulbricht, on lie la critique du culte
de la personnalité à son nom (1), on essaie ainsi d'approfondir, de faire
éclater en plein jour, une dissension qui sans doute existe à l'état latent
au sein des milieux dirigeants.
H. BELL.
RAKOSI SE DESTALINISE
« J'ai non seulement toléré le culte de la personnalité,
mais je l'ai favorisé. La réhabilitation de toutes les victimes
des illégalités commises au cours de ces dernières années se
poursuit activement et elle sera terminée dans les semaines
qui viennent. J'y ai ma part de responsabilité, au même titre
que toute la direction du parti. Nous regrettons tous vive-
ment, et moi particulièrement, que des injustices aient été
(1) Cf. Neues Deutschland, 28 et 29 avril 1956 ; Leipziger Volks-
zeitung, 17 mai 1956.
143
commises. Nous en tirons les conséquences et nous ferons
tou ce qui sera en notre pouvoir pour que de tels abus ne
se reproduisent pas à l'avenir. »
(Cité par Le Monde, 20 mai.)
LA DESTAKHANOVISATION EN POLOGNE
On peut assez facilement répondre à la question générale : Qu'est-ce
que le Stakhanovisme ? C'est d'abord le prolongement stalinien d'une
idée, peut-être généreuse mais en tout cas malheureuse, de l'époque léni.
nienne : l'émulation socialiste. Les ouvriers, après la défaite du capita-
lisme, allaient s'organiser eux-mêmes pour améliorer la production ;
l'émulation socialiste signifiait que, dans cet effort général, c'était à
chacun ou à chaque groupe d'ouvriers de faire le mieux possible.
Certes, si on y réfléchit, cette idée était contradictoire en elle-même.
L'organisation collective des ouvriers eux-mêmes dans la . production ne
peut signifier que la gestion de la production par les ouvriers. S'il n'y a
pas gestion, c'est-à-dire s'il n'y a pas organisation véritablement collec-
tive, il ne peut y avoir que des trucs » individuels ou, au mieux, au
niveau de petits groupes. C'est cette contradiction qui a éclaté dans la
pratiquę stalinienne de « l'émulation socialiste ».
En effet, le stakhanovisine n'est pas l'adaptation de ce genre de
« trucs » à l'idéologie bureaucratique qui est essentiellement basée sur
l'esprit de hiérarchie et de compétition individuelle.
Cette adaptation a été favorisée par l'étape industrielle dans laquelle
la Russie se trouvait à cette époque, étape qui est d'ailleurs encore dans
de très nombreux secteurs celle des pays les plus avancés, et qui se
caractérise par le fait que les métiers qualifiés nécessitent de la part de
l'ouvrier un travail qui mêle intimement des tâches purement manuelles
et élémentaires (alimentation des machines et évacuation des pièces) à
des tâches. qualifiées (réglage, contrôle, surveillance).
L'astuce consiste alors à adjoindre à l'ouvrier qualifié intéressé un
ou plusieurs vulgaires manœuvres qui s'acquittent à sa place des tâches
élémentaires qu'il assumait autrefois. L'ouvrier qualifié peut alors
prix d'un eſfort supplémentaire très pénible augmenter considérable.
ment son rendement.
La morale hiérarchique, qui est le propre du stalinisme, se manifeste
dans le fait que cette augmentation du rendement est imputée au seul
ouvrier qualifié (qui a théoriquement eu l'idée de la mise au point du
« truquage » adopté). Lui seul en profite dans son salaire (et ceci d'une
manière qui est plus que proportionnelle à l'accroissement du rende.
ment : c'est ce que l'on appelle le salaire au rendement progressif) et lui
seul est récompensé par les honneurs dus à son rang (lisez les avantages
matériels dont il est gratifié : vacances plus ou moins luxueuses, bons
spéciaux d'alimentation et d'habillement à des prix normaux, etc...).
L'émulation socialiste devait théoriquement augmenter la producti.
vité ; la réalité stakhanoviste n'a rien à voir avec la productivité
d'ensemble d'une usine donnée. Au contraire elle constitue dans la plu-
part des cas un frein : les gains retirés de la pression qui est ainsi
exercée sur les ouvriers non stakhanovistes sont amplement contrebalan-
cés, et au-delà, par les pertes immenses qui résultent de l'antagonisme
qui est créé entre les ouvriers du rang et les stakhanovistes.
Jusqu'il y a peu de temps, tout cela, pour un stalinien, n'était que
théorie sommaire et pour le moins malveillante. Jusqu'il y a peu de
temps, car maintenant...
au
144
Qu'on lise plutôt cette citation récente de la revue polonaise
* Kronika » :
« C'est une chose connue que beaucoup de ces ouvriers, héros du
travail, étaient aidés par des « nègres » mis à leur disposition par la
direction des usines qui était fière d'avoir parmi son personnel des
grands champions. Ce n'est un secret pour personne que tous nos vieux
ouvriers plaisantent entre eux en disant que si les Geyer, les Scheibler,
les Poznanski (anciens propriétaires des usines polonaises) n'avaient
atteint que la production présente, avec en plus, l'accroissement de
dépense que représente l'appareil bureaucratique, ils auraient été ruinés
en quelques jours. »
C'est bien là tout ce que nous venons de dire, mais dans des termes
que les ouvriers savent rendre concrets et vivants...
Et qu'on juge enfin du langage onvrier par cette dernière citation :
« La première mesure à prendre, c'est d'en finir avec toute la
bureaucratie de l'émulation. Il faut licencier tous les bureaucrates qui
s'en occupent, et confier cette question aux syndicats ouvriers, mais ceci
(et ici nous soulignons nous-mêmes), à condition que les syndicats
cessent d'être une institution fictive et morte, et redeviennent une repré-
sentation active des masses ouvrières. »
Cette condition n'est pas prête d'être réalisée, c'est le moins qu'on
puisse dire.
PH. GUILLAUME.
DE L'ETAT DE SIEGE A LA NOUVELLE CRITIQUE
Certains moralistes s'inquiètent : le P.C.F. sera-t-il le dernier à
dénoncer le stalinisme ? Voici de quoi les rassurer : dans Libération du
30 mai 1956, Claude Roy, l'enfant (si peu) terrible du P.C., profite de
la parution d'un livre de Camus pour nous instruire des conflits dont
sa conscience est, depuis bientôt quinze ans, le théâtre :
« Oui, plus on y réfléchit, plus on voit que la situation
de la pensée de gauche, en France et dans le monde, était
comparable depuis des années à celle des défenseurs et des
partisans d'une citadelle assiégée. Au-dehors, ceux qui
tiennent que la cause défendue par la citadelle est fonda-
mentalement juste, soupçonnent peut-être que le comman-
dant de la place, profitant de la loi martiale, se livre à des
excès d'autorité terrifiants ou ridicules. Ils découvrent len.
tement que les principes soutenus par les assiégés au péril
de leur vie sont parfois éludés ou niés dans la vie quoti-
dienne de la garnison. Doivent-iis le proclamer, quitte à
aider à ouvrir une brèche ceux qui ne s'intéressent qu'à une
chose : prendre la forteresse, la raser, en abolir le souvenir
même, et refonder sur ruines une cité totalement
injuste ? Faut-il au contraire attendre que soit levé le siège,
suspendue la loi martiale, éloigné le danger ? »
Que devaient donc faire ceux dont Claude Roy nous dit « qu'ils
aimaient les assiégés » ? Non, la question n'était pas simple et « nal
ne vit impunément ».
< Camus a essayé... et c'est pourquoi je veux dire qu'il
me semble avoir eu raison sur beaucoup de points essen-
tiels. En temps de siège, les raisons s'entrecroisent sans
toujours se pénétrer. »
ses
145
Sur queis points Camus a-t-il eu raison ? Claude Roy ne nous en
instruit guère. On le sent tout préoccupé d'autre chose :
« Je sais bien que ça ne se fait pas de reconnaître aux
autres quelque raison. »
Singulier aveu. Mais aujourd'hui :
« Il faut savoir faire ce qui ne se fait pas. »
Certes Camus a eu tort de tomber dans les « excès du désespoir ».
Mais il a des excuses :
«Il n'est pas facile de maintenir l'équilibre de la raison
entre une condamnation passionnée et périlleuse des erreurs
de la révolution et une justification fataliste et lâche de
ses détours. En ce temps-là, le communisme avec lequel se
débattait Camus, se battait lui-même contre de terribles
menaces. Il était conduit par les circonstances historiques
à se présenter en effet comme un système inconditionnel.
Le manichéisme anticommuniste renforçait le manichéisme
communiste. Camus n'oubliait pas l'iniquité fondamentale
du monde dans lequel il vivait, mais il se cognait doulou-
reusement à une révolution qui exigeait qu'on la reçut en
bloc et la servit sans réserve, qui considérait que le moindre
détail était une partie essentielle de l'ensemble, que la plus
légère critique, le moindre désaccord accessoire ouvraient
immanquablement le champ à la trahison totale. »
Camus n'est d'ailleurs pas le seul à être tombé dans l'excès :
« Ceux qui étaient persuadés que l'Histoire allait donner
raison à leur espérance ceux-là même croyaient parfois
que le silence était un dur et nécessaire devoir. C'était
souvent une erreur. »
On remarquera ici la manière savante et pleine de sous-enten-
das
dont notre critique use des adverbes. Mais voici que tout
change, la paix s'installe, l'état de siège est levé. Le dialogue et la
critique deviennent à nouveau possibles, « chaque adversaire fécondant
l'autre » pour parler comme Camus. Et ce mal dont est atteint Camus
(le désespoir), Claude Roy veut y remédier :
«Il me semble qu'aujourd'hui ce qui s'accomplit et se
réalise enfin, pourra demain réconcilier son désespoir et
l'espoir de millions d'hommes, ses réticences de jadis et
nos angoisses d'hier. Nous pourrons tous y aider. »
La parole est à Camus.
IL Y A DES LIMITES A TOUT
« Mais approfondissons le sens de toutes ces remarques.
Il me semble qu'elles veulent dire : Hervé, vous n'êtes pas
allé assez loin dans votre analyse, vous n'avez pas mis en
lumière les tenants et aboutissants des maux que vous
dénoncez, vous n'avez pas livré au public ce que vous savez
sur la vie intérieure du Parti communiste. Etes-vous assez
naïf, mon cher Sartre, pour n'avoir pas conscience qu'en
exigeant de moi de telles démarches, vous me demandez de
prendre mes distances par rapport au Parti communiste,
bref de m'éloigner...
« Je pourrais vous faire la réponse du berger à la ber-
gère et vous dire, par exemple : pourquoi ne nous parlez-
2
146-
>
vous pas de certaines histoires de Chine, qui, je le sais,
vous préoccupent... ? »
(Pierre HERVÉ, Lettre à Sartre, p. 68-69.)
* Que les autorités soient rassurées : nous continuerons
à ne pas publier, à ne pas diffuser les détails précis que
nous apprenons, presque chaque jour, sur le drame qui
ravage actuellement la jeunesse française... ce drame qui
conduit certains de ces jeunes hommes à transformer en
acte leur révolte morale. »
(J.-J. SERVAN SCHREIBER, L'Express, 8 juin 1956, p. 3.)
« Aucune nouvelle à ce sujet (la question du culte de la
personnalité) ne devrait filtrer à l'extérieur ; la presse spé-
cialement ne doit pas en être informée... Il y a des limites
à tout. Nous ne devrions pas fournir des armes à l'ensemi ;
ne devrions pas laver notre linge sale devant ses
yeux... >>
(N. KHROUCHTCHEV, Rapport dit « secret » au XXCon--
grès du P.C.U.S., Le Monde, 19 juin 1956, p. 3.)
N'est-il pas triste de penser que tous ces braves gens pourraient
être un jour forcés par les circonstances de se faire fusiller les uns
les autres ?
nous
LE P.C.F. APRES LE XXe CONGRÈS
La Déclaration du Bureau Politique du Parti Communiste Français
au sujet du rapport Khrouchtchev, faisant suite aux positions prises par
Togliatti et par plusieurs partis communistes occidentaux, dépasse large-
ment les limites que ses auteurs ont voulu lui fixer. En répudiant expli.
citement le « culte de la personnalité » à rebours inauguré par la nouvelle
équipe de Moscou, qui consiste à expliquer la bureaucratisation du parti
et du régime, la terreur et les « erreurs tragiques », non par des causes
sociales et politiques, mais par la volonté d'un seul homme appuyé sur
une camarilla de provocateurs, en reconnaissant la ncéessité d'une ana.
lyse de ces causes, en critiquant pour la première fois depuis trente ans
la direction politique de l’U.R.S.S., la Déclaration montre toute l'impor-
tance des réactions que la déstalinisation a suscitées chez les militants du
Parti, mais elle apparaît surtout comme le premier signe officiel d'une
situation nouvelle en train de mûrir.
Se répercutant sur la structure internationale du « communisme »,
les profonds changements intervenus en U.R.S.S. mettent en cause son
monolithisme, obligent les partis communistes à sortir de l'alignement
pur et simple sur les directives de Moscou.
Inconcevables il y a seulement un an, les affirmations de Togliatti
(« nécessité d'une autonomie toujours plus grande de jugement », « la
structure politique interne du mouvement communiste mondial est au-
jourd'hui transformée ») ou celles de Marcel Servin (« le P.C.
français n'est pas une section du P.C. de l'U.R.S.S. », « il y a des choses
qui sont du ressort des communistes de l'Union Soviétique et non des
communistes fraạçais, et réciproquement ») ne font que traduire
l'écart existant entre les buts et les moyens de la nouvelle politique
russe, inspirée plus ouvertement que jamais par des nécessités nationales,
et ceux des partis communistes dans les autres pays, ainsi que le besoin
de ces derniers d'agir à leur tour en fonction de leur propre situation
nctionale.
Pourtant, cette phase nouvelle s'est ouverte indépendamment de la
volonté des dirigeants des divers P.C., dont la plupart s'efforcent encore
d'en atténuer les conséquences.
147
Le fait est que la gran de lessive entreprise par Khrouchtchev (dont
un autrte article de ce numéro analyse les causes et la signification) était
ressentie comme une nécessité par la bureaucratie russe; elle ne l'était
pas par les partis communistes occidentaux, encore moins par la direction
du parti français. Il n'y a pas en France de démocratie populaire, mais
une démocratie bourgeoise tout court; le P.C. n'est pas au pouvoir mais
dans l'opposition. Sa situation de seul grand parti opposant constitue la
raison essentielle de son influence sur les travailleurs, mais son idéologie
et ses méthodes ne se justifient que par l'existence d l’U.R.S.S. et des
a pays socialistes ». L'infaillibilité de l’U.R.S.S. et de Staline (fondée sur
leurs « grandes victoires ») garantissait jusqu'ici celle du P.C. français
et de Maurice Thorez. Elle n'était pas seulement la réponse-clé face aux
militants mais encore la justification des dirigeants à leurs propres yeux.
On comprend donc l'embarras du P.C. immédiatement après le XX
Congrès (1) et pourquoi il a évité alors tout ce qui aurait pu mettre en
cause celui que le dernier Congrès du P.C.F. (juin 54) saluait par la
bouche de Duclos comme « Notre grand camarade Staline, ce prestigieux
architecte du communisme, ce maître du socialisme, dont les leçons nous.
inspirent et nous guident dans nos combats ».
Si les voies de Staline avaient été quelque fois ténébreuses, celles
de Khrouchtchev se révélaient surprenantes, même pour les bons élèves
français. Mis devant le fait accompli, les dirigeants du P.C.F. devaient
non seulement amortir le choc de leurs militants, mais se convaincre encore
eux-mêmes de la portée et de la sagesse de la révision anti-stalinienne.
Une rapide lecture de « L'Humanité » nous donne un aperçu de cette
répudiation douloureuse et prudente.
Ainsi « L'Humanité » du 20 février titre en première page, à
propos
du Congrès : « Molotov: La France et l’U.R.S.S. peuvent s'entendre ».
C'est le lendemain du jour où Mikoyan avait déclaré:
« Au cours des quelques vingt dernières années nous n'avons eu
aucune direction collective. Florissait alors le culte de la personnalité... »
« La caractéristique essentielle de la tâche du Comité Central au cours
des trois dernières années a été de créer, après un long intervalle, la
direction collective du parti » < ...cette direction collective a réussi
à restaurer les normes léninistes concernant la vie du pays de la base
au sommet... »
Mais « L'Humanité » supprime carrément ces passages et dilue enim
suite les critiques du « Précis d'Histoire du P.C. russe » et de la bro-
chure de Staline « Problèmes économiques du socialisme en U.R.S.S."».
Par contre, les jours suivants, de longs articles détaillent les * Non-
veaux progrès du bien-être en U.R.S.S. », les « Réalisations grandioses du
Plan ». On porte l'accent sur la coexistence, le rapprochement avec la
social-démocratie, la possibilité enfin reconnue d'utiliser des voies paci.
fiques vers le socialisme.
Le 5 mars « L'Humanité » publie encore, en troisième page il est
vrai, un portrait de Staline avec une légende élogieuse.
Le 10 mars Duclos fait une conférence sur le XX Congrès à Wagram.
Répondant aux détracteurs de Staline, il admet:
« Ce qui est vrai c'est que durant une période de l'activité de Sta.
line le principe de la direction collective n'a pas toujours été appliqué.
(1) Bien sûr, le « tournant » ne datait pas du XX Congrès. Dès le
lendemain de la mort de Staline, les réformes commençaient et la Russie
accentuait sur le plan international la politique de « coesistence » dont
les conséquences furent immédiates sur la ligne des para communistes
dans tous les pays. On passait progressivement de la politique du type:
manifestation contre Ridgway (mai 1952) à celle d'ententę syndicale
(1953), de propagande du Front Populaire (1955) et de soutien au Gour
vernement Guy Mollet (1956).
148
Il est vrai aussi que dans ces conditions des fautes ont été commises ».
Mais il proclame aussitôt: « Personne ne peut oublier qu'à la direc-
tion du Parti et de l'Etat soviétique, Staline joua un rôle de premier
plan dans cette défense nécessaire des conquêtes de la Révolution d'Octo-
bre 1917. Personne ne peut non plus oublier le rôle joué par Staline
dans la construction du socialisme en U.R.S.S. et dans la conduite de la
guerre contre les hitlériens. Les mérites du camarade Staline sont inscrits
l'Histoire, ils font partie du patrimoine du mouvement ouvrier in.
ternational. »
Plus prudent encore, François Billoux, dans un long article, « Après
le XX° Congrès », trouve le moyen de parler de « l'autocritique qui y a.
été faite ) sans rentionner le nom de Staline.
L'idéal serait de minimiser ainsi le tournant russe, mais la déstalini-
sation fait son chemin en Russie et toute la presse mondiale s'en fait
l'écho.
Le 19 mars « L'Humanité » doit bien avouer l'existence du rapport
secret de Khrouchtchev. Elle le confirme le lendemain et en donne un
résumé édulcoré mais contenant déjà de vives critiques de Staline.
Le Comité Central réuni le 22 mars consacre l'embarras du P.C.: la
Résolution adoptée doit admettre une certaine critique de Staline; inais
Thorez ne participe pas aux débats. Et il commente, sans se référer à
cette Résolution, les travaux du XX° Congrès ; tout en reconnaissant le
culte de la personnalité et des erreurs, il fait un vif éloge de Staline.
Cependant, le lendemain, « L'Humanité » doit publier des extraits
d'un violent article de la « Pravda »: « Staline a abandonné les prin.
cipes du Parti, il a méconnu la démocratie dans ses rangs, il a violé la
légalité révolutionnaire et a pris des mesures injustifiées de répression...)
Le 11 avril « L'Humanité » reproduit, en sens contraire, un article
du « Quotidien du Peuple », organe du P.C. chinois, où les grands
mérites de Staline sont évoqués à côté de ses dernières fautes.
Trois jours plus tard elle doit de nouveau se faire l'écho d'attaques
contre Staline en reproduisant un articles de la revue russe a Ques-
tions d'Histoire » sur l'analyse de certains événements historiques
d'avant Octobre a l'actuel après-guerre.
Balloté entre les mérites et les erreurs, entre les éloges et les cri-
tiques, le P.C.F. en arrive ainsi à la publication par la presse mondiale
du rapport secret de Khrouchtchev.
« L'Humanité » devient tout à coup muette: ni démenti ni confir-
mation. Son silence ne pouvait pourtant pas durer. Le décalage entre le
contenu de ce rapport et l'attitude de la direction du P.C. ne faisait
qu'accroître le malaise des militants. Un mois à peine avant publicatica
intégrale du rapport, Thorez n'affirmait-il pas encore, en commentant le
Projet de Thèses approuvé par le Comité Central du 10 mai:
« C'est lui (Staline) qui nous avait enseigné la nécessité de la cri-
tique et de l'autocritique... et pourtant, par le culte de la personnalité, il
s'est laissé conduire à l'absence de critique et d'autocritique véritables,
Ii a été conduit à la suffisance et à la présomption ». Mais: a Tout eela
n'est pas simple, rectiligne. Au même moment, Staline lui-même nous
donnait un ouvrage sur la linguistique qui reste une base très utile, véces
saire, d'explication de notre théorie du matérialisme dialectique... »
« ( L'Humanité 12-5-56).
.
Khroucktchev dit: Staline ordonnait le massacre de communistes, fal-
sifiait l'histoir fabriquait des fausses accusations, faisait assassincr ses
collaborateurs déportait des nations entières ; Staline, qui étudiait les
opérations militaires sur une mappemonde, était responsable de la mort
de centaines de milliers de soldats soviétiques, Staline « est écoeurant ».
Il était suffisant et présomptueux, dit Thorez, mais il faisait de l'excel.
lente linguistique et la linguistique cela compte tout de même!
149
La siffusion du rapport re pëut donc être indéfiniment ignorée. Qua-
rante-huit heures après la publication de l'interview de Togliatti, le P.C.F.
reconnaît à son tour son existence, tel que la « presse bourgeoise pu-
blie », et la « légitime émotion qu'il suscite permi les membres du Parti
Communiste Français ».
Après avoir regretté « qu'en raison des conditions dans lesquelles le
rapport du camarade Khrouchtchev a' été présenté et divulgué, la presse
bourgeoise ait été en mesure de publier des faits que les communistes
avaient ignorés », la Déclaration du Bureau Politique poursuit:
« Les explications données jusqu'à présent sur les fautes de Staline,
leur origine, les conditions dans lesquelles elles se sont produites, ne sont
pas satisfaisantes. Une analyse marxiste approfondie est indispensable pour
déterminer l'ensemble des circonstances dans lesquelles le pouvoir per.
sonnel de Staline a pu s'exercer.
II était erroné, du vivant de Staline, de lui adresser des éloges
dithyrambiques et de lui attribuer le mérite exclusif de tous les succès
remportés en Union Soviétique grâce à une ligne générale juste au ser.
vice de la construction du socialisme. Cette attitude contribuait à déve.
lopper le culte de la personnalité et à influencer dans un mauvais sens
le mouvement ouvrier international. Aujourd'hui, il n'est pas justę d'attri.
buer Staline seul tout ce qu'il y a eu de négatif dans l'activité du Parti
Communiste de l'Union Soviétique.
Staline a joué un rôle positif durant toute une période historique.
Avec les autres dirigeants du Parti, il a pris une part active à la Révo.
lution socialiste d'Octobre, puis à la lutte victorieuse contre l'intervention
étrangère et la contre-révolution. Après la mort de Lénine, il a combattu
les adversaires du marxisme-leninisme et lutté pour l'application du plan
leniniste d'édification du socialisme. Il a contribué dans une grande mesure
à la formation de tous les partis Communistes.
Staline s'est acquis un prestige mérité qu'il a laissé se transformer
en culte de sa personne. Le développement de ce culte a été facilité par
la situation de l'Union Soviétique, longtemps seule exposée aux entre-
prises d'un monde d'ennemis, ce qui exigeait une tension extrême des
forces du peuple, une discipline de fer et la centralisation rigoureuse du
pouvoir de l'Etat prolétarien. Ces circonstances aident à comprendre les
difficultés énormes auxquelles l'Union Soviétique a dû faire face, sans
justifier toutefois les agissements de Staline. Il s'est livré à de nombreuses
wiolations de la légalité soviétique; il s'est engagé dans une répression arbi-
traire contre des militants communistes; il a transgressé les principes da
Parti et, utilisant des méthodes condamnables, il a causé de graves
dommages à l'Union Soviétique et mouvement communiste inter-
national ».
La Résolution rappelle ensuite le « bilan exaltant de l'Union So-
viétique qui ayant achevé la construction du socialisme, s'est engagée sur
le chemin de la société communiste », promet aux militants une discussion
sur le rapport Khrouchtchev avant le Congrès de juillet et se termine
sur un hymne au Front Populaire.
Le P.C.F. n'accepte donc pas la version Khrouchtchev. Mais son
propre essai d'interprétation est un modèle de confusion. En premier lieu,
il est remarquable que la Déclaration ne conteste nullement la validité des
critiques faites par Khrouchtchev à Staline (déportations de peuples
entiers, assassinats et tortures, etc...) elle se contente de dire que ce
dernier ne peut être rendu seul responsable. Par ailleurs, le Bureau Poli.
tique continue d'attribuer une importance décisive à l'action de Staline
pendant la révolution et la guerre civile, alors que Khrouchtchey explique
dans son rapport qu'il était pratiquement inconnu des masses avant 1924
et que des publications officielles comme la « Pravda » et la revue
a Questions d'Histoire » ont rappelé son influence négative pendant toute
une partie de la Révolution de 1917 et montré comment il avait inventé
V 송
au
150
lui-même après-coup son rôle éminent dans la guerre civile. La Déclara-
tion reconnaît que les erreurs de Staline orit eu de graves conséquences
pour le mouvement ouvrier international, mais affirme en revanche que
a Staline a contribué dans une grande mesure à la formation de tous
les partis communistes ». Enfin, le Bureau Politique demande une « ana.
lyse marxiste approfondie des. circonstances dans lesquelles le pouvoir
personnel de Staline a pu s'exercer ». Mais alors que Togliatti va jusqu'à
évoquer « un développement excessif des appareils bureaucratiques dans
la vie économique et politique soviétique », la Déclaration ne donno
aucune base sociale aux « erreurs » et se contente de rappeler les a diffi-
cultés énormes auxquelles l'Union Soviétique a dû faire face ».
Cela n'exclut d'ailleurs pas que la direction du parti français fasse
un tel genre d'analyse si les circonstances l'exigent. Mais il y a analyse
et analyse. Or, un examen des causes réelles de ce que le Bureau Poli.
tique appelle des erreurs ne pourrait que dévoiler les contradictions du
régime en, U.R.S.S., l'existence des classes, leur lutte quotidienne. C'est
pourquoi tout ce que, dans le meilleur des cas, les Thorez et Cie (ou leurs
remplaçants) seraient capables de faire c'est d'élaborer une espèce
d'explication pseudo-trotskyste (fondements socialistes de l’U.R.S.S. mais
influence négative de certa es couches bureaucratiques favorisée par les
nécessités de la défense contre l'encerclement capitaliste), explication
d'ailleurs purement rétrospective puisqu'ils voient dans la Russie actuelle
un régime socialiste engagé dans la voie du communisme. Mais même
cette interprétation il est fort douteux qu'ils arrivent à la formuler, car
elle risquerait d'élargir dangereusement la brèche ouverte par Khrou-
chtchev, et de mettre en question le rôle joué par les dirigeants actuels
de l'U.R.S.S. et des partis communistes, collaborateurs et exécutants de
la politique stalinienne. Et pourtant ce serait la seule qui pourrait pré-
senter un semblant de solidité. La difficulté pour le P.C.F. aujourd'hui
réside justement là, dans le fait qu'il doit répondre et que toute réponse
tant soit peu sérieuse ne peut que saper sa propre base idéologique.
Il éprouve ainsi combien se révèle relative la toute-puissance de
l'appareil dirigeant face à l'enchaînement d'événements provoqué par le
développement de forces sociales antagoniques que l'industrialisation a
suscité en U.R.S.S. C'est une cruelle leçon de matérialisme dialectique pour
les dirigeants du P.C.F.! Mais leur propre appartenance à cet appareil
les empêche de changer de méthodes. La préparation du prochain Con-
grès à coups de résolutions approuvant la politique de l'actuelle direction,
la plate comédie de la « Tribune Libre » de « L'Humanité », laissent
présager de la façon dont le Bureau Politique entend mener la discussion
promise sur le rapport Khrouchtchev.
Quelle que soit l'importance des répercussions de la déstalinisation,
elle ne doit pas nous faire perdre de vue les problèmes politiques que pose
au P.C. la situation en France. Placé dans le cadre nouveau de la détente
internationale, libéré des consignes de lutte contre l'Etat qu'imposait,
auparavant, la stratégie de l'U.R.S.S., le P.C. est voué à développer une
politique de collaboration de classe. Celle-ci répond d'ailleurs à sa nature;
elle traduit la pression que l'ordre social bourgeois exerce sur ce grand
parti fonctionnarisé et « représentatif » en le poussant sur le terrain na-
tional et réformiste.
Le Projet de thèses élaboré pour le XIV Congrès est à cet égard très
clair. L'essentiel de ce document est consacré à l'exaltation des « triomphes
da camp socialiste » et à la justification d'une politique parfaitement
exprimée par son sous-titre: « Le Parti Communiste Français dans la lutte
pour le progrès social, pour la paix, pour un avenir de grandeur
nationale n.
Le P.C.F. cherche à sortir de son isolement politique. Il accentue le
caractère réformiste et national de sa politique dans tous les domaines
comme en font foi son attitude en faveur du maintien de la présence
151
!
frangaiso ou Afrique du Nord et son extrême modération sur le terrain
dos rovondications ouvrières et déclare ouvertement que son but est de
créer los conditions d'un nouveau Front Populaire.
On pout bien constater que le Projet de thèses ne dit rien sur le
contenu de celle nouvelle orientation et que la formule de la France
socialintos rente purement abstraite. Cependant le besoin que ressent le
P.C.I d'un programme national est réel et l'insistance qu'il met à pro-
clamor l'objectif du Front Populaire témoigne de son effort pour ouvrir
une nouvelle voie. Le Projet contient une série détaillée de mesures immé.
dialos de salut national. Il revient en outre sur les déclarations de Thorez
on 1946 ( « Nous avons toujours pensé et déclaré que le peuple de
Frunce, riche d'une glorieuse tradition, trouverait lui-même sa voie vers
plus de démocratie, de progrès et de justice sociae ») et réaffirme qu'il
est possible de s'acheminer pacifiquement vers le socialisme. A cet égard
il n'hésite pas à procéder à une ahurissante démonstration sur l'usage
révolutionnaire qu'on peut faire du Parlement bourgeois pour instaurer
le socialisme.
C'est donc sur de telles bases que le P.C.F. compte mener en France
$2 lutte pour « le progrès social, pour la paix et pour un avenir de
grandeur nationale ».
Cependant, on s'abuserait si l'on pensait que cette politique peut se
développer sans heurts. Ce serait oublier que le P.C. doit tout le crédit,
dont il jouit auprès des masses, à ce qu'il paraît combattre la bourgeoisie;
ce serait également oublier que, dans la conjoncture actuelle, la guerre
d'Algérie l'oblige à afficher une certaine opposition au Gouvernement et
qu'elle ne lui permet pas de collaborer avec les socialistes comme il le
souhaiterait. Compte tenu de cette situation, on doit reconnaître que le
tournant russe, s'il facilite une attitude réformiste, rend plus difficile
les manoeuvres du P.C. vis-à-vis des masses. Il risque d'amener entre
IU.R.S.S. et le capitalisme français une série d'engagements, de conces-
sions réciproques et de marchandages qui peuvent mettre le Parti dans
une fausse position par rapport à la classe ouvrière. En outre, la déstali-
nisation en altérant le mythe du « paradis socialiste » atteint le Parti
et aſſaiblit le prestige de ses dirigeants.
Incertaine en ce qui cencerne la réelle portée des mesures appliquées
eu Russie et les perspectives internationales, prise entre ses tendances
naturelles à la collaboration avec l'Etat et le rôle limité que le poussif
capitalisme français peut consentir à la bureaucratie syndicale et politique,
soucieuse de ne pas se couper complètement de sa base ouvrière, la direc-
tion du P.C.F. ne peut pas s'engager franchement dans la vie d'une oppo-
sition purement légale et nationale. D'où ses tentatives de se délimiter du
réformisme en général, ses références à Lénine, ses attaques verbales
contre l'opportunisme, parallèlement aux appels à l'unité avec les socia-
listes et les démocrates, à son souci de patriotisme et de légalité répu-
blicaine. En même temps par son idéologie, par sa structure et par son
passé tout aussi incapable que les autres partis communistes nationaux
de s'engager dans la voie révolutionnaire du développement des initiatives
et de la conscience du prolétariat, de la coordination de ses mouvements
de classe à l'échelle internationale, le Parti Communiste Français est de
moins en moins en état d'élaborer une politique « payante » autre que
celle du réformisme et du nationalisme. Or, la « destalinisation », en
portant au paroxysme cette contradiction apparue en clair dès la fin de
la « guerre froide » risque de miner de plus en plus le « monopole »
du stalinisine français et par là d'ouvrir une nouvelle étape de
la lutte prolétarienne en France.
A. VEGA.
1
153
L'INGENUITE DECONCERTANTE DES
CHEFS GENIAUX
« Il est vrai que nous avons ignoré que Staline exerçait
un pouvoir personnel. L'aurions-nous su que nous arrions
désapprouvé cette atteinte à nos principes... Il est vrai que
nous avons cru que les principes qu'enseignait Staline étaient
par lui respectés. Aurions-nous su qu'ils étaient violés, que
nous aurions désapprouvé cette pratique... »
(A. Wurmser, l’Huma-Dimanche, 24 juin 1956).
RIDEAU SUR LA METAPHYSIQUE DES PROCES
Et comment se peut-il qu'une personne confesse des crimes qu'elle
n'a pas commis? D'une seule manière: à la suite d'applications de mé-
thodes physiques de pression, de tortures, l'amenant à un état d'incons-
cience, de privation de son jugement, d'abandon de la dignité humaine.
C'est ainsi que les confessions étaient obtenues.
(Khrouchtchev, Rapport secret au XX Congrès du P.C.U.S.,
Le Monde, 9 juin 1956).
Khrouchtchev ne parle que de certains procès, et non des plus im-
portants. Ceux sur qui il s'apitoie sont en général ses semblables: des
vrais staliniens, qui, après avoir maintenu le tête des victimes de Staline
sur le billot ont à peine eu le temps de sentir la hache s'abattant sur
leur propre nuque. Postychev, Kossior, Antonov-Ovseenko ont été pris
dans le fonctionnement de cette même machine infernale qu'ils avaient
aidé à mettre en place, à laquelle Khrouchtchev et la direction actuelle,
plus chanceux, plus habiles, plus serviles aussi peut-être, ont pu échapper.
Khrouchtchev ne parle que de certains procès. Mais son explication
vaut pour tous. Dans tous les procès, les aveux étaient la SEULE
« preuve ». On reconnaît maintenant qu'ils étaient obtenus par la tor-
ture. Par ailleurs Khrouchtchev regrette que la répression contre les « tro-
tskistes, zinoviévistes, boukhariniens » ait été poussée trop loin, et qu'une
politique correcte ne les ait pas ramenés dans le parti. Les trotskistes, les
zinoviévistes et boukhariniens ont été condamnés en ayant avoué qu'ils
étaient des agents d'Hitler, qu'ils travaillaient pour déclencher la guerre
et démembrer l'U.R.S.S., qu'ils empoisonnaient des ouvriers, qu'ils fai-
saient dérailler les trains. Dire qu'il fallait les ramener au parti, c'est
dire, dans la manière gluante et lâche qui est celle de Khrouchtchev, que
tout cela était faux, que ces aveux avaient été arrachés par la torture
donc que ces procès aussi étaient des machinations pures et simples.
Enfin, dans la plupart des pays satellites de la Russie, on a hâtivement
« revisé » les procès des dirigeants staliniens Rajk, Kostov, etc. qui
avaient pourtant « avoué » leur trahison, et on les a « réhabilités » (1).
(1) Sauf Slansky, que Prague s'obstine à considérer seul parmi ses
coaccusés aujourd'hui « réhabilités » comme agent de l'hitlérien Tito,
qui, il est vrai, n'est plus hitlérien, mais un honnête dirigeant communiste
calomnié par l'espion anglais Béria, à en croire du moins Khrouchtchev,
dont on ne sait encore pour le compte de qui il travaille. Le mépris de
l'humanité, que traduit l'incohérence et le cynisme des mensonges des
staliniens, n'a jamais été égalé dans l'histoire, pas même par les chefs
du nazisme.
153
Dem proces, il n' route plus rien.
llions de la mort physique qu'on avait voulu bâtir sur leur exemple.
Rion de la lleorio de la culpabilité objective, des choix déchirants entre
los politique no lo moralité, de la crise de la dialectique marxiste qu'ils
murnirul imute (2). Le raisonnement: l'opposition avait besoin d'alliés,
cillo aliruit pour utiliser les koulaks, ceux-ci auraient pu échapper à son
0111 role ol reussir à restaurer le capitalisme donc, l'opposition aboutis-
Molit objectivement à préparer la restauration du capitalisme, ce sorite
obomurda sule, ne nous laissant que les éclats de l'amalgame du procureur,
dllquel le philosophe avait essayé de conférer à son propre usage un sens
factice.
Factice, car tout d'abord on interprétait les procès en les situant dans
we perspective révolutionnaire qui n'a jamais été la leur. Depuis de
longues années, les accusés des procès avaient abandonné le terrain de la
lutte prolétarienne; comment les conflits possibles de la conscience de
Boukharine ou d'un autre auraient-ils pu dans ces conditions traduire une
crise de la dialectique marxiste? Tout au plus, auraient-ils pu témoigner
d'une de ces oppositions insolubles entre la « morale » et l' « efficacité »
qui appartiennent organiquement à la politique bourgeoise. Nous ne
voulons pas dire qu'une politique révolutionnaire ne peut jamais, par
définition, se trouver devant des contradictions insurmontables sur l'ins-
tant même, que pour elle la solution de tout conflit possible est garantie
d'avance. Mais de telles contradictions n'apparaissent que dans des situa-
tions-limites, elles marquent un arrêt du développement du processus révo-
lutionnaire, leur persistance au cours de ce processus est inconcevable.
Dire qu'un conflit entre « morale » et « efficacité », entre « intentions »
et résultats », entre « programme » et « réalité » a pris à la gorge les
dirigcants et les opposantsrusses de 1923 à 1939, c'est tout simplement dire
que ces dirigeants et ces opposants (quelles qu’aient pu être leurs « in-
icntions ») ne pouvaient plus se situer sur le terrain de la problématique
revolutiounaire objectivement (parce que la configuration du processus
historique et la place qu'ils y avaient assumée leur interdisait de le faire);
c'est dire que la société russe après 1923 a été dominée par cette même
scission fondamentale entre la vérité et l'efficacité, l'intérieur et l'extérieur,
la direction qui sait, calcule et agit et l'exécution qui ignore,
attend et subit qui est constitutive d'une société d'exploitation. On est
alors renvoyé à une analyse historique concrète de la société russe contem-
poraine, de la nature économique et sociale de la bureaucratie, du rôle
du stalinisme. Fuyant cette analyse et discutant les problèmes des politi-
ciens du système, dirigeants ou opposants, en les plaçant dans une perspec-
tive révolutionnaire dont ji ne se demande pas si elle peut désormais être
la leur, le philosophe crée une opposition imaginaire entre une réalité
redevenue la simple réalité de l'exploitation et de l'aliénation
projection sur un écran révolutionnaire, projection arbitraire dont il est
seul responsable. On aurait pu discuter des contradictions insolubles aux-
quelles peut se heurter une politique révolutionnaire, non pas à propos
des procès de Moscou, ni même des « capitulations » de 1928 qui les
commandent, mais à propos de Kronstadt, par exemple. On se serait alors
aperçu qu'elles ne traduisent pas simplement une crise de la dialectique
marxiste, mais beaucoup moins et beaucoup plus à la fois :: une crise,
un arrêt ct un recul de la révolution tout court. Et certes, cet arrêt, de
même que le nouveau départ de la révolution, ne laisse pas de poser des
problèmes, qu'il eut fallu examiner. Mais en même temps, il eut été alors
in possible de ramener Boukharine à Socrate, Lénine à Edipe et Trotsky
l’Apprenti sorcier, de supprimer les questions propres à la révolut par
le « maléfice de la vie à plusieurs » et d'aboutir à ce désert du scoprin
et sa
(2) M. Merleau Ponty, Humanisme et terreur.
154
cisme politique où, quoiqu'on dise par ailleurs, tout se vaut, où tous les
projets se fanent tôt ou tard, où toute perspective d'action rationnelle est
finalement abolie.
Factice, cette inétophysique l'était aussi en un autre sens; les « révé-
lations » de Khrouchtchev confirment que les procès ne traduisaient même
pas des oppositions politiques au sein de la bureaucratie, du genre de celles
pouvant exister pour une politique bourgeoise. Même à la dissertation
classique sur les conflits de l'intention et du résultat de la fin et des
moyens, au sein d'un monde aliéné, ils ne sauraient servir d'exemple.
L'épuration d'une partie de la bureaucratie par son noyau dirigeant n'a
certes pas été le résultat de la folie de Staline, ni d'un culte de la person-
nalité tombé du ciel, comme voudrait le faire croire Khrouchtchev; les
procès ont accompli une fonction sociale la terreur a cimenté la bureau-
cratie et glacé pour quelque temps le peuple et une fonction politique
ils ont consacré sans contestation possible le groupe dirigeant et la
personne incarnant la classe bureaucratique. Mais à aucun moment ils
n'ont traduit un conflit politique actuel, vécu comme tel par les pro-
tagonistes. L'exécution de quelques ex-opposants marquants parmi les mil-
liers de staliniens sacrifiés ne visait pas à liquider des divergences poli-
tiques, abandonnées ou tues depuis de longues années, mais à fournir à
la fois un prétexte et un masque politique à cette auto-épuration de la
bureaucratie, àà terroriser les éventuels opposants vrais en leur montrant
l'horrible sort de tout opposant
même fictif.
Rien des « explications » des aveux par les « mystères de l'âme
russe », ou, plus élégamrnent sinon plus sérieusement, par la complicité
des accusés et du tribunal, par le fait que ceux-ci adhéraient en somme
à la théorie de la culpabilité objective et se prêtaient librement à la
mise en scène la plus efficace. Boukharine, a-t-on dit, s'inclinait devant
l'histoire, et se reconnaissait coupable parce que vaincu. « Boukharine, >>
dit en fait Khrouchtchev, ne reconnaissait rien du tout; la torture
l'avait amené « à un état d'inconscience, de privation de son jugement,
d'abandon de la dignité humaine » tel qu'on pouvait lui faire tout dire.
Certes la torture n'est pas un absolu, et si les hommes y cèdent
c'est en fonction d'une psychologie et d'une perspective politique.
L'« explication » de Khrouchtchev, si elle est superficiellement cor-
recte, comme description des faits matériels, est en même temps incom-
plète et mécaniste, et traduit par là précisément encore une fois la
mentalité bureaucratique de l'interprète. A Moscou la torture n'a eu
de prise que sur des gens qui étaient déjà des cadavres idéologiques.
Comme le faisait remarquer à l'époque Victor Serge (3), pas un oppo-
sant révolutionnaire authentique n'a jamais figuré aux procès. La tor-
ture n'a pu jouer que contre des gens politiquement brisés depuis
longtemps, ayant capitulé, s'étant reniés, ayant en fait complètement
abandonné non seulement toute perspective révolutionnaire, mais toute
attitude politique. D'ailleurs, la torture n'a été efficace que dans la mino-
rité des cas; il y a eu des suicides, les plus nombreux des fusillés l'ont
été sans jugement public. On n'amenait aux procès que ceux dont on
était sûr; même parmi ceux-là certains, comme I.N. Smirnov pendant le
procès des Seize, ont failli tout compromettre.
Ce n'est pas devant le tribunal qu'il y a eu « complicité » des
accusés. La « solidarité » des condamnés avec le système qui allait les
fusiller, il faut la chercher ailleurs: dans leur capitulation, dans leur
participation à l'idéologie et à la mentalité bureaucratiques. Le ressort
moral qui permet à un révolutionnaire de résister à la pression physique
et à la torture est solidaire de tout ce qu'il pense, de tout ce qu'il est :
de sa haine irréconciliable du système d'exploitation et du type humain
(3) Destin d'une révolution (1937), p. 255.
155
1
-
représenté par les exploiteurs, leurs procureurs et leurs policiers ; do la
perspectivo humaniste positive qu'il se pense en droit de leur opposer.
Ce qui apparuit comme l'héroïsme du révolutionnaire, c'est que certaines
idéos collont encore plus fermement à son corps que ses ongles et sa
poau, ot con idées ne sont que le critique menée jusqu'au bout de la
société d'oxploitation et le projet d'une société humaine. La force de cet
héroïsme owl Ja conscience d'une scission radicale avec les oppresseurs
de l'opposition absolue de deux mondes. Or les accusés des procès
qu'il s'agisse de ceux de Moscou avant guerre, ou de ceux des pays satel.
lites après la guerre
étaient en fait solidaires du système d'oppression
qui venait de s'établir. Les groupes successifs des capitulards ex-bolchéviks
qu'ils fussent auparavant des opposants « de gauche » ou « de droite »
ou dos fidèles de Staline n'avaient jamais critiqué, si ce n'est super-
ficiellement, le régime qui s'établissait depuis 1923; ils avaient plutôt
contribué à l'établir; encore moins étaient-ils capables de lui opposer une
perspective sociale fondamentalement difffférente. La Russie restait pour
eux un pays socialiste, et le socialisme le pouvoir de la bureaucratie
qu'ils auraient voulu moins brutal. Où donc auraient-ils puisé la force
de s'y opposer? Cela est encore plus clair dans le cas des épurations des
pays satellites d'après guerre. Les Rajk, les Kostov, les Slansky, quelles
qu'aient pu être leurs particularités individuelles, en quoi différaient-ils
politiquement et nous donnons à « politique » le sens marxiste d'une
philosophie de l'histoire et d'une conception de l'homme devenues pra-
tique quotidienne des Rakosi, des Gottwald? Pour les uns et pour les
autres, il s'est toujours agi d'utiliser la révolte de la classe ouvrière afin
de s'emparer du pouvoir par tous les moyens, d'établir une planification
économique et une dictature totalitaire (qu'au fond d'eux-mêmes ils
appellent cela « socialisme » et le considèrent comme le salut de l'hu-
manité imporle peu, aussi bien en général que pour notre discussion). Que
le hytome ne retourne contre eux, quelle motivation leur reste pour
lutter? Aucune autre que le modul personnel et dès lors, l'«
abrige la torture at permet de wooccrocher i l'espoir d'une grâce, dont
Ja lueur apparaît d'autant plus forte que l'accuse He wait perdu.
En ce sens, il est vrai que les « aveux » impliquaient que les neceum
reconnaissaient leur identité finale avec les juges - non pas qu'ils recon-
naissaient en ceux-ci des révolutionnaires victorieux, mais qu'ils recon-
naissaient en eux-mêmes des bureaucrates vaincus.
Dès les premiers grands procès de Moscou, il apparaissait clairenient
que les accusations étaient forgées de toutes pièces. Pour tous ceux qui
persistaient à vouloir penser, les réquisitoires n'ont jamais été que des
énormes accumulations de faux monstrueux, fabriqués par des procu-
reurs maladroits et médiocrement intelligents, à qui la censure totalitaire
et l'appareil publicitaire international de la bureaucratie permettaient de
bâcler leurs dossiers, inventant à plaisir des hôtels inexistants, des ater-
rissages d'avions qui n'avaient jamais eu lieu, etc... (4)
Cela ne signifie pas qu'il ait eu, à l'extérieur des cercles staliniens,
une clameur contre l'imposture des procès. Au contraire. Il faut certes
rappeler face à la nouvelle mystification qui déjà se développe, que les
aveu >>
(4) L'accusé Goltzman « avoua » avoir rencontré Trotsky à Copen-
hague en 1932 à l'hôtel Bristol qui avait été détruit par un incendie
en 1917.
Piatakov « avoua » s'être rendu en Norvège par avion le 12
ou 13 décembre 1935 et avoir atterri à Oslo. La presse norvégienne ayant
inimédiatement affirmé qu'aucun avion étranger n'était arrivé à Oslo on
décembre 1935, Vychinski fit dire à Piatakov à l'audience, deux jours plus
tard, qu'il avait atterri « près » d’Oslo, et produisit un communiqué do in
représentation commerciale de l’U.R.S.S. en Norvège affirmant que l'acro-
drome de Kjeller, « près d'Oslo », recevait toute l'année les avions Strap-
156
ont pu
dirigeants russes actuels ont autant de sang sur les mains que Staline; quo
Khrouchtchev, Malenkov, Mikoian, Molotov, Kaganovitch écrivaient ou
faisaient écrire à longueur de journée pendant les procès: Fusillez les
chiens enragés! ; que Thorez, Duclos, Togliatti, Pollit, Gallacher, etc... ont
participé activement aux assassinats, en propageant les faux, en faisant le
silence sur tous les démentis, en traitant quiconque osait douter de fas.
ciste et de policier; qu'ils ont beau vouloir passer du rôle de chefs géniaux
et infaillibles à celui de crétins avalant pendant vingt ans toutes les inven.
tions d'un « fou » et d'un « espion britannique », il reste qu'ils ont eux.
mêmes assassiné tant qu'ils ont pu les opposants révolutionnaires
trotskistes, anarchistes, poumistes, socialistes de gauche partout où ils
en Espagne, en France, en Grèce, en Indochine
à une
échelle d'autant plus vaste qu'ils se sentaient plus proches du pouvoir;
qu'ils continuent les mensonges et les amalgames tous les jours, puisque
l'Humanité, depuis quatre mois, n'est qu'un long mensonge pour ce qui
concerne le XX° Congrès, puisque la résolution de leur Bureau politique
n'est qu'un mensonge de plus lorsqu'ils y prétendent « avoir tout ignore >>
eux, sans l'aide active et conscient de qui une bonne partie des crimes
de Staline eut été impossible.
Mais il faut rappeler plus. Il faut rappeler que les crimes de Staline
ont joui de la complicité de toute la société établie. Car, dans la mesure
où l'on exterminait les militants révolutionnaires, ou les représentants,
même « capitulards », même avilis, de 1917, bourgeois aussi bien que
réformistes s'en réjouissaient. En fait, ce n'est qu'après 1945, lorsque
la guerre froide les poussa à chercher des arguments pour leur propo.
gande anti-russe, lorsque, tout mouvement révolutionnaire leur paraissant
impossible, ils ne craignirent plus de renforcer une opposition ouvriere
an stalinisme, lorsqu'aussi les victimes des procès commencèrent à être
recrutées parmi les bureaucrates staliniens purs et simples, qu'ils ont
commence à « dénoncer » les procès. Jusque-là, ils ont été presque tous
complices: la S.F.I.O., dont le Populaire s'est tu depuis 1934 sur les
crimes du Guépéou (le rapprochement Staline-Laval d'abord, le Front
populaire ensuite l'exigeaient!); les socialistes espagnols, laissant les
mains libres à ce même Antonov-Ovséenko, dont Khrouchtchev pleure
aujourd'hui l'injuste exécution par Staline combien injuste, en effet,
puisqu'Ovséenko a été, en même temps que Marty, l'organisateur de la
répression contre-révolutionnaire en Espagne républicaine; les socialistes
norvégiens, au pouvoir en 1935-36, dont le ministre de la « justice »,
Trygve Lie, bâillonnait Trostky pendant trois mois en 1936, en plein
procès des Seize, l'isolant et l'empêchant de se défendre contre une ma-
chination qui le visait en premier; la Ligue des Droits de l'Homme fran.
çaise, dont le président, Victor Basch, trouvait la procédure des procès
de Mascou parfaitement normale ; les journalistes « objectifs », comme
M. Duranty, les juristes « socialistes », comme Mr. Pritt, Conseiller de
gers. Le surlendemain, le directeur de l'aérodrome de Kjeller déclarait
qu'on pouvait constater sur les registres de l'aérodrome qu'aucun avion
étranger n'y avait atterri entre le 19 septembre 1935 et le 10 mai 1936.
Ce fait, en même temps que le témoignage que Trotsky n'avait certaine-
ment pas pu rencontrer Piatakov en décembre 1935, furent portés à la
connaissance du « tribunal » de Moscou avant la clôture des débats par
télégramme de Konrad Knudsen, député socialiste norvégien, hôte de
Trotsky pendant son séjour en Norvège. Le « tribunal » ignora naturelle-
ment cette déposition d'un témoin non cuisiné par le Guépéou, et Piatakov
n'en fut condamné et fusillé que plus rapidement. Sur tout cela, et une
foule d'autres faits analogues, v. « Les crimes de Staline » de Trotsky
(1937).
157 -
Ha Majumba borin. 197000', qui, invité à Moscou pendant les procon, 110110u
lv porovoduna impeccable et les verdicts justifiés -, etc,, cle...
Complorem, inuis les intellectuels « de gauche »,
à des rares (xcep-
Lionom porin
"I 11019 ne parlons pas des staliniens avérén, mais de touto
In venire ancoporie de « sympathisants » proches ou lointains; les saints
my love officers, les Romain Rolland et les JeanCassou, couvrant de leur
autorila morale l'ignoble opération, et tous les autres qu'il serait fasti.
dieux d'éminérer.
« Ignoraient-ils », eux aussi? Lamentable excuse! Il suffisait d'une
trace d'intelligence pour s'apercevoir à la lecture des compte-rendus offi-
ciels que cela ne pouvait pas être vrai ; il suffisait d'une trace d'objectivité
pour prêter un quart d'oreille au principal accusé, Trotsky, et pour
trouver dans ses déclarations à la presse, ses articles, ses livres, les preuves
écrasantes, irrefutables de l'imposture. Non, il n'y avait pas d'ignorance.
Pour une partie, l'intérêt jouait, directement ou indirectement, comme
toujours. C'est le cas qui nous importe le moins.
Pour les autres, il s'agissait du « sacrifice de la conscience », d' « efh.
cacité », de « réalisme » de cette reprise de la vieille morale conser-
vatrice qui, camouflée sous des lambeaụx de marxisme, permet aux intel-
lectuels « de gauche » de se mystifier eux-mêmes et de donner une valeur
idéologique à leur aliénation. Ils se vouent à l'adoration de la « dure
réalité de l'histoire » en fait la prosternation devant la force brute,
à la sublimation de l' « incarnation » en fait l'opportunisme devant
le pouvoir établi, d'autant plus confortable moralement que le pouvoir se
présente comme « révolutionnaire ». Ils ont dit, ils disent et diront encore
que la vérité porterait préjudice à la cause de l'U.R.S.S. refusant de
se demander jusqu'à quel point une cause vraie peut être défendue par
le mensonge, et confondant, dans des stupides sophismes, le mensonge
d'un révolutionnaire persécuté par la police et le mensonge d'une police
de persécuteurs de prétendant révolutionnaires. Seul le résultat compte,
disaient-ils, qui est de renforcer le mocinalisme. Mais Khrouchtchev dit
aujourd'hui que les proces ont « considerablement alluibili » la Russie.
Donc, d'après les résultats de leurs actions, 100% crux qui ont fourni à
Sialine la couverture idéologique et la caution morale, qui, au lieu de
dresser devant lui un barrage d'opinion, lui donnèrent le sentiment qu'il
pouvait tout se permettre et lui rendirent ainsi objectivement possible
de fusiller un, puis dix, puis cent, puis mille tous ceux-là ont « objec-
tivement » contribué à affaiblir la Russie; ils seraient donc à fusiller
d'après leurs propres normes. Beaux paradoxes de la « morale du ré-
sultat »; ces gens ont poussé les accusés dans la fosse, parce que l'oppo-
sition au régime les transformait « objectivement » en agents de la Ges.
tapo; mais eux-mêmes étaient, ce faisant, « objectivement » des agents
de la police anglaise et de l'espion Béra et ne peuvent s'en excuser
aujourd'hui que sur leurs intentions.
Sommes-nous naïfs, notre indignation est-elle de mauvais aloi? N'est-
il pas indécent de mentionner les victimes devant les bourreaux, impoli
d'insister sur les erreurs des autres? N'est-il pas normal que les cadavres
se trouvent sous terre et les assassins au pouvoir, qu'on puisse se tirer de
tout en disant « excusez, il y a eu erreur », que les poètes de la cour
chantent Néron après Caligula ? Le cynisme des dirigeants et des intellec-
tuels staliniens, s'il est plus grand que celui des autres, en est-il au
fond différent? Les cadres nazis ne se promènent-ils pas tranquillement
à Bonn, ne récupèrent-ils pas jour après jour les postes dirigeants? Mollet
n'est-il pas Président du Conseil, ne fait-il pas la guerre en Algérie après
avoir été élu en promettant qu'il l'arrêterait? N'est-ce pas de cela qu'est
faite la société contemporaine, et, plus ou moins, toute l'histoire des
sociétés d'exploitation?
Oui, certes. Et il ne s'agit pas d'indignation. Notre propos est de
montrer une fois de plus, sur l'exemple des procès, que la bureaucratic
158
« communiste » est une partie intégrante de cette société, que ses mé-
thodes de son attitude sont les méthodes et le comportement séculaires
des oppresseurs, qu'elle ne combat un système d'exploitation démodé que
pour mettre à sa place un autre plus moderne et parfois plus horrible, que
sa politique, tout comme l'autre, exprime le même divorce radical entre
les prétentions et la réalité, les discours et les faits.
C'est aussi de inontrer que sous cet angle, le seul important, rien n'a
été fondamentalement changé avec la « déstalinisation ». C'est de lutter
contre la nouvelle mystification qui se prépare. Car ceux mêmes parmi
les staliniens qui vont aujourd'hui le plus loin dans la reconnaissance des
erreurs » du passé et en fait, combien sont-ils? ne le font en
apparence que pour pouvoir dans le fond continuer à mystifier les autres
et à se mystifier eux-mêmes. Que voit-on en effet ? Chez presque tous, la
hâte, après avoir prononcé du bout des lèvres et en regardant ailleurs
quelques excuses, d'escamoter ce qui s'est passé et sa signification, et de
retourner aux affaires courautes. Chez quelques-uns le « repentir », l'éta.
lage public des tortures de leur âme
que personne ne demande, car
personne ne s'y intéresse au lieu d'une analyse, d'un essai, d’un effort
de voir clair dans ce qui s'est passé et dans leurs propres actes. La révo-
lution prolétarienne ne punit ni ne venge, elle essaie de construire
consciemment l'avenir; elle n'a pas besoin de repentirs, mais d'une ana:
lyse lucide de l'histoire. Cette analyse, les intellectuels désorientés qui,
après avoir trouvé un substitut du catholicisme dans le stalinisme, se voient
aujourd'hui suspendus dans le vide, sont moins que jamais capables de
la faire. Leur « repentir » montre qu'ils restent inexorablement attachés
à l'univers bourgeois-bureaucratique au moment même où ils croient s'en
détacher le plus; il a pour fonction politique de fournir une couverture
morale à la mystification continuée du P.C. Le secrifice de la conscience
de soi-même et surtout des autres persiste. Peu importe, si Claude Roy
le vit désormais comme un déchirement et non comme une virilité.
Mais, dira-t-on, tout le monde demande cette « analyse ». En effet:
Thorez et Togliatti demandent une analyse à Khrouchtchev! Que ne
commencent-ils donc pas par eux-mêmes? Mais Khrouchtchev aussi de.
mande une analyse! A qui? Est-il la peine d'insister? Si le P.C. de-
mande une analyse », ce n'est pour lui qu'un moyen d'enterrer la ques-
tion, de tranquilliser les militants les plus troublés, d'ajourner indéfi.
niment la discussion. La manière dont il la demande, le sujet sur lequel
il voudrait qu'elle porte « déterminer l'ensemble des circonstances
dans lesquelles le pouvoir personnel de Staline a pu s'exercer »
trent qu'il ne s'agit que d'un camouflage. Tout se tient dans un système
social. Comme on essaye de le montrer par ailleurs dans ce numéro, les
rapports de Khrouchtchev (aussi bien le public que le secret) signifient
pour un marxiste un éclatement de l'intérieur de l'idée « l’U.R.S.S., pays
socialiste ». Ni Khrouchtchev, c'est-à-dire la bureaucratie russe, ni Thorez,
c'est-à-dire la bureaucratie du P.C.F., ne peuvent fournir d'analyse de
l'« ensemble des circonstances » sans se renier eux-mêmes et le système
qu'ils représentent, d'un bout à l'autre. Prenons date, et parions qu'à
quelques exceptions près, les intellectuels staliniens se contenteront en fin
de compte d' « analyses » peu différentes de celles ou l'« espion Béria »
joue le rôle principal.
P. CHAULIEU.
- non-
159