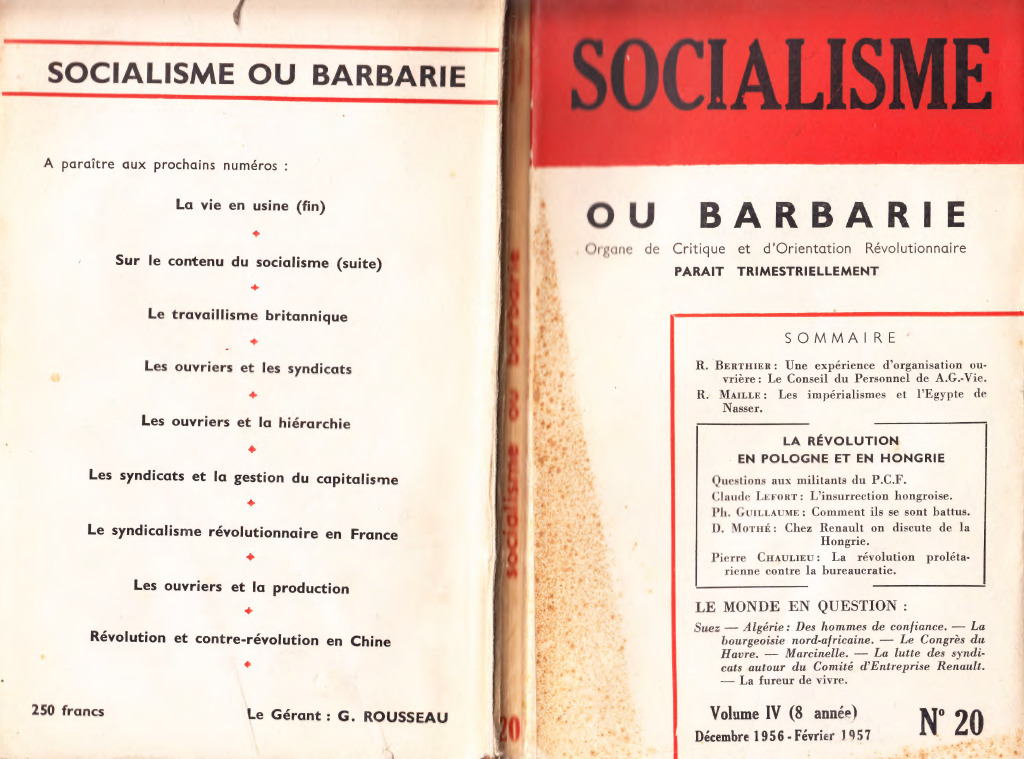BERTHIER, R. Une expérience d'organisation ouvrière: Le conseil du Personnel des Assurances Générales-Vie 20:1-64
L'INSURRECTION HONGROISE:
[Introduction] 20:65
Questions aux militants du P.C.F. 20:66-84 = FR1956I
LEFORT, Claude: L'insurrection hongroise 20:85-116 = L'invention démocratique
GUILLAUME, Philippe: Comment ils se sont battus 20:117-123
MOTHÉ, D.: Chez Renault on parle de la Hongrie 20:124-133 = Journal d'un ouvrier
CHAULIEU, Pierre: La révolution prolétarienne contre la bureaucratie 20:134-171 = FR1956J*
MAILLE, R.: Les impérialismes et l'Egypte de Nasser 20:172-181
LE MONDE EN QUESTION
BLIN, M.: Suez 20:182-186
BLIN, M: Algérie: des hommes de confiance 20:186-188
LABORDE, F.: La bourgeoisie nord-africaine 20:188-194 = La guerre des algériens
GARROS, A: Le congrès du Havre 20:194-200
NEUVIL, R.: Marcinelle 20:201-203
La lutte des syndicats autour du comité d'entreprise Renault (deux articles parus dans Tribune Ouvrière) 20:204-207
Fureur de vivre (de Nicholas Ray) 20:207-208
ANNONCE: Réunion publique 20:[209]
À PARAÎTRE AUX PROCHAINS NUMÉROS
Socialisme ou Barbarie - NO. 20 (DÉCEMBRE 1956-FÉVRIER 1957)
Table des matières
SOCIALISME OU BARBARIE
Paraît tous les trois mois
42, rue René Boulanger - Paris (vey
C.C.P.: PARIS 11.987-19
Comité de Rédaction :
P. CHAULIEU CI. MONTAL
D. MOTHE — A. VEGA
Gérant : G. ROUSSEAU
Le numéro
200 fre
Abonnement un an (4 numéros)
600 frg
n
Volumes déjà parus (I, º$ 1-6, 608 pages; II, nºs 7-12,
464 pages ; III, n ºs 13-18, 472 pages): 500 fr. le vol.
Le présent numéro comportant un nonibre de pages
plus élevé que d'ordinaire, est vendu 250 francs.
+
SOCIALISME OU BARBARIE
Une expérience
d'organisation ouvrière
Le Conseil du Personnel des Assurances Générales-Vie
L'article que nous présentons a été écrit par un employé
d'une compagnie d'assurances. Cependant son véritable auteur
est bien plutót collectif. Outre qu'il contient en de nombreux
passages la relation presque textuelle de propos et de ré-
flexions d'employés, il a été relu et corrigé, parfois de manière
importante, par quelques-uns des camarades les plus actifs
qui ont participé à la création d'un Conseil du Personnel dans
cette compagnie. Les méthodes de travail qui ont présidé de
l'élaboration de ce texte, sont ainsi les mêmes que celles qui
inspirent chaque mois la rédaction de l'organe du Conseil, le
Bulletin employé.
Comme le verra le lecteur, ce texte ne veut pas seulement
relater une série d événements qui ont abouti à la victoire
d'une nouvelle forme d'organisation authentiquement démo-
cratique sur les syndicats traditionnels fortement établis dans
une compagnie d'Assurances. Il vise à décrire l'évolution des
conditions de travail, de la mentalité, des relations entre les
salariés et les cadres, les salariés et la direction, les salariés
et les syndicats et entre les travailleurs eux-mêmes, dans une
entreprise particulière. C'est que les événements ne prennent
tout leur sens que dans le cadre de cette évolution; et rare-
ment, nous semble-t-il, ont été exposés, d'une façon aussi
fouillée et avec autant de rigueur, les rapports qui existent
entre les luttes ouvrières et les conditions de travail et de vie
au sein de la production. En outre, par le fait que la Compa-
gnie d'Assurances considérée es: une entreprise extrêmement
importante et en plein développement technique, on peut con-
sidérer que l'analyse qui lui est appliquée éclaire d une façon
décisive les traits du milieu employé à notre époque, et elle
montre les immenses possibilités qui sont offertes dans ce
milieu, aujourd'hui en complet bouleversement, dans la lutte
contre l'exploitation. L'auteur ou les auteurs ont le mérite
de souligner tous les traits qui sont particuliers à la situation
de leur entreprise et au milieu employé et se gardent de tirer
des conclusions générales håtives. Surtout ils ne veulent pas
1
présenter l'organisation qu'ils ont suscitée, grâce à un long
travail de militants, comme une recette applicable dans n'im-
porte quelle autre entreprise ou secteur de production. Nul
doute cependant que les ouvriers et les employés qui liront ce
texte reconnaîtront pour l'essentiel les problèmes qui se po-
sent à eux dans leur propre cadre de travail et pourront réflé-
chir sur la solution exemplaire qui est ici apportée.
ses
5
Celui qui observe la classe ouvrière de l'extérieur peut
être tenté d'accorder une importance exclusive à
manifestations les plus apparentes - grèves, élections, prise
de position des syndicats — et aussi de confondre la lutte du
prolétariat et celle de ses organisations traditionnelles. Sans
doute, certains grands mouvements, comme ceux d'août 1953
ou de Nantes-Saint-Nazaire de l'été 55, prouvent bien que
les
masses peuvent agir résolument en dehors de leurs syndicats
et même contre eux. Mais, même dans ce cas, on peut consi-
dérer
que les syndicats ont le dernier mot et que les ouvriers
ne parviennent finalement pas à s'organiser indépendamment
d'eux.
Celui qui vit dans une entreprise n'a pas le même opti-
que car il peut vérifier chaque jour, pour ainsi dire, qu'il existe
un immense antagonisme entre les travailleurs et les syndicats
qui se prétendent leurs représentants. Certes, le plus souvent,
les ouvriers et les employés continuent d'apporter leur bulletin
de vote aux organisations syndicales et, apparemment ils
tolèrent que celles-ci fixent avec le patronat leurs conditions
de travail sans les consulter. Mais ils sentent de plus en plus
que dans le monde capitaliste moderne les syndicats et leurs
représentants sont devenus des rouages d'un immense appa-
reil destiné à gérer leur force de travail. Presque tous les
travailleurs, même ceux qui donnent leur adhésion à la
C.G.T., la C.F.T.C. ou F.O., ont senti à un moment de leur
vie de salarié, que les représentants des syndicats, ceux qui
exercent une influence déterminante, n'appartiennent pas à
leur classe, en dépit des apparences, que dans la grande divi-
sion qui sépare la masse des exécutants des dirigeants, ils
font partie de ces derniers. Mais l'évolution des travailleurs
est lente; ils ont une certaine conscience du rôle réel des syn-
dicats mais ne parviennent pas à s'en composer une représen-
tation claire. Ils sentent la situation plutôt qu'ils ne la pensent.
Ils considèrent quelquefois les dirigeants syndicaux comme
des bureaucrates mais ils ne parlent jamais de bureaucratie,
ni de trahison. Ils accordent leur confiance ou ils la refusent;
ou bien encore ils donnent leur soutien sans leur confiance. Ils
commencent souvent à mettre en cause les personnes avant les
organisations elles-mêmes. C'est que dans la vie de tous les
jours le représentant du syndicat est d'abord un individu, un
militant qu'on considère comme bon ou comme mauvais et
2
ce n'est que
les luttes qui apprennent peu
à
peu que
l'individu
ne fait qu'appliquer les consignes d'une organisation.
A l'occasion d'une grève, par exemple, l'opposition aux
syndicats peut se cristalliser d'une façon spectaculaire, mais
en réalité c'est par une lente maturation que la prise de cons-
cience devient possible et que s'accumule l'énergie nécessaire
pour sortir des chemins tout tracés. Il y a un long chemine-
ment avant l'aboutissement; la conviction nouvelle se forme
au cours des années, à travers les doutes, les hésitations,
l'inertie des habitudes, le drame intime des ruptures avec les
choses auxquelles on a cru avec enthousiasme, avec les gens
en qui l'on avait une confiance totale. Et les difficultés sont
encore accrues du fait que parfois le militant du syndicat est
sincèrement convaincu que la politique de son organisation
s'identifie avec les intérêts de la classe ouvrière et qu'il juge
celui qui tourne le dos au syndicat comme un déserteur ou
comme un traître.
L'intérêt des faits que nous allons rapporter c'est
qu'ils montrent qu'en dépit de tous les obstacles qu'elle
peut rencontrer l'évolution des travailleurs peut se pré-
cipiter et aboutir à la formation d'organisations d'un type
nouveau. La création d'un Conseil du Personnel aux Assu-
rances Générales Vie, dans une entreprise solidement encadrée
par les syndicats traditionnels prouve que là où il existe un
noyau de militants lucides, patients, résolus, les salariés peu-
vent se regrouper sur un terrain pratique et prendre en main
leur propre défense.
Nous avons voulu replacer cette expérience dans le cadre
total de l'entreprise et, à cette fin, analyser sa structure et
l'évolution corrélative des conditions de travail d'une part, de
la mentalité et du comportement des employés de l'autre.
Détachée de ce cadre, la création du Conseil serait inintelli-
gible et en ce sens nous insisterons sur les traits bien parti-
culiers de l'entreprise. Mais cette analyse nous permet en
même temps de dégager des traits caractéristiques d'une évo-
lution sociale générale. Actuellement, les employés prennent
contact avec le progrès technique le plus avancé : les machines
électroniques. Un bouleversement inoui des conditions de
travail de ces milieux « rétrogrades » se produit. Il y a quinze
ans encore beaucoup d'employés étaient au stade du porte
plume et du grattoir ; ils affrontent maintenant la mécanisa-
tion avec un demi-siècle de retard et se trouvent devoir parcou-
le chemin
que
les ouvriers de l'industrie ont
mis près de 50 ans à parcourir. Tandis que les modes de tra-
vail archaïques cotoient la technique la plus moderne, les
hommes passent d'une mentalité traditionaliste à une vision
radicale de l'exploitation et des exigences de lutte; et souvent
cette vision ne les délivre pas de leur ancienne mentalité; par
exemple, ils continuent de raisonner selon des schémas con-
rir en peu
de temps
I
ruu
Vo
10:
P?
21
iar
μο! ?
Puo
servateurs alors qu'ils se conduisent comme le font les ouvriers
les plus avancés de la grande industrie.
Tous les contrastes qui sont aujourd'hui typiques de la
mentalité des employés, non seulement nous ne voulons pas
les dissimuler, mais nous souhaitons au contraire les mettre
en pleine lumière pour comprendre l'originalité du Conseil qui
a été créé.
Les employés n'ont pas constitué en effet cette organisa-
tion parce qu'ils se trouvaient convaincus de la justesse de la
ligne politique de quelques militants. Ils ont suivi ces mili-
tants parce que ceux-ci étaient indépendants de tout parti
politique et qu'ils cherchaient seulement un regroupement du
personnel dans l'entreprise sur une ligne de lutte contre
l'exploitation. Ils n'ont pas eu conscience de créer une orga-
nisation modèle, d'un caractère sans précédent; ils ont seule-
ment décidé qu'il leur fallait se défendre eux-mêmes et avoir
des délégués qu'ils contrôleraient à tout moment. Dans leur
esprit, ce qu'ils ont fait s'inscrit dans la lutte de chaque jour
et en somme ils n'ont eu d'autre souci que de « faire leurs
affaires eux-mêmes ». Ils n'ont pas voulu abattre les syn-
dicats en général, mais ils ont jugé que les directives des syn-
dicats tendaient à les transformer en masse de mancuvre et
ne leur permettaient pas de se défendre efficacement, que
décidément les syndicats ne s'occupaient pas d'eux. Enfin ils
ont compris qu'il existait un terrain sur lequel les exploités
pouvaient se rencontrer, quelle que soit leur situation propre
et leurs idées particulières et qui était celui de la lutte pratique
au coeur de la production. Cela ne signifie pas que des dis-
cussions qui impliquent des prises de position politiques soient
bannies dans le Conseil; ses membres ont, bien sûr, des opi-
nions politiques, qu'elles soient systématiques on non, et ils
ne manquent pas de les affirmer pour expliquer de leur point
de vue, ce qui se passe dans l'entreprise. Mais la règle d'or du
Conseil fixée dès le départ et maintenue avec une farouche
détermination est que les idées de chacun doivent pour deve-
nir les idées du Conseil être soumises à tous les employés et
être adoptées par eux. A chacun s'impose l'autorité de tous.
Les employés décident eux-mêmes et ne tolèrent plus les di-
rectives de partis ou de syndicats qui, au nom des intérêts
<< supérieurs » de la classe ouvrière, agissent en fait selon
leurs propres intérêts.
Vouloir porter un jugement théorique sur la nature du
Conseil n'est pas dans nos intentions. Certains considèreront
peut-être avec quelque dédain que la lutte se développe à un
niveau bien élémentaire, d'autres pourront affirmer au con-
traire que son mode d'organisation est révolutionnaire. Il
nous suffit de montrer qu'il s'agit d'une expérience neuve et
qui plonge très profondément ses racines dans l'évolution
sociale, qui par de nombreux aspects reflète une tendance
déterminante des exploités à prendre en main leur propre
ә
more
JIE
:]
4
défense dans la société capitaliste moderne. C'est aux emplo-
yés et aux ouvriers des autres entreprises à voir ce que peut
leur apporter cette expérience dans la lutte qu'ils mènent;
car si l'exploitation crée des conditions communes, il n'en est
pas moirs vrai que dans chaque secteur, dans chaque milieu
une situation particulière peut appeler des formes de lutte et
d'organisation originales.
A. SITUATION DE L'ENTREPRISE.
Il est difficile de donner une idée exacte de l'importance
d'une société d'assurances par rapports aux autres entreprises.
Il n'en sort aucune production au sens économique du terme.
Son but est simplement de drainer les capitaux de tous les
milieux au profit de l'Etat et des banques d'affaires. Le vo-
lume de ces capitaux ne peut donner d'ailleurs qu'une idée
toute relative de cette importance en raison des sous-évalua-
tions considérables de l'actif des sociétés d'assurance sur la
vie.
a) Effectifs.
L'entreprise est située dans le « quartier des Assurances »
(la surface délimitée par le boulevard Haussman, la Gare
Saint-Lazare, la rue Lafayette et la rue Drouot, concentre
pratiquement 90 % des sociétés et de 15 à 20.000 employés).
La société compte en France environ 1000 salariés (450 em-
ployés et 100 cadres au Siège social de Paris, 150 employés
de province dans 40 centres, 300 cadres et inspecteurs pour
le secteur commercial); en outre, elle emploie 2 à 300 agents
commerciaux de toute espèce. Parmi les employés du Siège,
il y a au moins 70 % de femmes; par contre, parmi les cadres,
le pourcentage est très faible (10 %).
b) Domaine d'activité.
Il comprend la France et les territoires d'Outre-mer,
ainsi que la Belgique où sont situées d'importantes succursales;
une certaine activité s'exerce en Argentine, en Egypte, en
Espagne et en Israel.
c) Capital social.
De 24 millions en 1946 il a été porté successivement à
125 millions (1947), 250 millions (1949), 500 millions (1950),
I milliard (1952) sans apport extérieur, par incorporation de
réserves.
d) Eléments financiers.
En 1955, l'actif évalué se montre à 31 milliards; le reve-
nu des « placements » à 2 milliards; les encaissements annuels
de primes à 6 à 7 milliards. Ces encaissements représentent
10 % de l'encaissement de toutes les sociétés d'assurances vie
5
et les réserves environ 15 %. La société se classe parmi les
3 premières « grosses » sociétés d'assurance vie.
Pour donner une idée de la sous-évaluation de l'actif,
il suffit de mentionner que les valeurs (titres, immeubles)
y sont portées obligatoirement (il s'agit d'une obligation
légale) pour la somme la plus faible prix d'achat au
cours actuel.
Il s'ensuit que les immeubles figurent, parfois, pour le
1/4 ou le 1/5 de leur valeur réelle (plus de 100 immeubles)
et que la vente d'un seul immeuble dégage un profit consi-
dérable.
De l'aveu de la société elle-même, alors que
les
1 engagements de la Compagnie » envers les assurés sont en
fin de 1955 de 781 millions, le seul bénéfice de la gestion
financière, abstraction faite de tout bénéfice de vente, atteint
719 millions. Fin 1955 également, l'ensemble des placements
atteignait 27,3 milliards, la plus-value boursière dépassait
7,5 milliards et une timide revalorisation des immeubles déga-
geait une « réserve spéciale » de 541 millions.
e) Administration et orientation.
Jusqu'en 1946, la société était contrôlée
par
le groupe
de
Rotschild. La nationalisation (avril 1946) a amené à la direc-
tion un Conseil d'Administration composé de trois représen-
tants de l'Etat (fonctionnaires des finances), trois « représen-
tants des assurés », trois techniciens, trois représentants du
personnel (des employés, des agents, des cadres). Pratique-
ment les « postes » sont partagés entre les différentes bureau-
craties patronales et syndicales. Le Président-Directeur
général est nommé par le Ministre des Finances ; il était
d'abord, ainsi que toute l'équipe de direction venue en 1940,
social-démocrate et vraisemblablement ayant des liens avec la
franc-maçonnerie ; depuis 1952, le Président-Directeur géné-
ral a des attaches politiques dans les milieux U.D.S.R. et
Radicaux. L'orientation financière semble se faire, de nou-
veau, en faveur des banques qui contrôlaient la société autre-
fois (dont Rotschild). La nationalisation n'a d'ailleurs pas
étatisé l'entreprise; elle reste une entreprise commerciale, en
concurrence avec un secteur privé important et les autres socié-
tés d'assurances nationalisées, et subit, de ce fait, comme une
entreprise privée, tout le poids des impératifs de gestion
capitaliste.
1ə
"
B.
EVOLUTION DE LA STRUCTURE
DE L'ENTREPRISE.
Il existe actuellement trois catégories d'assurances :
Grande Branche, Populaire et Groupe, dont la pratique cor-
respond à des situations économiques bien définies, et dont
6
l'introduction a amené des modifications corrélatives dans la
structure et les conditions de travail de l'entreprise.
Pour permettre de comprendre ces catégories, on peut
dire que la «Grande Branche » correspondrait à un habit sur
mesure,
la « Populaire :» au vêtement de confection, et le
( Groupe » au bleu de travail.
a) Avant 1930.
Avant la guerre de 1914, l'assurance s'adressait unique-
ment à la classe bourgeoise aisée à laquelle il fallait du « sur-
mesure »; la « Grande Branche » était la seule activité, et
l'entreprise était au stade artisanal. Chaque employé devait
avoir des connaissances un peu sur tout; il avait des contacts
avec le public; lors de son recrutement, on recherchait unique-
ment des garanties d'une certaine éducation pouvant cau-
tionner à la fois un niveau d'instruction, une facilité de
parole et une moralité « exemplaire ». La division du travail
était peu poussée : une seule organisation commerciale cons-
tituée par un réseau d'agents non salariés; une « division »
par grande catégorie d'opérations : souscriptions, recouvre-
ments, comptabilité, actuariat, inventaire, services annexes.
La classification des emplois reflétait cette situation.
b) L'évolution de 1930 i 1945.,
La transformation des conditions économiques au lende-
main de la guerre de 1914 conduit à une modification de la
clientèle des compagnies d'assurances sur la vie. La classe
bourgeoise à laquelle s'adressait l'assurance du type « Grande
Branche » s'est appauvrie; la crise de 1930 accentue encore
cette évolution. Pour « tenir », les compagnies d'assurances-
vie doivent suivre l'évolution de cette classe et trouver un
nouveau champ d'activité dans la classe ouvrière dont les
conditions matérielles se sont au contraire améliorées. Mais
alors qu'à une classe riche conviennent des capitaux et primes
importants et des clauses « sur mesure » (gros contrats), à une
classe pauvre conviennent de faibles capitaux et primes avec
des clauses standard (petits contrats). Pour que l'opération
soit rentable, il faut désormais qu'à un petit nombre de gros
contrats corresponde un grand nombre de « petits contrats ».
Comme l'assurance « Grande Branche » ne disparaît pas et ne
peut assimiler la « fabrication » et la vente du vêtement de
confection qu'est cette assurance dite « populaire », il faut
créer une nouvelle organisation capable de « sortir une
grosse masse de contrats.
Cette organisation se juxtapose à la précédente. Elle
comporte un réseau commercial fortement hiérarchisé de sala-
riés assujettis à des chiffres de production déterminés, elle se
base sur la division du travail et la mécanisation des deux
services les plus importants : un central dactylographique
pour la sortie des contrats et un central mécanographique
pour la sortie des quittances. Les tâches intermédiaires s’ali-
7
1
gnent sur ces deux services mécanisés. Pour les vieux em-
ployés, les artisans de la « grande branche », la « populaire »
est considérée, de 1930 à 1945, comme une colonie péniten-
tiaire; ils ont conscience d'une sous-qualification, d'une non-
utilisation des capacités que l'on exigeait d'eux et dont ils
tiraient une certaine fierté. La direction entretient d'ailleurs
cette division; une mutation à la populaire équivaut à une
dégradation. Les anciens désignent ces services par des
expressions qui se veulent péjoratives « le wagon postal »),
les « machines l'usine mais qui, en fait, traduisent
l'introduction de la mécanisation et de la rationalisation. La
Direction est moins difficile sur le recrutement. En 1939, un
directeur peut dire : « Je prends n'importe qui dans la rue et
j'en fais un employé au bout de huit jours ». Il ne s'agit plus
de connaissances, mais de la simple possibilité « physique >>
de faire un certain travail, toujours identique.
6
»), el
>>
.
1
t
c) Le sens de l'évolution actuelle.
Plus récemment, autour de 1939 et surtout à partir de
1945, s'introduit une modification qui reflète d'une manière
plus précise encore la transformation des structures sociales.
Dans la société entière, l'industrialisation conduit à centrer de
plus en plus la vie des individus sur leur entreprise, tant pour
le cadre supérieur que pour le manquvre. L'assurance va trou-
ver sa forme « industrielle parfaite » en relation avec cette
concentration des individus autour de la cellule sociale qu'est
l'entreprise. L'assurance « de groupe » s'adresse maintenant
à une collectivité ; il n'y a plus qu'une police collective qui
fixe quelques règles applicables à tous : plus de quittances de
primes, mais un seul état d'âge et de salaires, fourni par
l'entreprise, et directement exploitable par les machines.
Tout est calculé d'après les salaires et les machines peu-
vent assurer 90% du travail, le reste étant un simple travail
de préparation » qui doit suivre le rythme des machines.
Cela entraîne la création d'un service nouveau; cette technique
nouvelle ne peut être assimilée ni par la « grande branche »
ni par la « populaire ».
Cette évolution s'accentue après 1945 avec le développe-
ment de la « populaire » dont les méthodes et le champ d'ac-
tivité empiètent peu à peu sur les secteurs dévolus à la
« grande branche ». De 1947 à 1952, la structure de l'entre-
prise est complètement remaniée; la rationalisation s'introduit
peu à peu dans la totalité des services.
I
d) Le travail à la chaîne dans une entreprise
d'Assurance-Vie.
Dans la « populaire », la chaîne est maintenant parfaite;
en voici les articulations :
.
I.
2.
Examen des propositions.
Les propositions sont examinées, étiquetées, vérifiées par
un bureau où la division du travail est très poussée, chaque
employé effectuant une tâche très limitée (compostage, tari-
fication, vérification, enregistrement...). Par exemple, le même
employé peut avoir à composter à deux reprises plus de
1.500 propositions par jour ; le service peut passer jusqu'à
10.000 propositions par semaine de 40 heures; un rendement
est obligatoire durant les dix jours de pointe de chaque
mois (sans paiement de prime de rendement).
Frappe des contrats.
Les propositions ainsi traitées arrivent au central dacty-
lographique où chaque dactylo doit taper et relire 75 stencils
à alcool. C'est une tâche difficile, salissante (carbones spé-
ciaux) et entraînant une grande fatigue nerveuse (bruit et
cadence de travail). Une prime de rendement est attribuée; si
les employées jeunes peuvent assurer le rendement, à partir
d'un certain âge (entre 30 et 40 ans), beaucoup ne peuvent
suivre le rythme et manifestent des troubles nerveux (1); les
employées essaient de tenir en travaillant après l'horaire, ou
en évitant les absences, même en cas de grande fatigue ou de
maladie, pour conserver le bénéfice de leur prime de rende-
ment ; mais à partir d'un certain âge, variable suivant leur
résistance physique, elles doivent accepter leur mutation dans
un autre service avec une perte de salaire mensuel d'environ
5.000 francs. A ce moment, leur longue période de travail
standard leur a fait perdre toute qualification et souvent leurs
troubles nerveux sont devenus chroniques.
3. Tirage des documents.
Ce seul et unique cliché, frappé par des dactylos, sert
à tirer, à l'aide de machines Ormig, tous les documents affé
rents à une police : polices, fiches intérieures, dont celles ser-
vant à l'établissement des cartes perforées. Le cliché est éta-
bli de telle manière que ces fiches contiennent les renseigne-
ments codifiés permettant directement la transcription sur la
carte perforée. Il y a un bureau entier de ces machines, bureau
exclusivement féminin. C'est un travail très salissant (car-
bones et encres violettes) nécessitant le changement de vête-
ments (blouses bleues) et le nettoyage à l'alcool. Il n'y a pas
de cadence fixée, mais il y en a une indirecte puisqu'il faut
écouler la production des dactylos qui, elles, sont à la tâche.
4.
Tri des documents.
Le contrôle et la ventilation des pièces sont un travail
purement manuel. Des employées (bureau exclusivement fémi-
(1) Il est remarquable, d'autre part, qu'il règne un climat de ner.
vosité très particulier, dans ce bureau qu'on impute au mauvais
caractère des employés alors que la nature de leur travail en est évi-
demment responsable.
9
i
nin) trient les pièces sortant « en vrac » des machines Ormig;
certaines « vérifient » par lecture les polices, d'autre les met-
tent sous chemise avec compostage des numéros, d'autres
mettent sous enveloppes les polices destinées à l'assuré, d'au-
tres enfin regroupent les documents destinés au circuit inté-
rieur des pièces.
Comme pour le tirage aucune cadence n'est imposée, mais
en réalité c'est toujours la cadence des dactylos qui règle
le travail. C'est une besogne fastidieuse, monotone, notam-
ment en ce qui concerne la lecture des contrats (travaillant
une partie de l'année à la lumière de tubes luminescents, les
employées se plaignent de troubles visuels et de l'inadapta-
tion de l'éclairage à leur travail).
5.
Etablissement de la carte perforée.
Le document de base de l'entreprise est la carte perforée.
Il est plus utile pour beaucoup d'employés de savoir « lire »
une carte perforée que de savoir écrire en bon français ou
calculer rapidement, critères du « bon employé » d'autrefois.
La perforation des cartes se fait essentiellement dans
un bureau de «c perfos » d'après les fiches dont il a été ques-
tion. Une seule fiche de contrat sert à l'établissement de plu-
sieurs cartes perforées, les unes destinées au quittancement
(soit deux cartes une pour la prime, une pour l'adresse
soit une seule pour la « populaire »), d'autres destinées au
calcul des réserves, d'autres au commissionnement. Sur cer-
taines cartes, des données seules sont perforées, le reste de
la perforation étant effectuée mécaniquement après calcul par
des machines calculatrices, à partir des éléments perforés.
Les perfos sont assujetties à une cadence élevée et per-
çoivent une prime de rendement. Pour 9.000 perforations à
l'heure, elles touchent une prime de base de 1.300 francs par
mois (environ 5 % du salaire de base) augmentée de 600 francs
par 1.000 perforations horaires supplémentaires (1). Un abat-
tement d'un quart d'heure est accordé le matin et l'après-
midi. Si l'employée ne peut réaliser la cadence minimum
moyenne, elle est mutée ; en cas de maladie, la prime est
diminuée proportionnellement aux jours d'absence.
Il s'agit encore d'un bureau exclusivement féminin. Le
travail entraîne une fatigue nerveuse dont l'effet à long terme
est peu connu en raison de l'introduction récente du système
(10 ans), et de la jeunesse des éléments féminins recrutés à
l'époque. Comme pour les dactylos, le souci de conserver la
prime ou de l'accroître, fait que ces employées travaillent
souvent à la limite de leur résistance nerveuse.
(1) Certaines employées arrivent à réaliser 12 à 13.000 perforations
à l’H ure. Toutefois il difficile de préciser le rythme exact d'un tel
rendement, certaines perforations étant automatiques.
10
6. Le central mécanographique.
Les cartes servent à l'établissement de documents indi-
viduels (quittances de primes, feuilles de commissions et
d'états divers, bordereaux de commissions d'agences), de
documents comptables et statistiques.
Les machines principales sont les tabulatrices, mais des
travaux préparatoires sont nécessaires : contrôle et mise à
jour des fichiers, tri des cartes, reproduction, calcul, classe-
ment (de nouvelles cartes) dans les fichiers. La plupart de
ces travaux sont effectués par d'autres machines (calculatri-
ces, reproductrices, trieuses)
Les employés de ce service sont presque exclusivement
masculins, ils ont une certaine qualification professionnelle.
Pratiquement, il s'instaure une routine de travail qui rend
inutile cette qualification à quelques exceptions près. Le tra-
vail exige une cadence et une station debout continuelles, dans
une atmosphère de bruit. L'employé est le plus souvent le
servant d'une machine. Une prime dite de « planing » (prime
de rendement déguisée) est attribuée; la cadence de travail
est fixée non par des temps précis mais par l'obligation de
sortie de documents à des dates limites.
7. Le contrôle et l'envoi des documents.
Le contrôle, travail de pure mise en ordre, se fait dans
les vestiges d'anciens services qui préparent le regroupement
pour l'envoi dans les agences (« grande branche ») ou dans
des centres de gestion (« populaire ») ou directement à la
clientèle (« groupe »).
ou
e) Les chaînes annexes d'approvisionnement
de la chaîne principale.
Autour de cette chaîne centrale, épine dorsale de l'entre-
prise, dont chaque rouage doit fonctionner normalement au
risque de tout bloquer, les travaux d'« alimentation »
d'« évacuation » ne sont pas encore entièrement rationalisés.
Différentes raisons empêchent cette rationalisation totale,
qui est cependant possible puisqu'elle est réalisée dans quel-
ques entreprises pilotes.
a) Certaines règles légales obligent à des tâches qui
nécessitent le recours à des techniques périmées. Par exemple,
les règlements de capitaux à la suite d'un décès ne peuvent
être effectués sans la réunion obligatoire de pièces, ce qui
nécessite l'établissement manuel d'un dossier et de correspon-
dance. Jusqu'à une date récente, la législation imposait la
tenue de répertoires de polices qui ne pouvaient être que rédi-
gés à la main. Le décalage est tellement énorme entre la tech-
nique et les obligations légales, que certaines règles légales
ne sont plus observées, avec la tolérance du Ministère des
Finances, chargé de contrôler les sociétés d'assurances. On
+
11
-
pourrait écrire des pages sur ces nombreuses règles sur lesquel-
les butte la mécanisation.
6) Rationaliser tous les travaux signifierait imposer une
cadence, celle de la chaîne, à tous les employés, quelles que
soient leurs aptitudes physiques. Mais l'ancien système de
travail artisanal a laissé une séquelle de vieux employés pra-
tiquement « non récupérables » (ceux-là même que le patron
qualifie de « toquards », en évoquant le poids qu'ils consti-
tuent dans l'entreprise). Deux solutions peuvent résoudre le
problème : la mise à pied ou l'attente de l'élimination par les
départs en retraite. La nécessité de maintenir « un climat
social » dans l'entreprise empêche toute transformation radi-
cale. Les travaux de la chaîne sont assurés par un minimum
de jeunes, les travaux annexes, non rationalisés ou semi-
mécanisés, sont assurés par un maximum de vieux employés.
La transformation se fait progressivement.
On trouve donc dans les travaux annexes toute la gamme
des activités qui ont jalonné l'évolution du travail jusqu'à nos
jours et souvent les employés qui ont continué de les effec-
tuer pendant tout ce temps.
1° L'artisanat. Ce sont les services en voie de dispa-
rition : la comptabilité générale (obligation de tenue de
livres), le service "I groupe » ancienne gestion (types de
contrats encore en cours non-standard) ou maintenus en rai-
son d'obligations légales (règlements) ou en voie de transfor-
mation (établissement des contrats « grande branche » dont
la rationalisation est en cours).
2° La semi-mécanisation. Ce sont les services en cours
de transformation : inventaire (calcul des réserves), calculs
(une partie importante de ces calculs est faite maintenant
directement sur calculatrice électronique, ce qui entraîne une
réduction importante de personnel); services financiers et
comptables (comptes d'agents) dont la rationalisation a été
poussée aussi loin que possible.
3° La mécanisation. Ce sont les véritables chaînes
annexes soumises à une cadence directe ou indirecte : archi-
ves, courrier, central dactylographique (centralisation de la
frappe du courrier, usage de magnétophones), établissement
des documents de mutations de contrats (vestige d'un service
de quittancement n'effectuant plus que des travaux élémen-
taires).
4° Les bureaux de province. La chaîne ne peut fonc-
tionner régulièrement que si elle « exploite » des éléments
standard ou tout au moins ne présentant pas une grande
diversité. Par suite, ce qui « sort » de la chaîne correspond
également à un certain degré de standardisation. Mais la
concurrence commerciale, surtout dans l'assurance, contraint
l'entreprise à tenir compte d'une multitude de détails, dans
les clauses de contrats, dans l'encaissement des primes, etc.
Il est donc nécessaire qu'un travail préparatoire soit fait sur
12
les documents de base (standardisation, groupement) et qu'en
sens inverse une reconversion s'opère à la sortie de la chaîne
(répartition aux encaisseurs des quittances, paiements isolés,
etc.). Des services furent donc créés pour effacer les détails
pratiques à l'entrée et les reconstituer à la sortie. Ce rôle est
joué tantôt par les agences (« grande branche » mais surtout
par les centres de province (« populaire »); pour le groupe »,
la perfection du mécanisme et la suppression des éléments
particuliers rendent inutiles ces services de conversion et de
reconversion.
Les centres de province créés en 1954 ont, d'une part,
un rôle centralisateur avec mission d'établir tous les docu-
ments (propositions, états d'encaissements, états de transfor-
mation, encaissements) de sorte que le siège puisse les assi-
miler immédiatement sans attendre de renseignements; d'au-
tre part, un rôle décentralisateur de répartition : des états,
quittances, feuilles de commission, paiements arrivent en bloc
au siège.
Il est évident que leur rôle est capital car ils sont les
intermédiaires entre toute l'organisation commerciale et l'or-
ganisation rationalisée du siège. Tel est bien ce rôle que leur
assigne la Direction car l'organisation de ces bureaux de pro-
vince est très fortement contrôlée et réglementée; elle trouve
d'ailleurs d'autres avantages dans ces centres. Le travail en
province peut être moins payé qu'à Paris et la main-d'oeuvre
« plus souple », plus facile à exploiter (la rareté des emplois
opérant une plus forte pression sur le travailleur), peut être
plus adaptée à des pointes de travail périodiques que l'orga-
nisation rigide du siège ne pourrait tolérer.
L'importance de ce secteur peut être mesuré au fait que
les employés de province représentaient à peine 7 % de l'effec-
tif total du Siège en 1950 alors qu'ils représentent plus de
25 % de cet effectif actuellement,
f) La modification du recrutement des employés.
Les modifications des conditions de travail ont complè-
tement transformé le recrutement des enıployés.
Avant 1930, un emploi de bureau était une bonne « situa-
tion » pour la petite bourgeoisie. Depuis la mécanisation, la
plupart des emplois cessent d'être intéressants, car rémuné-
rations et conditions de travail se rapprochent de celles de
l'industrie.
Avant 1930, le recrutement se faisait par relations ;
l'origine sociale était une garantie de « bon esprit » et les con-
ditions de travail ne pouvaient qu'enraciner en chacun les
préjugés déjà bien établis.
Après le développement de la branche « populaire », de
1930 à 1939, le personnel nouveau était appelé à effectuer
des tâches divisées sous une discipline plus rigoureuse, à une
cadence plus élevée. Pendant cette période entrèrent dans l'en-
12
treprise des professionnels de l'industrie et du commerce sans
travail. Beaucoup espéraient ne rester que temporairement ;
certains sont encore employés, d'autres firent « carrière ».
Un peintre décorateur est maintenant archiviste après
avoir été garçon d'étage; un ancien souffleur de verre est
garçon jusqu'à sa retraite; un autre verrier est devenu chef
de service; des imprimeurs, des métallos, etc., rejoignirent
aussi l'assurance. Ainsi se justifie la réflexion déjà citée d'un
directeur en 1939 : « on peut prendre n'importe qui dans la
rue pour en faire un employé »).
Ces éléments nouveaux avaient un esprit tout à fait dif-
férent de celui des anciens; ce sont eux qui furent les plus
actifs en 1936; minoritaires, ils ne réussirent pas à entraîner
le personnel dans le mouvement de grève mais ils fondèrent
la section syndicale C.G.T. de l'entreprise.
La guerre, la rationalisation accentuée après 1945
devaient bouleverser à nouveau le recrutement ; il entra,
notamment dans l'après-guerre immédiat, beaucoup de jeunes
issus de tous milieux et surtout de milieux petits employés
et ouvriers. Cependant, les éléments « petits bourgeois >>
pourvus d'une certaine instruction se détournent maintenant
de ces travaux « abrutissants ». A l'intérieur même de l'entre-
prise, les vieux services sont désorganisés et de nouveaux sont
créés, entraînant des mutations fréquentes et un véritable
brassage des employés. Il devient de plus en plus clair qu'on
ne peut plus « faire carrière »; nombreux sont ceux qui
s'aperçoivent qu'ils ne sont que des pions que l'on déplace
à volonté pour les utiliser là où l'on a besoin d'eux.
La transformation des conditions de travail des vieux
employés, le contact des anciens et des nouveaux éléments
achèvent de modifier le comportement du personnel. A l'indi-
vidualisme tend à se substituer le sens de l'action collective
(première grève de douze jours en mars 1950); au débrouil-
lage individuel la solidarité; l'arrivisme tend à reculer et
les employés deviennent sensibles aux injustices sociales. Ils
tendent à se fondre dans la grande masse des travailleurs.
Un indice très significatif de cette évolution se retrouve
dans l'habillement : vers 1930, l'employé était le «prolétaire
en faux-col », les femmes devaient venir travailler en bas et
en chapeau ; la tenue était un attribut de l'employé. Aujour-
d'hui, dans tous les services de la chaîne, hommes et fem-
mes portent des blouses grises, bleues ou blanches, et même
certains portent des bleus de travail; les femmes changent de
tenue pour ne pas salir leurs vêtements.
8) Le rôle des cadres.
Les cadres d'avant 1930 étaient souvent des fils de
famille parfois issus de la noblesse que
leur
manque
cité avait empêché de caser dans la diplomatie, l'armée, les
finances ou les affaires. Ce qui importait, c'était que leurs
de capa-
14
« bonnes manières » et le vernis qu'avaient pu laisser leurs
études puissent inspirer le respect béat des inférieurs de la
petite bourgeoisie, tout heureux de côtoyer chaque jour
de
tels supérieurs. On retrouve encore aujourd'hui chez un cer-
tain nombre d'employés ce culte du cadre.
Du jour où le travail se transformait, le cadre n'était
plus le « supérieur » : il devait être ou bien un technocrate,
l'équivalent de l'ingénieur (technicien en mathématiques ou
en droit) ou bien celui qui commande et impose la discipline,
le « garde-chiourme ». La majorité des emplois de cadres
appartiennent à cette dernière catégorie et ne requièrent
aucune connaissance particulière; beaucoup de cadres sont
recrutés dans le rang en considération non de leurs capacités
mais de leurs aptitudes à « servir ». Le «garde-chiourme »
traditionnel tend d'ailleurs à être remplacé par un autre de
type plus habile. C'est que la cadence du travail rend inutile
la discipline stricte et que la division très poussée du travail
nécessite un fonctionnement sans heurts; on ne demande donc
plus au cadre qu'à être un surveilant de la vaste et complexe
machine, sachant mettre de l'huile dans un rouage et être
attentif à tout bruit du mécanisme pouvait révéler un défaut
de fonctionnement.
Il a un rôle de coordination mais on lui demande surtout
de maintenir un climat social favorable : ce sont plus cef-
taines qualités psychologiques qu'on requiert de lui que des
qualités professionnelles. L'appartenance à un groupe social
défini (syndicat « maison », francs-maçons, catholiques) est,
en général, la référence pour la promotion des cadres, l'indé-
pendance étant au contraire une contre-indication.
Les cadres tendent à remplir leurs fonctions ainsi dén-
nies en brisant la cohésion et la solidarité qui est la conse-
quence normale d'un travail rationalisé. Ils font preuve,
cet égard, d'une mentalité nouvelle, cherchant à s'immiscer
dans la vie privée de leurs subordonnés pour mieux les domi-
ner, ne reculant pas devant une certaine familiarité et visant
parfois à jouer le rôle de confident et de conseiller. Au reste,
cette attitude que favorise la présence constante du cadre
auprès de l'employé n'exclut pas le recours à des procédés
plus traditionnels (mouchardage, chantage, etc.); mais.ces
derniers sont de moins en moins efficaces et tendent à paraî-
tre périmés. Les cadres du type adjudant n'ont plus la core
dans l'entreprise car le fonctionnement régulier d'une chaîne
de travail ne peut souffrir les conflits et les tensions qu'ils ne
manquent pas d'amener.
h) La nationalisation.
La nationalisation de l'entreprise, réalisée en 1946, a
permis aux salariés de faire l'expérience de la bureaucratie;
tout employé sait qu'elle ne lui a rien apporté, qu'il n'a fait
que changer de maître et qu'une équipe de « petits copains >>
a remplacé les anciens administrateurs et directeurs.
à
Les Assurances Générales-Vie sont une des rares entre-
prises où il y ait eu, du jour au lendemain, un remplacement
quasi-complet de l'équipe dirigeante. Ceux qui arrivaient
pour prendre les places étaient des fonctionnaires de grade
moyen sans autre appui que le syndicat, le parti politique
ou peut-être la franc-maçonnerie. Ils n'avaient pas de base >>
définie. Dix ans après, les employés parlent encore de la
situation modeste des membres de la direction lors de leur
arrivée, de leurs démarches pour se concilier les responsables
syndicaux C.G.T. (et par contre-coup les employés) en accré-
ditant la légende « qu'ils n'étaient pas des gens différents
des employés ».
En bons bureaucrates, leur ligne de conduite était de se
constituer une base dans l'entreprise et des relations à l'extė-
rieur de l'entreprise. Une gestion sans histoire et une grande
souplesse vis-à-vis des gouvernements successifs devaient
leur permettre de conserver leur poste à travers les évolutions
politiques.
Après s'être appuyée sur la C.G.T. avant la scission de
1947, la Direction s'appuya sur F.O., puis sur la C.F.T.C.
quand le Président-Directeur général, mis à la retraite, fut
remplacé par un ancien Directeur des Finances qui se trouva
avoir la même appartenance politique que le bonze inamo-
vible de ce dernier syndicat. Tous les employés connaissent
le « bon syndicat » dont il faut faire partie si l'on veut espé-
rer une promotion rapide ou de petits avantages personnels.
La direction a ainsi nommé successivement agents de maîtrise
ou cadres des militants C.G.T., F.O. et C.F.T.C. dans
l'espoir qu'ils formeraient une base fidèle qui permettrait de
dominer plus facilement le personnel.
Sauf les vieux employés qui attribuent à la nouvelle
Direction les inconvénients de la rationalisation et qui disent
« c'était mieux autrefois », la plupart des employés traduisent
la réalité par des réflexions du genre : « la nationalisation
n'a rien changé ».
La Direction nouvelle, issue de la nationalisation, a pu
trouver en dix ans un cercle d'appuis politiques et a constitué
avec les directions analogues des autres sociétés, de la Sécu-
rité Sociale, des syndicats, de certains partis, une couche
bureaucratique consciente de sa position dominante, qui tend
à conserver le pouvoir qu'elle détient; elle a surtout des liens
dans les milieux politiques que l'extrême-droite appelle « de
gauche » (radicaux, U.D.S.R., S.F.I.O., P.C., M.R.P.) et
dans tous les syndicats, y compris la C.G.T. Cette couche
dirigeante montante qui a le regard tourné vers l'avenir peut
appartenir pratiquement à des organisations et des partis
différents qui en apparence luttent pour la prise totale du
pouvoir; mais, faute de mieux, les membres de cette couche
se partagent les postes disponibles et se serrent les coudes
pour se maintenir. Il y a plus de liens et d'affinités entre la
2
16
couche dirigeante des syndicats (C.G.T. comprise) qu'entre
ces mêmes dirigeants de syndicats et les employés, même
syndiqués.
Cette couche dirigeante s'est heurtée évidemment aux
vieilles couches traditionnelles plus ou moins rénovées. Ces
luttes traduisent des rivalités économiques et apparaissent
dans l'orientation financière de l'entreprise : changement de
relations avec tel groupe bancaire quand le Président-Direc-
teur général change; remplacement du jour au lendemain, au
Central mécanographique, des machines I.B.M. par des ma-
chines Bull, services rendus à tel groupe ou tel homme poli-
tique (appartements, prêts d'argent aux collectivités, à cer-
taines personnalités).
Cette lutte aboutit à la formation de clans sur le plan
de l'entreprise et se poursuit par des cheminements obscurs,
dont l'influence est surtout sensible parmi les cadres. Les
employés restent souvent étrangers à ces luttes de clans dont
is constatent seulement les effets : montée en flèche ou dis-
grâce d'un cadre (sans capacités particulières), orientation
nouvelle d'activité de l'entreprise, réforme des conditions de
travail; même s'ils ne trouvent pas d'explications précises,
ils se doutent que ce qui est présenté comme « l'intérêt de la
Compagnie » pour expliquer tout n'est en réalité que la consé-
quence
de luttes de clans.
i) Les syndicats et leur action.
1936 marque pratiquement le départ de l'activité syndi-
cale dans l'entreprise. Auparavant dominait le mythe du bon
patron, qu'on rencontre encore chez certains vieux travail-
leurs. Un grand nombre d'employés respectaient la hiérar-
chie; ils pensaient que seule leur soumission leur permettrait
d'obtenir certains avantages et ces avantages ils les inter-
prétaient comme le signe de la libéralité du patron non comme
un dû.
Les services qui connurent les premiers des conditions
de travail plus dures, et où entrèrent des éléments issus d'au-
tres milieux professionnels, posèrent d'emblée les relations
de travail en termes différents : la constitution de la section
C.G.T. de l'entreprise en fut la conséquence. Le patron, pour
y faire pièce, suscita d'abord la formation d'une section du
syndicat fasciste S.P.F. qui n'eut qu'une existence éphémère
parce que politiquement trop voyante, puis s'appuya sur la
C.F.T.C., notamment par l'intermédiaire des cadres moyens.
Des employés parlent encore des pressions exercées avant
1939 et après 1944 par les chefs des grandes divisions sur
leurs employés pour les forcer à adhérer à la C.F.T.C.; c'est
à ce même syndicat que la Direction remit en 1945, lors de
la création des Comités d'Entreprise, les auvres sociales,
sûre qu'elles seraient gérées dans son intérêt comme dans
celui de ce syndicat.
17
De fait, après la période de la guerre pendant laquelle
la plus grande confusion semble avoir régné, dans l'entre-
prise comme partout, ce syndicat a toujours joué et joue
encore le rôle de « courroie de transmission » entre Direction
et employés. L'origine sociale des vieux employés et d'une
partie des nouveaux, la survivance de services non rationa-
lisés, la position dominante de ce syndicat dans les ceuvres
sociales, son habileté consommée à appuyer une espèce de
paternalisme éclairé, tout cela lui assure une position de leader
parmi les syndicats traditionnels dans l'entreprise. C'est
d'ailleurs pratiquement un seul homme, le « délégué » (cumu-
lant les fonctions de délégué du personnel, de délégué au
comité d'entreprise et de secrétaire de ce comité ayant la
haute main sur toutes les « æuvres sociales » depuis la can-
tine jusqu'à l'arbre de Noël, la caisse de retraite et la maison
de repos) qui assure la fonction, nécessaire dans une entre-
prise moderne, de porte-parole de la Direction auprès des
salariés. Il ne fait aucun travail, possède un bureau avec télé-
phone, peut obtenir de tous services tous renseignements sur
les employés. Les cadres le respectent comme détenteur d'un
pouvoir de même nature que le leur; les employés ne veulent
pas se mettre mal avec lui parce qu'ils savent « qu'il a le bras
long ». Le Président blague ouvertement en public sur « ce
personnage qu'on paie à ne rien faire », mais en aparté déclare
« il est bien utile ». Ce délégué définit d'ailleurs sa fonction
comme d'essence supérieure : jamais un compte rendu écrit
ou oral au personnel, jamais de réunion du personnel, Aux
réunions avec la Direction où l'on marchande les intérêts du
personnel qui commence à « remuer », il lui est arrivé plu-
sieurs fois de déclarer « tout ce qui se dit ici devra rester
secret » et il pratique d'ailleurs obstinément quant à lui le
secret comme un attribut de sa fonction. Son action, il la
résume dans cette formule : « Nous faisons du social et du
familial ». Sa politique est celle du cas personnel, jamais
celle de l'action collective.
Seule la C.G.T., numériquement plus puissante que la
C.F.T.C. en 1946 dans l'entreprise, aurait pu faire pièce à
cette influence grâce à l'appui que la Direction nouvelle pou-
vait lui apporter dans le cadre de la nationalisation. Mais
les militants les plus marquants se contentèrent d'occuper
les places de cadres qu'on leur offrait, alors que le « délégué »
C.F.T.C. continuait à jouer avec beaucoup d'habileté et
d'expérience son rôle traditionnel, fort d'ailleurs de cette
espèce d'indépendance de façade opposée à la « compromis-
sion » des ex-militants C.G.T. (1)
(1) Il semble d'ailleurs que les syndicats se partagent les entreprises
en zones d'influences (postes aux Conseils d'Administration des entreprises
nationales, délégués, Conseil National des Assurances, services sociaux
intercompagnies); ils peuvent ainsi se rendre des services en cas de dan-
ger les menaçant tous. Cette attitude n'est d'ailleurs pas exclusive d'une
18
La scission de 1947 devait amener une section F.O.
forte de la quasi-totalité des adhérents de la C.G.T. et de
l'appui de la Direction, tandis que la section C.G.T. se trou-
vait réduite à des effectifs squelettiques (quelques employés
restés par « fidélité » autour des quelques membres du P.C.
de l'entreprise), et ne pouvait plus recueillir qu'une trentaine
de voix aux élections suivantes.
L'évolution déjà décrite des membres de la Direction de
1947 à maintenant, et le rôle dévolu à la section F.O., le
caractère anti-stalinien du nouveau syndicat, faisaient que
rien ne distinguait celui-ci de la C.F.T.C., sauf des ques-
tions de personnes. De fait, les délégués F.O. ex-C.G.T.,
collèrent très étroitement à la C.F.T.C., les réunions de sec-
tion furent souvent communes et les deux permanents se
partagèrent le « travail syndical ».
L'appartenance à l'un ou l'autre de ces deux syndicats
dépend alors de considérations politiques ou religieuses; si
l'on donne son adhésion à tel ou tel c'est parce qu'on espère
être épaulé pour grimper dans la hiérarchie, ou bien béné-
ficier de quelques avantages (logements, prêts, secours) ou
encore qu'on veut manifester sa reconnaissance pour un ser-
vice rendu (que le délégué a su monter en épingle) ou tout
simplement parce qu'on craint l'hostilité d'un cadre syndiqué.
Quant à ceux qui se contentent de voter pour un syndicat,
ils n'ont, pour la plupart, d'autre souci que de maintenir en
face du patron des organismes susceptibles de les défendre,
malgré tous les défauts qu'ils leur reconnaissent (le souci d'ef-
ficacité semble très fort chez les employés).
La C.G.T. connaît un nouvel essor à partir de 1950.
Jusque là, c'est-à-dire durant les trois années qui suivirent
la scission, elle fut coupée de la masse des salariés. La poli-
tique de la C.G.T. à l'échelle nationale, essentiellement axée
sur les actions politiques du P.C. (aussi timidement qu'elle
fût exprimée par les militants de l'entreprise) détournait vio-
lemment les employés de ce syndicat.
En 1950, la section C.G.T. fut ranimée par deux mili-
tants, indépendants de tout parti politique, soutenus par un
groupe d'employés, qui adoptèrent une politique de lutte à
l'égard de la direction. Ils réussirent à évincer les membres
du P.C. de la section et entreprirent un travail patient
d'explication, destiné à dresser les employés à la fois contre
le patron, les syndicats réformistes et la politique stalinienne
traditionnelle de la C.G.T. La remontée rapide de la section,
qui eut été plus rapide encore si la C.G.T. en tant que telle
n'inspirait la méfiance, fut, en outre, favorisée par les nom-
breuses contradictions que la rationalisation développait au
sein de l'entreprise.
internet
certaine compétition entre eux, dans la mesure où certaines normes sont
respectées.
19
Même lorsque la C.G.T.-Assurance, en 1954, réussit à
manæuvrer et à replacer à la tête de la section un membre
du P.C., la section maintint la nouvelle influence qu'elle avait
acquise.
Il faut d'ailleurs souligner que la Direction de la C.G.T.-
Assurance, même dans les périodes « dures », n'a jamais
rompu ses contacts avec la Direction de l'entreprise. Chacun
sait
que le Secrétaire général de la C.G.T.-Assurance tutoie
le Directeur général-adjoint et qu'il obtient, à l'occasion, cer-
taines concessions de détail par intervention personnelle (par
exemple, le réembauchage d'employés licenciés ou le maintien
d'employés menacés de licenciement), à titre d'échange de
bons services entre bureaucrates. On sait aussi
que
l'admi-
nistrateur C.G.T. obtint un appartement de la compagnie
dès sa nomination. Après 1954, sous le couvert de l'unité
d'action, la section C.G.T. s’aligna sur les autres syndicats
et les contacts purent s'établir à l'échelon des délégués de
l'entreprise (1).
C. - LES CONTRADICTIONS AU SEIN
DE L'ENTREPRISE.
Telles qu'elles viennent d'être décrites, les structures de
l'entreprise paraissent devoir permettre un fonctionnement
régulier. En réalité, comme dans toute entreprise capitaliste,
de multiples contradictions se font jour. C'est, d'une part,
que les employés sont des hommes que l'on ne peut conduire
comme des machines et, d'autre part, que l'intérêt qu'ils peu-
pent avoir pour l'entreprise est en contradiction avec le rôle
de purs exécutants dans lequel on les cantonne.
Comme tous les salariés, ils se trouvent dans l'obligation
d'exécuter leur travail de manière à ne pas encourir de repro-
ches; suivant leur intérêt élémentaire, ils arrivent à souhaiter
que l'entreprise marche bien. Ils peuvent d'ailleurs en tirer
une légitime fierté, jusqu'à dire que leur travail fait marcher
l'entreprise. En réalité, la bonne marche de celle-ci est liée
surtout à la vente des « produits » donc à la situation
économique — et à l'habileté de la gestion de la Direction.
Les employés sentent qu'au-delà de leur « bon travail
», l'es-
(1), Il apparaît que la position de la C. G.T. dans ce milieu
employé est adaptée à sa position minoritaire en face des réformistes et
à la mentalité particulière des employés. Il est certain que dans les mi-
lieux ouvriers elle manifeste un plus grand souci de s'adapter à la comba-
tivité ouvrière et dissimule avec le plus grand soin les contacts qu'elle
peut avoir avec les patrons et les autres syndicats. Toutefois il y a une
unité d'attitude qui se révèle dans le fait qu'un bon membre du parti
doit savoir s'adapter au milieu dans lequel il se trouve et, tout en ouvrant
uniquement pour le parti, garder une façade de « meilleur défenseur de
la classe ouvrière ». Ce ne sont que les travailleurs de chaque entreprise
qui peuvent asquer, à l'aid d'exemples concrets, l'attitude réelle de
la C.G.T.
20
sentiel leur échappe et que d'une certaine manière ils n'ont
aucun intérêt à la bonne marche de l'entreprise qui les
emploie.
a) Coexistence de différents systèmes de travail.
L'impossibilité d'atteindre une rationalisation totale a des
causes très diverses : législation en retard sur les développe-
ments économiques, luttes de clans se cristallisant autour de
la lutte pour teile ou telle méthode de travail, obligation de
maintenir un « climat social » que des mesures draconiennes
briseraient obligation qui s'impose aussi bien aux bonzes
syndicaux qu'à la Direction).
Nous avons déjà noté, en ce sens, la coexistence de ser-
vices anciens et de services modernes. Par exemple, de chaque
côté d'un couloir, il y a deux services qui font exactement
le même travail : l'examen des propositions. L'un traite les
propositions « populaires » et est intégré dans la chaîne (nous
l'avons décrit); l'autre traite les affaires « grande branche >>
selon une répartition géographique des tâches, chaque em-
ployé effectuant la totalité des opérations qui sont divisées
dans l'autre bureau. Le rythme de travail est ici et là très
différent. Le service rationalisé passe trois à quatre fois plus
de propositions que l'autre. Le vieux service est coté « travail
qualifié », l'autre «« travail d'ordre »; la différence de salaire
de base est de 4 à 5.000 francs par mois (de 15 à 20 % du
salaire de base).
En outre, dans les vestiges de vieux services, il y a
encore des « planques » où l'on travaille « à la papa » et qui
sont souvent dénommées « services spécialisés »; des salaires
de base élevés leur sont réservés.
A cette injustice ressentie par ceux qui travaillent le
plus pour un moindre salaire, se juxtapose le drame de ceux
que l'on doit muter des vieux services vers les nouveaux par
suite de la marche inexorable de la rationalisation comman-
dée par la pression économique. C'est la source d'une double
contradiction :
1° Les employés des « vieux services » sont des anciens
qui peuvent difficilement s'adapter dans les nouveaux ser-
vices en raison de leur âge et du fait qu'ils ont acquis une
routine irréversible de travail; ils considèrent comme humi-
liant et dégradant d'être mutés à un poste beaucoup moins
intéressant que celui auquel ils étaient rattachés auparavant.
Le plus paradoxal est que ce sont précisément les employés
non évolués (et qui sont les plus sûrs soutiens de l'employeur)
qui sont les plus directement exposés à ces mutations. La
chute sera d'autant plus brutale que les cadres préoccupés de
rendement les mépriseront et les qualifieront de « déficients »,
de « toquards », de « pauvres types » qu'on garde par cha-
rité jusqu'à ce que la maladie ou la retraite en débarrase
l'entreprise.
21
2° Pour maintenir la stabilité du personnel, les em-
ployeurs ont toujours garanti le maintien des avantages
acquis; la politique du cas 'personnel pratiquée par la direc-
tion et les syndicats a toujours tendu à accroître ces avan-
tages quand l'employé donnait satisfaction. Quand l'employé
est muté dans un service rationalisé à bas salaire, il conserve
tous ses « avantages » (sauf les primes de rendement), de
sorte que se manifestent des différences de salaires allant
parfois du simple au double entre des employés effectuant
le même travail. Cette différence est d'autant plus ressentie
que, selon le langage des cadres, ce sont ceux « qui gagnent
le plus qui fournissent le moins de travail ». Un jeune avait
un jour calculé qu'il faisait dans sa journée deux fois plus
de travail qu'une ancienne employée dont le salaire était de
plus de 50 % supérieur au sien.
b) La disparité des systèmes de rémunération
et les impératifs de rationalisation.
Le système de rémunération dans son ensemble contient
d'ailleurs une contradiction beaucoup plus importante.
Le travail à la chaîne crée des tâches semblables; les em-
ployés des services rationalisés ont conscience que les paies
devraient être les mêmes. Mais patrons et syndicats, pour
pouvoir pratiquer la politique du cas personnel, et aussi par
une sorte de conservatisme bureaucratique, maintiennent et
même font proliférer une classification établie en 1936, renou-
velée en 1945 et 1954, qui ne compte pas moins de 110 caté-
gories d'emplois et qui est de l'aveu des syndicats très ina-
daptée.
Dans les services vitaux pour la cadence de la chaîne
(contrats et central mécanographique), l'octroi de primes de
rendement substantielles qui semble venir compenser l'inéga-
lité entre les salaires des services qui travaillent plus et ceux
des services qui travaillent moins, suscite une autre injustice
vis-à-vis des service: intermédiaires de la chaîne qui ont une
même cadence de triivail mais sans prime.
Il est difficile de décrire l'imbroglio que constitue ce sys-
tème de rémunérations qui évolue d'ailleurs vers une simpli-
fication sous les pressions économiques et selon une ligne défi-
nie
par le syndicat patronal : réintégration de l'ensemble des
avantages individuels dans les salaires (fixation d'une rému-
nération annuelle de base). Il semble aussi qu'une évolution
se dessine dans le sens d'une simplification des classifications
d'emplois (un employeur d'une entreprise-pilote en matière de
rationalisation proposant à ses employés trois catégories
d'emplois au lieu de 110).
Mais cette politique qui tend à résoudre une contradic-
tion en soulève une autre : pour une « saine » gestion écono-
mique et pour maintenir le « climat social », on tend à
égaliser les salaires sur des minima; mais les employés pen-
sent cette égalisation selon des maxima... D'où les réactions
22
aux
devant une opération chirurgicale où tout le monde se sen-
tirait lésé. Syndicats et patrons hésitent donc à remettre en
cause le statu-quo qui maintient des contradictions connues
pour une solution qui risquerait d'en soulever de plus graves
encore.
c) Qualification technique
et travaux d'ordre subalterne.
La nationalisation a entraîné l'application d'un pro-
gramme de formation technique des employés d'assurance :
une Ecole Nationale d'Assurances fut créée avec un cycle
élémentaire (C.A.P. pour les employés), un cycle normal pour
les cadres inférieurs et un cycle supérieur pour les cadres
supérieurs. La mystification du système consistait à faire
croire à la possibilité d'une promotion ouvrière du simpie
employé au directeur. En réalité, on avait voulu assurer la
formation de personnel pour certains postes « techniques ».
De fait, le cycle supérieur, où l'on entre sur recommanda-
tion, assure surtout la formation de ceux qui s'intégreront
dans la couche dirigeante. Les autres cycles ne conduisent
pratiquement à rien.
En effet, la rationalisation conduit résultats
suivants :
a) Les postes techniques d'assurance disparaissent; des
tâches élémentaires leur sont substituées. Par exemple : un
calculateur d'actuariat devait avoir une certaine qualifica-
tion; aujourd'hui, le travail de cet employé est entièrement
fait par une calculatrice électronique et l'employé réduit à
la confection des fiches.
b) Les techniques utilisées maintenant sont des techni-
ques générales qui n'ont rien à voir avec l'assurance : dactylos
habiles, opérateurs sur machines à cartes perforées.
c) Même ces derniers postes techniques tendent à s'avilir,
la machine accomplissant la partie la plus complexe du tra-
vail de l'employé, ou bien la routine de travail dégradant
la technicité de l'employé par utilisation d'une partie infime
de sa formation professionnelle (c'est le cas pour les dac-
tylos assurant la frappe des contrats ou pour les opérateurs
effectuant périodiquement le même travail).
Or, pendant ce temps :
a) Les jeunes qui sont embauchés ont tendance à avoir
un niveau d'instruction légèrement au-dessus de la moyenne
(autour du B.E.); si le poste requiert une certaine formation
technique, il est exigé souvent les diplômes techniques corres-
pondants.
b) Chaque année, des employés nantis du C.A.P., du
Brevet professionnel ou de diplômes leur donnant des con-
naissances techniques assez étendues rentrent dans l'entre-
prise. Tous ces employés qui ont cru à la promotion ouvrière
cherchent une récompense de leurs efforts et tombent d'autant
plus haut qu'ils se rendent compte de l'inanité de leur travail.
23
3
Leurs espoirs tournent en déception d'autant plus amère
qu'ils sont employés à des tâches élémentaires, qu'ils en savent
souvent plus long que les cadres qui les commandent et que
par leur attitude critique ils s'éloignent encore plus sûrement
de l'avenir qu'on leur avait promis. On ne donne pas de
place de cadre aux « mauvais esprits » même pleins d'intel-
ligence et de capacités.
d) Les nécessités économiques limitant l'accès
à la couche bureaucratique.
A cette dégradation de la qualification professionnelle,
issue directement de la rationalisation, répond la nécessité de
fermer la promotion vers le sommet. Pour bien gérer l'entre-
prise il est nécessaire de réduire les frais généraux; les cadres
coûtent cher, le travail au rendement permet d'accroître consi-
dérablement la quantité de travail fourni avec un encadre-
ment très différent.
Nous avons déjà évoqué l'attitude de la nouvelle direc-
tion lors de la nationalisation qui avait promu beaucoup de
cadres et d'agents de maîtrise pour se créer une base sociale.
Vers 1950, il y avait au siège social de la Société plus de
110 cadres et environ 250 agents de maîtrise pour à peine
600 employés. Or, pour que la rationalisation nécessaire soit
payante, il faut que l'on puisse en tirer toutes les consé-
quences. La direction avoue maintenant : « il y a 30 % de
cadres en trop » (en pensant 50 ou 60 %). Les licenciements
de cadres n'étant guère possibles, la réduction de leur effectif
s'effectue par non-remplacement des sortants et utilisation
des inutiles comme employés (avec une paie de cadre). Les
promesses de promotion restent lettre morte, et sont d'autant
moins oubliées que les nombreux cadres nommés il y a quel-
ques années sont toujours là pour rappeler l'origine de leur
ascension. Le blocage de l'avancement est un grief souvent
formulé par les employés et il témoigne d'une étape de leur
prise de conscience; apercevant l'inanité de leurs efforts indi-
viduels, constatant l'échec de leurs ambitions, ils découvrent
les conditions qui sont le lot commun des exploités et la soli-
darité.
Cette tendance est renforcée par le fait que la bureau-
cratie dirigeante de l'entreprise et d'ailleurs est considérable-
ment organisée depuis dix ans. Les membres de la Direction,
isolés en 1946 et cherchant des appuis dans l'entreprise, se
sont créé aussi bien dans le « monde de l'assurance » que
dans les milieux politiques, un réseau de relations et n'ont
plus guère à craindre des changements politiques. Ils n'ont
plus les mêmes raisons de maintenir une couche inférieure de
bureaucrates sur lesquels ils s'appuieraient puisqu'ils se sen-
tent intégrés dans une couche supérieure. Ils détruisent ainsi
24
d'autant plus le mythe que la nationalisation pouvait « appor-
ter quelque chose » et ils creusent d'autant plus le fossé entre
dirigeants et exécutants qu'ils avaient essayé de masquer lors
de leur arrivée.
D. -- LES EMPLOYES ET L'ENTREPRISE.
Les appréciations que l'on peut entendre dans le grand
public sur les milieux employés se réfèrent soit à une époque
où les « bureaux » étaient en marge de l'évolution indus-
trielle, soit à une catégorie bien particulière, celle des fonc-
tionnaires. Mais en réalité, l'industrialisation des bureaux
venant avec cinquante ans de retard sur les autres secteurs a
transformé complètement la mentalité de beaucoup d'em-
ployés, la plupart du temps à leur insu.
Pour apprécier ces transformations, il ne faut pas s'arrê-
ter aux aspects les plus apparents de la vie de l'entreprise,
comme si celle-ci se résumait essentiellement par l'activité
syndicale et les grèves. Il faut voir que l'entreprise est un
monde en évolution constante. Le renouvellement des salariés
se poursuit sans cesse parallèlement au progrès technique ;
des hommes provenant d'un milieu social déterminé viennent
rejoindre l'entreprise à telle ou telle étape et leur évolution
se développe à chaque fois selon un rythme propre. Certes,
la ligne générale de l'évolution est la même pour tous, mais
l'inégalité de développement des divers groupes ou individus
n'en demeure pas moins, alors même que ceux-ci font un
travail identique. Ainsi retrouve-t-on dans le présent, juxta-
posées, les différentes étapes parcourues successivement : côte
à côte travaillent l'employé type 1920, l'employé conscient
du fait de l'exploitation et des employés à tous les stades
intermédiaires d'évolution. Le brassage effectué par
les
tations nombreuses des dernières années accroît encore la
diversité ainsi constatée, de sorte que finalement le comporte-
ment collectif est à comprendre davantage comme une résul-
tante (les influences des éléments avancés et des éléments
moins évolués s'entrecroisant) que comme une véritable unité.
mu-
a) L'origine sociale et le recrutement.
En l'absence de statistiques précises, il n'est possible
de donner que des indications sur ce point. Si, autrefois,
les nouveaux venus étaient issus de milieux bourgeois tradi-
tionnels et bien pensants, le recrutement s'est ensuite considé-
rablement prolétarisé (milieux petits employés et ouvriers).
Beaucoup d'éléments nouveaux, jeunes, sont entrés dans l'en-
treprise à la fin de la guerre; ainsi s'explique le pourcentage
actuel assez fort d'adultes de
30
à
40 ans, l'autre
groupe,
le
25
plus important, étant formé de « vieux » de 50 à 65 ans (dont
certains dans la Compagnie depuis plus de 20 ans). Les très
jeunes (18 à 25 ans) sont assez peu nombreux car, en raison
de la rationalisation, les partants ne sont pas remplacés. Le
pourcentage de femmes est important, entre 60 et 70%. Géné-
ralement elles occupent des emplois « subalternes ».
Les raisons qui ont incité ces salariés à venir prendre
un emploi de bureau sont fort diverses : attrait d'un emploi
jugé supérieur à un emploi manuel, espoir d'un salaire supé-
rieur à celui d'autres professions pour une fatigue moindre,
déclassement social (maladie, échec dans des études ou dans
d'autres emplois); pour les femmes, nécessité de trouver un
salaire de complément; pour les jeunes filles, nécessité de
gagner un salaire permettant de sortir du milieu familial.
Mais
pour la plupart, il n'y a pas eu de choix, ils cherchaient
un emploi, ils sont venus là parce qu'ils ne trouvaient pas
autre chose et auraient été aussi bien travailler ailleurs; ils
sont restés parce que de « petits avantages » font pencher la
balance en faveur de l'entreprise (1).
Ce sont ces mêmes avantages qui assurent la stabilité
du personnel.
sont
(1) Il arrive d'entendre des réflexions du genre « On n'est pas mal
ici, il ne faut pas se plaindre », notamment chez ceux qui possèdent des
éléments de comparaison (emplois antérieurs, travail du conjoint dans
une autre entreprise).
De fait, les « petits avantages » ne sont pas négligeables ; ils sont
conçus, non dans l'intérêt des employés mais dans celui, bien compris, du
patron. La plupart des travaux du moins dans l'ancien système
faits de routines et supposent une « connaissance » plus ou moins étendue
des différents services et des circuits de pièces. L'intérêt de l'employeur
est dans la stabilité, sinon de tout le personnel, du moins d'une fraction
de celui-ci. D'où des avantages parfois assez substantiels, la plupart condi.
tionnés par l'ancienneté:
prime d'ancienneté (1 % par année de présence avec plafond de 25 %,
mais acquise seulement après 3 ans de présence);
prime annuelle de « bonne gestion » (environ 1/2 mois de salaire
pour les basses catégories), acquise seulement après 4 années de présence;
prime d'intéressement aux résultats, fonction des bénéfices acquis après
2 ans de présence;
augmentation de la durée des vacances avec l'ancienneté: 4 semaines
après 7 ans de présence.
26
b) L'arrivisme et la prise de conscience.
On peut dire sans beaucoup de chances d'erreur que près
de 80 % des employés, lors de leur entrée dans l'entreprise,
étaient disposés de par leur origine sociale à croire à la pos-
sibilité d'arriver par leurs propres moyens. « Moi, l'argent
seul m'intéresse », « Je ferai ce qu'il faudra pour arriver »,
ces réflexions d'employés beaucoup les ont faites pendant un
temps plus ou moins long de leur carrière dans l'entreprise.
Les moyens utilisés pour « arriver » sont :
1° L'application au travail, l'assiduité, en un mot le
zèle. Ce sont surtout les jeunes qui croient à la « promotion
ouvrière »; ils suivent les cours d'assurance, bien persuadés
que le diplôme leur donnera la « place ». Mais leurs illusions
se dissipent avec le temps. Plus ou moins rapidement, suivant
l'expérience personnelle, l'emploi occupé, l'habileté des cadres,
l'origine sociale, tous se rendent compte que les qualités
requises pour les promotions ne sont ni le travail, ni les capa-
cités, mais surtout le « bon esprit », l'exécution fidèle des
ordres et le respect un peu servile des cadres. Une première
différenciation se fait entre ceux qui acceptent, qui s'intè-
grent dans le système et ceux qui refusent de se plier, par
orgueil, par amour-propre, par dignité, parce qu'ils se ren-
dent compte qu'ils ne sont pas « de taille », parce que ça ne
les intéresse pas (attitude fréquente chez les femmes dont le
travail est destiné à apporter un salaire de complément). Ceux
qui ne peuvent ainsi s'intégrer prennent assez rapidement
conscience du fait de l'exploitation. Prise de conscience très
élémentaire mais qui peut se développer rapidement à la
faveur d'un fait quelconque. Leur attitude commune est la
résistance aux conditions de travail, au système d'exploita-
tion; elle se précise dans des réflexions de ce type : « On en
fait bien assez pour ce qu'on est payé ».
2° Un individualisme forcené qui suppose une certaine
intégration dans la couche dirigeante.
Le manque de scrupules amène certains à vouloir parvenir
à tout prix, fut-ce en écrasant les autres. Ils agissent souvent
comme s'ils étaient dans la peau du personnage qu'ils rêvent
d'être dans l'entreprise. Il y a les malins qui savent les défauts
des chefs et qui les utiliseront, les salauds qui mouchardent,
les forts qui sauront naviguer patiemment dans les intrigues,
qui connaîtront tous les petits secrets privés et feront à l'occa-
sion du chantage discret. Tout ceci évidemment lié à une
compétition malsaine sur le plan du travail, caractérisée par
le souci constant de se faire bien voir et de rabaisser les
« concurrents possibles ».
27
Mais même parmi ceux qui suivent cette voie, seule une
minorité réussit. Beaucoup voient la vanité de leurs efforts :
l'âge, la rationalisation, les événements imprévus (maladie)
amènent souvent soit la mise à l'écart, soit l'hostilité des
cadres. Même s'ils ont un peu progressé dans la hiérarchie,
ils en voient d'autres leur « passer sous le nez ». Ces faits
les conduisent à considérer d'une toute autre manière les rap-
ports de travail; ils deviennent sensibles à des événements
qui autrefois les auraient laissés indifférents. Cependant,
leurs illusions ne disparaissent pas radicalement et ils restent,
tout en évoluant, timorés; leur attitude demeure parfois
ambiguë. Aussi faut-il bien les connaître pour ne pas « cho-
quer » les idées auxquelles ils ont pu rester attachés.
Parmi bien d'autres, l'exemple le plus typique est sans
doute celui d'un garçon d'étage qui vivait un peu en marge
de l'entreprise et restait fidèle à de vieux clichés sur la jus-
tice du système établi; il fut un beau matin muté aux archives
pour classer des polices, à l'âge de 50 ans. Les courbatures
de son dos, la monotonie et la cadence du travail firent plus
que toutes ses expériences antérieures; il devint d'abord un
rouspéteur, puis une sorte de « militant » sans le savoir,
exprimant ses réactions d'une manière d'autant plus juste
qu'il était resté imperméable à toute phraséologie politique
ou syndicale.
Paradoxalement, ceux qui croient à la morale bourgeoise
sont plus rapidement conduits à la révolte individuelle. Sur
le plan de l'entreprise, on s'aperçoit rapidement que cette
morale est unilatérale, que ceux qui la prônent ne la respec-
tent jamais et que les principes ne sont qu'un cadre de domi-
nation. Le recrutement du « bon personnel » ne représente en
réalité aucune garantie pour l'employeur : il en tire bien des
ambitieux qui confondent leur intérêt personnel avec « l'inté-
rêt de la Compagnie » mais il en tire aussi sûrement des
employés sensibles aux injustices.
Le monde des employés compte autant d'aspects positifs
que d'aspects négatifs; car l'évolution qui mène à la prise de
conscience de l'exploitation est parfois fort longue et peut
exiger une vie entière d'employé. Ceux qui croient à la possi-
bilité d'arriver par leurs moyens sont évidemment les éléments
qui freinent les luttes, qui brisent la solidarité d'un bureau;
c'est sur eux que spéculent les cadres et la Direction pour
maintenir leur domination sur le personnel. Pour qu'une lutte
prenne un caractère unanime, il faut que toutes ces manifes-
tations d'individualisme soient dépassées par la quasi tota-
lité des employés. Cela, les employés les plus conscients le
sentent et cette impression est un des éléments importants de
leur appréciation de l'efficacité probable d'une lutte.
28
c) La vie personnelle des employés
et leur vie collective dans l'entreprise.
Pareillement, le contact avec l'entreprise tend à trans-
former complètement la vie privée de l'employé. Il perd peu
à peu, dans ce cadre, ses habitudes de vie individuelles et,.
de plus en plus, ses préoccupations se centrent sur la cellule
sociale qu'est l'entreprise. Il arrive souvent d'entendre des
employés dire carrément : « Je vis ici 8 heures par jour, la
partie la plus importante de ma vie, j'organise ma vie autour
de cela ».
La réduction de la pause de midi a rendu nécessaire l'or-
ganisation d'une cantine. En dix ans elle a conquis presque
tous les employés; le réfectoire où l'on mange à la gamelle
individuelle a perdu presque toute sa clientèle. L'entreprise
est, de plus en plus, un centre commercial actif; beaucoup
d'employés s'approvisionnent à une sorte de coopérative; des
commerçants de toutes sortes viennent dans un local réservé à
cet effet vendre pratiquement de tout.
Plus que son lieu de domicile, l'entreprise est pour l'em-
ployé le lieu de ses contacts sociaux: c'est là qu'il se fait des
amis, que jeune, il fréquente des jeunes filles, qu'il organise
des « sorties ». Les discussions les plus importantes, il les a
sur le lieu de travail avec ses camarades de travail. Il tend à
modeler sa vie, depuis les détails matériels de l'habillement
en passant par ses lectures, ses distractions, ses vacances,
d'après les contacts qu'il a dans l'entreprise. Les conversa-
tions qu'il a le soir chez lui tournent souvent autour de sujets
évoqués dans la journée sur le lieu de travail.
Sans qu'il s'en rende compte, ses manières de penser, ses
habitudes de vie ne sont plus les « siennes propres » mais
celles de la collectivité dans laquelle il vit. Sans doute, il
semble parfois rester un individualiste, mais, de plus en
plus, les problèmes de sa vie privée se posent à travers l'entre-
prise et c'est dans ce cadre qu'il cherche à les résoudre.
On ne peut bien comprendre les employés si l'on n'est
pas sensible au décalage qui existe entre leurs paroles et leurs
actes. En général ils s'expriment d'une manière beaucoup plus
modérée qu'ils n'agissent. Il n'existe pas d'ailleurs d'employé
type; chacun se situe à un moment donné de son évolution
dans une situation intermédiaire. De plus, des progrès ra-
pides sur le plan des rapports de travail n'entraînent pas de
progrès parallèles immédiats sur les autres plans. L'employé
croit encore plus ou moins aux principes de son éducation
alors que son attitude au travail tend à nier ces principes
mêmes. «Il y aura toujours des cadres, il ne faut pas attaquer
la hiérarchie » dit une employée. Mais dans son bureau elle
déclare : « c'est moi qui fait tout le travail ; ils (les cadres) ne
sont même pas capables de prendre leurs responsabilités ».
Une autre employée qui attaque violemment la direction et
les bureaucrates syndicaux ne met pas en cause l'ordre social
29
et, à défaut d'autres arguments, use de clichés patriotiques
pour critiquer la politique de la C.G.T. et ses liens avec le P.C.
Les mêmes employés qui, dans certaines circonstances, cri-
tiquent violemment les délégués syndicaux se laissent plus ou
moins prendre aux manifestations paternalistes organisées par
eux (Fête des Mères, Arbre de Noël, etc.)
D'autre part, la vie dans l'entreprise et son intérêt oblige
le salarié à un minimum de relations avec les cadres et les
bureaucrates syndicaux; même s'il est édifié sur leur attitude
réelle, il ne peut faire autrement que maintenir des rapports
de façade avec ceux-ci. Chacun sait qu'ils sont puissants et
que manifester ouvertement et individuellement son hostilité
envers eux serait se mettre bien inutilement dans une situation
délicate. « Ça me fait mal au ventre de lui serrer la main »,
disait un employé parlant du permanent C.F.T.C.; mais il
la lui serrait et ne pouvait faire autrement.
Le travail des bureaux favorise les contacts sur tous les
plans; même si la cadence de travail est élevée, il y a des
moments de battement où l'on cause. Des employés sont appe-
lés à circuler et à avoir des contacts avec d'autres services. Si
l'on ajoute que les cadres inférieurs travaillent avec les ém-
ployés, on peut imaginer les discussions qui ne manquent pas
de naître sur des sujets de toute espèce.
« La Compagnie, c'est un village », disait un employé
voulant évoquer à la fois la vie collective et les multiples rela-
tions entre individus (il le pensait sous la forme péjorative de
circulation de ragots). Le même ajoutait, d'ailleurs, que dans
leur ensemble les employés essayaient de s'évader de la mono-
tonie de leur vie de salarié en s'occupant notamment de la vie
privée des autres, en ayant une sorte de deuxième vie sur le
plan de l'entreprise beaucoup plus riche que l'autre.
Et telle est bien la réalité. Tout circule, se répète, se dif-
fuse, tantôt réel, tantôt grossi, tantôt inventé. Tout est le
point de départ de discussions. Cela va des ragots sur la
vie privée aux bruits de couloirs sur les nominations, les petits
scandales de la Direction et des Cadres, les incidents avec
les Cadres, des conversations sur un article lu dans le jour-
nal, jusqu'aux histoires lancées comme ballon d'essai
par
la
Direction et les syndicats. Tout le monde dit dans la Compa-
gnie que tout se sait et que la direction finit par tout savoir;
mais les employés finissent aussi par tout savoir.
Il ne faudrait pas en conclure qu'il s'agit d'une atmos-
phère pesante. Les remarques désabusées du genre « ce sont
des imbéciles », « ils écoutent tout ce qu'on raconte »), « j'en
ai marre de cette tôle » viennent soit d'aigris dont l'indivi-
dualisme est en conflit avec la vie collective de l'entreprise,
soit de délégués syndicaux qui ne peuvent manoeuvrer comme
ils le voudraient.
En fait, c'est à travers cette vie de l'entreprise que les
employés se transmettent tous les petits faits de la lutte quo-
tidienne, qu'ils peuvent juger de l'activité des cadres, du
pas exclu-
patron et des délégués syndicaux, qu'ils conservent le sou-
venir des éléments marquants du passé ; c'est par elle qu'ils
sont réellement membres de l'entreprise.
d) Les employés et le travail.
Tout employé qui travaille est un employé qui lutte. L'uti-
lisation de moyens égoïstes pour « arriver
» n'est
sive de l'utilisation d'autres moyens pour « avoir » le patron.
Il n'y a pas de discontinuité absolue entre l'employé qui joue
des coudes et flatte les cadres et celui qui maintient une façade
de travail pour en faire le moins possible ou celui qui se sent
solidaire de ses camarades de travail. Ainsi que nous l'avons
déjà souligné, l'attitude de l'employé dépend des circons-
tances, de son expérience antérieure, de ce qu'il espère encore,
de ce qu'il perçoit des chances d'une lutte individuelle ou col-
lective. Mais la ligne générale de son attitude tend dans la
plupart des cas à entraver constamment l'exploitation.
La direction et les cadres croient connaître tout ce qui
concerne le travail dans l'entreprise. En réalité ils ignorent
tout des petits trucs secrets utilisés, même par les plus rai-
sonnables, pour résister à la pression du patron et en quelque
sorte, rétablir l'équilibre — secrets gardés par les intéressés ou
connus de quelques initiés de confiance. Il est difficile d'en
donner une description; les uns sont archi-connus (utilisation
des lavabos, des heures d'entrée et de sortie) d'autres particu-
liers qui ne peuvent être révélés, bien qu'édifiants, parce que
ce serait les faire conaître à la Direction. L'esprit inventif des
salariés dans ce domaine atteint un niveau insoupçonné.
Cette lutte de tous les jours pourrait s'exprimer en une
tendance constante à grignoter les cadres que l'employeur
impose aux salariés. Ce grignotage est une réaction de dé-
fense élémentaire, indépendante de toute théorie, de toute
action coordonnée. Il s'adapte à toutes les règles, si dures
soient-elles, et touche toutes les disciplines de l'entreprise:
Le temps de travail: réduire le plus possible le temps
effectif de travail, accroître les temps morts pendant le tra-
vail, multiplier les absences sous forme de permissions, de
jours de repos, d'entrée après l'heure, de sortie avant l'heure.
La publication périodique de circulaires sur les heures de
sortie, les rappels à l'ordre pour les retards, les pointages illé-
gaux attestent cette chasse au temps de l'employeur et tout
autant son inanité.
- Le cadre des salaires: l'employé est un perpétuel insa-
tisfait. Il y a une pression constante sur toute la hiérarchie
des salaires qui fait que les basses catégories sont peu à peu
vidées de toute référence réelle et inutilisées. Indépendamment
des augmentations générales de salaires, l'échelle hiérarchique
se déplace constamment vers le haut, en retournant contre
l'employeur cette politique du cas personnel utilisée pour briser
la solidarité des employés. Au contraire, un cas personnel
satisfait devient le « cas » auquel on s'accroche pour réclamer
NE
21
ce qui n'était pas justifiable auparavant. Il en est de même
pour les avantages individuels dépendant d'une notation;
pratiquement l'échelle de notes prévue de o à 20 devient une
échelle de 12 à 18 et les protestations des mal notés sont si
véhémentes que de plus en plus ce système destiné à différen-
cier tend à se transformer en une répartition égale pour tous
(revendiquée d'ailleurs directement par beaucoup); les em-
ployés lésés par une nomination réclament très facilement des
compensations et essaient de les obtenir par tous les moyens.
Les règles de travail et le contrôle des cadres: Cette
négation de la hiérarchie sur le plan des rémunérations existe
aussi sur le plan du travail lui-même. Le conflit est constant
entre les cadres qui tendent à faire donner le maximum de
travail sous certaines formes permettant un contrôle étroit et
les employés qui tendent à en fournir le minimum sous des
formes plus élémentaires. Pour que le système de travail d'une
entreprise rationalisée soit efficace, il faut de nombreux con-
trôles permettant à la direction et aux cadres d'essayer de
saisir la réalité; d'où une lourde machine administrative pour
faire fonctionner « normalement » ce qui ne peut fonctionner
qu'avec le concours des salariés ; ceux-ci ne sont jamais con-
sultés et n'ont auun intérêt particulier à ce bon fonctionne-
ment; ils ne font donc que le strict nécessaire. Si le cadre
n'impose pas constamment par sa présence, par un contrôle de
chaque instant, les règles que lui et la direction ont fixées,
elles ne sont pas observées et tombent en désuétude.
e) Les employés et la gestion de leur travail.
Cette lutte contre les instructions et les règles de travail
peut prendre l'aspect plus conscient d'une attitude critique
face à l'organisation même du travail en général et de tous
ceux qui participent à cette organisation : direction, cadres,
délégués. La circulation des renseignements de tous ordres
permet l'exercice par l'employé d'une sorte de contrôle étroit
et de comparaison avec ce qu'il constate de par sa situation
dans l'entreprise. L'employé connaît un certain nombre de
détails matériels sur les « signes extérieurs » de la direction
et des cadres; il connaît aussi leur situation et leur compor-
tement dans l'entreprise. Il connaît encore plus intimement les
cadres les plus proches de lui.
Il a des idées sur l'organisation de son travail bien qu'il
sache qu'on ne le consultera pas pour l'organiser ; il sait et il
dit que ceux qui prennent les décisions tombent toujours à
côté parce qu'ils ne connaissent pas le travail. S’il invente
une amélioration, il la tait souvent. Témoin cet employé qui
regrettait amèrement d'avoir indiqué à un cadre une simpli-
fication dont celui-ci s'était servi pour se faire mousser auprès
des supérieurs. Autre témoin, cet employé des archives qui
expose, dans le plus grand détail, pendant plus d'une heure
et en traçant un plan des locaux ce qui aurait dû être
fait pour améliorer la marche du service et faciliter le travail.
32
C'est très souvent que l'on entend: « Ça marcherait mieux
sans cela, comme cela » er même « s'il n'y avait pas de
cadres ».
Ce souci de la gestion du travail se transpose sur le plan
de l'entreprise dans la recherche du renseignernent, de l'expli-
cation et dans la critique du gâchis et des injustices. L'em-
ployé ne peut parvenir à l'élever à une critique positive de
l'entreprise, car il ne peut réunir, comme il en est capable
à l'échelle de son bureau ou de son service, les fils qui lui
permettent de saisir la totalité de la situation. Ce qui est
positif c'est le désir d'avoir le plus de renseignements possi-
bles, et le souci de trouver une explication à telle ou telle
mesure. Mais son isolement relatif dans un service, le cloi-
sonnement en dépit des échanges de renseignements l'empê-
chent de parvenir à la notion d'une gestion de l'entreprise.
L'employé sent bien qu'il existe une réponse aux explications
qu'il recherche et que tout ce qu'il peut sentir doit se relier
d'une manière cohérente. Les explications que les délégués
des syndicats essaient de lui apporter ne le satisfont pas.
C'est sur cette base autant que sur l'efficacité que se définit
son attitude vis-à-vis de la direction et des délégués. Plus le
travail est divisé, moins l'employé parvient à saisir le sens
de ce qu'il fait, et plus il devient exigeant sur les explications.
En même temps, le patron éprouve d'autant plus le besoin
de cacher le véritable sens de l'exploitation accrue; il essaie
de mettre dans son jeu ceux qui pourraient jouer vis-à-vis des
employés ce rôle capital d'explication. De là le culte patro-
nal du secret, les mystifications de la Direction, des Cadres
et des Délégués. De là aussi l'appréciation par les employés
du rôle exact joué par les délégués en «place » dans l'entre-
prise.
Les employés, les militants et les délégués.
Que l'employé ne puisse juger la marche de l'entreprise
ou la manière dont la Direction utilise son travail, cela ne
signifie pas qu'il n'en soit pas capable ; il sent généralement
qu'il existe là un problème dont il lui manque des données.
Comme leur genre de travail, leur mode de rémunération
les prédispose à être des gens calmes et prévoyants; comme
leur bagage, peut-être légèrement supérieur à la moyenne,
les rend moins perméables à certaines mystifications, ils sont
en général méfiants et ne croient pas facilement ce qu'ils ne
vérifient pas. Les idéologies ont assez peu de prise sur eux,
la lecture du journal ou les petites discussions politiques ne
les passionnent pas particulièrement. Par contre, si à la
faveur d'un service rendu ou d'un fait dont ils ont eu eux-
mêmes connaissance, ils font confiance à une personne ou à
une idée, ce ne sera pas quelque chose d'éphémère. Cela peut
se traduire par une recherche de l'efficacité dans leur attitude
quotidienne sur le lieu de travail et par une attitude résolue
en cas de grève. Quand les employés du Central mécano-
graphique décident de faire grève, ils savent qu'ils ont de
bonnes chances, autrement ils se tiennent tranquilles.
L'attitude des employés vis-à-vis des délégués s'explique
aussi de cette manière. Le délégué permanent essaie de cap-
ter la confiance des employés, soit par des promesses, soit
par de petits services. Mais il ne peut pas tout, et les pro-
messes non tenues font réfléchir. Alors la confiance disparaît.
Pour l'employé, il n'y a pas de distinction entre des militants
sincères ou des bureaucrates syndicaux ; ces termes n'exis-
tent pas dans son langage ; il y a ceux en qui il a confiance
et ceux en qui il n'a pas confiance mais qu'il peut utiliser
en raison de leurs fonctions.
La confiance d'un employé ne se capte pas. C'est dans
le travail qu'elle se forme, et elle ne peut exister envers tous
ceux qui sont coupés de la communauté du travail. Les repro-
ches les plus fréquemment entendus sur les délégués des
syndicats visent la distance qu'ils ont prise par rapport à
l'entreprise : « c'est nous qui nous appuyons leur travail »
« ils ne sont jamais là » « on les a vus hier sortir du
bistrot d'en face » « ils sont encore en réunion ». Cette
rupture de solidarité dans le travail provoque de la colère
quand le bureaucrate syndical veut encore commander dans
le travail, témoin ce délégué C.F.T.C. qui ligue son bureau
contre lui pour avoir déclaré entre deux séances : « il y a
une drôle de pile de dossiers, il va falloir en mettre un
coup », et avoir réparti les dossiers entre les autres employés.
Les promotions des délégués sont soigneusement surveillées
et colportées avec le commentaire adéquat : « il vient de
passer AM3, qu'est-ce que cela récompense ? » « il a
8 degrés en 10 ans alors que les autres n'en ont que 4 en
20 ans. On sait ce que ça veut dire ».
Mais les griefs les plus graves contre les délégués témoi-
gnent du fait que les employés veulent comprendre ce qui
se passe : « ils ne nous disent jamais rien » li on ne sait
jamais ce qui se passe » — «on ne peut rien savoir »
nous disent ce qu'ils veulent bien nous dire ».
Le vrai militant, les employés le comprennent comme le
gars avec qui on échange quelque chose, expérience pour
expérience, qui doit pouvoir expliquer tout mais de manière
ce que cela recoupe l'expérience vécue ; ils le comprennent
comme celui qui travaille comme les autres, qui est irrépro-
chable sur le plan du travail. Le vrai militant c'est celui qui
vit le même rythme de vie, qui comprend sans qu'on ait à
faire de discours, qui écoute et tient compte de ce qu'on
dit. C'est celui dont on sait tout, ce n'est jamais celui qui
commande, qui dissimule ou qui a des idées derrière la tête.
Ce qu'un employé cherche chez celui en qui il a confiance,
ce n'est pas seulement des explications limitées à l'entreprise,
mais des explications sur tous les problèmes qui peuvent se
poser dans sa vie, sur ce qui l'aura intrigué à la lecture du
journal ou en réfléchissant sur tel ou tel fait. Et toujours
( ils
34
ce qu'il cherche ce n'est pas tant une leçon mais la confir-
mation de ce qu'il sent comme la véritable explication sans
pouvoir la formuler. Si un employé s'aperçoit qu'on veut
l'annexer dans un but quelconque ou qu'on utilise ses réactions
pour l'embrigader dans une direction ou une autre, il rentre
dans sa coquille; comme il est, en général, poli, il écoute peut-
être bien gentiment, mais il ne communique pas.
E. LA LUTTE DES EMPLOYES
ET L'ACTION D'UN GROUPE DE MILITANTS.
L'analyse que nous venons de faire des conditions et de
l'évolution du travail , de la mentalité et de la vie des em-
ployés, de leurs relations avec les syndicats, était indispen-
sable pour comprendre le sens de la lutte qui s'est développée
depuis six ans et qui a abouti à la création du Conseil du
Personnel.
La grève de mars 1950 fut la première manifestation de
l'évolution que suivait la mentalité des employés, en réponse
aux nouvelles conditions de travail. (1) Son échec constitua
pour beaucoup une prise de conscience des divisions syndi-
cales et de ce qu'elles représentaient. Pendant longtemps tous
les mouvements se heurtèrent au souvenir de la grève et à des
réflexions du genre: « pour que ça se passe comme en mars
1950! » Et quand ,par hasard, les syndicats diffusaient un
tract, on pouvait entendre: « enfin ils se décident à se mettre
d'accord ».
Entre 1950 et 1955, en revanche, il n'y eut pas apparem-
ment d'action marquante, mais une lente maturation se pour-
suivit. Quelques militants se rassemblèrent, décidés à mener
un travail systématique et pratique de démystification. Ils ne
furent d'abord qu'une poignée, mais ils prirent le contrôle de
la section C.G.T. de l'entreprise et tentèrent de mener de
front la lutte contre le patron, les syndicats réformistes et les
bureaucrates communistes de la C.G.T. (dans la période
« dure » de la guerre froide). Ils furent ensuite victimes des
manæuvres de la Direction de la C.G.T. qui cherchait à les
déposséder de leur influence; mais ils réussirent finalement à
entraîner avec eux la majorité de l'entreprise. C'est que leur
action exprimait justement l'évolution des conditions de tra-
vail et la prise de conscience par les employés du véritable
rôle des syndicats.
Pour situer leur lutte dirigée à la fois contre le patron et
les syndicats, il n'est besoin que de citer quelques épisodes
significatifs: Ce ne sont toutefois que des exemples d'une
action quotidienne pendant près de cinq années.
(1) Voir Socialisme ou barbarie, n° 7 (août-septembre 1950). H. Col-
LET, La grève des Assurances, p. 103.
Contre la collusion des bureaucraties syndicales et pa-
tronales: en 1950 un administrateur fut désigné par la C.G.T.
au conseil d'administration de la Compagnie (fait déjà cité);
deux mois après, il obtint de la Direction un appartement de
sept pièces, alors que les employés n'en obtenaient pratique-
ment jamais.
Lors d'une réunion faite par le secrétaire national du
syndicat C.G.T. de l’Assurance, « descendu » pour essayer
d'expliquer cette anomalie, une vingtaine d'employés prirent
violemment position contre les bureaucrates syndicaux.
- Contre la politisation de la C.G.T.: L'activité de
la C. G. T. était fertile à cette époque en mouvements
politiques dictés par le seul scuci d'alignement sur la poli-
tique de défense de l’U.R.S.S. du P.C. ; non seulement
notre équipe ne distribuait jamais les tracts politiques venant
du syndicat, mais elle adressait au secrétaire du syndicat des
motions de protestation contre de telles actions, signées par
la plupart des adhérents. Une de ces motions qui donna lieu à
un incident violent fut adressée à l'occasion du mot d'ordre
de grève du 12 février 1952; elle était ainsi rédigée:
La section syndicale Employés C.G.T. des Assurances
Générales Vie constate que le mouvement de grève du 12 fé-
vrier 1952 n'a été que très partiellement suivi et que cet échec
discrédite et ruine le mouvement syndical.
Elle pense que:
1° Les travailleurs dans leur ensemble n'étaient pas d'ac-
cord avec les mots d'ordre lancés;
2° Qu'à l'intérieur de l organisation, les travailleurs
n'approuvaient pas cette orientation.
Ces faits montrent qu'il existe un désaccord profond
entre la Direction du syndicat et la majeure partie des adhé-
tents.
Les membres de la section pensent que pour remédier à
cette situation il conviendrait:
1° D'appliquer plus largement les principes démocrati-
ques au sein de l'organisation syndicale;
2° De provoquer la réunion d'un congrès extraordinaire
pour élire démocratiquement des dirigeants syndicaux sur lil
base d'un ou plusieurs programmes.
3. De procéder avant chaque mouvement de grève à un
référendum parmi les syndiqués.
C'est, à notre avis, le seul moyen de redresser l'organisa-
tion syndicale. Bâtissons une organisation suffisamment large
pour que tous les travailleurs s'y sentent à l'aise.
Cette motion fut signée de 43 adhérents de la section sur
environ so et fut affichée dans l'entreprise.
Elle fut suivie d'une lettre individuelle du secrétaire du
syndicat à tous les adhérents de la C.G.T. de l'entreprise,
développant les arguments suivants:
* Comme tout adhérent de la C.G.T., ils avaient le droit
de n'être pas d accord. Ils avaient le droit et même le devoir
de le dire au syndicat. Nous aurions pu nous expliquer et con-
fronter nos arguments. Ils n'avaient pas le droit de se livrer
publiquement à une attaque aussi odieuse que mensongère
contre leur Organisation syndicale.
Mais ceux qui vous parlent de démocratie vous ont-ils
consultés avant d'apposer leur placard qui a fait la joie de
votre Direction et de ses agents ? Ceux qui vous parlent de
bâtir une organisation syndicale suffisamment large pour que
tous les travailleurs s'y sentent à l'aise, pensent la réaliser sur
la base d'une unification totale du balayeur aut Directeur ? »
La réunion convoquée par le secrétaire du syndicat donna
lieu à des explications violentes mais il n'y eut aucune dis-
cussion sur le fond. A part quelques membres du parti et
quelques « suiveurs », les autres employés présents purent
constater de quelle manière un bureaucrate syndical savait
se dérober à une discussion.
Contre l'attitude des cadres à quelque tendance qu'ils
appartiennent: Le conflit prit une forme très aigue à l'occa-
sion de la comparution devant un conseil de discipline d'un
employé de la C.G.T., ex-déporté et malade. Cet employé
qui avait travaillé sous les ordres d'un chef-adjoint membre
de la C.G.T. cadre, avait eu, sous l'empire d'une grande
fatigue nerveuse, un incident violent avec un autre cadre. Le
cadre C.G.T. rédigea un rapport écrasant concluant à « l'in-
capacité » de l'employé. Ceci était d'autant plus grave que
l'employé était étranger et que son renvoi l'aurait placé dans
une situation très difficile. Le cadre, placé devant ses respon-
sabilités, avait refusé de modifier quoi que ce fut de sa
position.
Il ne s'agit là d'ailleurs que d'un épisode de la lutte contre
les cadres en général, à quelque tendance qu'ils apparte-
naient, en tant qu'agents directs d'application de la « disci-
pline » et des réformes des méthodes de travail (mutation,
accroissement des cadres, renforcement du contrôle du
travail).
Contre la politique des syndicats réformistes, simples
auxiliaires de la gestion du travail. La lutte contre le patron
et celle contre les syndicats réformistes étaient presque insé-
parables. C'était la trame quotidienne de notre travail d'expli-
cation; et les faits les plus divers en fournissaient l'occasion:
refus de mutation d'un employé malade; abandon des em
ployés considérés « indépendables » pour la seule raison quc
la Direction les jugeait tels, votes de confiance à la Direc-
tion au Comité d'Entreprise. Tous les lieux étaient bons pour
se battre sur ce terrain: réunions de délégués du personnel,
Comité d'entreprise, etc... Dans cette lutte, il fallait d'ailleurs
compter non seulement avec une hostilité marquée de la Direc-
tion mais aussi avec l'inertie d'une importante fraction du
37
((
personnel qui se méfiait de notre participation à la C.G.T.
Voici des exemples:
Un employé des archives malade des reins (un seul
rein) demandait sa mutation, avec un certificat médical à
l'appui, depuis des mois; il s'était adressé en vain à son syn-
dicat F.0.; en désespoir de cause il parle de son cas à un des
camarades de notre équipe, délégué du personnel, qui de-
mande ausitôt une entrevue au chef du personnel. Les délé-
gués F.O. et C.F.T.C. l'apprennent et alertent la direction,
qui accorde la mutation immédiate de l'employé. Celui-ci et
un de ses camarades de travail comprennent sur ce cas indi-
viduel le rôle réel des syndicats et viennent grossir le rang
des
convertis ». Lors du départ d'un Président-Directeur
Général une quête pour lui offrir un cadeau est faite par le
délégué F.O.. Nous tirons un tract en dehors du syndicat,
intitulé « pas de quête pour le patron » qui rencontre un gros
'écho. Lors du vote du bilan au Comité d'entreprise nous refu-
sons le vote en expliquant que « voter le bilan c'est approuver
l'exploitation du patron ». Cela donne lieu, à plusieurs repri-
ses, à des incidents violents.
Cette action, si d'une certaine manière elle se trouve
favorisée par l'isolement de la C.G.T. des autres centrales
syndicales, est d'un autre côté freinée:
Par le manque de moyens matériels. La direction du
syndicat refuse de tirer les tracts qui lui paraissent attaquer
trop violemment le patron ou les autres bureaucraties syndi-
cales, ou bien contredire l'action de la C.G.T. et du P.C. Par
exemple, refus d'un tract rédigé parce qu'on avait accordé
une demi-journée de congé lors de la remise de la Légion
d'honneur au Président-Directeur Général, refus d'une réfé-
rendum lors de propositions de la direction pour l'augmen-
tation de la durée hebdomadaire de travail.
Par l'équivoque qui s'attachait à notre participation à
la C. G. T. Sans doute tous les incidents connus des employés
les faisaient progresser. Mais la masse des employés restait
méfiante, d'autant plus que nos bulletins syndicaux étaient
souvent modifiés d'office et que des mots d'ordre politiques y
étaient ajoutés par les dirigeants du syndicat de l'assurance.
D'autre part, des gens de l'extérieur venaient distribuer à la
porte de l'entreprise les tracts politiques émanant du syn-
dicat que la section de l'entreprise refusait, et pour cause, de
diffuser.
A partir de 1952, cette situation se modifia. Un certain
nombre d'éléments, parmi les plus actifs de l'équipe, quittè-
rent l'entreprise, ce qui favorisa l'action des membres du P.C.
à l'intérieur de la section de la C.G.T. En même temps, avec
la fin de la guerre froide, la C.G.T. commença un travail
d'approche vers les autres syndicats qui l'amena à prendre,
sur le plan de l'entreprise et vis-à-vis de la fédération patro-
nale, des positions semblables à celles des syndicats réfor-
mistes, utilisant toutes les opportunités pour rentrer dans le
38
circuit. Ce rapprochement se faisait essentiellement sous le
couvert « d'actions communes », toujours parties du sommet.
Cette mystification de « l'unité syndicale » rencontra un cer-
tain écho au départ chez les employés qui sentaient que les
divisions syndicales étaient les principales causes de leur fai-
blesse. En même temps, les membres du P.C. et leurs pro-
ches sympathisants s'entendaient avec les mêmes syndicats
réformistes, sous le couvert de l'unité, pour isoler, discré-
diter, circonvenir, décourager le groupe d'employés resté à
la section C.G.T. et opposé à leur politique.
La lutte se poursuivit pendant près de deux ans d'une
manière sourde et tenace, sans intervention apparente des
directions syndicales. Il ne peut être question ici aussi que
de rappeler quelques incidents marquants:
En juin 1953, la direction de l'entreprise et les réfor-
mistes veulent imposer un horaire de 43 heures au lieu de 40.
Le délégué C.G.T. (sympathisant communiste) est d'accord
avec les délégués des autres syndicats. Le secrétaire de la
section C.G.T. (seul restant de l'équipe de militants dout nous
avons parlé) se voit refuser par le secrétaire du syndicat le
tirage de tracts en vue d'un référendum et d'un appel au per-
sonnel. Ce n'est qu'une assemblée du personnel convoquée
sur sa seule initiative et une attaque violente des positions
des autres délégués qui provoquent une réaction du personnel,
laquelle force le patron à reculer et à lâcher une prime égale
à un demi-mois de salaire pour calmer l'agitation.
Paradoxalement c'est la C.G.T. qui tire le bénéfice de
cette action indépendante: sa liste et le délégué sympathisant
communiste récoltent un supplément de voix aux élections,
alors que pour la première fois la liste C.F.T.C. perd des
voix et que le nombre des abstentions s'accroît.
De son côté le syndicat utilise certains faits pour prouver
la supériorité de son action par intervention directe du secré-
taire national du syndicat auprès du directeur. Il se vante,
par exemple, d'avoir fait réintégrer un employé licencié pour
cause de maladie, alors que l'action dans l'entreprise a échoué
pendant un an en raison même de la passivité des délégués,
y compris celui de la C.G.T.
L'action de septembre 1953 fait ressortir mieux ce recol-
lement de la C.G.T. au syndicat' réformiste et la position
attentiste des employés qui ne sont pas décidés à agir sur
ordre, là où leur situation ne paraît pas menacée (1).
A l'intérieur de la section C.G.T., l'action des éléments
pro-communistes se fait plus pressante à mesure que se déve-
loppe la politique de la C.G.T. pour l'unité. Par décourage-
ment, par souci de ne pas couvrir certaines équivoques, les élé-
ments les plus conscients de la section syndicale C.G.T. se
retirent dans l'abstention.
(1) Voir Socialisme ou barbarie, nº 13 (janvier-mars 1954): J. SIMON,
La grève dans les Assurances, p. 46.
30
Ces départs se font tantôt isolément, tantôt collective-
ment, à l'occasion de faits qui font apparaître plus crûment
les contradictions à l'intérieur de la section syndicale: le 28
avril la C.G.T. lance un mot d'ordre de grève générale au-
quel s'associe plus ou moins la C.F.T.C.; les employés restés
dans la section discutent sur le point de savoir si la grève
sera suivie car elle n'intéresse pas la masse des employés. Tout
se passe dans la plus grande confusion, il y a quatre grévistes
sur 500 employés. Le lendemain l'un des grévistes, un gars
du Central mécanographique démissionne et pose une affiche
sur le panneau syndical, expliquant son désaccord avec le
syndicat. Sa démission entraîne celle de tous les gars du
central.
Jusqu'à l'été 1954, les réunions de la section syndicale
sont le lieu de violents conflits entre les employés restés fidèles
à l'ancienne équipe et les pro-communistes; chaque fait, même
le plus négligeable donne lieu à des discussions de principe,
en raison de la ligne adoptée par la C.G.T. La situation de-
vient si intenable qu'en septembre 1954 le secrétaire de la
section C.G.T. démissionne pour ne pas avoir à couvrir cette
politique sous peine de se discréditer totalement. A sa place
un membre du P.C. de la cellule inter-entreprise est désigné;
tout rentre ainsi dans la ligne.
Mais en même temps tout se clarifie; il y a désormais
deux catégories d'employés : ceux qui sont dans les syndicats
et ceux qui sont en dehors des syndicats. L'union des syn-
dicats F.O., C.F.T.C., C.G.T. peut alors se faire sans obsta-
cles, sur une position de collaboration avec la Direction (1).
Comme le dira plus tard le Président-Directeur Général,
« nous avons là une bonne équipe ». Mais l'évolution des
employés n'en continue pas moins, et les plus conscients
gardent des contacts en dehors de « toute organisation »,
au hasard des rencontres de couloir, des discussions de can-
tine, etc.
Les syndicats croient qu'ils peuvent jouer leur jeu en
toute impunité. Mais la mise au point par eux seuls avec la
direction d'un nouveau système. d'avantages individuels qui
laisse la plus large place à l'arbitraire patronal soulève de
violentes protestations des employés. En même temps les
délégués s'embarquent dans une histoire très paternaliste de
« maison de repos » pour le personnel de la Compagnie. Ils
deviennent de plus en plus, aux yeux de nombreux employés,
des simples auxiliaires de la Direction, quelle que soit leur
appartenance syndicale.
En octobre 1955, deux délégués C.F.T.C. démissionnent
publiquement pour protester contre cette ligne de conduite,
(1) Le nouveau secrétaire de la section syndicale C.G.T. est d'ailleurs
dès son entrée en fonctions appelé à la Direction. Il y est reçu seul et,
de son propre aveu, donne tous apaisements sur son action future, dé-
clarant qu'il ne sera jamais délégué du personnel.
0
se faisant l'écho de conflits et de refus de discussions au sein
de la section C.F.T.C. Une réunion de bureau conduit pra-
tiquement les responsables nationaux C.F.T.C. présents à
couvrir l'activité du principal délégué et à faire passer les
démissionnaires pour « des petits garçons qui ne comprennent
rien ».
Ce furent les grèves de novembre 1955 qui firent franchir
à beaucoup d'employés un nouveau stade.
F.
LES GREVES DE NOVEMBRE 1955 ET LA
FORMATION DU CONSEIL DU PERSONNEL.
Il ne s'était rien passé en août-septembre. Un timide
tract de la C.G.T. avait bien essayé, vers la mi-septembre,
de « poser la question des salaires » mais rien ne s'en était
suivi. Parmi le personnel on pouvait entendre ces réflexions:
« Qu'est-ce qu'ils attendent pour faire quelque chose, ils se
décideront quand ce sera fini ailleurs ».
Vers la mi-octobre les syndicats, cadres et employés de
toutes tendances, prirent des contacts avec la fédération pa-
tronale. La base reniuait, revendiquant l'augmentation de 5
à 10 % acquise dans tous les autres secteurs. Les employés sen-
taient que ça aurait pu être obtenu sans coup férir en sep-
tembre, avec un minimum de frais comme dans beaucoup
d'autres professions. Pour «« maintenir l'unité » la C.G.T., qui
rentrait cette fois carrément dans le circuit, acceptait les
revendications des autres syndicats : pas de salaire minimum
inférieur à 25.000 francs par mois, rétablissement de l'échelle
hiérarchique de 1947 (qui aboutissait à un sérieux étalement
de la hiérarchie).
Début novembre un « bulletin employé » fut diffusé
clandestinement dans l'entreprise à environ 80 exemplaires.
L'ex-secrétaire de la section C.G.T. l'avait rédigé et distribué
avec quelques employés sûrs. Le numéro I comportait une
prise de position abstentionniste aux élections de la Sécurité
Sociale et essayait d'expliquer le rôle réel des délégués syn-
dicaux: Ces positions et l'annonce d'une parution régulière
intriguèrent et inquiétèrent les délégués « en place ».
Sur leurs mots d'ordre et pour « vaincre la résistance des
patrons », les syndicats engagèrent les employés à « agir »;
mais les consignes données aux sections syndicales d'entre-
prise étaient des consignes d'extrême modération. Alors qu'on
citait à qui mieux mieux, les modèles de Saint-Nazaire pour
solliciter les revendications particulières, on se gardait bien
de parler de grève générale; les seules formes d'action con-
seillées par les syndicats était les formes sporadiques déjà
prônées en septembre, alliées à un verbalisme plus ou moins
violent: grèves tournantes par service, pétitions, délégations,
etc. La plupart des employés se rendaient compte que « cela
ne rimait à rien, qu'il fallait en mettre un bon coup ». Cette
41
action se développa fin novembre pour arriver dans la der-
nière semaine de' ce mois à une situation très confuse dans
laquelle les syndicats de l'entreprise n'avaient pratiquement
plus le contrôle du mouvement . Les services débrayaient à
toute heure du jour en avisant simplement l'un ou l'autre des
délégués. Ceux-ci en arrivaient à dire: « C'est de l'anarchie,
on ne sait plus où l'on va. » Aucune réunion du personnel
n'avait eu lieu, ni pour définir les buts de la grève, ni pour
former un comité de grève. Sous la pression des employés les
plus conscients, qui dans cette énorme fermentation se retrou-
vaient pour critiquer les syndicats, les délégués convoquèrent
une réunion du personnel : ils exposèrent d'une manière bien
terne ce que les syndicats disaient dans les tracts et invitèrent
les employés à les suivre. Il y avait dans l'exposé de nombreu-
ses allusions au « Bulletin Employé » et un appel à un rallie.
ment à un syndicat quel qu'il soit, « l'essentiel étant de suivre
un syndicat pour être défendu ».
Un seul employé prit la parole pour demander quelques
explications que le délégué C.F.T.C., le « leader » des délé-
gués, retourna facilement et l'interpellateur ne put que re-
pondre qu'il « enregistrait ».
En même temps, les délégués des syndicats essayaient de
canaliser le mouvement avec un pseudo-référendum ne com-
portant que deux questions: « Etes-vous pour des grèves tour-
nantes d'une heure ou pour un arrêt général d'une heure ? »
Une majorité peu nette se dégagea en faveur de cette dernière
forme d'action. De toute manière, posée dans de tels termes,
une consultation du personnel ne signifiait rien. Aussi la si-
tuation « anarchique » continua quelques jours; tout ce que
chacun constatait était que « ce n'était pas clair, que les chiffres
donnés changeaient d'un tract à l'autre », qu'on ne « savait
rien de ce qui se passait ».
Brusquement, le 29 novembre, les syndicats qui discutent
à l'échelon national avec la fédération patronale, annoncent
par tract commun que les dernières propositions patronales
(22.000 francs de salaire de base et une « recommandation »
de 5 %) peuvent être discutées. De l'exposé du tract et des
explications embarrassées des délégués, il apparaît que:
1° Les syndicats (pour terminer la grève) étaient prêts à
signer cet accord malgré toute la démagogie précédente (il
semblait
que cet accord existait depuis un certain temps), mais
que l'on avait attendu pour le révéler qu'une certaine « fati-
gue » des employés puisse le faire accepter.
2° A la faveur de ce mouvement, les syndicats et les pa-
trons faisaient passer une refonte et une unification du système
de rémunération. (1)
(1) La Fédération patronale, en faisant des propositions de ce genre,
restait fidèle à sa politique fixée depuis plusieurs années en vue d'une
anification des salaires de la profession et une simplification du système
42
3° Pour avoir l'air de tenir compte de la volonté des em-
ployés, il était organisé, dans toutes les sociétés d'assurances,
un référendum tambour battant pour ou contre la signature
(déjà décidée par les syndicats). La hâte manifestée permet
tait aux délégués d'entreprise des syndicats de raconter ce
qu'ils voulaient et de prévenir toute réaction des employés; le
vote organisé par entreprise donnait toute garantie sur le ré-
sultat final.
Le 30 novembre, dans la Compagnie, les commentaires
allaient leur train et chacun attendait avec impatience ia
réunion de 15 h. 30 à laquelle les délégués, encouragés par
la « bonne tenue » de la première réunion et poussés par la
base ne pouvaient se dérober. Un débrayage général d'une
heure prévu depuis la veille devait suivre de 16 à 17 heures.
A cette réunion, les délégués exposèrent les « nécessités
qui devaient hâter une prise de position pour permettre la
ratification de l'accord et posèrent les questions:
« Doit-on signer l'accord ? Non à main levée,
sauf deux ou trois.
« Doit-on continuer le mouvement ? » --- Qui à main
levée, sauf deux ou trois (1).
Et les délégués annonçèrent qu'ils allaient porter cette
réponse au meeting des responsables syndicaux d'entreprise
convoqué à 17 heures.
C'est alors que l'ancien secrétaire de la section C.G.T.
demanda la parole. En termes précis, il commença à déve-
lopper méthodiquement le rôle réel joué par les syndicats,
par les délégués dans ce mouvement en montrant, se fondant
sur de nombreuses citations de tracts et sur les démarches
récentes, qu'ils ne souciaient guère des employés.
Les employés présents (environ 400), d'abord un peu
stupéfaits, prirent alors violemment à partie les délégués qui
s'empêtraient dans leurs réponses quand ils ne restaient pas
silencieux. Le délégué C.F.T.C. trouva habile lors d'une in-
terruption de signaler : « je vous annonce qu'il est quatre heu-
))
de rémunération pour tenir compte des effets de la rationalisation sur
les catégories d'emplois.
Cette fois, un important pas était franchi; un salaire annuel était
défini comprenant la totalité des rémunérations perçues dans l'année
(primes, avantages individuels, etc...). Cela entraînait la suppression pra-
tique des « avantages individuels » et des avantages d'entreprise. Pour
atteindre le nouveau salaire de base, on diminuait ces avantages parti-
culiers de sorte que l'employé ayant des avantages voyait son total de
salaire rester le même, « l'augmentation » se traduisant seulement par des
déplacements de chiffres sur sa feuille de paie. De là la « recommanda-
tion » d'augmentation minimum de 5 % alors que le salaire de base
(coefficient 100) était augmenté de 17,64 %. L'acceptation par les syn-
dicats de ces propositions patronales, en même temps qu'ils réclamaient à
cor et à cri dans leurs tracts « le retour à la classification de 1947 >
marquait bien leur duplicité.
(1) Quelques employés expliquèrent par la suite leur refus de la
grève par leur méfiance extrême des syndicats et des formes d'action pro-
posées par eux, formes qui ne conduisaient à rien.
***
43
res » voulant dire par là qu'il fallait retourner dans les bu-
reaux pour faire grève comme convenu. . Cette remarque fut
saluée
par
les huées. Celles-ci alternaient avec les acclamations
enthousiastes, les rires, dans une atmosphère quasi-délirante,
jamais vue à la Compagnie et assez extraordinaire chez les
employés. Cela dura plus de trois quarts d'heure.
Aucune décision ne fut prise. Il n'y avait aucune pers-
pective immédiate puisque les syndicats signaient. Continuer
la grève n'avait aucun sens. Beaucoup d'employés sentaient
que quelque chose venait de se passer. Certains cherchaient å
manifester leur accord tout de suite, à l'ancien. secrétaire
C.G.T., par des prévenances, par un sourire, par une poignée
de mains parfois accompagnée d'un simple « merci », par une
remarque c'est bien ». Un des délégués C.F.T.C. démis-
sionnaire lui déclara: « J'avais un papier dans ma poche, j'étais
prêt à intervenir si tu ne l'avais pas fait ». C'étaient surtout
les employés les plus simples et les plus mal payés qui expri-
maient leur approbation. (2)
Dans la soirée et le lendemain, un certain nombre d'em-
ployés vinrent voir l'ex-secrétaire de la section C.G.T. en in-
sistant sur le fait « qu'il fallait faire quelque chose ». C'était
manifestement l'opinion de tous. L'agitation était à son
maximum.
Vingt employés se réunirent et une proclamation fut ré-
digée en commun, conviant le personnel à une réunion le jeudi
7 décembre au Théâtre Grammont (1).
Le tract fut rédigé en commun d'après une règle toujours
suivie depuis pour chaque papier ou bulletin: une première ré-
(2) Le mouvement pour les salaires était d'ailleurs pratiquement
terminé. Comme prévu, le meeting des responsables syndicaux d'entreprise
se traduisit par un vote de confiance aux directions syndicales pour la
signature.
Pourtant le vote fut acquis de justesse (quelques centaines de voix)
malgré tous les artifices utilisés (vote par bureaux dans certaines Compa-
gnies sans réunions du personnel, appels et discours de responsables sans
contradiction).
La signature fut effective le 30 novembre, à minuit (un des argu-
ments pour la signature était passé ce délai, nous perdons l'augmenta-
tion de novembre »); les syndicats l'annoncèrent par tracts en renvoyant
les employés à se défendre séparément sur le plan des Compagnies pour
« améliorer l'accord »; en fait, à part deux ou trois sociétés, l'accord
patronal fut appliqué strictement (l'augmentation moyenne étant celle des
autres secteurs, de 5 à 7 %).
La C.G.T.-Assurances éprouva d'ailleurs le besoin pour calmer les
mécontents, d'expliquer dans un tract séparé, que « sa signature n'était
pas un accord ).
(1) Parmi les vingt employés, qui tinrent cette première réunion, dix
appartenaient à des services de la « chaîne de travail », sept à des ser-
vices en voie de transformation, deux étaient des garçons, un sous-chef,
quatre étaient des femmes, quatorze avaient appartenu à un syndicat au
cours des deux dernières années (deux C.F.T.C., le reste C.G.T.), six
étaient non-syndiqués, neuf avaient 30 ans ou moins, six étaient des
« anciens » entrés avant 1939.
daction circule entre les vingt qui apportent souvent des modi-
fications (2). Dans le cas présent, deux questions se posaient :
En premier lieu, l'appel au meeting de Grammont serait-il
signé? Tous répondirent sans hésiter « qu'il fallait prendre ses
responsabilités », (certains employés protestèrent même après,
parce que leur nom n'avait pas figuré). Et en second lieu, qui
supporterait les frais ? Tous furent d'accord pour dire qu'il ne
fallait « rien demander à personne », que « nous seuls devions
payer ».
En cinq minutes, les participants trouvèrent l'argent né-
cessaire pour tirer le tract et louer la salle (plus de 12.000 fr.).
Restait à fixer ce qui serait fait à la réunion du personnel:
il fallait de toute évidence tenter un regroupement dans une
organisation « qui ne soit pas un syndicat ».
Les tendances qui se dégageaient des discussions de tous
fixèrent les principes de base de cette organisation:
1° En toute chose concernant les salariés de l'entre-
prise, aucune décision ne devait être prise, aucune démarche
ne devait être faite, sans l'accord préalable de tous les em-
ployés intéressés.
Poser cette règle équivalait à se référer constamment à la
base et à considérer que toute idée, exprimée par un respon-
sable, un délégué ou un simple employé devrait être retenue en
tant que suggestion mais ne pouvait être exprimée par l'orga-
nisation et entraîner une démarche ou une action quelconque
que
si elle avait l'accord de tous.
Cette pratique était exactement l'inverse de celle des syn-
dicats. Ou bien ils donnent des ordres en tant que « direc-
tion », ou bien ils pratiquent une caricature de démocratie
qui consiste à faire choisir entre deux solutions posées par
eux. Comme l'exprimait récemment la C.G.T. dans un tract:
<< Moyens d'action: participation du personnel à des
mouvements ou actions orientées par nos syndicats, mais
décidées par les travailleurs eux-mêmes » (c'est le tract
lui-même qui soulignait).
Comme principe de base de la future organisation, l
était au contraire posé que les employés devaient définir eux-
même l'orientation.
2° Les « fonctions » de délégués devaient être ramenées à
leur juste mesure: celle de porte-parole de la volonté des sa-
lariés. Cela comportait deux conséquences:
a) Le maintien de la solidarité entre les délégués et les
travailleurs; pas de réunion pendant les heures de
travail; le délégué doit avoir la confiance des em-
ployés de son bureau; pas d'utilisation des « heu-
res » de délégués; pas de permanent; le délégué est
et reste un employé qui ne doit profiter d'au-
cune faveur légale ou patronale. Il doit rester soli-
daire des autres travailleurs de l'entreprise.
........
(2) Voir le texte de ce tract en Annexe I.
45
6) Le contrôle des employés sur l'activité des délégués
avec comme règles:
- pas de démarches séparées à la Direction;
démission si les employés de son bureau cessent
de lui faire confiance;
des comptes-rendus largement diffusés de toutes
les démarches et réunions.
3º La future organisation ne se lierait à aucune autre orga-
nisation ou parti; ceci étant un peu le corollaire des positions
définies au premier paragraphe.
Deux camarades rédigèrent un projet de statut pendant
le week-end, qui fut lu et corrigé par les vingt qui lançaient
l'appel. Ce projet modifié devait être soumis aux employés qui
viendraient à la réunion, s'ils étaient d'accord pour un regrou-
pement. Le projet de statųt tel qu'il était établi, essayait de
répondre le plus largement possible aux tendances manifes-
tées: c'était évidemment la pratique qui devait tout rôder.
Une autre question se posa: laisserait-on les organisa-
tions syndicales venir troubler la réunion?
On décida que celle-ci étant destinée aux employés de
l'entreprise, tous les employés, y compris les délégués pour-
raient y assister et prendre la parole, mais qu'aucun bureau-
crate « de l'extérieur » ne pourrait entrer.
La réunion se déroula sans incidents. Il y vint de 130
à 150 personnes. (1)
L'accord se fit pour un « regroupement ».
Les statuts étaient approuvés. Quelques « délégués » de
l'extérieur envoyés par la C.G.T. et la C.F.T.C. essayèrent
d'entrer en cours de réunion. La porte leur fut fermée, non
sans discussions violentes où les présents furent traités de
« sociaux-démocrates » et « vendus au patron ».
Le Conseil du Personnel était formé. (2)
Les statuts furent déposés. L'organisation était consti-
tuée. Pendant deux mois les réunions se succédèrent entre
les vingt, en dehors du travail, une fois, deux fois par
semaine; tous prenaient part aux discussions sur l'orientation
du Conseil, sur l'activité, sur le Bulletin employé.
1° L'organisation, telle qu'elle était fixée par les statuts,
ne fut pas mise en place. Il ne venait à l'esprit de personne de
.
(1) C'était un chiffre important pour une réunion tenue en dehors
des heures de travail, le soir, et pour un personnel comprenant beaucoup
de femmes et de banlieusards; un nombre relativement important d'em.
ployés s'était d'ailleurs, chose inusitée, fait excuser. Indiquons en outre
qu'il avait été à peine nécessaire d'organiser cette assemblée. Les plus
actifs, parmi les vingt camarades dont nous avons parlé, firent d'eux.
mêmes le contrôle à l'entrée. D'autre part, il n'y eut aucune propagande
dans l'entreprise pour persuader les employés d'assister à la réunion,
chacun devant rester libre de sa démarche. Les délégués des syndicats, en
revanche, n'observèrent pas la même réserve: ils firent courir les bruits
les plus divers, mêlèrent les menaces aux plaisanteries et assurèrent qu'on
ferait payer la salle par les assistants.
(2) Voir les statuts en annexe.
46
ne pas présenter de candidats aux élections de délégués du
personnel. En demandant aux employés de voter blanc au
premier tour, on pourrait mesurer la force du mouvement
anti-syndical parmi les employés. Mais l'essentiel de la lutte
n'était pas dans ces candidatures ou dans une « organisa-
tion »; l'essentiel était de poursuivre inlassablement le travail
d'explications, d'informations, le travail de démystification
tant vis-à-vis du patron que des syndicats.
2° Aucune « campagne de recrutement » ne fut orga-
nisée. On pensait « Il vallait mieux aller lentement »; des
cartes provisoires furent simplement données à ceux qui le
demandaient.
3° Un bulletin d'entreprise devait paraître chaque mois;
il continuait le Bulletin employé dont un numéro était paru
avant les grèves. La rédaction et la mise au point étaient
collectives selon les mêmes règles qui avaient été fixées tout
au début.
Les syndicats n'avaient pas réagi: ils déclaraient à tout
venant que « c'était un feu de paille », que « ça ne durerait
pas »; le patron manifestait son hostilité, pas trop ouverte-
ment parce que ç'aurait été donner des armes au Conseil et
qu'il était tout prêt aussi à croire que « ça ne durerait pas ».
Tous faisaient l'union pour qualifier le mouvement de « pou-
jadiste ». Qu'y pouvaient-ils d'ailleurs comprendre? Un
bureaucrate syndical ou patronal joue son rôle en toute cons-
cience dans son univers propre, inaccessible à celui des gens
qu'il « commande » a guide » à'une manière ou d'une
autre.
Les délégués avaient d'aileurs « en secret », sans com-
prendre la leçon du 30 novembre, passé des accords avec le
patron sur les salaires: les employés voyaient leurs salaires
mensuels majorés de 17,64 % par application des minima
fixés par les syndicats et la Fédération patronale. Mais l'in-
certitude subsistait quant à certaines primes à toucher en 1956
qui pouvaient être supprimées et faire ainsi baisser le pour-
centage d'augmentation.
Cette position était une première victoire due à l'agita-
tion du personnel. Toutes les autres Compagnies avaient
obtenu 5 % au maximum 7 ou 8 %. Nous tenions 17,64 %
provisoirement. Le sens de la lutte pour les salaires était
clair : faire l'impossible pour « toucher les primes » pour que
ce pourcentage ne baisse pas trop.
Mais cette lutte, toute importante qu'elle fût, n'était pas
essentielle. C'est la lutte contre toutes les formes d'exploita-
tion, qui reste au centre de la vie du salarié. Le Bulletin
employé et les discussions dans les réunions portaient autant
sur cette lutte que sur les salaires. D'autre part le Bulletin
essayait de toucher tous les employés: il devait être adressé
aux employés de province (au nombre de 135).
ou
47
G.
LES ELECTIONS DE DELEGUES ET LA MISE
EN PLACE DU CONSEIL DU PERSONNEL.
Il serait bien fastidieux d'exposer minutieusement tout
ce qui fut fait au moment des élections et après. Tout sembla
se dérouler suivant un ordre sans hiatus, comme quelque chose
depuis longtemps mûri.
Pourtant les membres du Conseil du Personnel ne pen-
saient pas eux-mêmes que
leur mouvement allait atteindre tant
d'ampleur. De même que les syndicats ne pensaient pas me-
surer aussi brutalement la faiblesse de leur influence.
Chronologiquement les faits se déroulèrent ainsi:
7-8 février: tract du Conseil appelant les employés à voter
blanc et leur annonçant comment il fallait voter blanc et com-
ment ils seraient appelés à désigner des candidats s'il y avait
une majorité de bulletins blancs.
Même appel aux employés de province.
Tracts C.F.T.C. et F.O. contenant des attaques person-
nelles et s'efforçant de vanter les « bienfaits des syndicats ».
Pas de tract C.G.T.
Il faut imaginer ce que représentait le fait de demander
aux gens de voter blanc.
Peu d'employés (et peu de salariés) connaissent le mé-
canisme des élections de délégués du personnel et de délégués
au Comité d'Entreprise. En fait, ces lois votées en 1945-46
à une époque où les deux syndicats (C.F.T.C. et C.G.T.) et
les trois partis (M.R.P., S.F.I.O., P.C.) essayaient d'asseoir
leur puissance, sont des lois de protection des syndicats et de
leur bureaucratisme contre les travailleurs alors qu'elles ont
toujours été présentées comme une protection contre les pa-
trons. La procédure complexe des élections vise à décourager
les candidatures extra-syndicales et à assurer aux « têtes »,
permanents de chaque entreprise, une réélection même si leur
impopularité leur fait obtenir un nombre plus faible de voix
que le dernier des colistiers.
Au premier tour des élections, seuls les candidats des
syndicats « représentatifs » peuvent se présenter. Mais si les
suffrages exprimés, non compris les bulletins blancs ou nuls,
n'atteignent pas la moitié des électeurs inscrits, le premier tour
est nul et tout le monde peut se présenter au second tour.
Donner la consigne de voter blanc n'était pas une petite
tâche. Il fallait expliquer la nécessité du vote blanc, aussi bien
aux employés du Siège qu'en province. Même si en novembre,
dans un moment de colère ou d'enthousiasme, des employés
pouvaient dire « je ne voterai pas pour eux » (les syndicats),
qu'en serait-il trois mois après ? Même les plus optimistes,
parmi les membres les plus actifs du Conseil du Personnel,
n'osaient espérer un succès. D'autant plus que les syndicats ct
la Direction affichaient un superbe mépris pour cette aventure
sans importance « qui ne durerait pas ».
48
10 février: Premier tour des élections de délégués. Vote:
inscrits: 596; votants: 500. Bulletins blancs: 193; nuls: 41;
syndicats: 266.
Du 10 au 23 février : le patron est « extrêmement mécon-
tent ».
« Je regrette la bonne équipe ». Il manquvre sur la
fixation de la date du second tour. Une assemblée de tout le
personnel réunit près de 250 personnes et le Conseil demande
de désigner leurs « délégués de bureau ». C'est fait en une
après-midi et le lendemain les employés choisissent les douze
candidats délégués par référendum sur la liste des trente-
huit délégués de bureau. Les syndicats se déchaînent: tract
commun des « trois syndicats reconnaissant que cette divi-
sion toute interne qu'elle soit, dépasserait bientôt le cadre de
la Compagnie si elle devait être effective », trouvant « l'es-
sentiel du problème » dans le fait que « les leaders en sont des
agents de maîtrise » et cherchant à justifier l'attitude des
délégués dans l'entreprise.
Puis paraissent deux tracts F.O. et C.F.T.C. excessive-
ment.violents, allant du mouchardage individuel à la divul-
gation de secrets personnels. Une réunion convoquée in
extremis (affiche apposée à 14 heures sous l'étiquette C.G.T.
pour le soir) attire une trentaine d'employés, en majorité les
bureaux des sections syndicales». Il est vraisemblable que
les organisateurs s'étaient arrangés pour ne pas réunir tout le
personnel, conscients que leurs calomnies auraient été alors
impossibles. Les secrétaires nationaux de chaque syndicat
étaient « descendus », chose que jamais ils n'avaient faite
auparavant. Il n'y eut aucune discussion sur le fond, mais des
injures et des rodomontades sur « l'efficacité », les « 'con-
quêtes » des syndicats. Nous étions des « poujadistes », des
« vendus au patron », des « hitlériens ». L'ex-secrétaire de la
section C.G.T. répondit en reprenant les contradictions les
plus flagrantes des syndicats, mais fut violemment pris à
partie par le secrétaire national de l'assurance C.G.T. à pro-
pos de l'attitude de la C.G. T. et du P.C. en 1936 et en 1945.
La réunion finit dans la confusion la plus complète. Il ne
pouvait en être autrement.
23 février: second tour des élections de délégués. Ins-
crits: 596; votants: 541; blanc: 1; nuls: 9. Conseil du Per-
sonnel: 258 voix; Syndicats (3 listes) 246 voix.
Il y eut 3 délégués pour le Conseil, 2 pour la C.F.T.C.,
I pour F.O., la C.G.T. perdant son siège. Passées les élec-
tions, la C.G.T. sortit un tract de « mise au point » atta-
quant uniquement l'ex-secrétaire de la section, allant jusqu'à
écrire que « l'assassinat est l'idéologie révolutionnaire dont il
se nourrit »).
19
H.
LE FONCTIONNEMENT
DU CONSEIL DU PERSONNEL.
Une organisation vaut ce qu'elle vaut. Les meilleurs sché-
mas sur le papier ne sont rien si les « militants » (les vrais) ne
cherchent pas à maintenir la ligne directrice fixée au départ.
Mais eux-mêmes ne seraient rien d'autres qu'eux seuls si cette
ligne ne consistait à s'effacer constamment devant la masse
des employés, à rester avec la base. Le meilleur contrôle pour
éviter que le Conseil reste dans « la bonne voie » n'est pas
dans l'application stricte de principes mais dans une sorte
de fonctionnement spontané qui s'exprime plus par des initia-
tives non commandées que par des présences à des réunions
ou des affirmations répétées « d'accord »: les employés ne
s'expriment que lorsqu'ils ont besoin de s'exprimer, parce que
pratiquement cela leur apparaît nécessaire. Les prises de posi-
tion théoriques ne les intéressent pas.
Comme l'exprimait un employé « il faut dire des choses
simples ». Dès le départ, le Conseil, dans tout, s'est efforcé
de dire des choses simples, non pas seulement simples dans
le langage, mais simples parce qu'elles n'essayaient pas de
théoriser mais de prendre les cas concrets et de les expliquer
en termes de lutte de classe accessibles à tous,
« Dire des choses simples », cela clarifie immédiatement
la situation. La formation du Conseil a pratiquement fait
éclater tous les syndicats. Deux blocs existent maintenant:
« syndiqués » et « membres du Conseil ». Bien sûr, un nombre
important d’employés suivent encore les syndicats. Mais il
faut tenir compte de l'incroyable réseau d'intérêts que les
bureaucraties syndicales ont pu tisser dans des entreprises
nationalisées. Les employés qui espèrent décrocher une place,
ceux qui agissent et pensent comme s'ils étaient titulaires d'une
place de cadre, ceux à qui le cadre a promis « quelque chose »
et qui y croient, sont en général dans les syndicats, c'est-à-
dire dans le syndicat qui est le plus conforme à leur intérêt
(celui du cadre, celui du délégué le plus influent, celui le plus
en faveur auprès de la Direction). La facilité avec laquelle
les syndiqués de la C.G.T., eux-mêmes, acceptent « l'union
des syndicats » pratiquement derrire la C.F.T.C. confirme
que cette notion d'intérêt est la base de la « confiance » main-
tenue au syndicat. Les réactions spontanées des employés
vont bien dans ce sens. Un extraordinaire bouillonnement de
discussions révèle que la formation du Conseil a permis à
beaucoup d'employés de « se libérer » en exprimant tout ce
qu'ils avaient l'habitude de taire et de refouler dans les syn-
dicats. Dans les positions simples de lutte de classe, les
employés les plus conscients ont retrouvé la ligne directrice
qu'ils cherchaient dans le noir, se heurtant au cloisonnement
des Directions patronales ou syndicales.
En réponse à un questionnaire un employé écrivit:
« ils (le Conseil) osent dire ce que beaucoup cachent ou pen-
.
50
sent. » Un autre exprimait sa prise de conscience, maintenant
qu'il avait. « pris position », en déclarant: « il n'y a qu'en
bossant avec les gens qu'on s'aperçoit de ce qu'ils valent ».
Mais cette espèce de proclamation, rédigée peu de temps
après les élections, traduit au mieux le sens de la réaction de
tous les employés:
CE QUE NOUS VOULONS:
« Nous voulons:
que la délégation soit un acte de dévouement à la
cause commune du Personnel et non une sinécure
pour quelques-uns.
que les délégués soient aux ordres du Personnel et
non redevables envers la Direction.
que les discussions aient lieu en dehors des heures
de service, car il est inadmissible que les collègues
de ces « messieurs » se voient dans l'obligation con-
tinuelle d'effectuer leur travail et que leurs chefs ne
puissent les compter au nombre de leurs employés
que lorsqu'il s'agit de leur attribuer des augmenta-
tions, méritées par ceux qui les remplacent à lon-
gueur d'année.
qu'en aucun cas un délégué ne puisse se rendre seul
chez des Messieurs de la Direction. La justice pour
tous, délégués ou non, est que cesse le règne du
favoritisme, et des « petits copains ».
l'uniformité de la prime de vacances; elle doit être
la même pour tous employés ou cadres, car si tou-
tefois cette prime devait être hiérarchisée elle devrait
l'être en sens inverse...
que dans notre compagnie règne l'ordre, la justice, la
propreté et l'union, tout ce qui est en somme con-
traire à ce que désirent les syndicats et leurs délé-
gués, qui ne trouvent leur force que dans la dés-
union et le mécontentement. »
Cette vie réelle d'une organisation, que nous évoquions,
est la traduction dans les faits, de ces constatations. Un
observateur extérieur pourrait dire que les employés « pren-
nent leur rôle au sérieux » mais la vérité est qu'ils ne jouent
pas de rôle. Le Conseil du Personnel doit s'identifier à la vie
même des salariés dans l'entreprise; autrement il en résultera
un décalage qui sera la mort de l'organisation. S'il existe un
décalage, c'est plutôt dans le sens de la réalité qui va plus
loin que la théorie.
Le « sérieux » des employés, il fut frappant lors de l'as-
semblée qui précéda la désignation des délégués de bureau
pendant les élections. Il est difficile de décrire l'atmosphère
d'une salle, mais elle était totalement différente de celle de
la réunion un peu délirante du 30 novembre. C'est souvent
51
1
une impression de maturité, de réflexion, qui se dégage de
ces réunions, sans doute parce que ce qui y est dit correspond
à ce que les employés pensent ou ont pensé. Parce qu'aucune
ombre, aucune arrière-pensée n'existe et qu'ils se sentent « en
confiance ». D'ailleurs, sauf en période de grève, de telles
réunions sont espacées: les communications et l'élaboration
se fait aussi sûrement par une sorte d'osmose, par la voie des
discussions de bureau.
Il semble que l'institution des délégués de bureau assure
en période « calme » plus que des réunions du personnel le
rôle d'informations, d'explications, d'échanges nécessaires.
Dans le bureau, ces délégués de bureau savent tout ce que le
Conseil doit savoir, aussi bien sur la marche de l'entreprise et
les démarches des délégués du personnel, que sur la vie du
bureau dont ils sont un des membres.
Les réunions du Comité de Gestion (Comité responsable
du Conseil) sont exactement l'inverse des réunions syndi-
cales habituelles ; elles se sont tenues jusqu'ici chaque semaine.
Quinze à trente personnes y asistent régulièrement; tantôt
l'un, tantôt l'autre, selon ce que chacun pense avoir à dire.
Certains y assistent régulièrement (noyau d'une dizaine).
Ceux qui « suivent » le plus, semblent être ceux qui n'ont pas
fait l'expérience des syndicats parce qu'ils étaient très mé-
fiants vis-à-vis d'eux. Les discussions sont très animées. Tous
les sujets peuvent être discutés. Les « responsables » n'ont la
parole qu'en dernier lieu. Chaque employé présent dit d'abord
ce qu'il a à dire. L'expérience apprend que le fait le plus insi-
gnifiant en apparence peut être le plus significatif et être
retenu pour un article du Bulletin ou entraîner une explica-
tion fructueuse pour tous. Ce qui est dit va des « ragots de
couloir » aux incidents de bureaux, cas personnel aux in-
formations de la Direction.
Les choses plus sérieuses » (préparation des réunions
de délégués, questions pratiques, etc...) sont traitées ensuite
également par discussion.
L'élaboration du Bulletin employé est significative à ce
sujet. Les articles n'ont été écrits au départ que par un seul
militant; celui-ci composait de simples projets qui, avant
d'être publiés, circulaient à trente exemplaires afin d'être dis-
cutés et réformés par le Comité de Gestion. Maintenant trois
employés participent régulièrement à sa rédaction ; les articles
sont toujours discutés de la même manière; et, comme on peut
le penser, la discussion les loin d'être de pure forme.
Les idées d'articles viennent de partout; « Tu devrais
mettre cet écho dans le journal », dit l'un; l'autre juge « il
vaut mieux parler d'autre chose. » Les observations sont
fréquentes sur la présentation, sur la périodicité, sur le for-
mat. Toutes les remarques, tant sur la forme que sur le fond,
témoignent du souci d'assurer le maximum d'effet, compte
tenu de la mentalité des employés: « Ton article sur l'augmen-
tation de la vie n'est pas mal, mais il faudrait le présenter
52
-, *** i **** in***
autrement, par exemple parler de ce qui intéresse la boîte »
« Les attaques personnelles ne sont pas intéressantes »).
Après la publication d'un numéro, une discussion a lieu
sur les échos qu'il a rencontrés; chacun raconte ce qu'il a
entendu ou vu faire: « ça me fait mal au ventre de voir cer-
tains le mettre au panier », dit l'un. Les remarques les plus
significatives viennent non pas tant d'employés mais des mi-
litants de syndicats ou des cadres.
Le Bulletin employé est un organe d'explication et de
discussion; ses sujets sont plus particulièrement ceux qui inté-
ressent tous les employés, soit par leur nature, soit
par
leur
valeur d'exemple.
Mais il y a aussi une tâche d'information qui doit jouer
dans les deux sens: le Conseil doit informer les employés de
tout ce qu'il peut savoir de l'entreprise; il doit se renseigner
pour savoir à chaque moment ce que pensent tous les em-
ployés. Toutes les réunions avec la Direction, les réunions du
Comité de Gestion, toute démarche, font l'objet de comptes
rendus très détaillés avec commentaires, qui sont ronéotypés,
affichés et mis en circulation auprès des délégués pour com-
munication à tous les employés; l'expérience a montré qu'ils
étaient attendus et suivis. Lors des réunions du Comité de
Gestion, chaque employé présent a la parole avant tout res-
ponsable pour communiquer à tous ce qu'il croit utile de dire
sur n'importe quel sujet touchant l'entreprise; cette règle sem-
ble avoir libéré beaucoup d'une sorte de timidité et les réunions
sont devenues beaucoup plus vivantes. Pour les questions
importantes, circulent des questionnaires destinés à faire
préciser aux employés ce qu'ils pensent. Le premier de ces
questionnaires fut très large; les autres roulaient sur les ques-
tions plus particulières. Ils visent aussi à habituer les em-
ployés à réfléchir sur leurs conditions de travail et sur l'en-
treprise. L'important est de leur donner tous les éléments
nécessaires pour leur permettre de formuler un jugement en
toute connaissance de cause.
Les employés veillent d'ailleurs avec un soin jaloux à être
exactement informés; iis ne pardonneraient pas une tentative
quelconque de déformer ou de cacher la vérité; cela serait
irrémédiablement le point de départ d'une méfiance compa-
Table à celle dont ils font preuve à l'égard des syndicats.
Chaque rencontre motive des i qu'est-ce qu'il y a de nou-
veau? » pleins de sous-entendus. Si un compte rendu a un
peu de retard: « Il faut faire un papier. »» « Vous n'avez pas
parlé de cela. » Et il faut une explication.
Mais ce contrôle n'est pour eux que la contrepartie d'une
activité spontanée. A partir du moment où le Conseil est leur,
ils le défendent et prennent des initiatives localisées. Un
compte rendu est-il arraché d'un panneau, un employé en
colle un autre à même le panneau; un autre colle une étiquette
disant: « Nous en avons encore cinquante »; un troisième met
53
une coupure d'article sur l'affichage libre, sur les panneaux
syndicaux.
Les faits et gestes des délégués des syndicats sont
rapportés fidèlement. La collecte des fonds chaque mois
s'effectue sans hiatus bien que sans ordres; on est loin de la
lourde machine des timbres, collecteurs, carnets de pointage
des syndicats. Une employée apporte 1.000 francs en une
seule fois bien que son salaire soit modeste et demande l'ano-
nymat; une autre employée propose ce qu'elle peut pour aider,
faire des enveloppes chez elle sur son temps de repos; c'est la
même employée qui transmet un article de journal, pensant
« qu'il peut être utile ». Pourtant, c'est une employée âgée,
très simple, mise à l'écart pour faire un travail d'ordre et qui
n'a jamais été d'aucun syndicat. D'autres soulèvent dans leur
bureau des critiques, des discussions et font sans le vouloir
souvent le travail de vrais militants, parce qu'ils se sentent
plus forts. Peut-être retomberont-ils dans la passivité, mais
d'autres se relèveront, car c'est la situation objective dans
l'entreprise qui les pousse à s'exprimer et cette situation est
en pleine évolution. C'est parce qu'ils savent que le Conseil
travaille pour eux que les employés ont confiance. Les plus
conscients savent que, quoi qu'il arrive, ils n'abandonneront
pas et qu'ils poursuivront leur travail autour du Bulletin.
Le principal écueil est plus dans le bloc des syndicats,
qui trouve une aide indirecte dans l'attitude patronale, que
dans la masse des employés non évolués. Ce faisceau d'inté-
rêts dont il a été parlé explique par exemple l'attitude d'un
employé qui avait participé à la sortie, semi-clandestine, du
premier numéro du Bulletin employé et qui, du jour où tout
se fit au grand jour, refusa de suivre et rallia son syndicat
(son chef de service est du même syndicat et lui a. promis
une nomination d'AM3); et pourtant, c'est le même employé
qui critique toujours ceux « qui donnent des ordres et qui
décident de tout sans connaître le travail... »).
Un autre employé qui, au départ, paraissait s'associer
au mouvement fit savoir ensuite qu'il « ne marchait plus »
(son chef de service est aussi du même syndicat et l'employé
se trouve dans une situation financière délicate parce qu'il
re fait construire ». Un tout jeune avait spontanément, sans
que personne lui demande rien, organisé tout un service de
la manière la plus parfaite; l'organisation est restée; lui, nou-
vel employé non titularisé, a fait l'objet de pressions patro-
nales et syndicales qui l'ont amené à abandonner le Conseil
en disant « qu'il avait compris ». D'autres employés restés
dans un syndicat et même candidats aux élections de délégués
sur la liste syndicale, affirment en aparté leur solidarité avec
le Conseil et lui apportent leur suffrages.
Les délégués des syndicats n'ont d'ailleurs rien modifié
de leur attitude; leur conception du syndicalisme et de leur
rôle de défenseurs est tellement inhérente à leur incompréhen-
54
1
sion des rapports de travail qu'ils ne saisissent même pas ce
que dit le Conseil. Ils ne voient en lui qu'une nouvelle orga-
nisation qui tente de prendre les places auxquelles ils s'accro-
chent désespérément. Ils continuent à tenir le même rôle
d'auxiliaires du patron, à tout faire en secret, s'associant au
paternalisme le plus grossier et acceptant les manifestations
i d'amitié » du patron. D'ailleurs, même à supposer qu'ils
soient habiles, l'industrialisation qui se poursuit ne peut
qu'accentuer les contradictions qui leur ont coûté si cher. Pris
à leur « rôle », la vue même de ce qui se passe réellement dans
l'entreprise leur échappe; ils vivent à la petite semaine, avec
le « programme, lointain et bien abstrait du syndicat comme
référence, à l'occasion. Sous cet angle, il n'y a pas, semble-t-il,
de revirement à craindre parmi les employés. Sans doute lez
délégués des syndicats pourront-ils détacher les hésitants;
sans doute, certains ambitieux déçus qui ont cru miser sur le
Conseil passeront-ils de « l'autre côté ». Mais il s'agira de cas
isolés, car le Conseil n'est pas extérieur aux travailleurs; il
est les travailleurs eux-mêmes.
Il est difficile de définir précisément quelles sont les caté-
gories d'employés qui suivent le Conseil; ceux qui y sont
hostiles, ce sont ceux qui ont un intérêt plus ou moins lointain
à rester dans le syndicat, les employés des vieux services non
encore transformés ou des services de jeunes nouvellement
recrutés (par exemple le central dactylographique); ce sont
par contre ceux qui ont fait l'expérience des syndicats, les
employés d'un certain âge, ceux qui n'ont plus d'espoir ou
ceux qui se trouvent soumis, le plus directement, aux nou-
velles cadences de travail qui tendent à considérer que le
Conseil exprime ce qu'ils pensent. Ce qui est certain, c'est qu'il
y a déjà un noyau de dix employés très conscients et très
actifs, et une centaine d'employés qui ont bien compris ce
qu'était
le Conseil.
1.
- LES PERSPECTIVIES DU CONSEIL.
Au sein de l'entreprise, la seule perspective est la recher-
che constante de cette identification entre les employés et le
Conseil.
La désaffection de la classe ouvrière vis-à-vis des syndi-
cats, ce découragement et cette passivité dont parlent sou-
vent les délégués syndicaux vient du décalage entre les Di.
rections (qui n'épousent les revendications ouvrières que dans
l'intérêt de leurs organisations) et les salariés (qui ne com-
prennent pas les positions des syndicats parce qu'elles ne coïn-
cident que rarement avec leurs intérêts).
Il est certain que les membres les plus actifs du Conseil
ont des idées sur le système social; mais ils ne cherchent pas
à les imposer. Car les employés, comme tous les salariés, ont
aussi des idées sur leur travail, sur l'entreprise (des idées
55
partielles car elles ont pour support une expérience concrète
limitée).
Le rôle du Conseil du Personnel et de ceux qui l'animent
est de parvenir à provoquer un échange, à faire saisir entiè-
rement au plus grand nombre de salariés le sens réel de leur
travail, de les amener à penser leur expérience en termes plus
généraux de lutte de classe et à la relier à tout le système
d'exploitation. C'est un travail de longue patience car il n'est
pas possible de pousser plus vite que la réalité objective ne
progresse. S'il existe dans l'entreprise un noyau conscient,
une majorité est et peut rester longtemps encore dans des
situations intermédiaires ambigues, n'évoluant que
lentement.
La tâche est immense, car les rivalités des syndicats, leur né-
gligence volontaire d'une formation des employés, font que
ceux-ci ont souvent à apprendre les notions les plus élémen-
taires de lutte. Non pas dans des brochures ou en se faisant
catéchiser, mais à travers des explications de ce qu'ils sentent
de leur situation de salariés et de leur expérience personnelle.
Même si le Conseil se réduisait au groupe d'employés les
plus conscients, le plus important serait qu'il puisse poursuivre
ce travail d'explication. Et cela, ceux qui ont formé le Conseil
le savent. Dans cette voie, il n'y a pas d'échecs, il n'y a pas
de découragement ; il y a simplement de la persévérance et
l'abandon de l'idée habituelle des syndicats qu'il faut con-
quérir quelque chose pour l'Organisation. On ne conquiert
rien dans la classe ouvrière, on lutte et les perspectives de
lutte apparaissent au fur et à mesure de cette lutte, l'élargis-
sement de l'action se fait naturellement au cours de cette
lutte.
La première tâche fut d'annoncer dans l’Assurance
l'existence de cette expérience; en avril, un tract imprimé (1)
fut distribué à 10.000 exemplaires aux portes des plus gran-
des Compagnies d'Assurances. Le résultat immédiat fut l'éta-
blissement de liaisons dans cinq importantes Compagnies, avec
la perspective de pouvoir y faire un travail d'explication iden-
tique à celui poursuivi dans l'entreprise. Le but n'est pas tant
de provoquer la formation de Conseils du Personnel dans
chaque entreprise, que celle de noyaux actifs, chacun adaptant
son action aux nécessités propres de l'entreprise et à l'état
d'évolution des employés.
Les contacts entre tous ces noyaux sont nécessaires, non
sous le signe d'une Direction, mais sous celui d'un échange
de discussions, d'une harmonisation des points de vue et d'une
solution commune des questions matérielles (impression et
distribution de tracts, documentation), chaque groupe d'entre-
prise gardant son autonomie et restant toujours juge de ce
qui doit se faire dans son entreprise. On pourrait aussi
s'orienter vers une sorte de Fédération, chaque groupe d'en-
(1) Voir le texte de ce tract en Annexe III.
56
nous sommes
treprise gardant son autonomie propre, tout ce qui viendrait
de l'extérieur devant se soumettre au contrôle absolu des
employés de l'entreprise.
En tout, il s'agit à la fois de suivre et de guider et ja-
mais de diriger. Ce qui marque à notre avis que
dans la bonne voie c'est cette sympathie, cette solidarité des
gens simples, de ceux que les délégués des syndicats disent
indéfendables, de ceux qui n'ont plus rien à espérer, de tous
ceux qui sentent que le travail dans une entreprise capitaliste
a écrasé leur jeunesse, leur vie et les a laissés plus ou moins
désemparés. Il n'est pas de geste plus symbolique et plus
pathétique à la fois que celui de cette vieille femme, un peu
tournée en dérision par tous, qui à l'issue de l'extraordinaire
réunion du 30 novembre vint serrer la main de celui qui avait
pris la parole, ne lui disant rien d'autre que « merci ».
A ceci fait écho cette réflexion d'un délégué syndical de
l'entreprise : « Qu'est-ce que vous voulez faire avec les X,
les Y, les Z. », en citant les plus humbles parmi les employés
qui avaient signé le premier appel pour la réunion du Théâtre
Grammont, avec un ton de mépris et d'ironie à la fois. Juste-
ment c'est avec tous ceux-là que notre lutte aura un sens,
comme le disait un retraité, ouvrier d'un service public qui
travaille comme employé et qui a un passé syndical riche
d'expérience: « Ce n'est qu'avec ces gens-là qu'on fait du
travail ».
ROGER BERTHIER.
57
1
ANNEXE I.
Le premier appel signé de 20 employés
Au cours des derniers mois tous les employés de la Compagnie out
pu prendre conscience plus que jamais du rôle joué par tous les syndicats
et par les délégués syndicaux de la Compagnie:
1° Les organisations syndicales après avoir, le 21 nocembre, « réal.
firmé avec force qu'elles n'accepteraient de diescuter que » 25.000
et 10%, ont signé avec la Fédération le 30 novembre pour 22.000
et une a recommandation » de 5 %. « Avec force ? Quand on
veut faire un mouvement, qui réussisse, on n'attend pas que les
grèves soient finies depuis deux mois dans tous les autres secteurs,
on demande l'accord de 'tout le personnel sur des revendications
précises et on organise une grève qui gêne réellement les patrous.
Si la Fédération n'a pas cédé, c'est que rien ne l'obligeait à céder.
Et en particulier surtout pas la force des employés dispersée et
fragmentée dans les fameuses grèves tournantes dont le résultat est
bien connu.
2° Après s'être distingués dans l'élaboration en secret avec la Direc-
tion du nouveau système d'attribution des avantages individuels,
les délégués de la Compagnie sans exceptions ont fait au cours les
grèves la démonstration la plus évidente de leur incapacité de
mener la lutte et de leur mépris des revendications des employés.
3° Les organisations syndicales ne sont plus le lieu où les travailleurs
peuvent se regrouper en rue de défendre leurs intérêts, mais le
moyen idéal pour les bureaucrates syndicaux d'entrer en contact
avec les autorités (Patronat et Etat) et de se tailler des avantages
individuels autrement plus stables que les nôtres: par exemple les
délégués du personnel devenús cadres ou en passe de l'être, ou
auxiliaires précieux du chef du personnel, etc..
Ving années de collaboration avec le patronat et l'apareil d'Etat n'ont
pas apporté à la classe ouvrière plus d'avantages que les luttes antérieures,
elles ont entretenu parmi nous des maux que seule la volonté de tous
pourra extirper:
Isolement de chacun dans l'entreprise;
Stagnation de l'esprit de solidarité;
Division et méfiance à cause des salaires ;
Soumission et passivité, toutes choses, même les luttes étant
décidées d'en haut.
La réunion de mercredi dernier a clairement prouvé que la majo.
rité des employés en avaient assez d'être mystifiés et voulaient a jaire leurs
affaires eux-
mêmes ».
Pour cela, il n'y a qu'un seul moyen, nous grouper et nous organiser
nous-
mêmes en fixant les règles qui dans chaque circonstance nous per
mettront de décider nous-mêmes pour nos salaires et nos conditions do
travail.
Tous ensemble, mercredi prochain, nous pourrons voir comment nous
y prendre. En venant trus sans exception,
MERCREDI 7 DECEMBRE, à 17 h. 30 au THEATRE GRAMMONT.
Nous montrerons que nous, employés, pouvons balayer tous ceux qui
profitent de nous en nous divisant et jeter les bases d'une action où nous
nous retrouverons unanimes.
.
58
ANNEXE II.
Statuts du Conseil du Personnel
I. DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PREMIER. Il est formé entre les salariés de la Compagnie
d'Assurances Générales sur la Vie, 87, rue de Richelieu, à Paris, une orga-
nisation régie par les dispositions du livre III du Code du Travail sur
les syndicats professionnels et dénommée « Conseil du Personnel des Assu-
rances Générales Vie ».
ARTICLE 2. Le siège social est fixé à ...
ARTICLE 3. Cette organisation a pour objet exclusif d'asurer la
défense des intérêts du personnel salarié de la Compagnie d'Assurances
Générales sur la Vie; elle s'interdit toute activité politique ou religieuse.
II. - COMPOSITION. - ADMISSION. EXCLUSION.
ARTICLE 4. Sont membres de droit de l'organisation tous les sala-
riés de la Compagnie d'Assurances Générales sur la Vie.
ARTICLE 5. Tout salarié de la Compagnie reçoit sur sa demande
une carte de membre où sont mentionnées les contributions qu'il acquitte.
ARTICLE 6. Les membres ne sont pas astreints au versement de
cotisations, Pour assurer le financement des frais du Conseil, il est fixé à
titre de référence les cotisations suivantes:
20/00 pour les salaires mensuels inférieurs à 35.000 francs ;
30/00 pour les salaires mensuels de 35.000 à 50.000 francs;
4 0/00 pour les salaires mensuels supérieurs à 50.000 francs.
ARTICLE 7. La qualité de membre de droit se perd lors du départ
définitif de l'entreprise au d'exclusion prise à la majorité des deux tiers des
membres de l'assemblée générale, sur proposition de tout employé de
l'entreprise.
ARTICLE 8. Aucun des membres de l'organisation ne peut avoir de
fonction appointée de quelque nature qu'elle soit.
Chaque mois, le reliquat disponible des cotisations après règlement
des dépenses d'administration est versé à un fonds de solidarité.
III. FONCTIONNEMENT
ARTICLE 9.
Assemblée générale. L'assemblée générale est formée
de tous les employés de l'entreprise adhérents ou non à l'organisation.
ARTICLE 10. Comité de gestion. Il est procédé par les travail.
leurs de chaque bureau, adhérents ou non, effectuant un même travail, à
la désignation d'un délégué pris parmi eux et adhérent ou non, sur la
base de la confiance de ces travailleurs dans ses capacités pour la défense
de leurs intérêts, ce délégué pouvant à tout moment être révoqué et rem-
placé par les travailleurs qui l'auront mandaté.
Ces délégués forment un comité de gestion chargé des questions admi.
nistratives et de l'exécution des décisions prises par l'assemblée générale
des travailleurs dans l'entreprise. Tout salarié de l'entreprise, adhérent ou
non, à l'exclusion des délégués ou représentants des syndicats, peut assister
aux réunions du Comité de gestion.
Les délégués au Comité de gestion, désignent parmi eux les respon-
sables pour tout travail pratique dont:-
Un secrétaire,
Un secrétaire suppléant,
Un trésorier,
Un trésorier suppléant,
responsables des fonctions purement administratives.
Les délégués au Comité de gestion devront satisfaire aux obligations
des articles 5 à 6 du livre III ilu Code du Travail (uationalité française,
jouissance des droits civils); les secrétaires trésorier et leurs suppléauts
devront être adhérents.
59
ARTICLE 11. Pouvoirs de l'assemblée générale. Les décisions rela-
tives à des questions intéressant l'ensemble des travailleurs de l'entreprise
ne peuvent être prises que par l'assemblée générale à la majorité absolue
des salariés présents dans l'entreprise ; cette assemblée devra être réunie
chaque fois qu'une telle question aura à être résolue, à la demande de
tout intéressé.
L'assemblée générale décide à la majorité des deux tiers des salariés
présents dans l'entreprise des modifications des statuts et des sanctions.
ARTICLE 12. Pouvoirs du Comité de gestion. Les questions rela-
tives aux travailleurs d'un service, d'un bureau, ou à un travailleur déter.
miné ne pourront être résolues par le Comité de gestion qu'avec l'accord
du ou des intéressés; en cas de contestation entre le Comité de gestion et
le ou les intéressés, celui-ci ou ceux-ci auront la possibilité de porter cette
question devant l'assemblée générale.
Le Comité de gestion décide des questions de pure administration sans
en référer à l'assemblée générale (ouvertue d'un compte chèque postal,
engagement de dépenses matérielles); le secrétaire, le trésorier et leurs
adjoints ont une délégation perraanente du Comité de gestion pour
l'accomplissement de toutes formalités de déclaration et de publication
prévues par la législation en vigueur.
Toute autre question engageant l'organisation vis-à-vis du chef de
l'entreprise ou relevant de la défense des intérêts des travailleurs de
l'entreprise ne peut être résolue que dans les conditions fixées ci-dessus.
Les délégués et responsables du Comité de gestion n'ont pas de pou-
voirs particuliers autres que ceux définis ci-dessus. Tout délégué ayant été
révoqué par les travailleurs qui l'ont mandaté cesse, à dater de sa révo-
cation, d'occuper toute fonction qui aurait pu lui être confiée.
ARTICLE 13. Sauf en cas de grève les réunions se tiendront en
dehors des heures de travail.
Sauf en cas de grève, les lieux et dates de réunion devront être rendus
publics au moins quarante-huit heures à l'avance.
Tout salarié de l'entreprise, adhérent ou non, y la possibilité de
demander la convocation de l'assemblée générale ou du Comité de gestion,
et il aura toujours la possibilité de s'exprimer dans ces assemblées; seuls,
les délégués et représentants des syndicats ne pourront participer aux
séances du Comité de gestion.
IV.
STATUTS DES DELEGUES DU PERSONNEL
ET DU COMITE D'ENTREPRISE
ARTICLE 14. Les candidats aux élections de délégués du personnel
et de délégués au Comité d'entreprise seront choisis par l'ensemble des
travailleurs de l'entreprise sur une liste composée de toute personne adhé.
rente ou non ayant fait acte de candidature.
Les délégués du personnel sont distincts des délégués au Comité d'en-
treprise.
ARTICLE 15. - Les questions présentées par les délégués devront être
fixées par les travailleurs intéressés et le Comité de gestion dans les condi-
tions posées ci-dessus. Lors des réunions avec le chef d'entreprise, les
délégués présenteront ces questions et défendront la position arrêtée en
commun. Ils ne devront, en aucun cas donner un accord définitif compor-
tant une concession quelconque qu'après accord des travailleurs intéressés.
Les délégués ne pourront être reçus séparément par le chef d'entre-
prise ou l'un quelconque de ses représentants.
Aucun délégué ne pourra présenter lui-même une revendication qui
lui serait particulière; lors de la discussion de son cas avec le chef d'en-
treprise, il devra se faire remplacer par un suppléant.
V.
- PUBLICATIONS
ARTICLE 16. Le Comité de gestion doit publier un bulletin men.
suel donnant un compte rendu précis de toutes les activités et de la situa.
tion financière.
60
ARTICLE 17. Lors de la discussion de toute question intéressant
l'ensemble du personnel, les points de vue en présence devront être exposés
dans des tracts diffusés à l'ensemble du personnel. Tout salarié de l'entre-
prise, adhérent ou non, ayant un avis différent pourra obtenir la diffusion
de son point de vue dans les mêmes conditions.
VI. MODIFICATIONS DES STATUTS.
AFFILIATIONS. DISSOLUTION.
ARTICLE 18. Toute modification des statuts pourra être faite par
l'assemblée générale, à la majorité des deux tiers, sur proposition de tout
travailleur de l'entreprise, adhérent ou non.
ARTICLE 19. L'organisation ne pourra s'unir qu'avec des organi.
sations dont les statuts présenteront un caractère identique.
ARTICLE 20. La dissolution de l'organisation est décidée par l'assem-
blée générale à la majorité des trois quarts des salariés de l'entreprise et
l'actif disponible à ce moment est attribué par vote de l'assemblée à la
même majorité, conformément à la loi.
- 61
ANNEXE III.
Extraits du tract distribué
dans les autres Compagnies d'Assurances
La majorité du personnel des Assurances Générales Vie, 87, rue de
Richelieu, Paris n'est plus d'accord pour confier la défense de ses intérêts
aux syndicats, quels qu'ils soient.
C'est à la suite de la grève de novembre 1955 que nous avons décidé
de défendre nous-mêmes nos intérêts.
QU'AVONS-NOUS FAIT ?
1? Nous publions tous les mois un journal d'entreprise a Bulletin Employé
dont les colonnes sont ouvertes à tous ceux d'entre nous qui ne
peuvent s'exprimer dans les journaux des syndicats. Avant d'être
publié, chaque article e st discuté entre nous pour qu'il représente
bien l'opinion de tous.
24 Nous nous sommes organisés, le Conseil a un statut légal mais
NOUS NE SOMMES PAS UN SYNDICAT OU TOUT SE DECIDE
D'EN HAUT:
Tout salarié de l'entreprise est membre de droit du Conseil du
Personnel, qu'il verse ou non une cotisation.
Aucune question ne peut être résolue sans l'accord de l'intéressé,
des employés du bureau ou de tout le personnel, selon qu'il s'agit
d'une question intéressant un seul employé, un bureau ou tout
le personnel.
Toutes les réunions sont publiques et tout employé s'y exprime
librement.
Nous sommes tous solidaires dans le travail, le Conseil n'a pas
de permanents, les réunions ont lieu en dehors du travail.
3° Tout responsable est désigné sur la base de la confiance personnelle et
révocable à tout moment :
L'Assemblée Générale du Conseil, formée de tout le personnel, dé-
cide des questions importantes.
Le Comité de gestion, formé de 38 délégués du bureau, chacun
représentant un groupe d'employés effectuant le même travail,
règle les questions pratiques.
4? Pour être reconnu dans l'entreprise, le Conseil du Personnel a du faire
élire des délégués du personnel.
Mais les syndicats sont bien protégés par la loi; seuls ils pea-
vent présenter des listes. Ce n'est que si leurs listes ne recueillent pas
la moitié du nombre des électeurs que les élections sont nulles, au
second tour tous candidats peuvent se présenter.
Aujourd'hui, les organisations syndicales lancent les pires calomnies
sur le Conseil: Poujadistes, diviseurs, fascistes, vendus au patron, etc...
Il est nécessaire pour elles de briser ce regroupement spontané d'em-
ployés sinon ce serait la preuve qu'il est posible de se passer des syndi-
cats parce que les employés sont capables de s'organiser eux-mêmes, ce
serait la preuve que l'appareil bureaucratique et politique des syndicats
est inutile.
62
.
VOILA CE QUE PENSE LE CONSEIL DU PERSONNEL DES A.G.-VIE:
LES SALAIRES:
Tous les employés d'une entreprise participent à une tâche collec
tive. Chacun a des devoirs et des droits égaux.
Mais personne ne touche le même salaire.
Consultez collectivement vos feuilles de paie et jugez. Patronats et
syndicats ont signé des accords:
qui font varier la rémunération d'après l'emploi occupé (110 caté
gories d'emploi dans la classification de juillet 54)
qui élargissent constamment la hiérarchie ct accroissent les diffé.
rences de salaires (accord de juillet 54, d'avril et novembre 55).
Dans l'entreprise, les délégués des syndicats pratiquent souvent une
politique du « cas personnel » qui élargit cette différenciation. Le ré-
sultat: c'est que, dans toutes les entreprises, le personnel est divisé.
Patrons et syndicats sont les diviseurs.
LES CADRES:
Cette division due à la biérarchie des salaires est encore plus marquée
vis-à-vis des cadres.
Ou bien ils ont le même travail que leurs cmployés.
Ou bien ils sont réduits au rôle de simples surveillants,
Pourquoi alors cette hiérarchie aucunement justifiée?
LES SYNDICATS:
Ils négocient avec le patronat des « accords de salaires qui nous
laissent quelques miettes de l'augmentation des profits. Un point, c'est
tout. En dehors de cette question, le patron est maître chez lui, il fait
ce qui lui plaît en ce qui concerne le travail.
Constatez vous-mêmes combien les délégués officiels defendent l'an-
torité des directions dans l'entreprise.
LE TRAVAIL:
Dans l'immense majorité des cas, l'emploi que nous ocupons dépend,
non pas de nos capacités réelles, mais du bon vouloir de la direction.
Les tâches que rous avons à remplir nous fatiguent de plus en plus
au fur et à mesure du progrès de la rationalisation et de la mécanisation.
Le travail est conçu de telle façon qu'il ne nous permet pas d'appli-
quer 10 % de nos capacités réelles.
Les syndicats F.0. et C.F.T.C. participent à la commission de la
productivité.
La C.G.T. en 1945 invitait les salariés à faire tous leurs efforts poar
accroître la production.
Nous ne voulons pas que le travail soit encore plus pénible et plus
stupide. Nous pensons, au contraire des Directions et des syndicats, que
nous sommes capables de comprendre le sens de notre travail, et de
l'organiser.
LES DIRECTIONS D'ENTREPRISE ET LA FEDERATION
PATRONALE :
Elles utilisent tous les moyens (cadres, syndicats) pour accroître le
rendement. Un seul principe: autorité absolue du patron dans l'en-
treprise.
Cette autorité entraîne le gaspillage, l'injustice, l'inadaptation au
travail, la fatigue, la colère, le découragement.
Si, autrefois nous avons pu faire confiance aux syndicats pour ba-
lancer cette autorité, nous nous sommes rendu compte, qu'en général, les
syndicats servaient cette autorité au lieu de la combattre.
03
CE QUE NOUS POUVONS TOUS FAIRE
Dans vos entreprises, vos difficultés sont les mêmes que les nôtres.
Vous ne pouvez compter que sur vous-mêmes.
Vous n'êtes pas ce que disent les syndicats et les patrons: des inca-
pables qu'on doit diriger.
Vous êtes les plus nombreux, c'est sur vous que repose le fonction-
nement des entreprises, vous êtes capables de vous grouper, tout en
laissant à chacun la possibilité de contrôler et de gérer l'organisation
eommune à tous; vous êtes ceux pour qui la solidarité n'est pas un
vain mot.
nous
AIDONS-NOUS
Dans chaque entreprise, vous pouvez former un conseil du personnel
qui regroupe en une unité contre la Direction, tous les employés divisés
et commandés par les syndicats.
Si ce n'est pas possible tout de suite, formez un groupe pour publier
un bulletin d'entreprise pour préparer la voie à la formation d'un
conseil.
Quelles que soient vos possibilités, prenez contact avec nous :
vous apporterons notre expérience et l'aide matérielle nécessaire.
Le Conseil du Personnel des Assurances Générales Vie ne vivra que
si d'autres Conseils se créent dans d'autres Compagnies ; d'autres Con-
seils ne pourront se créer que parce que nous avons pris conscience de
notre force.
Soyons tous solidaires : c'est pour nous tous que nous luttons.
Le 15 mars 1956.
Le Conseil du Personnel des A.G.-Vie.
j
64
1
L'INSURRECTION
HONGROISE
Depuis quatre semaines, les politicien's et la presse de la
bourgeoisie se livrent, à propos des événements de Hongrie, à
une démagogie d'un cynisme rurement égalé dans le passé.
Que Bidault, Laniel et Triboulet se découvrent d'un coup
un amour sans bornes pour les travailleurs
pourvu qu'ils
habitent Budapest; que les massacreurs de Malgaches, de
Vietnamiens et d’Algériens trouvent inacceptable l'attaque
armée contre un peuple pourvu que cette attaque soit
faite par d'autres qu'eux-mêmes; que l'Aurore et Paris-
Presse se déchaînent en faveur de la révolution pourvu
qu'elle ne soit pas dirigée contre la bourgeoisie, ces farces
ignobles nous avaient déjà été offertes en spectacle par le
passé. Mais c'est au moment même qu'ils faisaient débarquer
leurs troupes en Egypte que Mollet et Pineau osaient s'indi-
gner contre l'intervention russe en Hongrie. C'est sur la même
page que Le Figaro se réjouissuit de la « nouvelle vigueur »
insufflée à la politique française par Mollet - vigueur que
mesurent à la fois les milliers de cadavres de civils à Port-
Saïd et la déconfiture lamentable de l'aventure égyptienne
et condamnait avec véhémence l'impérialisme russe. C'est en
même temps que les dirigeants de Force Ouvrière et de la
C.F.T.C. refusent la moindre action contre la guerre d'Algé.
rie — ils ne font pas de politique, voyez-vous — et appellent
à la grève... contre la guerre en Hongrie.
La bourgeoisie et les « gérants loyaux du capitalisme »
que sont les dirigeants d'un parti inexplicablement intitulé
socialiste, utilisent les événements de Hongrie pour courrir
leurs propres crimes. C'est clair. Mais cela ne change rien à
la signification de ces événements ni au devoir impératif pour
tous les travailleurs de connaître et de comprendre ce qui
s'est passé. La lutte des travailleurs contre l'exploitation et
l'oppression est une et la même sous tous les régimes et sous
toutes les latitudes. Cette information, cette compréhension
sont rendues pour beaucoup d'ouvriers en France d'autant
plus difficiles, que la presse hourgeoise a présenté les insur-
gés hongrois comme luttant à peu près pour la restauration
d'une démocratie capitaliste « à l'occidentale », et que la
presse du P.C.F. a surenchéri sur l'Aurore, en les présentant
comme des fascistes purs et simples.
Les pages qui suivent veulent dissiper le brouillard de
la propagande, dont on se sert de tous les côtés pour dissi-
muler la réalité sur la révolution hongroise, et montrer les
véritables tendances, prolétariennes et socialistes, de cette
révolution.
65
Questions aux militants du P.C.F.
Dans son exposé du 2 novembre (publié dans L'Humanité
du 3), Fajon a dit vouloir « répondre aux camarades peu rom
breux une douzaine » qui se sont plaints de l'attitude
de L'Humanité à l'égard des événements de Pologne et de
Hongrie, reprochant au journal d' « avoir informé incomplè.
tement ou mal ses lecteurs ». La réponse de Fajon est que
« la tâche de L'Humanité n'est pas de publier sans discer-
nement toutes les informations d'agence, toutes les opinions
formulées par tel ou tel dirigeant d'un parti frère sur tel ou
tel problème politique. Sa tâche est de publier des faits
vérifiés et importants, en même temps que le point de vue
du P. C. F. sur les grandes questions posées ).
Or voici comment L'Humanité a informé ses lecteurs sur
les événements de Hongrie. Le 25 octobre, elle titre :
ves émeutes contre-révolutionnaires mises en échec à Buda-
pst ». Le même jour, page 3, longue dépêche de l'Agence
Tass suivant laquelle « l'ordre est rétabli à Budapest ». Le
26 octobre, titre : « L'émeute contre-révolutionnaire a été
brisée ».
Le 27, elle reproduit une dépêche de Tase affir-
mant que « le Gouvernement est cependant maître de la
situation ». Le 28, Huma-Dimanche titre : « La contre-
révolution vaincue à Budapest ». — Le 29, lorsque Nagy a
cédé devant les insurgés refusant de déposer les armes et
qu'à sa demande les troupes russes, sérieusement éprouvées,
se sont retirées de Budapest, L'Humanité écrit : « L'armée
hongroise, soutenue par des éléments soviétiques, s'est rendue
maître au cours de la matinée des derniers îlots ».
« Gra-
1° Ces informations étaient-elles des « faits vérifiés » ou des
mensonges purs et simples?
Le 6 novembre, dès la formation du gouvernement Kadar
et la deuxième intervention russe, L'Humanité annonce « la
victoire complète du pouvoir populaire... le travail reprend ».
Le 7 novembre, elle ne parle que des « secours envoyés par
l'U.R.S.S. à la Hongrie ». Le 8, les journaux du matin n'ont
pas paru ; mais le 9, les quelques lignes qu'elle publie sur
66
la Hongrie laissent croire qu'il ne s'y passe rien... sauf. la
reprise du travail. De même, à la lire le 10, le 12, le 13, le
travail ne fait que reprendre. Pourtant, le 13, elle reconnaît
indirectement, en citant Michel Gordey, sans le démentir,
que les combats ont continué au moins jusqu'au vendredi
9 novembre.
2° Est-ce, oui ou non, un fait vérifié que L'Humanité a cons-
tamment menti à ses lecteurs, en leur cachant que pen-
dant six jours du dimanche 4 novembre à l'aube du
vendredi 9 novembre – la population de Budapest s'est
battue contre l'armée et les blindés russes ?
L'Humanité ne se borne pas à affirmer continuellement,
depuis le 6 novembre, que « le travail reprend » et que « la
situation est redevenue normale », infligeant ainsi chaque
matin un démenti à ce qu'elle écrivait la veille. Elle écrit,
le 12 novembre : « S'appuyant sur les travailleurs le gou-
vernement Kadar remet le pays en route ». Pourtant, le même
jour. Libération qui n'est qu'une succursale de L'Humanité
à l'usage des « progressistes » cite le correspondant du jour-
nal yougoslave Politika qui résume ainsi la situation : « Les
masses hongroises sont inquiètes... Nagy n'a pas réussi, or la
tâche de Kadar est bien plus difficile ». Le 14, un incroyable
reportage d’André Stil, qui à la fois contredit tout ce que
L'Humanité a écrit jusqu'alors et se contredit lui-même à p!u-
sieurs reprises (on y reviendra), affirme qu'à Budapest « une
foule pressée se rend au travail ». Or, le même jour, Libzéra-
tion écrit: « Budapest continue à être privée de tous trans-
ports publics. Devant les rares magasins autres que des maga-
sins d'alimentation ayant rouvert, des gens stationnent autant
que devant les boulangerie. Une foule considérable circule len-
tement... sur les grandes artères qui ont subi les dégâts les
plus terribles. Toutes les façades sont incendiées et quelques
murs sont écroulés. Des gravats ou des morceaux de vitres
tombent parfois des maisons. Des centaines de personnes sta-
tionnent devant les hôpitaux. On entend partout répéter:
"C'est pire qu'en 1945". (En 1945, Budapest avait été pen-
dant des seniaines le théâtre de batailles acharnées entre les
divisions allemandes et les divisions russes.)... On constate que
l'industrie lourde et demi-lourde de la région est encore
complètement arrêtée... Les invitations des Russes d'il y a
quelques jours et celles présentes du gouvernement Kadar
à la reprise du travail se heurtent à une désorganisation de
fait. Bien que la plupart des ministères n'aient subi
que
peu de dégâts, il est difficile de trouver quelq::'un à son
poste. Les habitants de Budapest ignorent encore où se trouve
le Gouvernement, le Parlement reste portes closes. Il ne
semble pas qu'une grève systématique puisse se prolonger
67
bien longtemps. Très peu de travailleurs peuvent se permet-
tre le luxe de ne pas toucher leur salaire ».
3° N'est-il pas clair qu'André Stil est un menteur ?
4° N'est-il
pas
clair
que, loin de « s'appuyer sur les travail-
leurs », Kadar se trouve, dix jours après la « victoire
complète du pouvoir populaire », face à une grève quasi-
totale ?
5° N'est-il pas clair que Kadar,
un gouvernement
ou un patron capitaliste, compte sur la faim pour réduire
la résistance des travailleurs et que, pour un ouvrier hon-
grois, avoir une opinion sur le gouvernement de son
pays est, comme l'avoue cyniquement « Libération »,
( un luxe qu'il ne peut pas se permettre » ?
сотте
Pendant les quinze premiers jours des événements de
Hongrie, L'Humanité, l'agence Tass, Radio-Moscou n'ont
parlé que de « bandes fascistes », « émeutiers contre-révolu-
tionnaires », «.provocateurs payés par les Américains », etc.
Le lecteur de L'Humanité devrait croire qu'il n'y avait rien
d'autre dans l'insurrection hongroise.
En Espagne, en 1936, Franco disposait de la plus grande
partie de l'armée de métier, il était soutenu par
les
proprié.
taires fonciers et la bourgeoisie qui détenaient le pouvoir
dans le pays, par des organisations fascistes qui se prépa-
raient de longue date; il était aidé par Mussolini et Hitler
qui lui envoyaient des armes, des avions et même des divi-
sions entières. Il lui a pourtant fallu deux ans pour vaincre
la résistance des travailleurs.
6° Est-il concevable qu'en Hongrie, pays, la veille encore,
entièrement contrôlé par le << parti des travailleurs »
(communiste), des « bandes fascistes » aient pu après
six jours de combat (du mardi 23 au dimanche 28 octo-
bre) venir à bout des forces gouvernementales, aussi bien
dans la capitale que dans toutes les villes importantes de
province et aient obligé les forces russes à se retirer de
Budapest ?
7° Est-il concevable que, à partir du dimanche 4 novembre,
le commandement russe ait eu besoin de jeter dans la
bataille de nombreuses divisions nouvelles amenées en
toute hâte (estimées généralement à 200.000 hommes et
plusieurs milliers de chars) pour liquider quelques « ban-
des fascistes », et qu'avec des forces aussi écrasantes, des
blindés, des armes automatiques modernes, etc., il ait eu
encore besoin de six jours pour écraser toute résistance
organisée ?
68
8° Ces faits seraient-ils possibles s'il n'y avait pas eu, dans
l'insurrection hongroise, une participation massive de la
grande majorité de la population et une neutralité favo-
rable à l'insurrection du reste ?
A plusieurs reprises, pendant la première semaine de
l'insurrection hongroise, L'Humanité affirme que le gou
vernement s'appuie sur les ouvriers, qui participeraient
à la lutte contre les « émeutiers fascistes ». Mais Stil,
dans L'Humanité du 14 novembre, crache le morceau et
avoue les mensonges de son propre journal : « Ce qu'il fau.
dra expliquer, c'est comment les travailleurs, après tant de
sacrifices pour un régime qu'ils savaient être le leur, ont pu,
tout en réprouvant les émeutiers fascistes, se laisser troubler
au point de ne pas intervenir avec force et résolution pour
défendre contre eux ce régime ».
9° Le fait que L'Humanité mentait en parlant de lutte des
ouvriers contre les insurgés n'est-il pas maintenant établi
par le témoignage de Stil?
10° N'est-il pas plutôt infiniment probable que les ouvriers
armés se sont battus contre le goilvernement et les Rus-
ses ? Sinon, comment expliquer la défaite des forces
gouvernementales ei des troupes russes pendant la pre-
mière semaine de l'insurrection ? Les combats acharnés
qu'ont dû livrer ensuite, du 4 au 9 novembre, les troupes
russes renforcées pour écraser l'insurrection ? La grève
générale après la victoire militaire des Russes ?
11° Ne peut-on pas parier que ni André Stil, ni aucun autre
dirigeant du P.C.F. n' « expliquera » jamais pourquoi
les travailleurs « ne sont pas intervenus pour défendre
ce régime », pourquoi ils l'ont plutôt combattu jusqu'à
le mort? Cette explication ne serait-elle pas que les tra.
vailleurs, au bout de dix ans d'expérience, ont conclu
que ce régime les exploitait et les opprimait?
Après avoir imprimé pendant deux semaines que dans
l'insurrection hongroise il n'y avait que des fascistes, L'Huma-
nité, s'infligeant à elle-même un démenti, commence main-
tenant à expliquer qu'il y avait aussi des travailleurs, trom-
pés ou « intimidés » (!) par les fascistes. Stil a le front
d'écrire, les 14 et 15 novembre, que les fascistes « usant de
la démagogie autant que de l'intimidation », maintiennent
en grève les usines.
12° Si l'on pense qu'après plusieurs années de régime « socia-
liste » et de pouvoir du « parti des travailleurs », la
majorité des ouvriers, des paysans et de la jeunesse de
69
Hongrie est capable de se mettre en lutte à l'instigation
des fascistes, de se faire tuer pendant trois semaines
il y a eu des dizaines de milliers de morts à Buda-
pest, ville de 1.500.000 habitants et de rester en
grève par la suite, après que les fascistes se soient démas-
qués « en assassinant les militants ouvriers », comme dit
L'Humanité, ne faut-il pas conclure que la société est
irrémédiablement vouée au fascisme ? Peut-on rester un
militant communiste avec de telles croyances ?
13° Cette idée, que quelques démagogues au service de buts
inavoués, peuvent faire ce qu'ils veulent de la masse,
n'est-elle pas la base de toute l'idéologie et de toute la
pratique politique du fascisme ? N'est-ce pas cette même
idée que depuis des années à propos de Berlin-Est, de
Poznan, de la crise polonaise d'octobre 1956, de la révo-
lution hongroise, soutiennent quotidiennement les diri-
geants du P. C. russe et du P.C. F.? Que faut-il penser
d'eux ?
mere
en SAKSAS til
En parlant du soulèvement de Poznan, que L'Humanité
a présenté et continue à présenter comme l'oeuvre de provo-
cateurs et de gangsters, Gomulka a dit devant le Comité
Central du parti polonais : « Tenter de présenter la tragédie
de Poznan comme une cuvre des impérialistes et des provo-
cateurs fut d'une grande naïveté politique. Les agents de
l'impérialisme et les provocateurs peuvent se manifester en
tous lieux, en tous moments. Mais jamais et nulle part ils
ne peuvent déterminer l'attitude de la classe ouvrière... C'est
chez nous,
c'est à la direction du parti, au gouvernement,
que se trouvent les causes véritables de la tragédie de Poznan
et du profond mécontentement de la classe ouvrière. Le feu
couvait déjà depuis plusieurs années ». (Comme le P.C.F.
n'a pas publié à ce jour le discours de Gomulka, nous le
citons d'après le texte publié dans France-Observateur et
dans L'Express.)
14° Indépendamment de son application aux événements de
Poznan, cette phrase ne contient-elle pas une vérité
générale? Ne pourrait-on pas l'appliquer avec beau-
coup plus de force aux événements de Hongrie ?
Fajon, dans son discours du 2 novembre, a refusé d'ac-
cepter l'explication de Gomulka sur les événements de Poz-
nan, qu'il a qualifié de « défaitiste », et a continué à pré-
tendre que le soulèvement ouvrier de Poznan était l'oeuvre
de provocateurs, etc. Pourtant, avant même Gomulka, Cyran.
kiewicz, Président du Conseil polonais, et Ochab, Secrétaire
général du parti polonais, avaient reconnu que les ouvriers
70
s'étaient soulevés parce qu'ils avaient des motifs justes de
mécontentement.
15° A qui est-il plus facile de mentir, à Gomulka Cyran-
kiewicz, etc., parlant devant des Polonais de choses que
ceux-ci ont vécues, ou à Fajon, à Paris, devanı les cadres
du P.C. F. ?
16° Le marxisme est-il une conception matérialiste de l'his
toire pour laquelle l'action des classes sociales est déter-
minée par leurs intérêts, leur place dans la production
et la conscience qu'elles développent à partir de leur
situation - ou bien est-il une conception policière de
l'histoire suivant laquelle l'humanité est formée par des
masses aveugles, que des espions et des provocateurs
mènent à volonté ?
17° La « conception » de Fajon, suivant laquelle la classe
ouvrière peut être menée à volonté par les espions et
les provocateurs, ne traduit-elle pas un profond mépris
de la classe ouvrière ? N'est-ce pas plutôt cette concep-
tior, qui serait profondément défaitiste ? Préférant pré.
senter les ouvriers comme des imbéciles sans espoir plu-
tôt que d'admettre les crimes de l'appareil bureaucra-
tique qui ont conduit le proletariat à la révolte, Fajon
ne se montre-t-il pas comme un bureaucrate ennemi irré-
conciliable des ouvriers ?
Après avoir constamment écrit que l'insurrection hon-
groise était l'oeuvre de fascistes et de hortystes, L'Humanité
publie, le 12 novembre, sans s'expliquer et sans rougir, le
discours de Kadar, diffusé le 11 par Radio-Budapest, qu'elle
résume ainsi : « Revenant sur l'origine des combats, Janos
Kadar a déclaré que le mécontentement des masses était
justifié mais que les contre-révolutionnaires ont exploité ce
mécontentement légitime dans le but de renverser le pouvoir
populaire. Ces forces, a dit Janos Kadar, risquaient de pren-
dre le dessus ».
Cependant, même ce résumé de Kadar - qui inflige un
cinglant démenti aux calomnies que L'Humanité a déversé
pendant quinze jours sur les travailleurs hongrois est
falsifié par L'Humanité. Voici le texte du discours Kadar
publié le même jour par Libération : « L'indignation des
masses était justifiée. Elles ne voulaient pas renverser la
démocratie populaire mais corriger les erreurs du passé.
Cependant des contre-révolutionnaires se sont infiltrés dans
les rangs du peuple et ont exploité l'action légitime des
masses dans le but de renverser le pouvoir populaire. Ces
forces risquaient de prendre le dessus, etc.). Nous avons
souligné le mot « action » qui montre bel et bien que l'insura
71
rection a été l'ouvre des masses. D'ailleurs, le programme
du gouvernement Kadar (publié par L'Humanité du 5 novem.
bre) comportait comme point 3 « Le gouvernement n'ad-
mettra pas que les travailleurs soient poursuivis pour avoir
participé aux événements de ces derniers jours ».
:
18° Kadar n'avait-il pas tout intérêt à dire lui aussi, comme
L'Humanité, comme l'Agence Tass, comme Radio-Mos-
cou, qu'il n'y avait parmi les insurgés que des fascistes ?
19° S'il est obligé de reconnaître que « les travailleurs ont
participé aux événements de ces derniers jours » et que
« l'action des masses » était « légitime », n'est-ce pas
parce que, étant en Hongrie, il ne peut matériellement
pas mentir sur des faits auxquels la grande majorité de
la population a participé, et qu'il essaie désespérément
de se réconcilier avec les travailleurs, après les avoir
fait tuer par les blindés russes ?
20° Comment expliquer le fait que ni Kadar, ni les Russes
n'ont été capables de gagner à eux les éléments de l’in-
surrection qui « voulaient corriger les erreurs du passé »
et de les opposer à ceux qui « voulaient renverser le
pouvoir populaire » ? N'est-ce pas là une faillite politique
sans précédent? Ne résulte-t-elle pas de ce que personne
en Hongrie n'accorde la moindre confiance ni à Kadar, ni
aux Russes? A quoi cela serait-il dû? Serait-ce la conclu-
sion que la population a tiré d'une expérience de dix ans?
De 1948 à 1954, les dirigeants russes, ceux du P. C. fran-
çais et de tous les P. C. du monde qualifiaient Tito d’hitle-
rien, d'assassin, etc., et le régime yougoslave de régime fas-
ciste. Puis, brusquement et sans aucune explication, ils ont
tous déclaré simultanément que la Yougoslavie était un pays
socialiste qui suivait « sa propre voie pour réaliser le socia-
lisme ».
our
21° L'Humanité, pendant six ans, publiait-elle des « faits
vérifiés » sur la Yougoslavie, ou des mensonges invrai-
semblables sur commande ? Le « point de vue du P.C.F.
sur les grandes questions posées » comme dit pompense-
ment Fajon ne consistait-il pas à prendre un pays « so-
cialiste » pour un pays « fasciste », c'est-à-dire le
pour la nuit?
22° La différence entre socialisme et fascisme est-elle une
nuance si délicate pour que de telles erreurs soient
possibles, ou bien faut-il penser que les dirigeants du
P.C.F. et du P.C. russe qualifient toujours de fascistes
ceux qui s'opposent à leur volonté ?
72
La seule « explication » donnée sur le tournant du P.C.
russe concernant la Yougoslavie a été la piteuse phrase de
Khroutchev arrivant à Belgrade : « Nous avons été trompés
par Béria »).
23° L'appréciation politique et sociale d'un régime dépen-
drait-elle donc pour les dirigeants russes des informa-
tions secrètes d'un chef policier ? Béria pourrait-il faire
croire à Khroutchev ou à Thorez que la France, par
exemple, est un pays socialiste ?
24° Est-il concevable que les directions des P.C., qui se
veulent les Etats-Majors du prolétariat mondial se trom-
pent pendant six années consécutives, non pas sur les
agissements d'un individu, mais sur la nature d'un
régime qui fonctionne au grand jour, est visité par les
journalistes et tous ceux qui le désirent, etc.?
25° Est-il concevable qu'on dise aujourd'hui le contraire de
ce qu'on avait dit la veille sans expliquer sérieusement
ni pourquoi on s'était trompé, ni pourquoi on a changé
d'avis?
26° De tels changements de position sans explication contri-
buent-ils à élever la conscience des militants et des
ouvriers, ou à les plonger dans la confusion et la démo-
ralisation ?
27° N'est-il pas clair, sur l'exemple de la Yougoslavie, auquel
on pourrait facilement ajouter des dizaines d'autres, que
la direction du P. C. russe comme du P. C. français refuse
toute discussion avec ceux qui peuvent être en désac.
cord avec elle, caractérise immédiatement tous ceux qui
ne se plient pas à sa volonté de « fascistes », essaie de
les briser par la calomnie et la terreur ? Ces procédés
ne sont-ils pas typiquement fascistes ? Ne faut-il pas se
demander pour quelle raison la direction du P.C.
recourt à ces procédés et ne peut tolérer aucune dis.
cussion ?
28° Si les divisions russes étaient stationnées en 1948 en
Yougoslavie, ne seraient-elles pas intervenues
maintenant en Hongrie, contre le « fasciste Tito » ?
Thorez et L'Humanité ne les auraient-ils pas approuvées?
Qu'en serait-il alors advenu de la « voie propre de la
Yougoslavie vers le socialisme », solennellement recon-
nue six ans plus tard ?
L'argument sur lequel se rabat constamment L'Humanité
pour étayer ses calomnies contre les travailleurs hongrois,
c'est le fait que la presse bourgeoise et les politiciens bour-
geois font de la propagande contre l'intervention russe
Hongrie.
com me
en
73
29° Aussi longtemps que la Russie et les P. C. attaquaient
Tito, la presse bourgeoise n'a-t-elle pas « soutenu » Tito
et la Yougoslavie ? Les Etats-Unis, l'Angleterre et la
France n'ont-elles pas fourni au grand jour à Tito des
centaines de millions de dollars, des armes, etc. ? Tito
n'a-t-il pas conclu un pacte militaire avec les gouverne-
ments réactionnaires de Grèce et de Turquie, pacte qui
est toujours en vigueur ? Tout cela empêche-t-il Khrout-
chev et Thorez de voir aujourd'hui dans la Yougoslavie
un « état socialiste »?
30° Les directions des P. C., de 1948 à 1954, n'avaient-elles
pas utilisé ces faits pour prouver que Tito était un
« agent de l'impérialisme américain » ? L'Humanité n'a-
t-elle pas monté en épingle, pendant ces six années tous
les signes d'aide des Occidentaux à Tito pour prouv. la
<< collusion » de celui-ci avec les Américains ? N'est-ce
pas là ce qu'elle fait aujourd'hui à propos de la Hon.
grie ?
31° La presse bourgeoise et les politiciens bourgeois n'ont-
ils pas, pour une bonne partie, « approuvé » et « 'éli-
Khroutchev pour s'être délimité de Staline?
Faut-il en conclure que Khroutchev est un agent de
l'impérialisme américain ?
32° L'attitude de la presse et des politiciens bourgeois face
aux événements de Hongrie ne s'explique-t-elle pas plu-
tôt par ces facteurs :
a) Qu'ils accueillent favorablement au départ tout ce
qui pourrait affaiblir le bloc russe (voir le cas yougo-
slave) ?
b). Que l'intervention militaire russe leur donnait des
magnifiques armes de propagande, dont ils avaient
bien besoin pour couvrir leurs entreprises impéria-
listes passées, présentes et à venir, et spécialement
en Algérie et en Egypte ?
c) Que l'ouverture d'une période de luttes politiques
ouvertes en Hongrie leur faisait croire qu'ils allaient
désormais avoir des possibilités d'action politique
dans ce pays ?
cité »
L'Humanité, Kadar, Radio-Moscou, etc., ont parlé de
« terreur blanche » qui aurait régné à Budapest pendant la'
deuxième semaine de l'insurrection. Il est possible que des
attentats terroristes ou des actes indivituels injustifiables
contre des innocents aient été commis il y en a toujours
dans toute révolution; en tout cas, après ce que l'on vient de
voir, le fait que l'Humanité les dit est loin d'en constituer
la preuve.
· 74
33° Dans un pays où la classe ouvrière s'est armée et a cu..sti.
tué des Conseils, l'instauration d'une « terreur blanche »
est-elle possible? Les ouvriers n'auraient-ils pas immé
diatement réagi si des véritables militants ouvriers étaiant
l'objet d'une persécution systématique?
Il est en revanche incontestable que des exécutions son-
maires des membres de la polic secrète A.V.H, ont eu lica
sur une grande échelle.
34" Savez-vous que l'insurrection a commencé parce que le
23 octobre la police secrète a ouvert le feu sur la foule
de manifestants non-armés?
35° Qu'était la police secrète en Hongrie? En quoi différaii-
elle de la Gestapo? Rajk et des centaines d'autres n'ont-
ils pas été exécutés comme traîtres pour être réhabilités
cinq ans après? N'avaient-ils pas « avoué » lcurs cri.
mes? Comment les avaient-ils « avoués » puisqu'ils ne
les avaient pas commis? N'était-ce pas sous l'i pression
d'atroces tortures? Khroutchev n'a-t-il pas reconnu de-
vant le XXe Congrès du P.C.U.S. que la police stalinienne
faisait avouer par la torture aux accusés des crimes ima-
ginaires? Gomulka n'a-t-il
pas
dit dans son discours :
« Chez nous également... des gens innocents ont été en-
voyés à la mort; d'autres innocents, nombreux. ont été
emprisonnés, et quelques fois pendant de longues
années; parmi eux, il y avait des commuristes; des
hommes ont été soumis à des tortures hestiales; on a
semé la peur et la démoralisation. » ? Ces membres de la
police secrète hongroise, n'étaient-ils pas des tor-
tionnaires?
36° Si vous aviez un frère, père, fils qui, arrêté par la police
et torturé, avait « avoué » des crimes imaginaires et avait
été fusillé, et que, après une insurrection victorieuse.
vous mettiez la main sur ses tortionnaires, êtes-voils cer-
tain de ce que vous feriez? N'y a-t-il pas eu des erécu-
tions sommaires après l'écroulement du nazisme, en
France et dans d'autres pays?
L'Humanité a présenté pendant presque trois semaines
l'insurrection hongroise comme une émeute de faescistes. A
l'en croire, personne d'autre ne s'y est manifesté sauf lcs
hortystes, les anciens capitalistes et propriétaires fonciers,
qui auraient déjà quelques jours après l'insurrection com-
mencé à rentrer en possession de leurs terres (!) On a vu que
Kadar a avoué qu'il s'agissait d'une « action légitime des
masses », au sein de laquele, d'après lui, des éléments contre-
révolutionnaires « risquaient de prendre le dessus. »
5
37° Quelle base, parmi les masses de la population, pour-
raient se créer des organisations politiques réactionnai-
res? Des partis visant à rendre les usines aux capitalistes
et la terre aux gros propriétaires fonciers pourraient-ils
avoir un écho quelconque auprès des ouvriers et des
paysans, qui forment l'énorme majorité de la population
hongroise? Les ouvriers, armés et revendiquant la gestion
des usines (voir plus bas), auraient-ils toléré l'existence
des partis demandant la restauration de la bourgeoisie?
Les paysans, exploités pendant des siècles par les féo-
daux, auraient-ils accepté qu'Esterhazy récupère ses do-
maines (comme L'Humanité a eu la bêtise de le pró.
tendre) ?
La presse bourgeoise a essayé de gonfler autant que pos-
sible l'importance qu'avaient pu avoir, pendant la deuxième
semaine de l'insurrection, les organisations politiques tradi-
tionnelles hâtivement reconstituées, pour prouver que les
Hongrois n'aspiraient qu'à ce bonheur suprême - une répu-
blique parlementaire du type occidental. L'Humanité a été,
sur ce point, absolument d'accord avec le Figaro et l'Aurore.
Elle a, comme la presse bourgeoise, essayé de cacher toutes
les manifestations révolutionnaires du prolétariat hongrois,
les revendications qu'il a mises en avant, le fait qu'il s'est
organisé dans des Conseils (c'est-à-dire des véritables Soviets,
dont les membres, élus démocratiquement par les ouvriers,
sont révocables à tout instant par leurs électeurs). De tels
Conseils ont existé dans toutes les villes industrielles impor-
tantes de la Hongrie. C'est le Conseil des ouvriers de Szeged
qui a le premier mis en avant la revendication d'auto-gestion
ouvrière des usines. Après s'être longtemps tue sur les Con-
seils, l'Humanité écrit le 15 novembre par le truchement
d'André Stil que les Conseils sont « constitués par des aventu-
riers et des éléments du lumpen-prolétariat ». Stil est en re-
tard d'un mensonge, car le lendemain du jour où il écrivait
cela, le gouvernement Kadar était forcé, par la grève géné-
rale, à entrer en négociations avec le Conseil Central des
Ouvriers de Budapest et à lui promettre que toutes ses reven-
dications seront satisfaites, pour obtenir la reprise du travail.
38° Le silence de L'Humanité et les ignobles calomnies de
Stil ne prouvent-ils pas que la direction du P.C.F. craint
par dessus tout une chose, l'organisation autonome des
ouvriers dans des Conseils, qui sont le véritable et seul
instrument du pouvoir ouvrier?
Les revendications de plusieurs de ces Conseils ont formé
l'essentiel du programme formulé par la direction des syn-
76
(c
dicats hongrois. Voici le texte de ce programme. tel qu'il a
été reproduit dans Le Monde du 28-29 octobre 1956 :
Constitution de conseils d'ouvriers dans toutes les
usines.
Instauration d'une direction ouvrière. Transformation
radicale du système de planification et de direction de l'éco-
nomie exercée
par
l'Etat.
Rajustement des salaires, augmentation immédiate de
15 % des salaires inférieurs à 800 forint et de 10 % des sa-
laires de moins de 1.500 forint. Etablissement d'un plafond
de 3.500 forint pour les traitements mensuels.
Suppression des normes de production, sauf dans les
usines où les conseils d'ouvriers demanderaient le
maintien.
- Suppression de l'impôt de 4 % payé par les céliba-
taires et les familles sans enfants. Majoration des retraites les
plus faibles. Augmentation d utaux des allocations familiales.
Accélération de la construction de logements par l'Etat. »
en
се
39° Pourquoi L'Humanité n'a-t-elle
pas
mentionné
programme?
40° Ce programme est-il réactionnaire, ou bien est-il pro-
fondément socialiste?
41° Le socialisme consiste-t-il en ce qu'un appareil de bu-
reaucrates dirige les usines et la production, ou bien en
ce que des Conseils d'ouvriers dirigent, comme le de
mandent les travailleurs hongrois?
42° Pourquoi les ouvriers hongrois demandent-ils la suppres
sion des normes de production sauf là où les Conseils
d'ouvriers en demanderaient la maintien? Comment sont
déterminées les normes de travail dans les démocraties
populaires et en Russie? Le sont-elles autrement quo
dans les pays capitalistes? Etes-vous conscient de ce que
signifie pour les ouvriers la détermination des normes
de travail par d'autres qu'eux-mêmes? Croyez-vous que
les ouvriers sont capables d'établir eux-mêmes une dis-
cipline dans la production, ou bien qu'il faut les y forcer
par les normes, le salaire aux pièces ou au rendement,
et la contrainte exercée par les contremaîtres?
Cette dernière position n'est-elle pas celle de M. Geor.
ges Villiers et de tous les patrons du monde?
N'est-ce pas celle qui est appliquée en Russie et dans
les démocraties populaires?
43° Pourquoi les ouvriers hongrois demandent-ils une ré-
duction considérable de la hiérarchie? Est-ce une reven-
dication réactionnaire? Pourquoi en France la C.G.T.
77
)),
soutient pratiquement toujours le maintien ou l'aggra-
vation de la hiérarchie?
44° Pourquoi les ouvriers hongrois demandent-ils l'établisse-
ment d'un plafond aussi bas pour les traitements inen-
suels (3.500 forint, le salaire moyen semblant se situer
autour de 1.000 forint) ? Cette revendication à elle seule
ne démontre-t-elle pas qu'il devait y avoir un gonflement
exorbitant des revenus des « mensuels c'est-à-dire les
bureaucrates? L'existence d'une hiérarchie étendue des
traitements ne rétablit-elle pas une répartition des re-
venus personnels comparable à celle qui existe dans la
société capitaliste, si l'on tient comnte du fait que le
bureaucrate utilise tout son revenu pour sa consoinma-
tion personnelle, l'accumulation étant faite par l'Ftat?
Exista-t-il ou non, dans les démocraties populaires et en
Russie, des traitements vingt, cinquante ou' cent fois su-
périeurs au salaire moyen des ouvriers? Cela n'équivau-
drait-il pas en France à les traitements ou à des revenus
mensuels de six cent mille francs, trois millions ou six
millions?
Pendant les deux premières semaines de l'insurrection, il
s'est constitué à Budapest un « parti révolutionnaire de la
jeunesse ». On sait que la jeunesse a joué un rôle de premier
plan dans toute l'insurrection. Le programme de ce parti,
publié par Le Monde du 3 novembre, déclarait « qu'il n'est
pas question de rendre les usines aux capitalistes, ni la terre
aux propriétaires fonciers ».
45° La constitution de ce parti ne montre-t-elle pas que, en
plus des Conseils ouvriers, des forces révolutionnaires
saines, qui voulaient rompre avec un passé répudié par
tout le monde et avancer vers le socialisme, étaient en
train de s'organiser? Que kadar n'a ni pu ni voulu s'y
appuyer? Que l'intervention armée des Russes a abouti
à les écraser?
Parlant des événements de Pologne et de Hongrie dans
L'Humanité du 25 octobre 1956, Marcel Servin attribue les
« difficultés matérielles qui subsistent encore » dans ces pays
aux destructions subies pendant la guerre, à l'effort de
défense, enfin à « des erreurs commises par certains partis
des pays de démocratie populaire, notamment dans l'établis-
sement de leurs plans économiques, erreurs reconnues, corri-
gées ou en voie de coriection ».
Quelques jours plus tard, Etienne Fajon, dans son dis-
cours à la Maison des Métallurgistes reproduit dans L'Hu-
manité du 3 novembre, disait :
78
« C'est ainsi qu'en Pologne, dès 1953, le revenu natio-
nal avait doublé par rapport à l'avant guerre; la production
industrielle avait presque quadruplé... l'année dernière, la
consommation de viande par tête d'habitant était deux fois
plus élevée qu'avant la guerre, la production de chaussures
dix fois plus élevée... Des transformations analogues avaient
été enregistrées en Hongrie... la production de l'industrie
alimentaire y avait triplé... ))
46° Si les données fournies par Fajon sont exactes, n'est-il
pas évident que Servin essaie de noyer le poisson en
parlant des destructions dues à la guerre, onze ans après
la fin de celle-ci, et lorsque tout le monde sait que dans
tous les pays européens, de l’Est comme de l'Ouest, la
reconstruction avait été achevée au plus tard en 1949.
1950 ? Et n'est-ce pas le même sophisme auquel se livre
Fajon plus loin dans son discours en parlant lui aussi
des « effroyables destructions de la guerre », après avoir
dit
que
dès 1953 trois ans avant les événements
actuels le revenu national en Pologne avait doublé
par rapport à l'avant guerre ?
47° Si les données de Fajon sont exactes consommation
de viande doublée, production de chaussures décuplée,
production des industries alimentaires triplée, etc.
c'est-à-dire si les masses travailleuses dans ces pays
avaient connues une amélioration aussi importante de
leur niveau de vie, y aurait-il eu la moindre chance pour
les anciens exploiteurs ou les agents américains de
fomenter une insurrection qui dure des semaines ? Les
travailleurs seraient-ils à ce point dépourvus, non pas
même de conscience de classe, mais du sens de la réalité?
Sur l'évolution du niveau de vie en Pologne, voilà ce
que dit Gomulka dans son discours du 20 octobre devant
le Comité Central du parti polopais, radiodiffusé dans tout
le pays (d'après le texte publié dans France-Ohservateur):
« Le plan sexennal économique que l'on a prôné dans le
passé avec beaucoup d'impétuosité comme étant une
velle étape en vue d'un accroissement élevé rlu niveau de vie
a trompé les espoirs des larges masses des travilleurs. La
jonglerie des chiffres, chiffres qui ont indiqué une augmen-
tation de 27 % des salaires réels au cours du plan sexennal,
n'a pas réussi; cela n'a fait qu'irriter davantage les gens ».
nou-
ܪܚܳܐ. ܐ ܕܚܬ݁ ܝܳܐܐ ܡܶܬܚܙܡܵtܗ
48° Croyez-vous que Gomulka pouvait mentir sur une telle
question dans un discours porté à la connaissance
de toute la population polonaise ? Si non, n'est-il pas
79
évident que Fajon et la direction du P.C.F. falsifient
les faits ?
Personne ne conteste qu'il y ait eu une augmentation
importante de la production dans les pays de démocratie
populaire. Il y en a une d'ailleurs également dans les pays
capitalistes. Mais à qui profite-t-elle ?
49° Si, comme le dit Gomulka dans le passage cité plus haut,
parler d'une augmentation des salaires réels en Pologne
n'est qu'« une jonglerie des chiffres qui ne trompe per.
sonne », à quoi a-t-on utilisé le supplément de produc-
tion ? A construire des usines ? Mais le capitalisme ne
construit-il
pas
lui aussi des usines ? A quoi sert l'aug.
mentation de la production dans le capitalisme, sinon
à construire des nouvelles usines et à augmenter la
consommation des privilégiés, les salaires n'étant aug.
mentés que dans la mesure où les ourriers luttent pour
arracher des augmentations? La situation dans les pays de
démocratie populaire est-elle différente à cet égard ? En
quoi ? Pendant que les salaires ouvriers stagnent en Polo-
gne, qu'advient-il des traitements des bureaucrates, de
ceux dont les ouvriers hongrois demandaient justement
la limitation ? Si l'on construit des usines automobiles,
par exemple, pendant que les salaires ouvriers stagnent,
à qui sont destinés les automobiles produites ?
0. Lange, économiste du Parti Ouvrier Unifié (commu-
niste) de Pologne, a écrit dans un article qui a servi de base
au programme économique élaboré au VI° Plenum du
Comité Central de ce parti (juillet 1956, donc avant le retour
de Gomulka au pouvoir) et qui a été traduit dans le numéro
de septembre-octobre 1956 des « Cahiers internationalix »
(revue dont le Comité de patronage comprend Alain Le
Léap):
« Pour cela (pour surmonter les difficultés économiques
existantes), il faut également liquider i'appareil bureaucra.
tique pléthorique qui a proliféré dans tous les domaines de
l'économie nationale. Cet appareil freine le bon fonctionne.
ment de l'économie ct absorbe de façon non productive une
partie excessive du revenu national. Les masses laborieuses
le savent, elles qui considèrent comme un signe de gaspillage
et de mauvaise gestion ce trop important appareil bureau-
cratique ».
50° Si l'appareil bureaucratique « absorbe d'une façon non
productive une partie excessive du revenu national »,
s'agit-il là d'une « erreur » ? Cet appareil ne vit-il pas
par l'exploitation du travail productif des travailleurs ?
80
51° Pourquoi Thorez et Fajon, ni dans leurs allocutions du
2 novembre, ni nulle part ailleurs, ne parlent-ils pas de
cet appareil bureaucratique, de ses privilèges basés sur
l'exploitation des masses, mais parlent seulement d'« er-
reurs de planification », comme si un ingénieur s'étoit
trompé avec sa règle à calcul ? N'est-ce pas parce qu'ils
sont eux-mêmes, et quelques milliers de cadres du P.C.F.,
candidats à ce rôle de bureaucrates-exploiteurs au cas
où ils accéderaient au pouvoir ?
Personne ne conteste l'augmentation de la production
dans les démocraties populaires. Mais comment est-elle obte-
nue ? Gomulka constate, dans son discours, qu'au cours du
plan sexennal (1950-1955), la production de charbon do
Pologne est passée de 74 à 94,5 millions de tonnes. Mais,
en même temps, « les mineurs ont fait, en 1955, 92.634.000
heures supplémentaires, ce qui constitue 15,5 % du nombre
global d'heures réalisées au cours de cette période. Cela
représente 14.600.000 tonnes de charbon extraites en dehors
des heures normales de travail... En 1949, l'extraction houil-
lère, au cours d'une journée-travail, était de 1.320 kg par
mineur. En 1955, cette production est tombée à 1.163 kg.
c'est-à-dire de 12,4 %. Si nous considérons seulement l'extrac
tion calculée par équipe de fond, cette diminution de l'ex
traction s'élève à 7,7 % pendant ce temps par journée-
travail ».
Dans un autre extrait de son discours, cité par L'Express
du 26 octobre, Gomulka dit :
« La politique économique, en ce qui concerne notre
industrie minière, a été caractérisée par une légèreté crimi
nelle. On a institué comme règle le travail du dimanche,
ce qui ne pouvait que ruiner la santé et les forces du mineur,
et rendre impossible l'entretien adéquat de l'équipement
minier. On a imposé à beaucoup de nos mineurs un travzil
de soldat et de prisonnier ».
52° Les méthodes utilisées pour augmenter la production de
charbon en Pologne ne sont-elles pas comparables aux
pires méthodes d'exploitation capitaliste (heures supplé.
mentaires, travail du dimanche, discipline de « soldat »
et de « prisonnier »)?
53° Si le mineur polonais est soumis à ce régime pendant
son travail et si, parallèlement, son niveau de vie n'ang-
mente pas, en quoi la « nationalisation » et la « plani-
fication » ont-elles changé sa situation réelle ?
54° La diminution du rendement par mineur, citée par
Gomulka, relève-t-elle des « erreurs » et des « dispro-
portions » dont parlent Servin, Thorez et Fajon, ou bien
81
exprime-t-elle une attitude des mineurs face à la pro-
duction ? Dans tous les régimes où les travailleurs se
savent exploités, leur première réaction n'est-elle pas le
refus de coopérer à la production ? Dans les usines
capitalistes, n'observe-t-on
pas quotidiennement
conflit insurmontable entre les ouvriers et l'appareil de
direction autour du rendement ?
un
On pourrait penser que cette situation est particulière
à l'industrie minière. Voilà ce que dit, concernant l'économie
dans son ensemble, 0. Lange dans son article déjà cité
(pages 73 et 78):
« Nous observons, depuis plusieurs années déjà, une
indifférence croissante à l'égard du travail, dans l'appareil
administratif, de distribution et des services. Cette indiffé-
rence paralyse notre vie quotidienne. Actuellement, elle
gagne également les rangs de la classe ouvrière qui, étant la
partie la plus consciente -- du point de vue social et poli-
tique – de la nation, s'y était le plus longtemps opposée.
Toutes les possibiltés de diriger à l'aide de slogans moraux
et politiques et d'ordres de nature juridique et administra-
tive sont aujourd'hui épuisées... L'attitude nihiliste d'une
grande partie des travailleurs découle tant du bas niveau
de vie que du fait qu'ils doutent que la politique écono-
mique qui exige des masses laborieuses de tels sacrifices,
soit juste et fondée ».
55° Y a-t-il des raisons de penser que, sur les points essen-
ticls, la situation en Hongrie ou dans les autres démo-
craties populaires soit substantiellement différente de ce
qu'elle est en Pologne ?
56° Ce que Lange appelle, dans son langage de bureaucrate,
« attitude nihiliste des travailleurs », est-il autre chose
que la juste réaction de classe des ouvriers qui se savent
exploités, ne croient pas aux mensonges qu'on leur
raconte, et refusent leur coopération à la production
autant qu'ils le peuvent ?
57° Pour que cette réaction de classe des ouvriers arrive à
« paralyser la vie quotidienne » chose qu'on n'a pres-
que jamais vu dans aucune société d'exploitation
faut-il pas que l'exploitation et l'oppression soient deve-
nues intolérables ?
58° Lorsqu'à partir d'une telle situation les ouvriers, au lieu
de sombrer dans le désespoir et le « nihilisme », pren.
nent les armes, se révoltent, forment des Conseils et eri.
gent la gestion ouvrière de la production, comme ils
l'ont fait en Hongrie, êtes-vous avec eux ou avec « l'appa-
ne
82
reil bureaucratique qui freine le bon fonctionnement de
l'économie et absorbe de façon non productive une par-
tie excessive du revenu national » ?
Le vendredi 2 novembre, le gouvernement de Pékin a
publié une déclaration dans laquelle il est dit :
« Certains pays socialistes ont négligé le principe de
l'égalité des nations dans leurs rapports entre elles. Une telle
erreur, dont l'essence est de nature chauvine-bourgeoise,
peut, particulièrement lorsqu'elle est commise par une grande
puissance, causer un grand tort à la cause et à la solidarite
des pays socialistes... Ce sont de telles erreurs qui ont pro-
voqué des situations tendues qui autrement. ne se seraient
pas produites, comme celles de la Yougoslavie naguère, de
la Pologne et de la Hongrie actuellement ».
Cette déclaration a été reproduite par Le Monde du
4-5 novembre 1956, mais non par L'Humanité. C'est peut-être
une de ces « opinions de tel ou tel dirigeant d'un parti frère »
que, d'après Fajon, les lecteurs de L'Humanité n'ont pas le
droit de connaître. Toutefois, d'une façon emasculée, on
retrouve la même idée dans la déclaration soviétique clu
30 octobre (publiée dans L'Humanité du 31) où il est dit :
Plus d'une difficulté a surgi, plus d'une tâche n'a pas
été résolue, et des erreurs pures et simples ont été commises,
en particulier en ce qui concerne les relations entre pays
socialistes. Ces violations et ces erreurs ont réduit la portée
des principes de l'égalite en droits dans les relacions entre
les pays socialistes ».
59° Que signifie en français clair « négliger le principe de
l'égalité des nations dans leurs rapports entre elles » ?
Cela ne veut-il pas dire qu'une nation « une grande
puissance », comme dit la déclaration de Pékin, cvec
une délicatesse toute chinoise c'est-à-dire la Russie.
domine les autres ? Est-il concevable que de plusieurs
pays « socialistes » il y en ait un qui domine les autres ?
Comment, non pas tel acte de tel dirigeant, mais la
politique d'un pays « socialiste » pendant des années et
ses rapports avec d'autres pays « socialistes » peuvent-
elles présenter des « erreurs d'essence bourgeoise-chau-
vine » ? Ces « érreurs » n'ont-elles pas des racines éco-
nomiques et sociales aussi bien en Russie même
que
dans
les autres pays « socialiste » ? Lorsque la Russie prend
l'uranium hongrois ou tchèque, le charbon polonais, ie
tabac bulgare et vend à ces pays ses produits, en fixant
souverainement dans les deux cas le prix, est-ce une
ou de l'exploitation ? Cette exploitation,
même si elle prend des formes différentes, n'aboutit-elle
( erreur )
83
pas aux mêmes résultats que l'exploitation des pays
coloniaux par les pays impérialistes occidentaur ?
Comme dans le cas de l’Algérie et de la France, la domi-
nation politique et l'exploitation économique ne se con-
ditionnent-elles pas alors l'une l'autre ?
60° Si le gouvernement russe parle aujourd'hui et pour
l'instant il ne fait rien de plus que parler de redres-
ser ces « erreurs », est-ce parce qu'il est devenu meilleur
ou parce que la résistance des Polonais et des Hongrois
l'y oblige? En quoi diffère-t-il des colonialistes francais
qui n'ont commencé à se retirer du Maroc et de la Tunisie
que lorsque la résistance de ces peuples les y a forcés ?
Wink
84
L'insurrection hongroise
LA VERITE SUR DOUZE JOURS DE LUTTE
Que s'est-il exactement passé entre le 23 octobre et le
2 novembre ?
Nous essayerons de le dire en nous appuyant presque
exclusivement sur des informations diffusées par la presse
et la radio hongroise, c'est-à-dire sans nous référer à des témoi-
gnages dont on peut contester l'impartialité. La plupart des
informations dont nous faisons usage ont été publiées par la
presse française , mais cette presse a fonctionné comme presse
bourgeoise. C'est-à-dire qu'elle a cherché à dissimuler ou à
minimiser l'action du prolétariat et qu'en revanche elle a
mis au premier plan tout ce qui permettait de présenter
l'insurrection comme un souièvement national. Toutes les
revendications politiques et nationales ont été soulignées
et on a surtout parlé des combats que menaient les « insur-
gés » en général, sans chercer à expliquer quelles étaient
les forces sociales en lutte. Ce n'est que dans la toute dernière
période qu'on a annoncé que des tendances très diverses se
manifestaient. On n'a mentionné qu'incidemment l'existence
des conseils, et leurs revendications. Grâce à cette maneuvre
la presse a complètement déformé les traits de la révolution
pendant la toute première période. Pendant les trois premiers
jours en effet les émissions de radio-Budapest étaient pour
leur plus grande part consacrées à l'action des usines, celles
des faubourgs de Budapest – Csepel, Rada Utca, Ganz, I.unz,
Etoile Rouge, Jacques-Duclos – celles des grands centres
industriels de province -- à Miskolc, Gyor, Szolnok, Pecs,
Debrecen, etc...
Les villes où, selon des informations de sources diverses,
des mouvements insurrectionnels ont éclaté depuis la nuit
du 23 au 24 octobre ont été, en dehors de Budapest:
Région de Borsod: Hongrie nord-orientale, aux confins
de la Tchécoslovaquie. Mines de charbons et aciéries parmi
les plus importantes du pays, importantes centrales élec-
triques. Centre de l'industrie chimique hongroise. Ville la
plus importante: Miskolc, 100.000 habitants. Autre centre
sidérurgique: Diosgyoer.
85
I
C
t
C
De ces
1
€
Région de Baranya : Hongrie méridionale, aux confins
des frontières yougoslaves, entre le Danube et la Drau. Mines
de charbon, gisements d'uranium découverts il y a quelques
années. Capitale: Pecs.
Gyoer: Hongrie occidentale, sur le Danube, sur la route
de Budapest à Vienne. Ville industrielle, notamment la plus
grosse usine de matériel ferroviaire de Hongrie.
Szeged: troisième ville de Hongrie. Région agricole, aux
confins des frontières yougoslaves et roumaines. Importante
université.
Szolnok: l'un des plus gros centres ferroviaires de Hon-
grie. Base aérienne. Passage de la ligne de chemin de fer en
direction de Moscou.
émissions il ressortait qu'à l'exception de
Budapest où dès le début l'ensemble de la population
s'était soulevé, le combat révolutionnaire reposait exclut
sivement sur les ouvriers d’usine: ceux-ci formaient partout
des Conseils, partout formulaient des revendications révolu-
tionnaires, partout s'emparaient d'armes, en plusieurs endroits
se battaient avec acharnement.
On sait que tout a commencé le 23 octobre par une mani.
festation de solidarité en faveur des polonais, organisée par le
cercl, Petoefi, c'est-à-dire par les étudiants et les intellec-
tuels. Cette manifestation d'abord interdite, puis autorisée au
dernier moment par le gouvernement fut rejointe par des
masses d'ouvriers et d'employés qui avaient quitté les usines
et les bureaux. Elle se développa dans l'ensemble pacifique-
ment. Mais dans la soirée un discours de Geroe mit le feu
aux poudres. Alors qu'ils s'attendaient à d'importantes conces.
sions de la part du gouvernemnt les manifestants s'entendirent
dire que l'amitié de la Hongrie pour l’U.R.S.S. était indéfec-
tible, que des éléments troubles qui voulaient créer de l'agi-
tations seraient matés et que le comité central n'avait pas
l'intention de se réunir avant le 31 octobre, soit huit jours
plus tard. A la suite de Geroe, Nagy prodigua quelques bonnes
paroles et un appel au calme. Les manifestants ressentirent le
discours de Geroe comme une provocation. Une colonne de
manifestants se dirigea vers la Radio et chercha à
pour que soient diffusées leurs revendications : « La radio
mertNous voulons faire connaître ce que nous voulons ».
La police de sécurité tira alors sur les manifestants et à
partir de ce moment-là les combats se propagent dans la
Quelques heures plus tard, Geroe, affolé, appelle
Nagy au Gouvernement, mais cela ne modifie en rien l'atti-
tude des insurgés, qui mettent en avant des revendications de
fond, et ne se contentent pas d'un changement de personnes.
Le discours de Geroe mit donc le feu aux poudres. Mais
il serait risqué de penser que les manifestants seraient sage-
y pénétrer
vill.
86
dent rantrés chez eux si l'on avait bien voulu leur annoncer
e retour immédiat de Nagy au pouvoir. Il y avait très long-
emps qu'une extraordinaire effervescence règnait à Budapest.
Et nous ne pensons pas seulement aux manifestations du
ercle Petoefi où d'importants meetings avaient dénoncé tou-
ours plus violemment la politique du gouvernement et le
-ôle de l'U.R.S.S. Nous ne pensons pas seulement, non plus,
l'extraordinaire climat qu'avaient suscité les funérailles de
Rajk puis celles d'anciens membres du Parti et d'anciens
officiers dont les masses avaient appris quelques fois en même
emps la liquidation et la réhobilitation. Un fort courant
s'opposition grandissait depuis des mois au sein du Parti; la
Hémocratisation, la limitation de l'emprise russe étaient de-
mardées avec insistance, les crimes et les tares du régine
étaient dénoncées publiquement. Les événements de Pologne
avaient porté à son comble cette agitation. C'est cette situation
qui explique que, par la suite, la grande majorité des ca.!res
moyens du Parti et de ses militants de base se sont trouvés
du côté des insurgés. Mais en même temps, une grande agi-
tation se manifestait dans les usines.
Dès le mois de juillet dernier, l'organe du parti la signa-
lait et demandait des réforines d'urgence pour apaiser les
ouvriers. Le gouvernement dut ainsi promettre, à cette
époque, que le niveau de vie des masses serait relevé de
25% et annoncer l'abolition de l'emprunt forcé ( qui équiva-
lait à une retenue de 10% sur les salaires). Les promesses
n'avaient pourtant pas suffi, elles étaient d'ailleurs tempé-
rées par la légalisation de la semaine de 46 heures (heures
normales) alors qu'un projet précédent avait prévu 42 heures.
De toutes manières les ouvriers étaient décidés à ne pas se
contenter de quelques miettes; ils ne voulaient plus des ca-
elence de production imposées par le gouvernement; ils ne
voulaient plus des ordres du syndicat et du parti qui étaient
des agents de l'Etat aussi serviles que le directeur d’usine et
ils élevaient la voix d'autant plus haut qu'en face d'eux les
dirigeants syndicaux et politiques se trouvaient chaque jour
discrédités par l'étalage dans la presse des méfaits du régime
Rakosi auxquels ils avaient appartenu.
Les ouvriers qui étaient dans la rue le 23 octobre
n'étaient pas seulement venus réclamer le retour de Nagy;
ils avaient autre chose en tête, leur attitude peut être résu-
mée par la déclaration d'un ouvrier tourneur des grandes
usines Csepel, publiée deux jours plus tôt par l'organe des
jeunesses communistes : « Jusqu'à présent nous n'avons pas
dit mot. Nous avons appris pendant ces temps tragiques a
être silencieux et à avancer à pas de loup. Soyez tranquilles,
nous parlerons aussi »,
87
a
une
annonce
ce
mer
se
sont
Dans la nuit du 23 au 24, la police de sécurité continue
à tirer sur les manifestants. Mais les soldats hongrois frater.
nisent avec ces derniers, et dans les «asernes, ils fournis-
sent eux-mêmes des armes aux manifestants, ou n'opposent
aucune résistance lorsque ceux-ci s'emparent des armes. Des
ouvriers des arsenaux amènent des armes et les distribuert.
Le lendemain lieu notamment grande bataille
devant le parlement où interviennent,
Radio
Budapest, les chars soviétiques et des avions. Il n'y a pas
de doute sur le rôle que jouent les ouvriers
credi 24 ; ils battent
2 vec acharnement. Ce
les ouvriers des usines Csepel qui sont à l'avant-garde
et qui créent le comité central de l'insurrection. Un tract
édité par « les étudiants et les ouvriers révolutionnaires »
appelle à la grève générale. Le même jour la radio offi-
cielle annonce que des troubles ont éclaté en province dans
les usines; elle diffuse constamment des communiqués qui
font état de manifestations survenues dans les centres indus
triels de Hongrie. Le soir, elle annonce que le calme est
revenu dans certaines entreprises de province et elle appelle
instamment les ouvriers à reprendre le travail le lendemain
matin. Le jeudi, le gouvernement donne l'ordre de nouveau
aux ouvriers et aux fonctionnaires de reprendre le travail,
ce qui atteste que la grève continue.
A plusieurs reprises le gouvernement se croit maître de
la situation et le dit. C'est qu'il ne comprend pas exactement
ce qui se passe dans le pays entier: des comités ouvriers se
constituent un peu partout mais le plus souvent ils expriment
leur confiance à Nagy; la grève est générale mais elle n'est
pas dirigée contre Nagy. Par exemple le conseil révolution-
Daire de Miskolc qui joue très vite un rôle de premier plan
demande le 25 « un gouvernement où soient placés des com-
munistes dévoués au principe de l'internationalisme proléta-
rien, qui soit avant tout hongrois et respecte nos traditions
nationales et notre passé millénaire ».
Les conseils peuplent la Hongrie, leur pouvoir devient
dès jeudi le seul pouvoir réel en dehors de l'armée russe.
Mercredi, le gouvernement manie tour à tour la menace et
la prière. Tour à tour il annonce que les insurgés seront
écrasés et leur propose de rendre les armes en échange d'une
amnistie. Mais à partir de jeudi après-midi il s'avère qu'il est
impossible de faire quoique ce soit contre la grève générale
et les Conseils. Entre trois et quatre heures de l'après-midi
Nagy et Kadar promettent qu'ils vont négocier le départ des
Russes ; le soir le Front Populaire Patriotique déclare à la
radio: « le gouvernement sait que les insurgés sont de bonne
foi ». L'organe du P.C. hongrois, Szabad Nep a déjà reconnu
le même jour que le mouvement n'est pas seulement l'auvre
88
de contre-révolutionnaires mais qu'il est aussi « l'expression
de l'amertume et du mécontentement de la classe ouvrière ».
Cette reconnaissance partielle de l'insurrection a été, comme
on le voit, dépassée par les événements en quelques heures
et c'est l'ensemble de l'insurrection que le gouvernement est
contraint de légitimer. Le lendemain matin, le commandant
des forces de l'ordre s'adrese par la radio aux insurgés en les
appelant « jeunes patriotes ».
Il y a donc jeudi une espèce de tournant. Il semble que
l'insurrection ait vaincu, que le gouvernement cède. Et Nagy
sanctionne ce changement en réformant le gouvernement; il
appelle à collaborer avec lui Bela Kovacs, ancien secrétaire
du parti des petits propriétaires, emprisonné par les Russes
pour « espionnage » et Zoltan Tildy, du même parti, ancieri
président de la République, au lendemain de la guerre. Cette
transformation gouvernementale est très étonnante. Elle vise
bien à satisfaire l'opinion puisqu'elle montre que le parti
communiste est prêt à collaborer désormais avec d'autres
partis; en même temps Nagy donne des gages de son hosti-
lité aux Russes car il n'y a pas de doute que ses nouveaux
collaborateurs, persécutés récemment par Moscou, l'aideront
à exiger de nouvelles relations avec l’U.R.S.S. Mais cette ré-
forme ne satisfait pas les Conseils ouvriers: ceux-ci deman-
dent bien l'indépendance nationale et la démocratie, mais ils
ne veulent pas de politiciens réactionnaires qui, au surplus,
ont déjà collaboré avec les Russes. Le retour au pouvoir des
anciens leaders « petits propriétaires » satisfait probable.
ment, en revanche, une partie de la paysannerie et la petite
bourgeoisie de Budapest, mais en même temps elle incite ces
couches à s'enhardir, à formuler leurs propres revendications
et à venir sur le devant de la scène, alors que jusqu'à présent
le combat révolutionnaire avait reposé principalement sur le
prolétariat.
Plaçons-nous maintenant à la date du samedi 27 octobre
et avant de rechercher comment évolue la révolution, consi-
dérons ce que fut l'insurrection ouvrière durant les quatre
premiers jours.
Le Conseil de Miskolc nous servira d'exemple.
Ce conseil a été formé dès le 24. Il a été élu démocrati.
quement par tous les ouvriers des usines de Miskolc. indé-
pendamment de toute position politique. Il a ordonné aussitôt
la grève générale, sauf dans trois secteurs : les transports,
l'énergie électrique et les hôpitaux. Ces mesures témoignent
de son souci de gouverner la région et d'assurer à la popala-
tion le maintien des services publics. Très tôt également (le
24 ou le 25) le Conseil a envoyé une délégation à Budapest
pour prendre contact avec les insurgés de la capitale, leur
89
apporter le soutien actif de la province et agir de concert avec
eux. Il publie un programme en quatre points :
Retrait immédiat de toutes les troupes soviétiques ;
Formation d'un nouveau gouvernement;
Reconnaissance du droit de grève;
Amnistie générale pour les insurgés.
Sur le plan politique, le Conseil a nettement défini sa
position, le jeudi 25. Grâce à la radio dont il s'est emparé,
celle-ci a été aussitôt connue dans la Hongrie entière. Nous
l'avons déjà rapporté : il est pour l'internationalisme prolé-
tarien et simultanément pour un communisme hongrois na-
tional. L'association des deux idées peut paraître confuse du
point de vue des principes de communisme. Dans les cir-
constances présentes, elle est parfaitement compréhensible.
Le conseil est internationaliste, c'est-à-dire qu'il est prêt à
lutter avec les communistes et les ouvriers du monde entier,
mais il est national c'est-à-dire qu'il refuse toute sujetion à
l'U.R.S.S. et demande que le communisme hongrois soit libre
de se développer comme il l'entend.
Par ailleurs le Conseil n'est pas opposé à Nagy. Il pro-
pose un gouvernement dirigé par celui-ci. Cela ne l'empêche
pas de faire le contraire de ce que demande Nagy. Au mo-
ment où celui-ci supplie les insurgés de déposer les armes et
plus particulièrement les ouvriers de reprendre le travail, le
Conseil de Miskolc forme des reilices ouvrières, maintient et
étend la grève et s'organise comme un gouvernement local
indépendamment du pouvoir central. Ce n'est pas seulement
parce qu'il veut chasser les Russes et qu'il croit Nagy leur
prisonnier. Il n'est prêt à soutenir Nagy que si celui-ci appli-
que le programme révolutionnaire. Ainsi, quand Nagy fait
entrer au gouvernement les représentants du parti des pro-
priétaires, il réagit vigoureusement. Dans un « communiqué
extraordinaire » diffusé par sa radio le samedi 27 à 21 h. 30,
le Conseil déclare notamment qu'il « a pris en main le pou-
voir dans tout le comitat de Borsod. Il condamne sévèrement
tous ceux qui qualifient notre combat de combat contre la
volonté et le pouvoir du peuple. Nous avons confiance en
Imre Nagy, ajoute-t-il, mais nous ce sommes pas d'accord
avec la composition de son gouvernement. Tous ces politi-
ciens qui se sont vendus aux Soviets ne doivent pas avoir leur
place dans le gouvernement. Paix, Liberté et Indépendance ».
Cette dernière déclaration met bien en relief aussi l'acti-
vité du Conseil qui, nous venons de le dire, se comporte
come un gouvernement autonome. Le jour même où il prend
le pouvoir dans tout le département de Borsod, il dissoud les
organismes qui sont la trace du régime précédent, c'est-à-
dire toutes les organisations du parti communiste (cette me-
sure est annoncée le dimanche matin par sa radio). Il annonce
90
aussi que les paysans du département ont chassé les respon.
sables des kolkhoses et procédé à une redistribution de la
terre.
Le lendemain, enfin, radio Miskolc diffusera un appel
demandant aux conseils ouvriers de toutes les villes de pro-
vince « de coordonner leurs efforts en vue de créer un seul
et unique puissant mouvement ».
Ce que nous venons de rapporter suffit à montrer que
s'est manifesté dès le lendemain du déclenchement de l'in-
surrection de Budapest un mouvement prolétarien qui a
trouvé d'emblée sa juste expression par la création des con-
seils et qui a constitué le seul pouvoir réel en province. A
Gyoer, à Pecs, dans la plupart des grandes autres villes il
semble
que la situation ait été la même qu'à Miskolc. C'était
le Conseil Ouvrier qui dirigeait tout; il armait les combat-
tants, organisait le ravitaillement, présentait des revendica-
tions politiques et économiques. Pendant ce temps, le gouver-
nement de Budapest ne représentait rien ; il s'agitait, lançait
des communiqués contradictoires, menaçait puis suppliait les
ouvriers de déposer les armes et de reprendre le travail. Son
autorité était nulle.
En face des conseils il n'y avait que les troupes russes,
et encore dans certaines régions il semble bien qu'elles ne se
battaient pas. Dans le département de Miskolc, notamment,
on signala que les troupes étaient dans l'expectative et que
dans plusieurs occasions des soldats soviétiques fraternisaient.
Des faits analogues sont signalés dans la région de Gyor.
Nous ne connaissons pas précisément toutes les revendi.
cations formulées par ces Conseils. Mais nous avons l'exemple
du Conseil de Szeged. Selon un correspondant yougoslave
(du journal Vjesnik de Zagreb) qui se trouvait dans cette
villc, le 28 octobre a eu lieu une réunion des représentants
des Conseils ouvriers de Szeged, les revendications adoptées
ont été: le remplacement des autorités locales staliniennes,
l'application de l'autogestion ouvrière et le départ des troupes
russes
une
Il est tout à fait extraordinaire de remarquer que les
conseils nés spontanément dans des régions différentes, par-
tiellement isolés par les armées russes aient immédiatement
cherché à se fédérer. Ils tendaient à constituer à la fin de la
première semaine révolutionnaire république des
Conseils.
Sur la base de telles informations, l'image qu'a composé
la presse bourgeoise d'une simple participation ouvrière à un
soulèvement national est évidemment artificielle. Répétons-le:
on était en présence de la première phase d'une révolution
prolétarienne.
Quels étaient les objectifs de cette révolution?
- 91
Nous les connaissons par une résolution des syndicats
hongrois, publiée le vendredi 26, c'est-à-dire trois jours après
le déclenchement de l'insurrection. Elle contient toute une
série de revendications d'une immense portée.
Sur le plan politique, les syndicats demandent:
1° Que la lutte cesse, qu'une amnistie soit annoncée et
que des négociations soient entreprises avec les délégués de
la jeunesse;
2° Qu'un large gouvernement soit constitué, avec M. Imre
Nagy comme président, et comprenant des représentants des
syndicats et de la jeunesse. Que la situation économique du
pays soit exposée en toute franchise;
3° Qu'une aide soit accordée aux personnes blessées
dans les luttes tragiques qui viennent de se dérouler et aux
familles des victimes ;
4° Que la police et l'armée soient renforcées pour main-
tenir l'ordre par une garde nationale composée d'ouvriers et
de jeunes;
5° Qu'une organisation de la jeunesse ouvrière soit
constituée avec l'appui des syndicats;
6° Que le nouveau gouvernement engage immédiatement
des négociations en vue du retrait des troupes soviétiques du
territoire hongrois.
Sur le plan économique :
1° Constitution de conseils d'ouvriers dans toutes les
usines;
2° Instauration d'une direction ouvrière. Transformation
radicale du système de planification et de la direction de
l'économie exercée par l'Etat. Rajustement des salaires, aug.
mentation immédiate de 15 % des salaires inférieurs à 800
forint et de 10 % pour les salaires de moins de 1.500 forint.
Etablissement d'un plafond de 3.500 forint pour les traite-
ments mensuels. Suppression des normes de production, sauf
dans les usines où les conseils d'ouvriers en demanderaient
le maintien. Suppression de l'impôt de 4 % payé par les
célibataires et les familles sans enfants. Majoration des re-
traites les plus faibles. Augmentation du taux des allocations
familiales. Accélération de la construction de logements par
l'Etat;
3° Les syndicats demandent en outre que soit tenue la
promesse faite par M. Imre Nagy d'engager des négociations
avec les gouvernements de l’U.R.S.S. et des autres pays en vue
d'établir des relations économiques donnant aux parties des
avantages réciproques seur la base du principe de l'égalité.
Il est dit en conclusion que les syndicats hongrois de-
vront fonctionner comme avant 1948, et devront changer leur
appellation et s'appeler désormais « syndicats libres hon-
grois ».
92
Cette liste de revendications est signée par la présidence
du conseil des syndicats hongrois, mais il n'y a pas de doute
qu'elle reprend et systématise les revendications émises par
les divers Conseils ouvriers.
Considérons de près ces revendications. Assurément,
elles ne constituent pas un programme socialiste maximum.
Car un tel programme aurait pour premier point: gouverne-
ment des représentants des conseils appuyé sur les milices
ouvrières. Peut-être était-ce là ce que souhaitaient de nom-
breux ouvriers, déjà très en avance sur les déclarations des
« sommets ». Peut-être pas. Nous n'en savons rien. De toutes
manières ce qu'on peut considérer comme théoriquement
juste n'est pas nécessairement ce que pensent et
ce que
disent ceux qui sont engagés dans une révolution et qui sont
placés dans des conditions déterminées.
Tel quel, le programme des syndicats va très loin. D'une
part il demande que Nagy gouverne avec les représentants de
la jeunesse et ceux des syndicats. Or la jeunesse a été
à l'avant-garde de la révolution; d'autre part, les syndicats
doivent être transformés, redevenir des syndicats libres, de
véritables représentants de la classe, leurs organismes doivent
être démocratiquement élus. La demande revient donc à
exiger un gouvernement révolutionnaire.
En second lieu le programme prévoit l'armement per.
manent d'ouvriers et de jeunes qui, avec l'armée et la police,
seront le soutien du gouvernement.
En outre, et ce point est essentiel, la résolution demande
la constitution de conseils dans toutes les usines. Cela prouve
que les ouvriers voient dans leurs organismes autonomes un
pouvoir qui a une signification universelle; ils ne le disent
pas, ils n'ont peut-être pas conscience de ce qui leur sera
possible de faire, mais ils tendent à une sorte de république
des conseils. Ils ne sont pas du tout disposés à s'en remetre
au gouvernement du soin de décider de tout en leur nom,
mais veulent au contraire consolider et étendre le pouvoir
qu'ils détiennent eux-mêmes dans la société.
Mais ce qui prouve la maturité révolutionnaire du mou-
vement ce sont les revendications propres à l'organisation de
la production. Ces revendications échappent évidemment à
l'intelligence du journaliste jourgeois, car celui-ci ne voit
que ce qui se passe à la surface des choses, c'est-à-dire sur
le plan étroitement politique. Or ce qui dans la réalité décide
de la lutte des forces sociales ce sont les relations qui existent
au sein de la production, au coeur des entreprises.
Les ouvriers pourraient bien avoir au gouvernement des
hommes en qui ils ont confiance et qui sont aniriés d'excel-
lentes intentions, ils n'auraient rien gagné encore si dans leur
vie de tous les jours, dans leur travail ils demeuraient de
.
93
simples exécutants qu'un appareil dirigeant commande,
comme il commande aux machines. Les conseils eux-mêmes
seraient finalement dépourvus d'efficacité et destinés à dé-
périr s'ils ne comprenaient pas que leur tâche est de prendre
en main l'organisation de la production.
De ceci les ouvriers hongrois étaient conscients. Et c'est
ce qui donne à leur programme une immense portée. Ils en
étaient d'autant plus conscients que le régime stalinien, tout
en leur refusant toute participation à la gestion des usines
n'avait cessé de proclamer que les ouvriers étaient les vrais
propriétaires de leurs entreprises. En quelque sorte le régime
stalinien avait contribué sur ce point à son propre renver-
sement car il avait permis aux ouvriers de comprendre une
chose, plus clairement que partout ailleurs : c'est que l'exploi.
tation ne vient pas de la présence de capitalistes privés, mais
plus généralement de la division dans les usines entre ceux
qui décident de tout et ceux qui n'ont qu'à obéir.
Le programme des syndicats s'attaque donc à cette ques-
tion qui est fondamentalement révolutionnaire : i) demande
dans le même paragraphe « l'instauration d'une direction
ouvrière et la transformation radicale du système de planifi.
cation et de la direction de l'économie exercée par l'Etat ».
Comment cette transformation radicale s'effectuera-t-elle ?
Comment les ouvriers réussiront-ils au travers de leur direc-
tion à participer à la planification? Cela n'est pas dit. Cela
ne pouvait d'ailleurs être dit, trois jours après l'insurrection,
dans le feu de la lutte encore, et dans un document qui ne
pouvait affirmer que des principes. Mais si la revendication
est encore mal définie son esprit ne fait pas de doute: les
ouvriers ne veulent plus que s'élabore indépendamment d'eux
le plan de production, ils ne veulent plus que ce soit une
bureaucratie d'Etat qui envoie les ordres. Cela les intéresse
au plus haut point de savoir ce que la direction décide à
l'échelle nationale, comment la production sera orientée,
dans quelles branches on projette de faire les plus grands
efforts et pourquoi. Quel volume doit être atteint dans les
divers secteurs; quelle est la répercussion de ces objectifs sur
leur niveau de vie, sur la durée de la semaine de travail, sur
le rythme de travail que cela imposera.
Si l'on poursuit attentivement l'examen du paragraphe
« économique » du programme on s'aperçoit enfin que les
ouvriers ne s'arrêtent pas à des revendications de principe;
ils font une demande très précise et qui a immédiatement
une répercussion formidable sur l'organisation de la produc-
tion dans les usines : ils exigent la suppression des normes
de production, sauf dans les usines où les conseils en deman-
deraient le maintien. Cela revient à dire que les ouvriers
doivent être libres d'organiser leur travail comme ils l'en-
14
tendent. Ils veulent mettre à la porte toute la bureaucratie,
depuis les agents d'études jusqu'aux chronos qui veulent ali-
gner
le travail humain sur le travail de la machine et qui,
de plus en plus, alignent le travail des machines sur les
cadences folles imposées au travail numain, quitte à faire
sauter les machines.
Ils n'excluent pas que dans certains cas des normes doi-
vent être maintenues mais ils spécifient que ce sont les
ouvriers qui, à travers leur Conseil, sont seuls qualifiés pour
en décider.
De toute évidence, cette revendication pose les premiers
jalons d'un programme gestionnaire et si la situation lui
avait permis de se développer elle ne pouvait que conduire
à ce programme. Et, en effet on ne peut pas séparer l'organi-
sation du travail des hommes de celle de la production en
général. Les directeurs d'entreprise n'ont jamais toléré une
telle dissociation et ne le peuvent effectivement pas car tout
se tient dans l'usine moderne. Le jour où les hommes décident
de la conduite de leur travail ils sont amenés à envisager tous
les problèmes de l'entreprise.
Finalement détachons du programme des syndicats les
revendications de salaire. Ce qui est très caractéristique c'est
qu'elles visent à resserrer l'éventail des salaires, c'est-à-dire
à combattre la hiérarchie : 15 % au dessous de 800 forints,
10 % entre 8 et 1.500, un plafond de 3.500. Or la biérarchie
est l'arme des staliniens comme des capitalistes, parce qu'elle
leur permet, d'une part de constituer une couche privilé.
giée qui est un soutien pour le régime établi et, d'autre part.
de diviser les travailleurs, de les isoler les uns des autres
en multipliant les niveaux de rémunération. La lutte contre
la hiérarchie est aujourd'hui fondamentale pour les ouvriers
du monde entier qu'ils travaillent à Budapest, à Billancourt,
à Detroit ou à Manchester, et on la voit effectivement passer
au premier plan chaque fois qu'aux Etats-Unis, en Angleterre
ou en France une grève sauvage éclate, indépendamment des
syndicats. Cette lutte devient d'autant plus claire pour les
ouvriers que le développement technique tend à niveler de
plus en plus les emplois : l'extrême différenciation des
salaires apparaît ainsi absurde du point de vue de la logique
de la production et justifiable seulement par les avantages
politico-sociaux qu'en retire l'appareil dirigeant.
Dans l'appel que lancera quelques jours plus tard (le 2
novembre) le Conseil national des syndicats hongrois il sera
demandé un nouveau système de salaires, c'est-à-dire sans
aucun doute une refonte des catégories artificiellement mul.
tipliées par le régime précédent.
Quelle est l'image que composent ces premiers jours de
lutte? La population, dans son ensemble, s'est soulevée et a
05
cherché à balayer le régime fondé sur la dictature du P.C.
La classe ouvrière a été à l'avant-garde de ce combat. Elle ne
s'est pas dissoute dans le « mouvement national ». Elle est
apparue avec des objectifs spécifiques :
1°) Les ouvriers ont organisé spontanément leur pouvoir
propre: les Conseils, auxquels ils ont d'emblée cherché à
donner la plus grande extension possible ; 2°) ils ont constitué
avec une rapidité inouïe une puissance militaire qui a été
capable de faire reculer dans certains cas, de neutraliser dans
d'autres, les troupes russes et leurs blindés; 3°) ils se sont
attaqués à la racine même de l'exploitation en présentant Jes
revendications qui avaient pour effet de changer complète-
ment la situation des ouvriers dans le cadre même des en-
treprises.
DIVERSITE DES FORCES SOCIALES EN LUTTE
MOTS D'ORDRE DEMOCRATIQUES ET NATIONAUX
Reprenons la fin des événements au moment où nous
l'avions interrompu. Nous avons dit qu'à partir du jeudi 25
s'opère un tournant dans la situation. Le gouvernement recon.
naît d'abord le bien fondé de la lutte insurrectionnelle; il
promet qu'il négociera bientôt le départ des troupes russes;
il donne des portefeuilles à des non-communistes (petits pro.
priétaires). Sur cette base il se croit en mesure de réclamer
que les insurgés déposent définitivement les armes. Pourtant
les combais continuent. A Budapest la bataille fait rage au
début de l'après-midi du vendredi 26 contre les chars sovié-
tiques. Le gouvernement ne comprend pas cette situation : il
pense que ses concessions sont déjà très importantes et sur-
tout il est persuadé que les conseils ouvriers vont le soutenir,
car, répétons-le, ceux-ci proclament qu'ils ont confiance en
Nagy. Un ultimatum est donc lancé pour que les armes soient
déposées le vendredi 26 avant 22 heures. Le lendemain ma-
tin, la lutte se poursuit et la radio officielle soutient que ceux
qui continuent de se battre sont des « bandits » et seront
traités comme tels. Les insurgés sont de nouveau considérés
comme des « agents de l'Occident ».
Devant l'ampleur des combats qui reprennent (c'est no-
tamment dans la nuit de samedi à dimanche que la prison de
Budapest est attaquée et que sont exécutés les deux
Farkas, chefs policiers du régime Rakosi et responsables d'une
série de crimes, devant l'extension des conseils révolutionnai.
res qui se multiplient en province et englobent maintenant
toutes les couches de la population, le gouvernement est amené
de nouveau à céder. La situation est semble-t-il très confuse le
96
clara que
dimanche matin. D'une part des négociations avec des repré-
sentants étudiants à Budapest aboutissent à un armistice,
d'autre part, les combats persistent malgré cet armistice. Le
plus probable est que certaines fractions des insurgés qui
sont à court d'armes ou de munitions ou qui se trouvent dans
une mauvaise posture acceptent la négociation, tandis que
d'autres, réapprovisionnées en ormes par les soldats, poursui-
vent ou reprennent le combat.
Toujours est-il que l'après-midi du dimanche 28 amène
une seconde retraite gouvernementale, qui est en même
temps une capitulation russe. Entre 12 et 13 heures Nagy
annonce qu'il a ordonné à ses troupes de cesser le feu. Á
15 heures, Radio Budapest déclare: « Bientôt le combat
prendra fin. Les armes se sont tues. La ville est silencieuse.
Silence de mort. Il convient de réfléchir aux mobiles de ce
meurtre atroce, dont le stalinisme et la démence sanguinairo
de Rakosi sont les causes véritables ». A 16 h. 39 Nagy dé-
les troupes russes vont se retirer « immédiatement ».
En fait, on le sait, les Russes n'évacuent pas Budapest.
Ils attendent, soi-disant, que les insurgés déposent les armes.
Ceux-ci de leur côté refusent de les rendre et sont encouragés
par les conseils de Gyor et de Miskolc: les combats repren-
neni. Ce n'est que mardi soir qu'on paraît assuré du départ
des Russes qui est confirmé officiellement par Radio Moscou.
Nous n'avons plus maintenant besoin de suivre le cours
des événements d'aussi près et nous pouvons survoler la se-
conde semaine révolutionnaire pour en dégager les traits
principaux. Mais pour comprendre l'évolution du mouve-
ment révolutionnaire, il nous faut d'abord noter ce qui se
passe sur le plan gouvernemental, sur le plan politique gé-
néral et sur le plan militaire.
Sur le plan gouvernemental, Nagy faite toute une série
de concessions qui, en un sens, ont un caractère démocratique,
en un autre sens revalorisent les forces petites bourgeoises.
Successivement, il annonce la fin du régime du parti unique
(mardi 30) et le retour à un gouvernement de coalition na-
tional analogue à celui de 1946; il promet des élections
libres au suffrage universel ; il fonde un nouveau parti: le
parti socialiste ouvrier; il projette un statut de neutralité
pour la Hongrie et la dénonciation du pacte de Varsovie; il
crée un
nouveau gouvernement où les communistes n'ont
que deux portefeuilles tandis que les autres sièges (à l'excep-
tion d'un qui est accordé à un représentant du nouveau parti
Petoefi) sont partagés entre nationaux paysans, petits pro-
priétaires et sociaux-démocrates.
Sur le plan politique, les anciens partis se reconsti.
tuent rapidement: en province des sections des partis paysans,
sociaux-démocrates et petits propriétaires se multiplient.
97
Cependant une nouvelle formation apparaît issue de l'insur-
rection, le parti de la jeunesse révolutionnaire, situé sur une
base nettement socialiste. Plusieurs nouveaux journaux sont
publiés.
Sur le plan « militaire », la situation est dominée
par la présence des Russes. Ils ont feint d'accepter de partir
le dimanche 28 et au lieu de partir ils ont attaqué les insurgés
dans Budapest; ils ont annoncé qu'ils se retireraient dans la
soirée de lundi 29 et ont quitté en grande partie la capitale,
mais se sont regroupés à distance et à partir du jeudi 1er no-
vembre, d'importants effectifs pénètrent sur le territoire
hongrois.
C'est dans ce climat qu'évolue le mouvement des masses.
Or ce mouvement englobe maintenant de nouvelles couches
sociales. Il a d'abord été principalement un mouvement
des usines, sauf, rappelons-le, à Budapest où aux côtés
des ouvriers se trouvaient étudiants, employés petits
bourgeois. Il s'est traduit par l'apparition des conseils.
Mais le premier recul du
gouvernement (jeudi), la
formation d'un gouvernement de coalition (vendredi) encou-
ragent toutes les couches de la population à se soulever,
car la victoire apparaît à tous à portée de la main. Aussi bien
à Miskolc qu'à Gyor des conseils de villes et de départements
se constituent et viennent sur le devant de la scène. Il est bien
évident que la population non-ouvrière et particulièrement
les paysans sont avant tout sensibles à des revendications
démocratiques et nationales. Or ces revendications ont aussi
une profonde résonnance dans la classe ouvrière, car elles
constituent une démolition de l'ancien Etat totalitaire. Les
ouvriers sont pour l'indépendance de la Hongrie face à l'ex-
ploitation russe, ils sont pour l'abolition du régime du parti
unique qui s'est confondu avec la dictature stalinienne; ils
sont pour la liberté de la presse qui donne aux opposants le
droit de s'exprimer; ils sont même pour des élections libres
qui constituent à leurs yeux un moyen de briser le monopole
politique du parti « communiste ».
Une certaine unanimité dans l'euphorie de la victoire.
peut donc s'instaurer: il n'en reste pas moins qu'elle va de
pair avec une certaine confusion.
Cette confusion est accrue par la menace que fait
peser
l'armée russe, car tout le monde est obligé de brandir en
même temps le drapeau de l'indépendance nationale.
Et cette confusion est aussi entretenue par la politique
de Nagy qui, tout en reconnaissant les organismes autonomes
de la classe ouvrière et en se déclarant décidé à s'appuyer
dessus, ne fait en réalité que des concessions à la droite.
On aura une idée du flottement de la situation politique
en se reportant une fois de plus à l'activité du Conseil de
98
Miskolc. Dès le dimanche 29, celui-ci publie un programme
qu'il soumet aux Conseils de Gyor, de Pecs, de Debreczen,
de Szekesfehevar, de Nyiregyhaza, de Szolnok, de Magyarovar,
d'Esztergom et de plusieurs autres villes de province:
« Nous exigeons du gouvernement:
1. L'édification d'une Hongrie libre, souveraine, indé-
pendante, démocratique et socialiste;
2. Une loi instituant des élections libres au suffrage
universel;
3. Le départ immédiat des troupes soviétiques ;
4 L'élaboration d'une nouvelle Constitution;
5. La suppression de l’A.V.H. (Allamvedelmi Hatosa-
gnom, police politique). Le gouvernement ne devra s'ap-
puyer que sur deux forces armées : l'armée nationale et ſa
police ordinaire;
6. Amnistie totale pour tous ceux qui ont pris les armes
et inculpation de Ernoe Geroe et de ses complices;
7. Elections libres dans un délai de deux mois avec la
participation de plusieurs partis. >>
Ce programme, visiblement, reflète non plus seulement
la volonté des ouvriers des usines de Miskolc mais celle de la
population du département de Borsod dans son ensemble.
Dans la seconde semaine il semble que ceux qui
s'attaquent au communisme (sous toutes ses formes) parlent
plus fort, tandis que ceux qui luttent pour un pouvoir
prolétarien
manifestent pas
ouvertement
sur le plan politique. A Gyoer, dès le dimanche 29, un
communiqué du conseil ouvrier met en garde contre les élé-
ments troubles non-comimunistes qui cherchent à exploiter
la sitation. Le 2 novembre, des observateurs annoncent que
le pouvoir des éléments communistes y est menacé. A Buda-
pest, il semble que des manifestations réactionnaires ont lieu.
Cependant il serait absurde de penser que se développe
un véritable mouvement contre-révolutionnaire. Il n'y a pas
de base pour un tel mouvement. Nulle part ne se font jour des
revendications qui mettraient en cause les acquisitions de la
classe ouvrière. Les éléments « droitiers » qui sont au gou-
vernement prennent soin de déclarer qu'on ne peut en aucune
manière revenir en arrière. C'est ainsi que Tildy, leader des
petits propriétaires déclare le 2 novembre: « La réform
agraire est un fait acquis. Bien entendu, les kolkhoses dispa-
raîtront, mais la terre restera aux paysans. Les banques, les
mines demeureront nationalisées, les usines resteront la pro-
priété des ouvriers. Nous n'avons fait ni une restauration, ni
une contre-révolution, mais une révolution. »
Peu importe de savoir si Tildy pense effectivement ce
qu'il dit. Le fait est qu'il ne peut parler autrement parce que
les forces qui dominent sont révolutionnaires.
ne
se
aussi
99
Nous ne
A Budapest l'insurrection a été et reste l'ouvre des ou-
vriers et des étudiants. Le premier appel de la Fédération
de la jeunesse, le 2 novembre, est fort clair:
voulons pas le retour du fascisme de l'amiral Horthy. Nous
ne rendrons pas la terre aux gros propriétaires fonciers ni les
usines aux capitalistes. »
En province, la véritable force sociale en dehors du
prolétariat est la paysannerie. Or si les revendications des
paysans et leur attitude peuvent être confuses, il n'en est pas
moins évident que leur lutte pour le partage des terres est
de caractère révolutionnaire et que pour eux chasser les diri.
geants des kolkhoses a la même portée que chasser les gros
propriétaires.
En effet les paysans en Hongrie n'ont jamais eu posses-
sion de la terre; en s'en emparant ils ne régressent pas, ils
font un pas en avant. Ils étaient sous le régime Horthy dans
leur immense majorité des ouvriers agricoles et représen-
taient alors plus de 40% de la population. Ayant bénéficié
de la réforme agraire au lendemain de la guerre ils se sont
vu presque aussitôt dépossédés de leurs nouveaux droits
et condamnés à une collectivisation forcée. Leur haine contre
les bureaucrates qui dirigeaient les coopératives, et s'enri-
chissaient à leurs dépens s'est substituée presque sans transi.
tion à la haine qu'ils témoignaient à leurs exploiteurs ances-
traux, les aristocrates de la terre.
En outre, ou sait que la redistribution des terres après
le 23 octobre n'a eu lieu que dans certains secteurs, tandis
que dans d'autres les coopératives reprises en main par les
paysans, continuaient à fonctionner, ce qui prouve que pour
certaines couches paysannes les avantages du travail collec-
tif demeuraient sensibles malgré l'exploitation à laquelle il
avait été associé sous le régime précédent.
Il serait donc simpliste de prétendre que les paysans
constituent une force contre-révolutionnaire; même si pour
un grand nombre ils étaient disposés à faire confiance aux
représentants ds partis « petits propriétaires», attachés à
une tradition religieuse et familiale, empressés à saluer le
retour du cardinal Mindszenty ils demeuraient membres d'une
classe exploitée, susceptibles de rejoindre le prolétariat dans
sa lutte pour des objectifs socialistes.
Nous avons tout à l'heure cité le programme en 7 points
de Miskolc pour
montrer qu'il y apparaissait seule-
des revendications démocratiques et nationales.
Nous pouvons maintenant citer le programme de Ma.
gyarovar qui lui fait en quelque sorte pendant. Pro
gramme d'un « comité exécutif municipal » manifestement
dirigé par des éléments paysans il demande des élections
libres sous le contrôle de l'O.N.U., le rétablissement immédial
ment
100
des organisations professionnelles de la paysannerie, l'exercice
libre de leurs professions pour les petits artisans et les petits
comerçants, la répartition des graves injustices commises
contre l'Eglise et formule toute une série de revendications
démocratiques bourgeoises, mais en même temps, il réclame
la suppression de toutes les différences de classe (point 13).
Rien ne peut mieux montrer, à notre avis, l'ambivalence
du mouvement paysan dans lequel, comme la Révolution
russe en particulier l'a montré, coexistent toujours des élé.
ment conservateurs et révolutionnaires.
LA LUTTE OUVRIERE CONTINUE
On a essayé de faire croire qu'un important mouvement
contre-révolutionnaire s'était déclenché à la fin de la seconde
semaine de l'insurrection, et que les conquêtes ouvrières
étaient en passe d'être liquidées. Kadar a du revenir par la
suite sur ce mensonge et déclarer qu'il s'agissait d'une simple
menace que faisaient peser des bandes réactionnaires et que
le gouvernement avait du devancer leur action. Mais c'était
encore un mensonge. La suite des évènements l'a prouvé car la
classe ouvrière s'est battue avec acharnement dans la Hongrie
entière, la grève est redevenue générale et les usines ont été
de nouveau les bastions de l'insurrection. C'était les nouvelles
conquêtes ouvrières les conseils et l'armement des ouvriers
que les Russes ne pouvaient tolérer et qu'ils ont voulu
écraser avec l'aide d'un gouvernement fantoche.
Radio Budapest, durant la troisième semaine n'a pu
que rééditer le programme de supplications qu'elle avait
diffusé sous le premier gouvernement Nagy au début de
l'insurrection : les ouvriers étaient priés d'avoir confiance
dans le gouvernement, priés de déposer les armes, priés de
reprendre le travail.
La vérité est qu'à la veille de l'attaque des blindés
soviétiques la situation était ouverte et que l'avenir de la
société hongroise dépendait comme il en va dans toute
révolution de la capacité des diverses forces sociales de
faire prévaloir leurs objectifs propres et d'entraîner à leur
suite la majorité de la population.
Ce qui était exclu en tout cas c'était un retour à un
régime du type Horthy, une restauration du capitalisme privé
et de grande propriété foncière. Car il n'y avait aucune
couche sociale inportante susceptible de soutenir cette res-
tauration.
Ce qui, en revanche, était possible c'était soit la recons-
titution d'un appareil d'Etat qui serait appuyé sur un parle-
ment, aurait utilisé une police et une armée régulière et aurait
101
sens
incarné de nouveau les intérêts d'un groupe dirigeant de
type bureaucratique dans la production; soit la victoire de
la démocratie ouvrière, la prise en main des usines par les
Conseils, l'armement permanent de la jeunesse ouvrière et
étudiante, bref un mouvement qui se serait de plus en plus
radicalisé.
Dans ce dernier cas, sans aucun doute, une avant-garde se
serait rapidement regroupée; elle aurait opposé au pro-
gramme politique bourgeois ou bureaucratique un programme
de gouvernement ouvrier; elle aurait aidé les Conseils à
unifier leur action et à revendiquer la direction de la société.
Les deux voies étaient ouvertes et sans aucun doute les
évènements qui se seraient alors produits dans les autres
démocraties populaires auraient exercé une forte influence
dans un
ou dans un autre. D'un côté, il est douteux
qu'une révolution isolée ait pu se développer et triompher
en Hongrie ; d'un autre il est non moins douteux qu'un mou-
vement prolétarien ait pu durer sans faire sentir ses effets
sur la classe ouvrière de Tchécoslovaquie, de Roumanie et
de Yougoslavie qui continuaient à des degrés divers à subir
une exploitation analogue à celle dont s'étaient libérés les
ouvriers hongrois; sans donner une impulsion immense au
mouvement ouvrier en Pologne, qui a depuis un mois imposé
des concessions continues à la bureaucratie polonaise aussi
bien que russe.
Bien entendu, lorsqu'une révolution commence, son issue
n'est pas garantie d'avance. Dans la révolution hongroise, le
prolétariat n'était pas seul; à côté de lui, les paysans, les
intellectuels, les petits bourgeois avaient combattu la dieta-
ture de la bureaucratie, qui exploitait et opprimait toute la
population. Les revendications démocratiques et nationales
unissaient pendant une première phase toute la population;
s'appuyant sur elles, un développement conduisant à la re-
constitution d'un appareil d'Etat séparé et opposé aux Con.
seils. d'une « démocratie » parlementaire pouvant bénéficier
du soutien des paysans et de la petite bourgeoisie, était théori-
quement concevable. Dans une deuxième phase de la révo-
lution, le contenu contradictoire de ces revendications serait
apparu; à ce moment, il aurait fallu qu'une solution s'impose
brutalement aux dépens de l'autre, que s'impose le parle
ment de type bourgeois ou les Conseils, une armée et une
police comme corps spécialisés de coërcition ou une organi-
satior armée de la classe ouvrière. Au départ, l'insurrection
portait en elle les germes de deux régimes absolument
différents.
Cependant, la suite des événements a montré quelle était
la force de la classe ouvrière. Nous nous sommes étendus
volontairement sur le rôle des éléments non-prolétariens qui
102
corres-
se sont manifestés pendant la deuxième semaine de l'insur-
rection. Mais il ne faudrait pas non plus exagérer leur poids
réel dans la situation. Il est fatal qu'à la sortie d'un régime
dictatorial toutes les tendances politiques se manifestent, que
les politiciens traditionnels, à peine sortis de prison, tienvent
des meetings, fassent des discours, écrivent des articles, rédi-
gent des programmes; que dans l'euphorie de la victoire
commune, un auditoire soit prêt à applaudir tous les faiseurs
de phrases qui proclament leur amour de la liberté. La me-
nace que représentaient ces tendances politiques ne
pondait pas encore à une force organisée dans la société.
Pendant ce temps, les Conseils ouvriers continuaient à
exister; les ouvriers restaient, l'arme à la main. Ces Conseils,
ces cuvriers étaient la seule force réelle, la seule force orga-
nisée dans le pays
en dehors de l'armée russe.
C'est cette force que la bureaucratie russe ne pouvait
absolument pas tolérer. Les Tildy, les Kovacs, les Midszenty
même elle peut passer des compromis avec eux, gouverner
en leur faisant des concessions. Elle l'avait déjà fait en Hon.
grie, dans tous les pays de démocratie populaire, et en
France, où Thorez et Cie ne se sont pas gênés pour participer
aux côtés de Bidault à plusieurs gouvernements de 1945 à
1947 Mais l'organisation de Conseils par les ouvriers en
armes signifie pour la bureaucratie une défaite totale. C'est
pourquoi, forgeant l'alibi du « péril réactionnaire », elle a
lancé le dimanche 4 novembre ses blindés contre les Conseils,
dont la victoire risquait d'avoir des répercussions immenses
et de bouleverser son propre régime.
Ce qui s'est passé alors est absolument incroyable. Pen.
dant six jours, les insurgés ont résisté à une armée dont la
puissance de feu était écrasante. Ce n'est que le vendredi 9
novembre que la résistance organisée a cessé à Budapest.
Mais la fin de la résistance militaire n'a absolument pas mis
une fin tout court à la révolution. La grève générale a conti-
nué, plongeant le pays dans une paralysie complète, et démon.
trart clairement que le gouvernement Kadar n'avait stricte-
ment aucun appui parmi la population. Kadar, pourtant,
avait déjà accepté dans son programme, la plupart des reven.
dications des insurgés entre autres, la gestion ouvrière des
usines. Mais le prolétariat hongrois ne pouvait évidemment
pas se laisser duper par un traître, qui voulait instaurer son
pouvoir par la force des blindés russes. Pendant une semaine,
du 9 au 16 novembre, le gouvernement fantoche de Kadar a
multiplié les appels, tour à tour menaçant, suppliant, promet-
tant, et faisant en paroles des concessions toujours plus
grandes. Rien n'y fit. Alors, le vendredi 16 novembre. Kadar
était obligé d'entrer en pourparlers avec les Conseils
le Conseil central des ouvriers de Budapest. Il reconr.aissait
avec
103
par là même qu'il n'était lui-même qu’un zéro tout rond. que
la seule force véritable dans le pays étaient les Conseils, et
qu'il n'y avait qu'une seul moyen pour que le travail reprenne
c'était que les Conseils en donnent l'ordre. Sous la condi.
tion expresse qu'une série de leurs revendications seraient
satisfaites immédiatement et en déclarant qu'ils n'abandon-
naient pas « une virgule » du reste, les délégués ouvriers ont
demandé par la radio à leurs camarades de reprendre le
travail.
Ces faits ne montrent pas seulement, de façon rétros.
pective, le poids relatif des Jiverses forces dans la révolution
hongroise, et la puissance extraordinaire des Conseils ouvriers.
Ils-jettent une lumière crue sur la défaite totale de la bureau-
cratie russe, même après sa « victoire » militaire. Déjà le
fait de recourir à une répression massive, de mobiliser vingt
divisions pour venir à bout d'un mouvement populaire était
en lui-même, pour la bureaucratie russe obligée de se iúla
mer du socialisme, une défaite politique extrêmement lourde.
Mais cette défaite n'est rien, en comparaison de celle qu'elle
est eu train de subir maintenant: il lui faut, par le truche-
ment de Kadar, reconnaître qu'elle a massacré les gens pour
rier.. qu'elle n'a pas restauré son pouvoir en Hongrie, que
Kadaz a beau disposer de vingt divisions russes, il lui faut
quand même composer avec les Conseils ouvriers.
La révolution hongroise n'est pas terminée. Dans le pays,
deux forces continuent à s'affronter: les blindés russes, et les
ouvriers organisés dans les Conseils. Kadar essaie de se créer
un appui, en faisant des concessions extrêmement larges. Mais
sa situation est sans espoir. Au moment où ces lignes sont
écrites, à la veille du lundi 19 novembre, il n'est pas certain
que l'ordre de reprise de travail donné par les Conseils sera
effectivement suivi; il semble que beaucoup d'ouvriers copsi.
dèrent que les délégués ont eu tort d'accorder cette renrise
à Kadar. Celui-ci vient de faire encore un faux pas
était d'ailleurs obligé de faire : pour s'assurer que la reprise
du travail sera effective, il n'a qu'un moyen, réduire les ou-
vriers à la famine, exactement comme un patron ou un gou-
vernement capitaliste. Il a donc interdit que le ravitaillement
soit introduit à Budapest par les paysans autrement qu'avec
la permission du gouvernement et de l'armée russe et que les
ouvriers touchent des cartes de rationnement ailleurs que dans
les usines. Par là même, il ne fait que se montrer encore plus
clairement aux yeux des ouvriers hongrois tel qu'il est
fusilleur doublé d'un affameur et approfondir le fossé jui
le sépare d'eux. En même temps, les ouvriers continuent à
demander avec persistance éi en premier lieu, le départ des
troupes russes; celles-ci parties, on imagine aisément quel
serait le sort de Kadar.
qu'il
un
104
LE REGIME CONTRE LEQUEL
LES OUVRIERS SE SONT BATTUS
La répression russe est si monstrueuse, le combat des
ouvriers si évident que la vérité devrait s'imposer d'elle-
même. Les militants communistes fançais devraient prendre
conscience de la complicité qui unit dans le meurtre leurs
propres dirigeants et ceux de l’U.R.S.S. Mais précisément
parce que les illusions sur l'Etat « socialiste » sont près de
se dissiper, parce que la confiance dans la clique de l'Huma-
nité est près de s'évanouir, tous les moyens sont mis en
euvre pour cacher le véritable caractère des évènements de
Hongrie. Et peu importe que le mensonge soit immense, le
P.C. français n'a pas le choix. Comme les coupables qui
ont peur de se « couper » s'ils commencent d'avouer une
partie de leurs crimes, le P.C. nie tout en bloc, il nie que la
classe ouvrière se soit soulevée, il nie que les blindés russes
l'aient écrasée, il nie même que la population voulait chasser
la dictature de Moscou, il nie même que Nagy soit demeuré
communiste. Il s'accroche à la thèse des assassins : l'insur-
rection était un putch fasciste. These qui n'est d'ailleurs
nullement celle de Kadar puisque celui-ci ne cesse d'affirmer
que les revendications des insurgés seront satisfaites...
Le P.C. ne peut convaincre, mais il sait que ses men-
songes engendrent le trouble. Des militants, des sympathi-
sants vont répétant que les mots d'ordre mis en avant dans
la lutte étaient principalement bourgeois et donc réaction.
naires, que l'hostilité contre l’U.R.S.S. était une manifesta-
tion de nationalisme, qu'en l'absence d'une intervention russe
le régime nécessairement était voué à une restauration capi-
taliste. La plupart du temps ceux qui parlent ainsi ne com-
prennent pas quelle est la situation dans laquelle la popula-
tion se souleva, face à quel régime elle eut à se battre.
La Hongrie connaît depuis dix ans un régime dit de démo-
cratie populaire. Auparavant elle avait vécu pendant plus
de vingt ans sous un régime mi-féodal mi-capitaliste cou-
ronné par la dictature du Régent Horthy. Comme dans les
autres pays d'Europe Centrale et Orientale, la paysannerie
composait la majorité de la population, et les paysans pau-
vres, en l'occurrence les ouvriers agricoles, représentaient à
eux seuls près de la moitié de la population totale. Un pro-
létariat encore laivie, mais nettement plus développé que
dans les pays voisins (Tchécoslovaquie exceptée) travaillait
dans des industries largement financées par le capitalisme
étranger. Dans les villes s'était développé une classe moyenne,
mais dont les aspirations se heurtaient au pouvoir dictatorial
solidement établi sur l'aristocratie foncière et soutenu par
i'étranger. Comme dans beaucoup d'autres pays sous-déve-
105
loppés, la stabilité du régime était en outre maintenue grâce
à la complicité d'une partie de la bourgeoisie qu'une pers-
pective révolutionnaire terrorisait et grâce à l'inertie des
paysans qu'une extrême misère et un assujettissement com.
plet aux grands propriétaires fonciers freinaient dans leur
prise de conscience politique.
L'Etat hongrois n'avait été fondé en fait qu'en 1918.
Auparavant, les Hongrois, un des premiers peuples d'Europe
orientale qui se sont formés une conscience nationale et un
Etat, avaient été soumis pendant des siècles à la domination
de l'Autriche, de sorte que le problème de l'indépendance
nationale avait acquis, en particulier depuis 1848, une im-
portance explosive que la domination russe, après 1945,
lui donna à nouveau.
Le démembrement de l'Empire autrichien par le traité
de Trianon (1919) donnait une solution apparente au pro-
blème national de la Hongrie, mais nullement aux autres
problèmes de cette société : le problème de la terre d'abord,
propriété d'une minorité de nobles, tandis que les paysans
restaient soumis à une exploitation dont le fond, sinon la
forme, était féodal. Le problè:ne de la démocratie politique,
ensuite, impossible à instaurer, puisque l'écrasante majorité
paysanne du pays, si elle parvenait à s'exprimer politique-
ment, mettrait immédiatement en avant le problème du par-
tage des terres.
Comme en Russie tsariste, la bourgeoisie tardivement
développée, ne pouvait ni ne voulait s'attaquer à ces pro-
blèmes, craignant que les masses, une fois mises en mouve-
ment, ne mettent en question d'ensemble du régime social.
Et comme
en Russie, le prolétariat, numériquement mino-
ritaire, mais concentré et politiquement développé, fut poussé
par la crise de la société à proposer ses propres solutions. Ce
fut la révolution communiste de 1919, dirigée par Bella Kun,
que les erreurs de sa direction et l'intervention armée des
puissances de l'Entente ont conduit à la défaite. C'est sur
cette défaite qu'a été établi ie régime de Horthy, qui n'a,
comme on l'a vu, fait que maintenir par la force l'état de
choses antérieur.
Horthy participa à la guerre aux côtés d'Hitler Vers la
fin de la guerre, pourtant, un nouvement avait tenté de dé-
tacher la Hongrie de l'alliance avec l'Allemagne ; les Alle-
mands ont alors occupé le pays et ont exercé une véritable
terreur, pourchassant et exterminant les militants de gauche
et déportant 400.000 juifs dans les camps de concentration.
Avant leur défaite par l'armée russe, les Allemands retran-
chés dans Budapest se battirent dans chaque rue et laissè-
rent derrière eux une ville dévastée.
106
L'armée russe fit à son tour régner la terreur. Pillages,
viols, pendaisons se succédèrent jusqu'à ce que fut installé
à Budapest un gouvernement national.
Ce gouvernement, dirigé par les communistes, avait au
départ un terrible handicap : il était la création d'une armée
d'occupation, et il s'élevait au milieu d'un pays en ruines
que sa structure archaïque avait jusqu'ici condamné à vivre
sous la tutelle de Horthy. On vit bien quel était le pouvoir
réel des communistes quand aux élections de 1946 ils ne
réussirent qu'à obtenir 15 % des voix tandis que les autres
partis, petits propriétaires, nationaux paysans et social-démo-
crates se partageaient le reste du corps électoral.
Mais le parti communiste avait cependant dans son jeu
des atouts considérables. D'une part, l'appui de l’U.R.S.S.
lui garantissait une position dominante, d'autre part et sur-
tout l'existence d'un prolétariat et d'une paysannerie sur-
exploités lui offraient la possibilité de répandre rapidement
une idéologie révolutionnaire. L'immense majorité du peu-
ple hongrois était composée de travailleurs pauvres prêts à
comprendre et à soutenir une politique résolument révolu-
tionnaire.
Que fit donc le Parti Communiste ? Simultanément, il
s’employa à consacrer la défaite des anciennes couches domi-
nantes en procédant au partage des terres et à la nationali-
sation des banques et des industries et il chercha à s'appuyer
sur les membres de ces anciennes classes
pour constituer
une nouvelle bureaucratie d'Etat. Des techniciens, des mili-
taires, des hommes politiques même (par exemple, Kovacs)
qui avaient été les agents du régime Horthy devinrent les
cadres des nouvelles industries nationalisées, de la nouvelle
armée, de la nouvelle police et affluèrent dans le parti. D'un
côté donc des réformes spectaculaires, le partage des terres,
les nationalisations paraissaient profiter à la paysannerie et
au prolétariat; tandis que d'un autre côté se rétablissait une
division stricte entre une classe dirigeante et les exploités
auxquels le pouvoir restait aussi étranger qu'au temps du
régime Horthy.
Dans l'industrie, des conditions de travail extrêmement
dures furent instaurées, à l'image de celles qui régnaient en
U.R.S.S. Comme en U.R.S.S., comme dans les autres démo-
craties populaires, l'ordre sans cesse renouvelé d'élever la
productivité fut diffusé par les syndicats : les ouvriers
devaient accepter les fréquents relèvements des normes
passer pour des saboteurs. Les salaires étaient maintenus à
un niveau extrêmement bas car les ouvriers devaient se sacri.
fier pour la construction du « socialisme »; les grèves étaient
interdites comme des crimes contre l'Etat.
ou
107
Dans les campagnes, la collectivisation forcée succéda
vite au partage des terres; les prix imposés aux paysans
pour la vente de leurs produits à l'Etat, l'obligation dans
laquelle on les mit de travailler dans les coopératives pour
un revenu dérisoire les ramena à des conditions de vie ana-
logues à celles qu'ils avaient connues sous le régime Horthy.
Dans le même temps se construisait le Parti Communiste.
Ses effectifs, très faibles en 1946, devaient atteindre le chif-
fre considérable de 800.000 adhérents. Le but était de cons.
tituer un appareil de direction de la société qui obéit stric-
tement à la volonté du groupe dirigeant et qui contrôle à
tous les niveaux l'application des décisions de l'Etat. Comme
en U.R.S.S., comme dans toutes les autres démuncraties popu.
laires, cet objectif ne pouvait être atteint qu', la condition
de faire taire de force toute opposition, aussi bien à l'inté.
rieur qu'à l'extérieur du parti. Toute expression politique
publique fut donc contrôlée, la presse muselée, les intellec-
tuels mis au pas. Après une étape de collaboration nécessaire
avec les partis non communistes, le P.C. hongrois put gou.
verner seul. La discipline du parti, la force de la police et
des cadres de l'armée le dispensaient, dès 1948, de recourir
à une façade démocratique.
Cette évolution du Parti Communiste fut-elle due aux
erreurs de Rakosi ?
Il est bien évident que non. A dessein, nous n'avons
pas encore parlé des excès de la collectivisation, du pro-
gramme outrancier de développemeni de l'industrie lourde.
C'est que même si on ne les mentionne pas, le totalitarisme
du régime apparaît déjà clairement. Dans ses grandes lignes,
la politique communiste fut aussi bien celle de Rajk et de
Nagy que cele de Rakosi. C'est Rajk qui, ministre de l'Inté.
rieur jusqu'en 1949, constitua l'élément essentiel de la dicta-
ture : la police de sécurité, grâce à laquelle le gouverne-
ment put désormais gouverner sans demander leur avis aux
masses.
Rajk et Nagy ne furent jamais en désaccord avec Rakosi
que sur des modalités de la politique communiste. Nagy
pensait que le rythme d'investissement dans l'industrie
lourde risquait de désorganiser la production et de main.
tenir le pouvoir d'achat des masses à un niveau si bas que
l'on ne pourrait espérer un accroissement de la productivité.
En d'autres termes, il pensait que la création de hauts.
fourneaux ne pouvait être effectuée de manière satisfaisante
par un prolétariat en haillons. De même il recommandait
qu'on ne précipite pas la collectivisation parce qu'il avait
le souvenir de la terrible crise dans laquelle l’U.R.S.S. avait
été plongée du fait de la collectivisation forcée. Mais Nagy,
pas plus que Rajk, n'eut une seule fois le programme de
108
consulter les ouvriers et les paysans sur l'organisation de
la production. Encore moins proposa-t-il de faire participer
des Conseils d'ouvriers à l'élaboration du plan. Ni Rajk ni
Nagy ne luttèrent jamais pour une démocratisation effective
du parti qui aurait reconnu le droit des tendances à s'orga.
niser et à s'exprimer publiquement.
Un niveau de vie misérable, une exploitation renforcée,
un contrôle policier sur la vie sociale et intellectuelle, voici
les traits de la démocratie populaire hongroise pendant dix
ans. Le régime a substitué à la dictature Horthy une nou-
velle dictature, orientée vers de nouvelles tâches (l'industria-
lisation rapide, la collectivisation agricole), mais aussi hos-
tile aux inasses que la première.
Si l'on prend conscience d'une telle situation, on com.
prend pourquoi toutes les couches de la population se sont
liguées contre le pouvoir « communiste » aux premiers signes
de faiblesse qu'il a donnés.
LE SENS
DES REVENDICATIONS « DEMOCRATIQUES »
L’union des ouvriers, des paysans, des classes moyennes,
de la jeunesse et des intellectuels, on ne la trouve que rare-
ment dans l'histoire. C'est toujours dans une époque où le
despotisme a été poussé au point d'acculer à la révolte le
peuple entier. Une telle union a fait triompher la révolu-
tion russe contre le tsarisme; et dans cette révolution, comme
dans le mouvement hongrois, on retrouve en particulier la
même et exceptionnelle fusion de l'intelligentzia et du pro-
létariat et le même enthousiasme de la jeunesse qui résume
en elle-même l'avidité de changement.
Dans de telles conditions, les mots d'ordre démocra.
tiques ont un effet explosif. Elections libres, abolition du
régime du parti unique, liberté de la presse, droit de grève
pour les ouvriers, partage des terres entre les paysans, toutes
ces revendications ne représentent pas un pas en arrière mais
un immense pas en avant, car elles ont pour effet de briser
la machine de l'Etat totalitaire.
En fait, ces revendications n'ont pas été les seules avan.
cées. Nous avons montré que partout les conseils ouvriers en
ont présenté d'autres, radicales, propres au prolétariat. Ce
que nous voulons souligner à l'instant, c'est que les mots
d'ordre démocratiques de l'insurrection ont eux-mêmes une
signification progressive. Ils n'avaient jamais été réalisés
sous le régime Horthy et c'est tout ensemble à la dictature
féodalo-capitaliste et à la dictature stalinienne que les Hon.
grois tournaient le dos.
RUS
109
Les ouvriers n'étaient pas aveuglés par l'idéologie bour-
geoise; quand ils soutenaient les revendications démocrati-
ques, ils luttaient aussi pour leur propre cause. Car celles-ci
redonnaient la parole aux masses populaires dans leur ensem-
ble dont la voix avait été étouffée par la dictature.
Le proletariat ne veut plus d'élections dans lesquelles
le Parti Communiste impose une liste de candidats et dans
lesquelles le résultat est joué d'avance, il veut choisir ses
représentants. Demain, sans doute, il découvrira qu'il ne
peut dominer par l'intermédiaire d'un parlement qui noie
sa voix dans celle de toutes les couches sociales, demain sans
doute il devra s'il veut triompher opposer ses conseils à ce
parlement, mais dans l'immédiait il part des institutions
existantes et cherche à leur rendre vie. Il revendique la
liberté politique en général contre le totalitarisme, quitte à
définir plus précisément quelle doit être cette liberté dans
une seconde phase.
Le prolétariat est pour l'abolition du parti unique, car
il a vu que le règne exclusif d'un parti revient à interdire
toute opinion et tout regroupement qui s'écarte des normes
imposées par l'Etat. Il veut avoir la liberté de s'organiser.
Sans doute sera-t-il amené à faire une distinction entre la
pluralité des partis révolutionnaires qui est absolument légi-
time et la pluralité des partis bourgeois qui peuvent menacer
le régime socialiste. Sa réaction présente n'en est pas moins
fondamentalement saine. De même quand il demande la
liberté de la presse, il vise la destruction des organes inféo-
dés à l'Etat et affirme son droit d'exprimer publiquement
son opinion même si elle est oppositionnelle.
PARTAGE DES TERRES
ET COLLECTIVISATION FORCEE
De toutes les revendications démocratiques, la plus typi-
que concerne le partage des terres. Nous avons déjà noté
qu'en plusieurs endroit les coopératives ont été préservées,
mais nous ne reviendrons pas sur ces informations. Admet-
tons que l'immense majorité des paysans se soient emparés
de la terre. Pourquoi parler d'une geste réactionnaire ?
Les staliniens français s'indignent. La décollectivisation
est une terrible régression, une menace pour le socialisme,
disent-ils. Mais nous demandons à notre tour : où est la
vertu socialiste de la collectivisation ?
Pour nous, la voici : la réunion des paysans dans des
coopératives leur permet de mettre leurs ressources en com-
mun, d'acquérir des machines agricoles puissantes, d'accroi-
110
en
la
tre leur production et grâce à ce progrès de relever leur
niveau de vie et leur niveau culturel; en outre, le travail
commun change leur mentalité ; les problèmes qu'ils
affrontent dans leur entreprise les amènent à intensifier leurs
échanges avec le reste de la société, à comprendre les rela-
tions qui existent entre les diverses sphères de production,
à participer d'une manière de plus en plus active à l'orga-
nisation économique dans son ensemble.
Cette vertu socialiste animait-elle la collectivisation hon.
groise qui était une collectivisation forcée ?
Il va de soi que si les paysans sont contraints par
force de travailler dans des coopératives, si là ils ne déter-
minent pas en commun leur travail, mais doivent obéir aux
ordres de fonctionnaires qui ne travaillent pas, si leur niveau
de vie ne s'élève pas, si la différence de leurs revenus et de
ceux de la bureaucratie sont considérables, il va de soi,
disons-nous, que dans de telles conditions la collectivisation
n'a rien de socialiste. La haine des paysans pour la bureau-
cratie des coopératives est alors aussi saine que la haine
qu'ils témoignaient aux propriétaires fonciers ; leur désir de
posséder la terre et d'être maîtres de leur propre travail
aussi légitime qu'il y a dix ans. Les ouvriers révolution-
naires peuvent souhaiter que les paysans comprennent peu
à peu quels sont les avantages de la production collective,
car effectivement ces avantages sont immenses et le socia-
lisme ne
sera assuré que lorsque les paysans auront eux-
mêmes reconnu la supériorité des coopératives ; mais dans
l'immédiat les ouvriers ne peuvent qu'aider les paysans
à
combattre l'oppression dont ils ont été victimes.
L'Humanité a insinué que les gros propriétaires pour-
raient récupérer leurs terres. Mais comme nulle part, et pour
cause, les paysans ne songèrent à les rappeler, l'organe sta-
linier se sontenta d'annoncer la libération du prince Este-
rhazy. Libéré, il le fut bien puisque les prisons furent vidées.
Mais que fit-il ? Après un rapide tour dans sa campagne
natale, il passa en Autriche.
L'EXPLOITATION DE LA HONGRIE PAR L'U. R. S. S.
ET LES REVENDICATIONS NATIONALES
On a présenté les revendications nationales comme typi-
quement réactionnaires. Or, pour les apprécier correctement,
il faut de nouveau considérer la situation dans laquelle elles
se sont exprimées.
Les faits sont là : depuis dix ans, l’U.R.S.S. exploite la
Hongrie. Ce ne sont pas des statistiques et des témoignages
111
bourgeois qui nous l'enseignent, ce sont les communistes pro-
gressistes hongrois qui, depuis la défaite de Rakosi (c'est-
à-dire depuis juillet dernier), l'ont clairement dévoilé.
Dans une première phase, l'U.R.S.S. a exigé des répa-
rations qui ont fait peser un terrible poids sur l'économie
d'un pays déjà exangue. En 1946, 65 % de la production
totale du pays était consacrée à ces réparations; en 1947,
18 % du budget national y était encore affecté.
Dans une seconde phase, les Russes ont pratiqué, comme
dans toutes les démocraties populaires (et ce fut une raison
essentielle de la rupture de Tito), une exploitation indirecte
en contraignant les Hongrois à leur vendre produits indus-
triels et produits agricoles à un prix très inférieur à celui
qu'ils auraient obtenu sur le marché mondial. Ils s'appré-
taient finalement à mettre la main sur des gisements d'ura.
nium en offrant une contre-partie dérisoire.
En outre, la domination russe n'avait pas ce seul aspect
économique, elle apparaissait dans tous les secteurs de la
vie sociale, politique et culturelle.
Il était connu que le sort des tendances dans le P. C.
hongrois était strictement lié à l'orientation de Moscou ;
par exemple, la montée de Nagy dans la période Malenkov,
puis sa chute consécutive à la disgrâce de ce dernier, mani.
festèrent publiquement le rôle dirigeant du Politbureau
russe.
Les écrivains, philosophes ou artistes se voyaient de
leur côté imposer le modèle russe et toute tentative d'ex-
pression indépendante se voyait aussitôt réprimée ; c'est ainsi
que, par exemple, le philosophe hongrois Lukacs, marxiste
dépassant de cent coudées tout ce que la Russie stalinienne
a jamais pu produire en ce ccmaine, dut faire des auto-
critiques déshonorantes pour reconnaître qu'il n'y avait
qu'une littérature et qu'une philosophie valables, celles pra-
tiquées à Moscou. Dans les écoles, l'enseignement du russe
était obligatoire. Si l'on ajoute à ce tableau la présence per-
manente des troupes russes, on aura une idée des relations
entre la Hongrie et l’U.R.S.S. Ces relations traduisaient en
fait une exploitation de caractère colonial.
Or, si dans tous les pays coloniaux grandit le désir de
l'indépendance nationale, dans un pays comme la Hongrie
doué d'un riche passé national, la haine de l'exploiteur étran-
ger était décuplée. Qualifier cette haine de « réactionnaire »
est faux quand c'est la conduite de l'étranger qui est réac-
tionnaire.
Certes, les revendications nationales sont toujours pré-
tes à dégénérer en nationalisme (dans les pays coloniaux
également). Nous sommes convaincus que parmi ceux qui
brandissaient l'emblème de Kossuth ou qui arrachaient les
112
étoiles rouges des drapeaux hongrois, bon nombre d'éléments
cédaient à un pur et simple chauvinisme. Nous re savons
que trop que la petite bourgeoisie est un terrain d'élection
pour ce chauvinisme. Nous pensons nous-mêmes que
ie
déchaînement des sentiments anti-russes a pu réveiller chez
des paysans une haine ancestrale. Mais l'important n'est pas
là. Il y avait aussi dans les revendications nationales un
aspect sain. La jeunesse révolutionnaire et les conseils
ouvriers qui exigeaient le départ immédiat des Russes et
la proclamation d'une Hongrie souveraine et indépendante
attaquaient l'oppression de l'impérialisme russe ; ils combat-
taient simultanément l'Etat totalitaire étranger et l'Etat tota-
litaire hongrois.
Nous avons en outre la preuve que le combat mené
contre les Russes s'est accompagné en de nombreuses occa-
sions d'une conduite typiquement internationaliste. Les sol.
dats russes ont été appelés à fraterniser et ils ont effecti-
vement fraternisé. Il est à peu près certain que l'ampleur
de ces manifestations a contraint la bureaucratie de Moscou
à rappeler une partie de ses troupes et à envoyer des élé-
ments plus sûrs qui n'étaient pas susceptibles de sympathiser
avec la population. La fraternité avec laquelle les insurgés
ont accueilli les soldats qui refusaient de tirer sur eux est
attestée par une résolution demandant qu'on leur accorde
le droit d'asile en Hongrie.
Est-il besoin de dénoncer l'attitude des staliniens fran.
çais ? Ils osent s'indigner du nationalisme des insurgés hon-
grois alors qu'ils se sont vautrés dans un chauvinisme abject,
en face de ce qu'ils appelaient les a boches » à la fin de la
guerre.
LA BUREAUCRATIE RUSSE
ET LA REVOLUTION HONGROISE
-
On avait pu croire que le rideau était tombé sur le pre-
mier acte de la révolution hongroise, quand Nagy annonça
tout ensemble la victoire de l'insurrection et le départ des
troupes russes. Il n'y eut pas de pause. A peine baissé, le ri.
deau se relevait dans le fracas des tanks qui déferlaient sur le
territoire hongrois, encerclaient Budapest, occupaient les
ponts, les routes et coupaient le pays du reste du monde.
Nous ne pensions pas que l'U.R.S.S. oserait. Il y a 6 mois,
la dictature de Staline avait été solennellement condamnée;
les dirigeants russes avaient promis la fin de la terreur
policière, ils avaient multiplié les gestes qui visaient à réta-
blir la confiance, ils avaient signé avec Tito des déclarations
113
sur les principes d'égalité qui devaient régir les relations
entre nations socialistes ; il y a un mois à peine, ils avaient
cédé devant le courant révolutionnaire polonais; 5 jours plus
tôt, ils publiaient une longue résolution qui envisageait le
retrait des troupes russes de plusieurs pays d'Europe centrale
et orientale et qui confirmait le droit des démocraties popu-
laires à déterminer librement leur propre politique; 48
heures avant l'attaque, enfin, leur délégué à l'O.N.U. affir-
mait que les troupes russes ne cherchaient qu'à protéger le
départ des ressortissants soviétiques de Hongrie.
Mais en 24 heures les concessions sont reprises, les dé-
clarations annulées, les promesses bafouées, la démocratisa-
tion balayée et ils osent reprendre le visage hideux du stali.
nisme qu'ils avaient eux-mêmes transformé en épouvantail
pour ressusciter la confiance en leur propre personne.
Sans doute l'histoire le l'humanité est-elle pleine
d'exemples sanglants, pleine des mensonges et des traitrises
des gouvernements, mais on ne pouvait imaginer qu'un Etat
qui réclame du communisme fasse front contre un peuple
entier et déchaîne la plus féroce répression connue jusqu'à
ce jour.
Alors même qu'on était conscient du véritable caractère
du régime russe, qu'on connaissait le rôle contre révolution-
naire exercé par les staliniens dans toutes les luttes ouvrières
depuis 25 ans, qu'on se souvenait de l'impitoyable répression
qui a frappé toutes les oppositions en U.R.S.S., qu'on se sou-
venait aussi du sort subi par des populations entières, dépor-
tées par millions à l'époque de la collectivisation (Kroutchev
le confirmait récemment devant le 20e Congrès), on ne pen.
sait pas que dans la conjoncture présente, l'U.R.S.S. - nous
voulons dire son gouvernement assume devant le monde
entier, devant les travailleurs de tous les pays et les commu-
nistes de tous les pays la responsabilité d'écraser sous le poids
de milliers de blindés une insurrection qui avait mobilisé
toutes les couches de la population hongroise.
C'est chose faite. Nous avions sous-estimé le Kremlin,
sa puissance de mensonge, son cynisme et sa haine sans limite
des masses populaires. Les Kroutchev, les Mikoian, les Boul-
ganine qui se sont plus à charger Staline de tous les maux
et de toutes les atrocités du passé, qui se sont eux-mêmes
présentés comme les spectateurs impuissants d'une terreur
qu'ils n'avaient pas voulue, cette bande infâme qui depuis
plusieurs mois effectuait des pitreries dans diverses capitales
du monde afin de se faire passer pour de « braves gens », ils
ont dépassé Staline dans l'atroce. Et, de fait, jamais à Staline
ne fut fournie l'occasion d'un tel carnage. Les milliers de
discours d'hier et de demain n'effaceront pas leurs actes qui
les dénoncent comme des criminels, des fusilleurs d'ouvriers
114
et qui dénoncent par delà leurs personnes leur régime : le ca
pitalisme bureaucratique.
Ce régime, aucune réforme ne peut le transformer. Il peut
bien se libéraliser un moment pour tenter de recorquérir une
assise populaire. Dès qu'il est menacé, il agit selon sa logique
propre qui est d’écrabouiller l'opposant, cet opposant fut-il
un peuple de 10 millions d'hommes.
Que tous ceux qui étaient prêts à s'enthousiasmer pour
la nouvelle bureaucratie progressive de l'U.R.S.S. contemplent
aujourd'hui le visage hideux qu'elle a pris au combat, qu'ils
voient les ruines, l'amoncellement des cadavres, l'horrible
misère de ceux qui restent au milieu de leurs morts, isolés du
monde, condamnés de nouveau à vivre sous l'oppression et
qu'ils comprennent au moins qu'il faut choisir.Choisir radi.
calement non pas entre Staline et Kroutchev, Kroutchev et
Malenkov, entre les prétendus durs et les prétendus mous,
mais entre la bureaucratie totalitaire et ceux-là seuls qui
peuvent s'y opposer, ceux qui subissent l'exploitation et qui
seuls peuvent réaliser le socialisme.
LE JEU DU STALINISME
STALINISME FRANÇAIS
« Ne
en
comme
Nombreux sont ceux qui, aujourd'hui, sont écourés par
les mensonges des dirigeants communistes de Paris et de
Moscou. Mais ils se sentent paralysés. C'est à eux particu-
lièrement que nous nous adressons. Vous nous dites :
voyez-vous pas que la bourgeoisie exulte et que vous la ser-
vez en attaquant le P. C. ».
Nous vous répondons : « La bourgeoisie a effet
exploité à son profit la révolution hongroise. Mais il doit
être clair pour vous que la bourgeoisie exploitera toujours
les luttes qui se produisent dans le bloc russe,
l'U.R.S.S. exploitera toujours celles qui éclatent dans le bloc
occidental. Qu'en France le Figaro et l'Aurore ge réjouissent
bruyamment des difficultés d'un impérialisme qui est leur
adversaire, c'est naturel. Les ouvriers savent que la révolu-
tion hongroise qu'ils soutiennent n'est pas celle dont se
réclame leur ennemi de classe. Si vous vous laissiez para.
lyser devant cette révolution pour la seule raison que la
presse bourgeoise en tire un argument contre l'U.R.S.S. cela
signifierait que vous ne soutiendrez jamais une révolution
ouvrière qui éclatera dans un pays de l'Est ».
Vous nous dites : « L'insurrection hongroise a entraîné
des courants très divers, elle a redonné un pouvoir dange-
reux à des éléments petits bourgeois et même à des réac-
tionnaires ».
115
Nous vous répondons : « D'abord, une révolution n'est
jamais pure, des tendances diverses se manifestent nécessai.
rement. La grande révolution russe de février, vous le savez
bien, n'était pas pure; aux côtés des ouvriers et des paysans
pauvres il y avait aussi des petits bourgeois et même des
éléments qui se battaient parce qu'ils s'indignaient de ce que
le Tsar était incapable de mener la guerre contre l'Alle-
magne. C'est la dynamique de la lutte qui sépare et oppose
les tendances et qui règle finalement leur conflit. En Hon
grie, le mouvement avait éclaté depuis douze jours quand les
Russes ont décidé de l'écraser : le mouvement avait son ave-
nir devant lui.
« Ensuite, comprenez que dans toute révolution qui
éclatera dans les démocraties populaires ou en U.R.S.S., le
jeu des forces sera particulièrement complexe. Le totalita
risme a suscité de tels sentiments de révolte que tout le
monde est prêt à se liguer contre lui; dans le premier mo-
ment, tous ceux qui se soulèvent ont un objectif commun,
la liberté. Mais passé ce premier moment, les uns veulent
ressusciter le passé national, la religion des aïeux, les petits
profits d'autrefois, les habitudes inortes tandis que les autres
veulent transformer radicalement la société et instaurer enfin
le socialisme qu'on leur avait annoncé tout en les étouffant.
Le petit boutiquier remercie Dieu de ce qu'il va pouvoir
payer des impôts moins lourds et relever ses prix ; les
ouvriers forment un Conseil qui demande de diriger l'usine.
« Votre rôle n'est pas de gémir à l'idée que des bouti-
quiers crient vive l'Amérique ou que des paysans courent
se jeter aux pieds d'un cardinal. Votre rôle est de crier
partout ce que fait le prolétariat, ce qu'il réclame, comment
il s'organise et d'appeler à le soutenir ».
Claude LEFORT.
116
Comment ils se sont battus
UNE REVOLTE DE TOUT UN PEUPLE,
PROLETARIAT EU JEUNES EN TETE
Tout le monde sait maintenant comment cela a débuté.
A la suite de l'avènement au pouvoir de Gomulka en Polognc,
un grand espoir s'est levé sur la Hongrie. Tout le monde
espère le retour de Nagy, le Gomulka hongrois, parce que,
comme en Pologne, cela signifie un certain allègement de la
contrainte économique et une petite indépendance vis-à-vis
des Russes, moins d'ingérence ouverte de ceux-ci et moins de
prélèvements sans contrepartie des richesses produites par
le pays. Ce n'est pas grand chose, mais c'est déjà énorme en
comparaison d’un passé exécré, celui de Rakosi. Ces timides
revendications viennent des écrivains communistes (cercle
Petoefi) et des étudiants communistes. Ces écrivains ne sont
pas des écrivains « bourgeois », ayant une situation indé-
pendante, comme Mauriac ou Sartre en France. Ce sont
tous de véritables fonctionnaires du parti communiste. des
servants de son idéologie, comme le philosophe Lukacs et
qui, tous, ont chanté les louanges des Rakosi et de son ré-
gime, même si ils l'ont fait parfois à contre ceur. Depuis la
destalinisation cependant, et plus particulièrement depuis les
événements de Pologne, ils ont pris quelques libertés, se sont
exprimés ouvertement, ont tenu des réunions. Les étudiants
ne sont pas des étudiants bourgeois; ce sont des fils de mem-
bres du parti, de dirigeants syndicaux, de fonctionnaires de
l'Etat communiste et même d'ouvriers et de paysans, à qui
le régime qui a un énorme besoin de « cadres »
donné, en échange de leur soumission, leur chance sur une
échelle beaucoup plus grande que dans les pays capitalistes.
Une manifestation est décidée pour le 23 octobre, mais peu
après que les écrivains et les étudiants aient formé leur cor-
tèges, toutes les autres couches de la population, dont essen-
tiellement les ouvriers, se sont joints à eux jusqu'à former
des cortèges s'élevant à plus de deux cent mille hommes,
femmes et enfants.
On sait aussi que Geroe, le secrétaire en titre du « parti
des travailleurs » (communiste), prononçait devant les micros
presqu'au même moment un discours traitant les manifestants
de racaille et de ramassis d'individus. La nouvelle se répand
rapidement. En sortant du bâtiment de la radio, Geroe faillit
a
117
ses
ser-
être lynché par la foule. Immédiatement et spontanément les
masses passent à l'action, se dirigeant vers les divers centres
traditionnels du pouvoir, détruisant toutes ses insignes et
attaquant ses fonctionnaires, ses représentants et
viteurs.
Dès ce moment le véritable moteur de la révolution est
en marche : la destruction de l'appareil du parti et de l'Etat
(mais c'est ici la même chose) totalitaire dit « communiste ».
Pendant quinze jours, jusqu'à la deuxième intervention des
blindés russes, les masses n'auront de cesse avant de mener
à bien cette entreprise qui est la plus essentielle de toutes.
Les seuls qui, en France, peuvent comprendre cela sont les
ouvriers, car seuls les ouvriers connaissent la puissance, l'ar-
bitraire, l'arrogance des fonctionnaires de parti at de syn.
dicat. Qui ne se souvient de la Libération, où la moindre
opposition à la politique du parti communiste français et de
la C.G.T. était impitoyablement réprimée, où la moindre cri.
tique, même de détail, même venant de la part d'un militant
communiste ou cégétiste, était qualifiée de fasciste, et ceci à
une époque où le mot d'ordre principal du P.C. et de la
C.G.T. était le mot d'ordre anti-ouvrier de ( produire
d'abord et revendiquer ensuite », accompagné de cette
explication extraordinaire. a la grève, c'est l'arme
des
trusts ).
En Hongrie il en etait de même depuis 1949, avec par
dessus le marché, la police politique et les déportations. Il y
avait aussi en plus les « salaires au rendement progressif »,
les « béros du travail, jaunes à qui l'on donnait des croix,
les salaires des directeurs dix ou vingt fois supérieurs
des ouvriers, la sacro-sainte hiérarchie des salaires, la direc-
tion de droit divin des directeurs d'usine (le 3 novembre,
Ulbricht, le Rakosi ou le Thorez de l'Allemagne de l'Est,
disait : « Nous proposons que les ouvriers aient plus de res-
ponsabilités dans la direction des usines, mais notre propo-
sition n'a rien à voir avec l'autonomie ou l'auto-administra-
tion, qui conduiraient au chaos. »)
Toute la révolution hongroise a été avant tout cela :
l'élimination et la destruction, même physique, de tous les
suppôts de l'appareil du parti et de ses valets. On s'en prend
aux fonctionnaires, aux secrétaires du parti, aux policiers,
aux chefs d'entreprise.
A la campagne
et souvent avec l'appui des ouvriers
les paysans secouent le joug du kolhoz-prison dans lequel le
régime les a enfermés, pour les y soumettre au régime des
livraisons obligatoires à l'Etat et à l'exploitation la plus for-
cenée de la part des directeurs et des fonctionnaires de la
planification.
Voilà ce qu'est la révolution hongroise. Jeunes, ouvriers
et paysans (et qu'il y a-t-il d'autre dans un tel régime sauf les
pelits fonctionnaires de base du parti et de l'Etat?) prennent
сеux
4
118
les armes, refusent vingt fois de les déposer et s'en servent
justement pour liquider le parti totalitaire avant tout.
Tout le long de la révolution cela a été la trame perma-
nente des combats.
Oui, mais il y a eu les blindés et les troupes russes.
LE PREMIER ECHEC DES FORCES
DE REPRESSION RUSSES
« Ils nous prennent tout », disait-on en France pen-
dant l'occupation nazie. En Hongrie, comme dan toutes les
démocraties populaires c'était, à cet égard, la même chose.
Un seul exemple: on découvre en Hongrie de très riches gise-
ments de minerai d'uranium. Les Russes se précipitent,
creusent fébrilement pour extraire ce minerai qu'ils s'attri-
buent d'office, vont si vite qu'ils inondent par des infiltra-
tions d'eau souterraines les puits de pétrole hongrois. Or la
Hongrie, que les plans quinquenaux ont soumis à une indus-
trialisation intensive, manque d'énergie au point que beau-
coup d’usines nouvellement construites ne peuvent fonction-
ner non seulement à leur capacité normale, mais même sou-
vent à la moitié de celle-ci. Dans ces conditions, l'énorme
majorité des bureaucrates eux-mêmes voulaient se débar-
rasser de l'occupation russe.
Voilà donc les conditions dans lesquelles les Russes,
appelés par Geroe, interviennent: 99 % des Hongrois sont
contre les Russes, 80 % de la population veut détruire le
parti communiste totalitaire. La différence représente 19 %
qui sont pris entre deux feux. Ceux qui ne sont pas trop
ouvertement compromis avec le régime stalinien font front
commun contre les Russes, les autres se terrent ou attendent
leur heure. Et les Russes attaquent.
En juin 1953 à Berlin-Est il y avait déjà eu une révolte,
essentiellement ouvrière, que la seule présence des chars
russes, avec tout au plus quelques interventions mineuses.
avait suffi à briser. Il aurait dû en être de même en Hongrie,
au pire au prix d'une intervention un peu plus active, pen-
saient les Russca.
Il n'en a pas été ainsi.
Tout d'abord la présence des chars n’a nullement inti-
midé la foule. Le flot des manifestants passait, sans égard
aux chars. Cela a été le moment de l'insurrection « roman-
tique », peut-être le plus décisif. Un vieux à qui l'on pro-
posait une mitraillette (les soldats avaient déjà donné des
armes aux insurgés) répondit: « Nous n'avons pas besoin
d'armes, nous avons nos drapeaux ». L'intimidation avait
échoué. Désormais le cadre des opérations allait être une
foule révoltée, mais désarmée, une foule presque toujours
présente et au-delà de la peur.
119
Pendant ce temps la jeunesse étudiante et ouvrière ne
l'entendait pas de la même manière : très rapidement, les
jeunes soldats font cause commune avec les jeunes insurgés
et, par dessus les murs des casernes où ils sont sinon consi.
gnés, au moins enfermés, ils leur passent des armes. Les pre-
miers combats visent à liquider les troupes de la police poli-
tique, qui savent ce qui les attend et sont pratiquement le
dos au mur (Une dépêche de Varsovie du 3 novembre rap-
porte que les unités locales de la police de sécurité de Poz-
nan ont demandé au gouvernement qu'il veuille bien les
dissoudre!)
Pendant les quelques jours qui suivirent, la situation
générale est commandée par trois éléments : 1° armement des
insurgés par les soldats et même participation active de ces
derniers à l'insurrection; 2° les masses désarmées manifes-
tent sans être intimidées par les chars et les troupes russes ;
3° les insurgés les plus actifs sont les jeunes étudiants et
ouvriers qui réunissent dynamisme, ruse et mépris total du
danger. Les enfants de 14 ans sont nombreux parmi les in-
surgés et attaquent les chars avec des grenades et des bou-
teilles d'essence. Sans tradition, sans liens, opprimée et misé-
rable, cette jeunesse a montré au monde moderne la voie à
suivre.
Que s'est-il passé du côté russe? Tout d'abord une cer-
taine hésitation. Où était l'ennemi? Dans cette foule. le plus
souvent désarmée, qui manifestait tout simplement
était là? Fallait-il tirer sur tous sans distinction? Sur les
insurgés qui, suivant en apparence les instructions du gouver-
nement, déposaient les armes après s'en être servis jusqu'à
épuisement... et qui allaient ensuite en chercher de nouvelles
dans les casernes ? Pour des unités russes, les instructions pré-
cises sont sacrées, et pour les commandants d'unité les ins-
tructions politiques des dirigeants politiques sont encore plus
sacrées. De là de multiples flottements.
Cependant la répression s'étend rapidement, devient plus
brutale et plus sauvage et ceci sous l'influence de trois
facteurs : les provocations de la police politique hongroise
aux abois, parfois l'affolement des tankistes russes eux-me-
mes, et enfin l'attitude des dirigeants russes directement res-
ponsables, qui ne se rendent pas compte de la situation réelle
et donnent l'ordre de mettre le paquet.
Et c'est en effet ce qui se passe. La répression est sau-
vage : on pend aux reverbères des dizaines et des dizaines
d'insurgés, on tire dans la foule aveuglément. Les réactions
ne sont pas moins vives : des soldats russes sont pendus à leur
tour. En province le tableau est analogue, bien qu'atténué.
Les troupes russes s'y tiennent plus souvent dans l'expectative
et les massacres sont surtout dus à la provocation et à l'affo-
lement de la police politique.
Cela dure plusieurs jours, au sein de la confusion la plus
effroyable. Et puis tout d'un coup le commandement russe
ou
120
se rend compte de l'impensable: l'essentiel de l'armée hon-
groise passait du côté des insurgés ou pour le moins restait
dans une neutralité favorable, un nombre croissant et de toute
manière beaucoup trop grand de chars russes étaient mis
hors de combat, enfin certaines unités de l'armée rouge fai-
blissaient, quand même certains de leurs soldats n'allaient
pas jusqu'à fraterniser avec les insurgés.
Les bases logistiques de l'armée russe, c'est-à-dire en gros
son ravitaillement en essence, vivres et munitions ainsi qu'en
moyens de transport (voies ferrées, entre autres) n'étaient
nullement autonomes. C'était l'armée hongroise qui possédait
les stocks d'essence et de munitions, ainsi que les
moyens
de
réparations importants. C'étaient les cheminots hongrois qui
contrôlaient le réseau ferré.
Les tanks brûlaient dans les rues de Budapest et ne pou-
vaient plus agir isolément sans être attaqués par de véritables
gosses de 14 ou 15 ans. Les soldats russes stationnés depuis
longtemps en Hongrie, n'étant pas sans avoir eu quelques
contacts avec la population, ne comprenant pas que
l'or assas-
sine tout un peuple de travailleurs et de paysans comme eux
et qui de plus appartenait au bloc dit « socialiste », molis-
saient, refusaient parfois de tirer, dans quelques cas frater-
nisaient ouvertement et franchement.
Il fallut bien se rendre à l'évidence: l'insurrection avait
vaincu. C'est à ce moment - le dimanche 28 octobre
que
Nagy donna l'ordre à « ses troupes » de ne plus tirer. C'est à
ce moment que les Russes, les seules forces de répression
réelles, se sont aussi conformés à cet ordre et ont commencé à
se retirer dans les faubourgs de la ville.
Ainsi, pour la première fois dans l'histoire deux divi.
sions blindées, dotées d'une puissance de feu immense (en
Egypte deux divisions blindées israéliennes ont mis hors de
combat la moitié de l'armée de Nasser) ont marqué le pas
devant une insurrection populaire, au quart armée d'armes
légères. Le monde s'en est trouvé ébranlé jusque dans ses
fondements.
Battus, car pendant cette première phase ils ont été
battus, les Russes adoptent la manoeuvre politique. Utilisant
Nagy comme intermédiaire, ils disent: « déposez vos armes
et nous partirons ». Le Comité révolutionnaire des étudiants
et les Conseils ouvriers refusent et répondent: « Partez
d'abord Un moment l'attaque reprend en force à Buda.
pest. Elle échoue assez rapidement, malgré les moyens mis en
euvre. La révolution est « définitivement » victorieuse.
La situation politique continue alors à évoluer. On trou-
vera par ailleurs des analyses de cette évolution. Ce qui inté-
resse ici, ce sont les leçons qu'ont tirées les Russes de leur
échec.
».
121
LA PLUS BARBARE CONTRE-REVOLUTION
DE L'HISTOIRE
Il y avait longtemps que les bureaucrates russes avaient
compris que des opérations de police ne pouvaient se faire
qu'en utilisant des forces aussi puissantes que celles des plus
puissants groupements des armées régulières. Les unités de
police des pays de démocraties populaires sont déjà dotées
de chars légers, d'artillerie moyenne et de mitrailleuses lour-
des. Mais cela ne suffisait pas encore, ils le savaient. Ils
ne pouvaient vraiment compter que sur leurs propres unités
blindées. C'est là que résidait leur erreur. Quelque soient
les forces utilisées, elles sont inefficaces contre le soulève-
ment de tout un peuple, si l'on s'en sert dans le cadre étroit
d'un opération de police. Il fallait faire une véritable guerre,
avec les appuis logistiques correspondants, avec des troupes
dont on soit sûr et avec pour seul objectif l'extermination
pure et simple, sans ménagement aucun à l'égard de per-
sonne. Les Russes allaient-ils se lancer dans cette aventure ?
Ils prirent en tout cas rapidement leur dispositions en ce
sens. Les troupes peu sûres et fatiguées ou démoralisées
furent retirées. Plusieurs divisions blindées près de dix
envahirent le pays de tous côtés avec le ravitaillement néces.
saire, comme en temps de guerre. Le samedi 3 novembre
on pouvait encore douter de leur décision.
Il sera temps plus tard d'analyser les raisons de leur
décision et encore plus les répercussions au sein du mouve-
ment ouvrier mondial de leur action. Il est probable cepen-
dant que le Kremlin a
eu peur de voir sauter l'ensemble
du glacis, de la Pologne à la Roumanie, de l'Allemagne de
l'Est à la Tchécoslovaquie et la Bulgarie. Quant aux réper.
cussions, le plus clair c'est que le Kremlin s'est résigné en
agissant ainsi à un abandon à terme de toute influences des
partis communistes dans les pays capitalistes (Italie et France
avant tout) et au maintien de sa présence dans le glacis
par la seule force de l'Armée Soviétique.
A 5 h. 30 donc de ce matin du 4 novembre, une armée
entière a lancé contre les insurgés une bataille d'extermi-
nation avec les moyens les plus puissants : tanks de dernier
modèle T 54 jusqu'ici inconnus, équipés de stabilisateurs
gyroscopiques leur permettant de tirer en marche, obus au
phosphore aussi atroces que le Napalm, aviation.
La mission des troupes russes était double : détruire
les centres de résistance massifs contre lesquels ils s'étaient
précédemment « cassé les dents » ; paralyser par la terreur
le partisanat urbain qui avait jusqu'ici entravé les tentatives
d'attaque d'envergure contre les centres de résistance. En
un mot, il fallait dissocier ces deux pôles de la lutte des
insurgés hongrois dont l'association avait amené la défaite
de la première intervention russe. L'attaque des centres de
résistance a été effectuée suivant les règles les plus classiques
122
de l'art militaire : préparation d'artillerie, attaque de chars
avec groupes d'appui, encerclement par l'infanterie. L'artil-
lerie, ce sont des 105 et même les fameuses « orgues de
Staline » (batteries de fusées) qui avaient fait la terreur des
fantassins allemands à Stalingrad. La seconde mission peut
se résumer par cet ordre donné aux tankistes russes : « Si
on tire d'une fenêtre, détruire toute la maison ».
C'est la nature de cette mission qui explique le temps
que les Russes ont mis pour la remplir : trois jours pour
les principaux combats lourds contre les centres de résis-
tance, plus de six jours de terreur pour mettre fin aux tirs
des partisans.
Certes, cette mission militaire a été remplie par le com-
mandement russe, mais cette mission elle-même n'avait d'au-
tre objet que d'effacer l'échec précédent des troupes russes.
Cette « victoire » se situant sur le terrain limité des armes
ne signifiait pas obligatoirement la victoire définitive de la
contre-révolution. La grève générale dirigée par les conseils
ouvriers prit immédiatement la relève des armes.
Après plus de vingt jours, cette grève prend fin mais
les conseils ouvriers demeurent. Ayant organisé la lutte les
armes à la main, puis la grève générale, les conseils ouvriers
demeurent, aujourd'hui encore, la seule force sociale effec-
tive de la société hongroise. On ne pourra parler d'échec
définitif de la révolution hongroise que le jour où il n'y
aura plus de conseils ouvriers authentiques.
Philippe GUILLAUME.
123
Chez Renault
on parle de la Hongrie
Jeudi : Méfiance
A la sortie de 14 h. 30 France Soir étale ses colonnes :
« Révolte à Budapest. Le gouvernement fait appel à l'Armée
Russe ».
-
Ça à l'air de barder, là-bas.
Ce sont des bobards.
L'homme continue à lire les gros titres.
Ce n'est pas vrai; il ne savent pas quoi mettre dans
leur canard.
Il pousse son copain pour le faire avancer, mais ce der-
nier semble bien pensif.
Quelques mètres plus loin, d'autres ouvriers.
- Les Hongrois, ce n'est pas comme les Polonais, ils
ont été longtemps fascistes. Ils n'ont pas résisté
Allemands.
aux
Vendredi
Tu as vu les événements en Hongrie?
Non.
Tiens, lis.
L'ouvrier rend le journal que l'autre lui a prêté. Il semble
incrédule, sans opinion.
Les communistes de l'atelier ne bougent pas de leur ma-
chine; ils ne parlent pas des événements.
Samedi: Enthousiasme.
On se passe les journaux dans l'atelier. On discute avec
autant d'ardeur que pendant le Tour de France.
Tu as vu les Hongrois, ils ne se laissent pas faire.
Ils ont raison. Les Russes leur prennent tout. Ils en
ont marre. S'ils étaient heureux ils ne se révolteraient pas. Il
n'y a pas de doute.
Puis il répète pour lui-même: «« S'ils étaient heureux
ils ne se révolteraient pas ! »
Personne ne désapprouve. Cela semble à tous l'évidence
même.
124
Ça ira loin, cette histoire-là.
Tu vois, les Russes ils ont fait une gaffe de ne rien
leur donner à bouffer.
L'Huma est sur la table. Ceux qui parlent ainsi ont cer-
tainement lu l'article de Marcel Servin. Personne ne criti.
que L'Huma.
On aura beau nous dire ce que l'on voudra. C'est bel
et bien le peuple qui se révolte parce qu'il est misérable.
Lundi
Tu as vu les Russes, comment ils les soignent les Hon-
grois, à la sulfateuse (lance flamme ou mitraillette).
Est-ce de l'humour noir? Non; du dépit, de la rage
peut-être.
Tu as lu L’Huma, ce qu'elle en dit?
Oh, mais eux ce sont des cons. Il n'y a qu'un journal
qui dit la vérité. Le mien.
Lequel,
Libération.
Qu'est-ce qu'il dit,
Il ne fait pas de commentaires, il ne se mouille pas,
mais ça suffit, tu comprends ce qui se passe.
Puis, peu à peu toute la politique du P.C. et de la C.G.T.
est mise en question: les pouvoirs spéciaux, l'unité avec les
socialistes, le comité d'entreprise...
Au jour le jour, un peu partout.
C'est dégueulasse, ce qu'ils font en Hongrie.
Moi, je ne crois plus en rien.
Un militant communiste s'engueule avec un socialiste au
sujet de la Hongrie. E. se mêle subitement à la conversation.
Tes Soviets ce sont des salauds, et toi aussi.
E. est un ouvrier tout ce qui a de plus apolitique; il ne
prend presque jamais part aux discussions politiques. Dans
les querelles personnelles, il n'intervient qu'à coup sûr. Dans
une autre discussion E. intervient une fois de plus. Il exprime
l'indignation de beaucoup. Une armée d'occupation qui tire
sur les ouvriers ne peut pas trouver son approbation.
Alors, tu as vu le cardinal Midzensky qui voulait
prendre le pouvoir, Heureusement que les Russes ont mis de
l'ordre !
F. est visiblement satisfait et se plaît à narguer les autres.
1
La grève pour la Hongrie.
Nous surveillons qui va débrayer. Un ouvrier qui reste à
sa machine dans toutes les grèves s'habille; puis c'est un
autre du même genre qui s'en va. Les autres s'indignent et
ne débrayent pas. En tout une dizaine de F.0. sont partis.
125
en
Tu te rends compte, les salauds, ils n'ont même pas
voulu débrayer une demi-heure quand J. a été rappelé.
Ni donner un sou pour les copains qui sont
Algérie.
Moi, je ne ferais pas grève avec ces tocards. Mais
pas
avec les cocos non plus. Quand ils viendront me parler de
paix, ceux-là, je les enverrais sous les roses.
Dans un autre coin, les ouvriers sont indignés de l'affaire
hongroise. Bien que n'ayant aucune sympathie pour F.0.,
X. les a mis au pied du mur:
Puisque nous ne sommes pas content de ce qui se
passe là-bas, il n'y a qu'à débrayer.
C'est ce qu'ils firent. Comme ils discutaient avec beau-
coup d'ardeur, la chose s'est envenimée et un communiste
a promis à X. « qu'il serait pendu dès que les communistes
seraient au pouvoir ». Ceci n'a pas plu à X. Devant les co-
pains, il a répondu que de toute façon l'autre ne verrait pas
ce jour-là. »
Avant qu'on me pende, tu seras un mort.
Les copains ont estimé que la réponse était à la hauteur
de l'argument; quant au stalinien, il a difficilement caché
son inquiétude.
A l'atelier 11-50.
Les ouvriers n'ont pas voulu débrayer sans se délimiter
de F.0. Ils ont fait une résolution; c'est H. qui l'a rédigée.
Les ouvriers l'ont discutée, modifiée puis ils l'ont fait cir-
culer. 24 l'ont signée. Ils n'ont pas eu le temps de la faire
circuler partout mais ils ont débrayé.
Voici le texte de la résolution :
Un certain nombre d'ouvriers de l'atelier 11-50 ont dé-
cidé mercredi 7 novembre de signer une résolution
et de débrayer à 17 h. 45 ainsi que de se réunir
ensuite pour diffuser le plus largement possible le
texte de leur résolution en invitant les camarades de
l'atelier qui sont d'accord avec le texte de le signer
à leur tour.
Nous manifestons notre opposition à toutes guerres que
ce soit :
1° Des Russes en écrasant la volonté revendicative des
travailleurs et des paysans hongrois.
2° A la guerre d'Algérie qui dure depuis deux ans sans
apporter de solution, faisant chaque jour plus de victimes et
en apportant aussi plus de misère.
3º A la guerre en Egypte qui a pour but de défendre les
actionnaires de la Compagnie du Canal de Suez.
En conséquence nous condamnons indistinctement ces
guerres et affirmons que nos intérêts n'ont rien à voir avec
les actes du gouvernement.
126
Afin de faire connaître le plus largement notre position
nous proposons d'envoyer la résolution à un certain nombre
de journaux. L'Humanité, Franc-Tireur, Libération, France-
Observateur, Express.
Nous invitons les camarades d'accord avec la résolution
de donner leurs signatures.
Ailleurs, c'est une chaîne influencée par un gars du
S.I.R. qui a débrayé. Mais là aussi, ce sont ceux qui ne
débrayent jamais d'habitude. Il faut dire que la maîtrise a
forcé un peu la main. Le chef leur a dit :
Alors les gars, vous débrayez, Si vous débrayez, il faut
le dire et on arrête la chaîne ensuite.
Dans la chaîne d'à côté personne n'a débrayé, tellement
ils étaient indignés.
Dans l'ile Seguin.
On vient trouver G.
Tu sais, dans l'atelier d'à côté les gars veulent dé-
brayer pour la Hongrie.
Mais c'est F.O. qui lance le mot d'ordre.
F.0. ou pas F.O. on s'en fout. C'est dégueulasse, ce
qui se passe là-bas.
Mais que ce soit F.Ö. qui lance ça, ça me fait marrer.
G. a pris la résolution du 11-50 et l'a fait signer; ensuite
ils ont débrayé. Il fallait bien se délimiter.
Dans l'atelier à côté la plupart des syndiqués sont de
la C.G.T., mais ils ont débrayé. Quatre d'entre eux ont remis
leur carte C.G.T.; un jeune a déchiré sa carte de l’U.J.R.F. et
celle du syndicat.
Aux fonderies il y a eu pas mal d'ouvriers qui ont dé-
brayé et parmi eux, pas mal de sympathisants communistes.
Le fascisme ne passera pas
Indignation contre les fascistes qui ont incendié les lo-
caux de L'Huma. Pourtant quelques ouvriers chuchotent en
douce leur satisfaction :
Tu as vu ce qu'ils ont pris sur la gueule, les cocos!
B. est tout retourné. Maintenant, il soupçonne les Hon-
grois d'être des fascistes.
Tu as vu comment les réfugiés sont traités. On leur
donne des places aussitôt qu'ils arrivent ici. Il y a quelque
chose de pas clair la dessous.
Tu iras à la contre-manifestation?
Bien sûr, et avec une trique encore.
Le lendemain B. est revenu un peu déçu.
On ne s'est pas battu et devant Le Populaire on a
crié: « Unité! » Quelle connerie...
Tu vas voir quelle grève il y aura le 13.
127
b> han de
C
1
Puis, confidentiellement:
Il paraît que
les
gars
s'arment; ça va chauffer.
Mais personne ne sait exactement ce qu'il y aura. La
journée passe, des tracts sont distribués mais personne ne
débrayera. La journée d'action se termine comme toutes les
autres. Pourtant les staliniens ont fait une action et ce n'est
pas à leur honneur. Au meeting de midi, Place Nationale,
ils ont rossé Blanc, le secrétaire F.0. et trois autres ouvriers
F.O. qui étaient à ses côtés.
Dans l'atelier plaisanteries ironiques.
Ça lui fera les pieds à Blanc, c'est un salaud.
Tu as vu, l'unité d'action en marche.
Tu parles s'ils n'ont trouvé que cela pour leur jour.
née d'action.
C'est facile de casser la gueule quand on est 50 cona
tre 4.
Moi, le premier qui me touche, je l'assomme. J'ai
ce qu'il faut.
L., en passant, lance:
Tu crois qu'il passera? (le fascisme)
Impossible! Il a essayé, mais penses-tu, il ne peut
pas passer, tout est bouché.
Rires.
Quelques minutes plus tard :
Tu l'as vu? (le fascisme)
Oui, il est à la porte, mais il ne peut pas passer.
Gestes de la main, clin d'ail ironique.
On ne se dit plus bonjour, on dit « Il ne passera pas ».
C'est pour se moquer.
- Des enfants hongrois vont être adoptés.
Si ce n'est
pas malheureux ! Il n'y a pas assez d'éco-
les ni de logements en France, et on accepte des réfugiés.
La France, c'est le dépotoir. Tout le monde y vient
et nous on est la mouise.
Les staliniens font appel aux sentiments les plus réaction-
naires de la classe ouvrière. Ils ne reculent devant rien.
C
j
n
g
r
C
t
1
Avec les trotskystes nous attaquons.
Un tract est distribué Place Nationale. Il se prononce
contre la guerre en Algrie, la guerre en Egypte et contre la
répression en Hongrie. Il s'élève contre la dictature stali-
nienne Place Nationale et met en garde les ouvriers sur les
dangers d'une telle situation. Le ton est violent, mais les ou.
vriers l'accueillent avec sympathie. Il exprime ce que beau-
coup ont sur le cour. Par plusieurs petits groupes des ouvriers
sont là pour protéger les diffuseurs; très peu parmi eux dé-
passent la trentaine. Tous sont prêts à intervenir à la moindre
attaque stalinienne. La situation est tendue, mais il n'y aura
pas de bagarre; nous sommes les plus forts et cela ne manque
pas de renforcer la sympathie qu'on nous témoigne. Un
S
128
-
roupe de staliniens est sur le milieu de la place. Ils ne sont
isiblement pas contents; certains l'expriment en jetant
pectaculairement le tract avec mépris, d'autres le froissent
t le lancent comme une pierre. Ils sont plus âgés que nous et
ertains se sont fait une bonne réputation de dur. Quand je
egagne mon atelier ce n'est plus la même atmosphère. On
Liscute, le tract à la main, mais avec 'visiblement moins de
ympathie.
Un communiste m'apostrophe aussitôt :
Ton tract est rempli de mensonges. Ce ne sont que
Fes conneries.
Tu dis toujours la même chose, renouvelle-toi un peu.
Mais quand il fallait manifester contre les fescistes, tu
'étais pas là. Là, on ne t'a pas vu.
Va te faire foutre, toi et tes fascistes. Je n'irai pas
léfendre ton Huma. Si on te l'attaque, va te la défendre. Moi,
e considère que ce canard est une ordure.
Tu es un salaud.
Une table nous sépare, mais j'ai ma main qui s'est
-grippée à son encolure. Il fallait absolument réagir contre
es méthodes. Je suis prêt à me battre. Il en a l'air étonné,
nais il n'est pas chaud pour la bagarre à deux. Je ne sais
plus qu'en faire. A court d'imagination je fais ce que l'on
ait dans de telles circonstances. Je l'attire et le secoue, puis
e le pousse et le lâche. C'est symbolique; on est fâché. Il
ne dit:
Reste à ta machine et ne viens plus me voir pour
quoi que ce soit.
Je lui réponds qu'il est un c.. pour conclure l'affaire.
P. est navré.
Voyons, qu'est-ce que tu as fait? Tu crois que c'est
comme ça qu'on fera l'unité ? Non, tu n'aurais pas dû distri-
Duer ce tract.
Ah oui, ça te fait de la peine. Mais quand les autres
apent sur la gueule des ouvriers, alors là, qu'est-ce que tu
His? C'est une erreur. Quand on empêche les troskystes de
parler, que les communistes les chassent à coups de pieds dans
e derrière en les traitant de fascistes, alors toi qu'est-ce que
Bis? Oh là, tu es bien indulgent. Tu es aussi très indulgent
quand ils se font les complices des massacres des ouvriers
ongrois mais alors si on traite ces gens de dégueulasses alors
là, tu parles, là tu perds ton indulgence, tu t'indignes. Tu as
Le cœur bien fragile, tout d'un coup...
B. ne me pardonnera pas, lui non, plus d'avoir traité les
staliniens de ( nervis ». La division entre F.O. et C.G.T. le
paralyse, il n'a qu'une frousse, c'est d'être traité par ses co-
pains de F.0. Gueuler sur F.0., est pour lui une garantie suf-
Esante d'intégrité révolutionnaire. Il n'a d'ailleurs pas beau-
coup de mal à satisfaire sa conscience car les P.O. sont peu
nombreux et leur politique pas très appréciée des ouvriers. Il
129
1
insinue que je collabore plus ou moins à leur politique. Je
lui explique qu'en dehors de la C.G.T. et de F.0. il peut y
avoir une politique de la classe ouvrière.
Vous avec un certain culot. Qui est-ce qui fait des
appels continuels à F.0., si ce n'est la C.G.T. Et pourquoi
Thorez il casse pas la figure à Mollet quand il le rencontre
dans le Palais Bourbon ? Au contraire : là ce sont des sala-
malecs et des votes de confiance et des appels à l'unité, mais
quand il s'agit d'un ouvrier socialiste, là on lui casse tout
simplement la figure pour montrer aux ouvriers que le parti
est fort. Il est fort surtout quand il ne risque rien. A la
Chambre des Députés il y a les flics, tandis qu'ici on est entre
ouvriers; alors qu'est-ce qu'on risque? Ils respectent la dé-
mocratie là-bas, la démocratie bourgeoise, mais la démocra-
tie ouvrière, celle-là ils s'en foutent.
B. n'est pas convaincu ; il se butte. On se quitte à moitié
fâchés.
S., ce soir, vient me raconter ses malheurs.
J'étais avec F. (une autorité stalinienne de l'atelier),
nous parlions et M. nous interrompit. Il dit à F.: « Tu dis-
cutes avec lui? Mais il a dit que les communistes sont des
salauds ».
S. n'est pas content; il me dit que ce n'est pas bien de
mêler la politique dans les rapports personnels. « Ce n'est
pas parce que je ne suis pas partisan de leur politique qu'on
doit cesser de se parler. » Il conclut que M. est up. Espagnol
et qu'il n'a qu'à s'occuper de la politique de son pays. Je lui
réponds que M. est un imbécile non pas parce qu'il est Espa-
gnol mais parce qu'il est stalinien. Il finit par me croire,
On a beau dire à R. (un socialiste) que Guy Mollet est
un instrument de la bourgeoisie, et avec lui son parti, R.
réagit pas. Tout ce qu'il demande c'est qu'on « bouffe du
coco ». Cette seule plateforme lui suffit; il encaisse tout le
reste avec abnégation. Pour cette circonstance, je consens à
« bouffer du coco » avec lui, Depuis il vient sans cesse me
voir à la machine.
Tu es toujours fourré avec les F.0. maintenant, me
dit K.
Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? que je lui casse la
gueule?
En réalité les communistes doivent être jaloux, eux qui
réclament l'unité avec les socialistes. Tu ne sais pas, j'ai envie
de m'inscrire au P.S. pour avoir la bonne côte avec les com-
munistes. C'est peut-être le seul moyen.
Nous en rions.
ne
La position des communistes est un enfer de contradic-
tions. Ils en sont toujours à l'unité d'action, mais l'affaire
hongroise les oppose à tous ceux qui sont contre leurs idées.
130
Que faire? Ne pas en parler? Mais justement ils ne font que
ça, tellement ils ont à se justifier. Ils parlent de l'unité, mais
créent la division sur l'affaire hongroise et là ils ne peuvent
admettre le moindre doute ce qui aboutira à un durcis.
sement de leur position. Ils se trouvent isolés et bien que
leur effort soit extraordinaire, ils ne peuvent pas décider les
ouvriers à les soutenir. Certains ouvriers consentent à approu-
ver leurs flots d'arguments, mais c'est le maximum qu'ils peu-
vent faire. Au-delà, ils ne peuvent donner rien d'autre aux
staliniens. Pourtant les arguments sont tellement fragiles que
dès que le propagandiste tourne les talons son travail risque
de s'effondrer. Les arguments glissent. La superficialité de
l'emprise qu'ils exercent sur la question hongroise ne fait
aucun doute, et, à part cette question, les communistes ne
semblent rien avoir à dire.
D'autres ouvriers se rapprochent d'eux aujourd'hui
après les avoir délaissés. Pour eux, le raidissement de la
Russie les ultimatums de Boulganine et la contre-manifesta-
tion de la République sont des signes de durcissement contre
leur propre bourgeoisie. Ils espèrent ainsi que le P.C. va re-
venir à une politique de lutte. Pour cela, ils veulent bien
consentir à oublier les Hongrois où à les ignorer. Cette affaire
pour beaucoup est une plaie, qu'un commando de fascistes
peut bien faire cicatriser immédiatement, mais c'est une
plaie qui demeure et que le moindr heurt peut faire s'ouvrir
et s'envenimer. Les communistes paraissent des durs sur le
plan international, mais sont des mous sur le plan syndical
ou sur la politique intérieure française. Il y a malentendu.
T. est gêné de parler de la Hongrie avec moi; il jette de
temps en temps un coup d'oeil aux communistes pour voir
s'ils le regardent. Il a honte d'approuver mes arguments, mais
il a honte aussi d'approuver ceux des autres et il me jette le
même regard gêné lorsqu'il est avec eux. Voudrait-il ne pas
en parler? Non, car cette question le tracasse lui aussi, mais
il voudrait peut-être en parler dans un autre climat, au cours
de discussions amicales. Malheureusement il est difficile de
parler amicalement des morts que l'on se reproche. On s'em-
porte, on se hait sur le moment, et T. voit le petit édifice
de ses rapports harmonieux voler en éclats. Il souffre de notre
division, et nous tous en souffrons aussi bien que lui. Pau-
vre T., il voudrait qu'il n'y ait jamais de révolte en Hongrie.
I. admire la Russie parce qu'elle est forte. Il a misé sur
la Russie, bien que sur le plan de l'usine son comportement
ne corresponde pas toujours à celui des communistes. Parce
que je ne fais aucune concession à cette idée, il me déteste,
mais si je frappe sur la table ou m'engueule avec la maîtrise
il oublie ses griefs. Notre petite démonstration Place Natio-
nale l'a un peu impressionné. Y aurait-il d'autres forces qui
pourraient rivaliser avec le parti communiste?
- 131
C. est tourmenté au sujet de la Hongrie. Il est forcément
anti-bourgeois, anti-gouvernemental, anti-parti socialiste;
voilà ce qui le rapproche du P.C., qu'il a pourtant quitté.
Mais les ouvriers hongrois ne sont-ils pas de la même trempe
que lui? Il voudrait bien le savoir. Mais il a du mal à conce-
voir que le parti communiste puisse devenir un parti d'ex-
ploiteurs. Beaucoup, d'ailleurs, sont dans son cas; ils identi-
fient le rôle du P.C. français et le rôle du P.C. hongrois.
Suppose que la France devienne une démocratie po-
pulaire, le délégué C.G.T. deviendrait chef d'atelier, par
exemple. Eh bien, conclut C., si on se révoltait, crois-tu qu'on
le tuerait?
Non.
Eh bien, les Hongrois, c'est ce qu'ils font. Moi je ne suis
pas d'accord.
Et si le délégué devenait un flic, un type de la Ges-
tapo, par exemple? Crois-tu qu'il ne faudrait pas le des-
cendre?
Oui, malgré tous les griefs que l'on peut avoir contre
le délégué, comment penser qu'il puisse devenir un flic? C'est
impensable pour C. Pour moi, difficile à imaginer.
Les arguments des staliniens sont terriblement fragiles,
mais ils s'y accrochent comme à une planche de salut.
Tu dis que les ouvriers hongrois sont malheureux, eh
bien s'ils étaient si malheureux que ça, ils ne seraient pas si
bien habillés. Regarde un peu les photos.
Alors on épluche les photos, on discute pour savoir si
oui ou non les ouvriers hongrois sont bien habillés.
Ce sont les anciens fascistes qui font la pagaille là-
bas; au temps des Allem inds, ils étaient tous avec eux.
Qu'est-ce que tu faisais, toi, au temps des Allemands?
Moi? j'étais encore un môme.
Et les Hongrois, crois-tu qu'ils vieillissent moins vite
que nous ?
Un tract de la C.G.T. prétend que le secrétaire F.0. a
été simplement hué par les ouvriers.
Pourquoi ce mensonge? Pourquoi ne dit-on pas qu'il
s'est fait casser la figure?
Mais ce ne sont pas les communistes qui lui ont cassé
la figure. C'est un socialiste qui était au meeting.
Il doit être drôlement barraqué, ton socialiste, pour
avoir cassé la gueule à quatre F.O.
Ce sont des mensonges, et même des plus flagrants, qui
servent de rempart aux communistes. Oui, mais il faut les
discuter un à un. Dès qu'un mensonge est abattu c'est un
autre qui apparaît; mais il semble que tous les mensonges
dévoilés passent aussitôt dans le domaine de l'oubli. Que d'in.
dulgence pour les mensonges les ouvriers communistes
ont-ils ! Mais sont-ils oubliés réellement? Non. Demain, si un
132
communiste vient nous vanter le paradis roumain ou bul.
gare, les mensonges auront laissé leur trace. Personne ne le
croira. L'affaire hongroise marquera la classe ouvrière; au-
jourd'hui, elle ne fait que commencer à la marquer. Bien que
la question hongroise aujourd'hui soit un des motifs essentiels
de notre division, c'est cette même question qui contribuera
à nous rapprocher. Les illusions du paradis soviétique est
l'élément principal de notre division mais même les pro-
russes, s'ils conservent leur foi, en sortiront plus affai-
blis; un doute persistera ou s'accentuera. L'atmosphère qui
règne dans les ateliers est intenable; notre division se fait
sur une question, en apparence, étrangère à nos propres pro-
blèmes, elle devient par cela même à la longue un peu arti-
ficielle. Il ne tient qu'aux ouvriers communistes de la faire
disparaître.
Déjà nous avons repris un peu nos contacts humains.
Nous arrivons à plaisanter entre nous, même sur la politi-
que, et à discuter des problèmes de l'usine et de l'atelier.
L'affaire hongroise commence à lever l'hypothèque de la
Russie et c'est une des choses, parmi tant d'autres, que nous
ont données les ouvriers hongrois.
D. MOTHÉ.
:
the wind
133
La révolution prolétarienne
contre la bureaucratie
Le mouvement du prolétariat d'Europe orientale contre
la bureaucratie et son régime d'exploitation et d'oppression
frauduleusement présenté comme socialiste, explose mainte-
nant au grand jour. Il est resté pendant de longues années
enfoui dans les usines, s'exprimant par le refus chaque jour
renouvelé des ouvriers de coopérer avec leurs exploiteurs. Il
a envahi les rues de Berlin-Est en juin 1953. Il a pris les
armes en jụin 1956, à Poznan. Il a fait trembler de rage et
de peur les maîtres de la Russie et les a obligés finalement de
reculer en octobre 1956 en Pologne. Il monte à l'assaut du
ciel depuis sept semaines en Hongrie, où il réalise l'incroya-
ble: il pulvérise en quelques jours la classe dominante, son
Etat, son parti et son idéologie comme nulle part classe, Etat,
parti ou idéologie n'ont été pulvérisés ; il lutte les mains nues
contre les tanks et les mitrailleuses de l'armée la plus puis-
sante que la terre ait jamais portée; il retrouve, le lendemain
de sa « défaite » militaire, encore plus de force, de clarté, de
conscience et d'organisation qu'auparavant.
La révolution hongroise est la pointe la plus avancée de
ce combat. Cela veut dire qu'elle ne présente que l'expres-
sion la plus claire, la plus achevée des tendances et des buts
des ouvriers à notre époque. Sa signification est absolument
universelle. Ses causes profondes se retrouvent dans tous les
pays dominés par la bureaucratie soi-disant « communiste »
comme dans les pays capitalistes occidentaux. Ses leçons
valent pour les ouvriers russes, tchèques ou yougoslaves
comme elles vaudront demain pour les ouvriers chinois. Elles
valent également pour les ouvriers français, anglais ou amé-
ricains. Aux usines Csepel, à Budapest, comme
aux usines
Renault, à Paris, les ouvriers subissent, aux formes et au degré
près, la même exploitation, la même oppression. Ils sont frus-
trés du produit de leur travail, ils sont expropriés de la
direction de leur propre activité, ils sont soumis à la domina-
tion d'une couche de dirigeants despotiques affublés de mas-
ques « démocratiques » ou « socialistes ». Donc ici, comme
là-bas, quelles que soient ses formes, la lutte des ouvriers est
finalement la même. Ici, comme là-bas, les ouvriers visent et
ne peuvent que viser les mêmes buts : supprimer l'exploita-
tion, diriger eux-mêmes leur travail, créer une nouvelle orga-
134
nisation de la société. Les ouvriers hongrois ont poussé cette
lutte jusqu'à sa forme finale. Ils ont pris les armes, ils ont
constitué des Conseils, ils ont mis en avant les éléments essen-
tiels d'un programme socialiste : limitation de la hiérarchie,
suppression des normes de travail, gestion ouvrière des usines,
rôle dirigeant des Conseils d'ouvriers dans la vie sociale.
Obligés de cesser le combat armé devant la bestiale interven-
tion des blindés russes, ils n'ont pas pour autant abandonné
leur lutte. Depuis cinq semaines, leur grève générale, leur
refus de coopérer avec Kadar, le courage incroyable avec
lequel ils maintiennent leurs revendications en narguant les
tanks et les mitrailleuses de Kroutchev, malgré la faim, le
froid et les déportations, montrent au monde bouleversé
l'impuissance des oppresseurs et l’inanité de leurs crimes
devant la force immense d'un prolétariat conscient. Même si
elle était momentanément vaincue, la révolution hongroise
aura été une défaite profonde pour les exploiteurs, et ses
répercussions qui ne font que commencer, auront transformé
le monde en cette deuxième moitié du XXe siècle.
Pour la première fois, un régime totalitaire moderne est
mis en morceaux par le soulèvement des travailleurs. Ce é.
gime, depuis dix ans, n'avait fait qu'exterminer toute oppo-
sition; il avait enserré tout le pays dans un réseau de poli-
ciers et de délateurs; il avait prétendu contrôler toutes les
activités des hommes et jusqu'à leurs âmes. Et d'un coup,
le système scientifiquement organisé de l'oppression totali.
taire a volé en éclats devant la décision et l'héroïsme de la
population hongroise, pratiquement sans armes. Après six
jours de combats acharnés, les divisions russes elles-mêmes
ont dû reconnaître leur défaite et cesser le feu le dimanche
28 octobre. L'écrasement de la résistance armée
deuxième intervention russe, après le 4 novembre, qui a exigé
une semaine de combats et vingt divisions blindées, ne di-
minue pas l'exactitude de cette constatation : elle la renforce.
Aucune « opération de police » ne pouvait venir à bout de
l'insurrection hongroise. Il a fallu que plusieurs corps d'ar-
mée engagent des opérations militaires régulières pendant six
jours, pour vaincre la population civile d'un pays de dix
millions d'habitants. Et, sur le plan politique, la « victoire »
de l'impérialisme russe se solde par une défaite sans précé-
dent. Dominer un pays, ce n'est pas dominer des ruines ni
s'attirer à jamais la haine inexpiable de toute sa population
à l'exception d'une poignée de traîtres et de vendus.
Pour la première fois, le prolétariat se bat de front
contre le régime bureaucratique, qui ose se dire « ouvrier »,
et qui représente en réalité la dernière forme, la plus achevée,
des régimes d'exploitation et d'oppression. La totalité pres.
que absolue de la population d'un pays se soulève et combat
un régime prétendûment « populaire ». Par leur lutte, les
travailleurs hongrois ont arraché le masque « communiste »
par
la
135
à la bureaucratie et l'ont fait paraître aux yeux de l'humanité
dans sa hideuse nudité: une couche exploiteuse, pleine de
haine et de peur des travailleurs, en décomposition politi-
que et morale absolue, incapable de s'appuyer sur autre
chose que les blindés russes pour dominer et prête à faire
massacrer « sa » population, à réduire a son » pays en ruines
par une armée étrangère pour se maintenir au pouvoir.
La révolution hongroise démolit, non pas par des dis
cussions théoriques mais par le feu de l'insurrection armée,
la fraude la plus gigantesque de l'histoire : la présentation
du régime bureaucratique comme « socialiste » fraude à
laquelle avaient collaboré bourgeois et staliniens, intellectuels
u de droite » et « de gauche », parce qu'ils y trouvaient tous
finalement leur compte. L'usurpation du marxisme, du socia-
lisme et du drapeau de la révolution prolétarienne par la
couche d'exploiteurs totalitaires qui dominent en Russie et
ailleurs apparaît d'ores et déjà comme une insulte intolérable
aux yeux de larges masses de travailleurs. Il devient clair
même pour les moins avertis que
les staliniens au pouvoir
représentent la classe ouvrière autant que le garde chiourme
représente le forçat.
La crise polonaise et la révolution hongroise font écla-
ter au grand jour la crise terrible du régime bureaucratique,
qu'elles intensifient à leur tour au centuple. Elles forcent la
bureaucratie à ouvrir, ne serait-ce qu'en partie. ses livres de
compte et ses archives de police secrète. Ce qui en ressort,
n'est pas simplement l'image de l'exploitation et de l'oppres-
sion la plus inhumaine; c'est aussi l'image du chaos incroya-
ble de la société bureaucratique, l'anarchie effrayante de l'éco-
nomie soi-disant « planifiée », l'incapacité totale de la bureau-
cratie de gérer sa propre économie, son propre système. Par
leur action, les ouvriers polonais et hongrois ont également
montré la fragilité extrême de ce régime. Le « bloc » russe
n'est pas moins fait de pièces et de morceaux que le « bloc »
américain; l’un comme l'autre sont incapables d'organiser
leur domination sur leurs satellites. La classe bureaucratique
n'est pas plus solidement tissée à la société que la classe bour.
geoise; quelques jours d'insurrection suffisent pour faire dis-
paraître son régime, son appareil d'Etat, son parti.
La révolution hongroise a réduit à néant la « démocra-
tisation » et la « déstalinisation ». Elle a montré que pour la
bureaucratie, comme pour toute classe exploiteuse, il ne
pouvait jamais êtres question de concessions portant sur
l'essentiel. Le vrai visage de la « démocratisation », les ruines
de Budapest et les infâmes mensonges de Radio-Moscou le
montrent aux travailleurs du monde. Plus encore: la révo.
lution hongroise a montré l'incapacité où se trouve désormais
la bureaucratie, tout comme la bourgeoisie, d'avoir une poli-
tique cohérente quelconque, « démocratique » ou non. Il est
logique, pour une classe exploiteuse, de tuer les gens pour
une politique, mais il est clair que le massacre pur et simple
136
n'est pas, en lui-même, une politique, qu'il traduit plutôt
l'absence de politique et l'incapacité d'en avoir une. De
même que l'impérialisme français aux abois est à la fois
incapable de dominer par la force en Afrique du Nord et de
l'abandonner purement et simplement, de même la bureau-
cratie russe est à la fois incapable de se retirer de la Hon-
grie et de s'y maintenir. Obligée d'arrêter la « démocratisa-
tion » qui se transformait en révolution, incapable de revenir
au système stalinien désormais inapplicable, elle'en est ré-
duite à l'usage spasmodique de la violence qui ne résoud rien
et se retourne immédiatement contre elle. Kroutchev, gaf.
feur hystérique et bavard aviné, est la digne incarnation de
la période actuelle de la bureaucratie tout autant que Staline,
perfide, taciturne, borné et cruel, l’était de la période
précédente.
Face à cette bureaucratie exploiteuse, corrompue, décom.
posée, que la peur pousse à l'assassinat d'un peuple, se
dresse la figure humaine du proletariat hongrois. Dix ans lui
ont suffi pour faire l'expérience d'un régime nouveau d'ex-
ploitation, et pour en tirer les conclusions. La terreur totali-
taire et la misère ne l'ont ni réduit, ni démoralisé; elles ont
au contraire éclairci sa conscience, affermi sa détermination,
Sans aucune organisation préalable, sans que personne leur
ait enseigné quoi que ce soit, les ouvriers hongrois s'organi-
sèrent dès les premiers jours de l'insurrection dans les Con.
seils. Seule une armée étrangère les empêcha et les empêche
encore de s'emparer du pouvoir. Et pendant qu'une poignée
de traîtres essaie sans succès de reconstituer un appareil
d'Etat, les Conseils sont la seule forme d'organisation sociale
qui subsiste. Leur force est telle, qu'ils ont pu réaliser ce
miracle jamais vu auparavant: une grève générale de plu-
sieurs semaines après la défaite militaire de l'insurrection.
Leur programme égale et même dépasse celui de toute révo-
lution prolétarienne à ce jour: limitation de la hiérarchie,
gestion ouvrière des usines, suppression des normes de tra-
vail. Ils présentent des revendications politiques, qui mon-
trent qu'ils sont la seule force politique organisée dans cette
société en ruines, et exigent en fait un rôle politique diri-
geant. Ce sont eux qui demandent le retrait des troupes rus-
ses. le droit de publier leurs propres journaux, la constitution
de Conseils de travailleurs dans tous les secteurs de l'acti-
vité nationale, la reconnaissance de leur représentativité et
de leur fonction politique par le gouvernement.
Les journalistes et les intellectuels de droite et de gau-
che verront dans tout cela une foule de choses : l'incapacité
de certains dirigeants, la lutte de tendances au sein de la
bureaucratie, le hasard, la tendance vers le « socialisme na-
tional », une crise particulière au régime bureaucratique, des
nouvelles possibilités pour le réformisme. Ils y verront tout
ce qu'ils veulent y voir — sauf la chose fondamentale, la
seule qui importe: la lutte de la classe ouvrière contre
137
l'exploitation, la lutte de la classe ouvrière pour une nouvelle
forme d'organisation de la société. Ils ne verront pas que
der-
rière les événements d'Europe orientale, comme derrière
toute l'histoire depuis un siècle, il y a un facteur qui façonne
la société moderne et lui donne ses traits caractéristiques : le
développement du prolétariat et de sa lutte pour une société
sans classes.
Il n'y a pas de crise particulière de la bureaucratie et de
son régime, le capitalisme bureaucratique, dès qu'on consi.
dère le fond des choses. Bien sûr, la bureaucratie des pays
satellites, plus récente, moins homogène, n'est pas aussi solide
que la bureaucratie russe. Mais que celle-ci traverse, avec des
délais différents, la même crise à l'intérieur de son propre
pays, le XXe Congrès est là pour en témoigner. Et c'est
cette même crise, qui rend vains tous les efforts des classes
dirigeantes de l'Occident visant à stabiliser leur régime et
diriger leur société. C'est elle qui cause l'incapacité du capi-
talisme français de rationaliser la gestion du pays, ou de
régler ses rapports avec ses ex-colonies, l'incapacité du capi-
talisme anglais ou américain de discipliner leurs ouvriers,
de dominer leurs satellites. Le capitalisme bureaucratique en
Russie et en Europe orientale ne fait qu'appliquer à l'en-
semble de l'économie et de la société les méthodes que le
capitalisme privé a créées et appliquées à la direction de
chaque usine particulière. Ces méthodes, basées sur la domi.
nation d'une couche de dirigeants sur la masse des produc-
teurs, sont de moins en moins capables de permettre un fonc-
tionnement même modérément rationnel et harmonieux de
la vie sociale. A l'Est comme à l'Ouest, les régimes doivent
faire face à ce problème qui domine notre époque : aucune
classe particulière n'est désormais à l'échelle nécessaire pour
diriger la société. La vie du monde moderne, faite des acti-
vités entrelacées et constamment changeantes de centaines
de millions de producteurs conscients, échappe à l'emprise de
toute couche dirigeante qui s'élève au-dessus de la société.
Ce monde, ou bien il s'enfoncera de plus en plus dans le
chaos, ou bien il sera réorganisé de fond en comble par les
masses des producteurs, faisant table rase de toutes les insti-
tutions établies et en instaurant de nouvelles, permettant le
libre déploiement des capacités créatrices de millions d'indi-
vidus, qui seules peuvent venir à bout des problèmes créés
par la vie des sociétés modernes. Cette réorganisation ne
peut commencer autrement que par la gestion ouvrière de
la production, le pouvoir total et direct des producteurs orga-
nisés dans leurs Conseils sur l'économie et sur toute la vie
sociale.
Depuis des années nous nous sommes acharnés à mon-
trer comme d'autres groupes révolutionnaires l'ont fait
dans d'autres pays – que le capitalisme bureaucratique ne
résolvait nullement les contradictions de la société contem-
poraine ; que, tout autant que la bourgeoisie, la bureaucratie
138
creusait elle même son tombeau; que les prolétaires des pays
dominés par elle ne pouvaient être ni mystifiés par un « so-
cialisme » imaginaire, ni réduits à l'état d'esclaves impuis-
sants ; qu'au contraire faisant l'expérience de la forme la
plus achevée, la plus concentrée un capitalisme et de l'ex-
ploitation, ils mûrissaient pour une révolution dépassant dans
la clarté et la détermination les révolutions précédentes.
Aujourd'hui, c'est le proletariat d'Europe orientale qui
est à l'avant-garde de la révolution mondiale.
Nous nous sommes acharnés à montrer que la conclu-
sion claire, définitive et irrefutable de l'expérience de la
révolution russe était qu'un parti distinct de la classe
ouvrière ne pouvait être l'instrument de la dictature du pro-
létariat, que celle-ci était le pouvoir des organismes sovié-
tiques des masses; mais aussi et surtout que la dictature du
prolétariat n'avait pas de sens si elle n'était pas d'abord et
en même temps gestion ouvrière de la production.
Aujourd'hui, c'est la classe ouvrière hongroise qui fait
spontanément son programme de la gestion ouvrière et du
rôle prépondérant des Conseils des travailleurs dans tous les
domaines de la vie nationale.
De ces idées, la révolution hongroise est en train de faire
la conscience commune des travailleurs de tous les pays.
Par là même, par son exemple héroïque et quel que soit
son sort ultérieur elle bouleverse les classifications politiques
existantes, elle crée une nouvelle ligne de séparation aussi
bien au sein du mouvement ouvrier que dans la société en
général. Elle crée une nouvelle période historique. Une foule
de problèmes sont vidés de leur contenu. Une foule de discus-
sions deviennent purement et simplement oiseuses. Le temps
des subtilités et des faux-fuyants est révolu. Pendant les
années à venir, toutes les questions qui comptent se résume-
ront en celle-ci : Etes-vous pour ou contre l'action et le pro-
gramme des ouvriers hongrois? Etes-vous pour ou contre la
constitution de Conseils des travailleurs dans tous les secteurs
de la vie nationale et la gestion ouvrière de la production?
L'ECONOMIE BUREAUCRATIQUE
ET L'EXPLOITATION DU PROLETARIAT
La « planification > bureaucratique
Jusqu'ici, la propagande stalinienne -- aidée par les
subtils avocats « objectifs » de la bureaucratie, dont Bettel-
heim est le représentant typique en France — avait réussi à
persuader le public que la « planification » telle qu'elle est
pratiquée en Russie et dans les pays satellites représentait
un mode à la fois nouveau et supérieur de direction de l'éco-
nomie, infiniment plus efficace que l'orientation aveugle de
l'économie réalisée par le marché capitaliste.
139
Il s'agit d'un mythe. La planification bureaucratique
n'est rien d'autre que l'extension à l'ensemble de l'éco-
nomie des méthodes créées et appliquées par le capita-
lisme dans la direction « rationnelle » des grandes unités
de production. Si l'on considère l'aspect le plus profond
de l'économie, la situation concrète faite aux hommes, elle
est plutôt la réolisation la plus achevée de l'esprit du
capitalisme, elle pousse à la limite ses tendances les plus
significatives. Exactement comme la direction d'un grand
ensemble de production capitaliste, elle est effectuée par une
couche séparée de dirigeants formée par les bureaucrates de
l'économie, de l'Etat et du parti. Son essence consiste, comme
celle de la production capitaliste, à réduire les producteurs
directs au rôle de purs et simples exécutants d'ordres reçus,
d'ordres formulés par une couche particulière qui poursuit
ses propres intérêts. Cette couche ne peut pas diriger conve-
nablement, tout comme l'appareil de direction des usincs
Renault ou de Ford ne peut pas diriger convenablement (le
mythe de l'efficacité productive du capitalisme au niveau de
l'usine particulière, mythe que partagent les idéologues bour-
geois et staliniens, ne tient pas devant l'examen le plus élé-
mentaire des faits, et n'importe quel ouvrier de l'industrie (1)
pourrait dresser un réquisitoire écrasant contre la « ratio-
nalité » capitaliste jugée de son propre point de vue à elle).
Tout d'abord, la bureaucratie dirigeante ne sait pas ce
qu'elle doit diriger: la réalité de la production lui échappe,
car cette réalité n'est rien d'autre que l'activité des produc-
teurs, et les producteurs n'informent pas les dirigeants,
capitalistes privés ou bureaucrates, sur ce qui a lieu réelle.
ment; très souvent, ils s'organisent pour que les dirigeants ne
soient pas informés (pour éviter une augmentation de l'ex-
ploitation, par autagonisme ou tout simplement par' manque
d'intérêt : ce ne sont pas leurs affaires). En deuxième lieu,
toute l'organisation de la production est faite contre les tra-
vailleurs, à qui l'on demande toujours, d'une façon ou d'une
autre, davantage de travail sans contrepartie équivalente. Les
ordres de la direction rencontrent donc inévitablement
résstance acharnée de la part de ceux qui doivent les exécuter.
Par là même, l'appareil dirigeant, qu'il se trouve en France
ou en Pologne, en Amérique ou en Russie, passe la plupart
de son temps non pas organiser la production, mais à orga-
niser la contrainte, directe ou indirecte. En troisième lieu,
l'appareil dirigeant bureaucratique, autant sinon plus que
celui d'une usine capitaliste privée, est déchiré par des con-
flits internes; les diverses « catégories » professionnelles de
bureaucrates, auxquelles se superposent des coteries « poli-
une
revue:
(1) Voir, parmi les textes publiés dans cette
L'ouvrier
américain, de Paul Romano (N° 1 à 6), La vie en usine, de G. Vivier
(N°* 11 à 16), et le texte: Il faut se débrouiller (N° 18).
140
tiques », et même des clans et les cliques à proprement par-
ler (clans et cliques dont les luttes, dans un régime « fonction-
narisé », sont une donnée socialogique fondamentale) se
tirent dans les pattes, se trompent mutuellement, se rejettent
réciproquement les responsabilités, etc.
Tout cela fait que la « planification » bureaucratique est
un mélange de rationalité de d'absurdité comportant un degré
de gaspillage comparable à celui de l'économie capitaliste
traditionnelle. Car le gaspillage qui surgit dans toute usine
capitaliste du fait de la scission radicale entre la classe diri-
geante et la classe exécutantee et l'opposition irréconciliable
des intérêts et des attitudes de ces deux classes, existe tout
autant dans l'usine bureaucratique; et l'extension de ce mode
de direction à l'ensemble de l'économie, où les problèmes,
beaucoup plus complexes, sont beaucoup plus difficiles à
résoudre, fait que l'économie « planifiée » présente un degré
d'anarchie qui est finalement équivalent à celui qu'on observe,
sous d'autres formes, dans l'économie capitaliste privée.
La planification bureaucratique est un chaos autant que
le marché capitaliste.
Les staliniens et leurs apologistes parlent évidemment,
depuis quelque temps, de certaines « erreurs » de la planifi-
cation. Il ne s'agit pas d'« erreurs »; il s'agit d'une anarchie
qui est organiquement inhérente à la planification par la
bureaucratie. On voudrait faire croire, presque, que quelque
part dans les Bureaux du Plan, un calculateur s'est trompé
lors d'une multiplication. En fait, il s'agit d'un phénomène
social et historique fondamental: la bureaucratie est inca-
pable de diriger rationnellement l'économie, tout autant que
le capitalisme privé.
La démonstration empirique exacte de cette consiata-
tion était jusqu'ici extrêmement difficile, du fait que la
bureaucratie cachait systématiquement les données économi-
ques de son système. Maintenant, certaines statistiques com-
mencent à être publiées.
Notons en passant que ce changement d'attitude traduit
précisément cette crise dont nous parlons; en termes voilés,
Kroutchev et d'autres orateurs du XXe Congrès du parti
russe ont avoué que le mensonge de la bureaucratie se re-
tournait contre elle-même, puisqu'il la rendait incapable
de connaître même la vérité officielle sur sa propre économie.
Bien entendu, la bureaucratie ne peut guérir un de ses maux
qu'en s'en créant un autre: la publication de statistiques,
même truquées, ne peut manquer de provoquer des discus-
sions et des fermentations dans les milieux intellectuels, qui
ne sont pas tous, il s'en faut, définitivement acquis au régime.
Au niveau de l'ensemble de l'économie, le gaspillage
de la planification bureaucratique se révèle d'abord par le
manque de proportionnalité, de rapport technique rationnel,
entre le développement des divers secteurs de production. On
4
141
exploite les ouvriers pour construire de nouvelles usines,
mais ces usines ne fonctionnent pas ou fonctionnent très au-
deça de leur capacité de production, - parce que les sec-
teurs qui devraient leur fournir des matières premières ou
utiliser leurs produits n'ont pas été développés de façon
correspondante. Ainsi, d'après les chiffres officiels (2), la
production visée par le plan tchécoslovaque pour 1956 doit
rester de loin inférieur à la capacité de production installée
dans les principaux secteurs. Voici les chiffres :
Plan pour 1956
Capacité de
production
(par millions de tonnes)
Charbon
Lignite
Minerai de fer
Produits laminés
Ciment
(par milliers de tonnes)
Acide sulfurique
Engrais azotés
Engrais phosphates
23,4
40,6
2,95
3,21
3,16
28,9
63,5
6,4
4,75
5,12
427
69
106
484
94
203
Les ouvriers tchécoslovaques ont crevé de faim depuis dix
ans pour construire des usines qui ne tournent qu'à moitié de
leur capacité! Que se passe-t-il d'autre sous le capitalisme
privé? En fait, des pourcentages d'utilisation de la capacité
installée aussi bas que ceux qui résultent du tableau ci-des-
na de 68, 50 et même 40 %) n'apparaissent, en économie
vä pitaliste privée, qu'en année de dépression très sévère.
Ce n'est pas là une situation particulière à la Tchéco-
slovaquie. En Hongrie, « la capacité n'est pas pleinement
utilisée », disait au mois d'août, la Commission Economique
pour l'Europe, aussi bien dans les industries mécaniques que
dans les industries textiles et alimentaires, et cela pendant
que la population était sous-alimentée au degré que l'on sait!
En Russie, « les Directives pour le Plan Quinquennal révè-
lent que des réserves de capacité importantes existent dans
les industries mécaniques, chimiques et alimentaires >>
(C.E.E., ib., p. 26). Quant à la Pologne, la description de
0. Lange, économiste officiel du régime, est absolument
sinistre :
(2) Voir le Bulletin Economique pour l'Europe publié par la Com.
mission Economique pour l'Europe des Nations Unies, vol. 8, n° 2
(août 1956. Nos renvois se rapportent à l'édition anglaise). Tous les
chiffres donnés dans cette publication proviennent de sources officielles
des pays d'Europe orientale. Ces pays sont représentés au sein de la
C.E.E. dont le secrétariat, dirigé par l'économiste suédois Gunuar
Myrdal, a en général une attitude pleine de sympathie pour l' « écono-
mie planifiée » et a oué un rôle important dans reprise du commerce
Est-Ouest depuis trois ans.
142
a
« Au cours de ces transformations sociales et économi-
ques de caractère révolutionnaire (il s'agit de la création
d'une industrie lourde et de la « nationalisation » des moyens
de production - P. Ch.), de graves disproportions sont néan-
moins apparues : disproportion entre le développement de
l'agriculture et celui de l'industrie, disproportion entre la
capacité de production de l'industrie et son approvisionne-
ment, disproportion entre le développement quantitatif de la
production industrielle et sa qualité ainsi que ses prix de
revient, disproportion entre les programmes d'investissements
et de production, d'une part, et l'état technique arriéré de
nombreuses entreprises, de l'autre.
« Ces disproportions se font sentir sous forme de grandes
difficultés dans notre commerce extérieur, sous forme d'une
absence de stocks, entraînant des arrêts de la production et
l'utilisation partielle du potentiel productif existant de l'in-
dustrie; sous forme de gaspillage des fonds fixes et des ma-
tières premières ; sous forme d'un mauvais approvisionne-
ment, fonctionnant mal par surcroît, de la population. » (3)
Il faut comprendre pleinement ce que ces données signi-
fient. La bureaucratie masque les échecs de la planification
tout d'abord en mentant carrément en publiant des don.
nées fausses; personne ne pouvait jusqu'ici (et dans la plu-
part des cas, personne ne peut encore) vérifier si « le Plan
a été réalisé à 101 %.) - Cependant il y a plus : le Plan peut
être réalisé à 101 ou à 99 % par rapport à ses propres
objectifs. Mais quel est le rapport de ces objectifs avec les
possibilités réelles de l'économie? C'est sur cet aspect qui
ne concerne plus seulement le rapport d'une série de chiffres
sur le papier avec une autre série de chiffres sur le papiere."
que les données fournies plus haut jettent une lumière crue:
Si le plan de production tchécoslovaque des engrais phos-
phatés est réalisé en 1956 à 100 %, cela signifie un gaspillage
de 50 % de la capacité productive de ce secteur (voir les
chiffres du tableau ci-dessus) – pendant que l'agriculture a
un besoin pressant d'engrais.
On trouvera, dans l'étude déjà citée de la C.E.E. (p. 26 .
à 29) plusieurs autres exemples d'utilisation partielle de
la capacité productive c'est-à-dire de chômage des
machines. Lange dit à propos de la Pologne que
utilisation partielle des forces productives existent dans
l'industrie) est aujourd'hui considérée par la classe ouvrière
et toute l'opinion comme un indice de gaspillage dans l'in-
dustrie » (1. c., p. 75). Mais il est frappant de constater que
le chômage des machines va de pair avec le chômage des
« leur
(3) 0. Lange, sur le nouveau programme économique, Cahiers Inter-
nationaux, Nº 79, septembre-octobre 1956, p. 72-81. Cet article, publié en
juillet en Pologne, a servi de base au programme économique élaboré
par le VI Plenium du Comité Central du parti polonais qui a eu lieu
en juillet.
143
hommes. Lange constate qu'en Pologne « de sérieux élé-
ments de chômage apparaissent ». La C.E.E. est plus explicite.
En Pologne, en Hongrie, en Roumanie, dit-elle « l'industrie
manufacturière peut en général recruter autant d'ouvriers
qu'elle veut ». En Pologne « il y avait en juin dernier
300.000 chômeurs, soit 4,5 % du nombre de travailleurs
employés dans le secteur socialiste, et aussi bien en Pologne
qu'en Hongrie l'absorption des jeunes terminant l'école dans
la force de travail s'avère plus lente que d'habitude. A Buda-
pest, par exemple, un tiers des 14 à 15.000 jeunes âgés de
14 à 15 ans n'ont pas trouvé immédiatement de travail, et on
s'attend à des difficultés quant à l'emploi des jeunes âgés de
16 à 18 ans, qui n'ont trouvé jusqu'ici que du travail sai-
sonnier à la campagne » (1. c., p. 26).
erreurs >>
La résistance ouvrière,
cause dernière de l'échec du « plan >>
Une des expressions les plus graves de cette dispropor-
tionalité a été jusqu'ici dans presque tous les pays bureau-
cratiques, la Russie, l'Allemagne orientale, la Tchécoslo.
vaquie, la Hongrie et même la Pologne - le développement
absolument insuffisant de la production d'énergie. Dans cec-
tains cas, celui-ci résulte d'une « mauvaise planification » :
en Russie, par exemple, la production des raffineries de pé
trole pendant le premier semestre 1956 n'a pas atteint les
chiffres fixés par le plan, à cause des difficultés de transport
et du manque de capacité des entrepôts. Cela signifie
qu'après trente ans de pratique de la « planification » la bu-
ribucratie russe est encore capable de faire construire des
ralfineries sans résoudre en même temps le problème du
transport du pétrole jusqu'à ces raffineries ou de son entre-
posage! Qui ne voit que de telles «
ne sont pas
accidentelles, mais résultent intrinsèquement du mode de
planification bureaucratique ?
Mais la cause fondamentale du manque d'énergie réside
dans la crise de la production charbonnière. Cette crise
exprime le même conflit entre les mineurs et les dirigeants
de la production qui sévit également en France, en Angle-
terre ou en Allemagne, et qui empêche aussi ces pays de
développer leur production de charbon malgré le besoin im-
périeux qu'ils en ont. Les conditions de travail dans les
mines d'Europe orientale ne le cèdent en rien à celles des
pays capitalistes occidentaux; de sorte que, bien que les
salaires payés aux mineurs soient supérieurs à ceux des
autres branches de l'industrie, les ouvriers fuient les mines
dès qu'ils le peuvent, exactement comme dans les pays occi-
dentaux. En Russie, les mines de Donets n'ont pas réalisé leur
plan au premier semestre de 1956, à cause du manque de
main-d'oeuvre. En Tchécoslovaquie, l'absentéisme des mi-
neurs était de 9 % en 1937 (c'est-à-dire, un mineur ne se
144
Ou-
présentait pas à son équipe 9 fois sur 100); il a été de 18 %
au premier semestre 1956. « La situation du point de vue
de la main-d'æuvre dans les mines de charbon tchécoslova.
ques est en fait considérée comme tellement sérieuse que le
Gouvernement a récemment formellement interdit aux
vriers de ce secteur de le quitter mesure d'autant plus
frappante, que la tendance actuelle en Russie et dans d'autres
pays d'Europe orientale est vers une plus grande liberté dans
le choix de l'emploi » (C.E.E., ib., p. 25).
En Pologne, le plus important producteur de charbon
parmi les pays satellites et un des principaux producteurs
d'Europe, la production ne se développant guère (+ 3 % de
1954 à 1955, + 2 % entre le premier semestre 1955 et le pre-
mier semestre 1956), le programme d'exportation de char-
bon a dû être réduit, de 24,3 millions de tonnes en 1955 i
21 millions en 1956. Les exportations de charbon polonaises
étant surtout dirigées vers les autres pays satellites, la C.E.E.
estime que « les répercussions de cette réduction sur les éco-
nomies d'autres pays d'Europe orientale seront inévitable.
ment sérieuses » (ib., p. 27). La crise des charbonnages polo-
nais résulte surtout d'après la C.E.E., du manque de main.
d'œuvre et nous reviendrons sur les causes de ce manque.
Mais elle résulte aussi d'une baisse du rendement. Gomulka,
dans un passage de son discours devant le Comité Central du
parti polonais (4), constate que le rendement journalier de
l'équipe de fond dans les mines polonaises a diiminué de
7,7 % entre 1949 et 1955 (dans tous les pays capitaliste, le
rendement augmentait pendant cette période). Du même pas-
sage de ce discours il ressort que l'essentiel de l'augmentation
de la production polonaise de charbon entre 1949 et 1955 est
dû aux heures supplémentaires effectuées par les mineurs
cette bonne vieille méthode capitaliste.
Absentéisme, désertion de la mine, baisse du rendement
jusqu'ici inconnue dans l'histoire de l'industrie moderne
que signifie tout cela sinon le refus le plus acharné des mi-
neurs exploités de coopérer à la production?
Et quelle est la réponse de la bureaucratie à cette
situation? C'est Gomulka qui la décrit en ces termes : « On a
instauré comme règle le travail du dimanche, ce qui ne pou-
vait que ruiner la santé et les forces du mineur, et rendro
impossible l'entretien adéquat de l'équipement minier. On a
imposé à beaucoup de nos mineurs un travail de soldat et
de prisonnier. »
Comment la bureaucratie ne voit-elle pas que cette ré.
ponse, cette « solution » donnée au problème créé par le
refus des mineurs sur-exploités d'accepter son système, ne fait
qu'aggraver au décuple la crise existant au départ? C'est
(4) Passage cité en entier p. 81 de ce numéro de Socialisme ou
Barbarie.
145
qu'elle partage l'optique et la mentalité de toutes les classes
exploiteuses : la contrainte doit forcer l'ouvrier au travail.
Et elle a raison. Car dans son système, comme dans tout sys-
tème basé sur l'exploitation, il n'y a qu'une méthode, une
logique: la logique de la contrainte du producteur par les
dirigeants, contrainte physique directe ou contrainte écono-
mique indirecte.
On voit sur ces exemples à la fois ce que vaut la « pla-
nification » de la bureaucratie et quelles sont les racines les
plus profondes de son échec. Son propre système - le men-
songe, la terreur, le manque de contrôle, le gonflement sys-
tématique des résultats, la peur de paraître « critiquer » les
instances supérieures en montrant que leurs directives sont
irréalisables condamne inévitablement la bureaucratie à
planifier mal, à planifier de façon intrinsèquement erronée.
Mais il y a beaucoup plus : la bureaucratie prend pour cer-
tain que les ouvriers produiront ce qu'on leur dit de pro-
duire, d'après des normes fixées d'en haut (et constamment
accélérées). La bureaucratie décide sur le papier que les
mineurs produiront tant pour cent de plus (ses représen-
tants et ses garde-chiourmes dans les mines sont chargés d'y
forcer le mineur) et, sur cette hypothèse, elle bâtit tant bien
que mal le reste de son « plan » : le charbon ira dans telles
fonderies ou aciéries, qui produiront tant d'acier, qui servira
aux laminoires pour fabriquer tont le tôles, etc... Mais les
mineurs quittent la mine, et ceux qui restent diminuent leur
rendement. Le charbon n'est pas produit, et tout le plan
est par terre.
(Tout plan comporte bien entendu une certaine élasti-
cité: plusieurs secteurs ont une production flexible dans des
marges importantes, il y a des substituts, les stocks peuvent
être diminués ou augmentés, etc... L'utilisation intelligente
de cette flexibilité est cependant difficile pour la bureau-
cratie, pour les mêmes raisons qui lui rendent impossible une
planification intelligente. Mais de toute façon, lorsqu'à une
planification déjà intrinsèquement mauvaise, vient s'ajouter
la résistance des ouvriers à la production dans des secteurs
essentiels, aucune élasticité au monde ne peut résorber la
perturbation qui en résulte. Le gâchis se propage de façon
cumulative de secteur à secteur, et il n'y a dès lors rien
d'étannant si l'ensemble de l'appareil productif ne fonctionne
quà 70, 60 ou 50 % de sa capacité.)
La crise de la productivité
« Nationalisation » et « planification » n'ont en rien
changé la situation réelle de l'ouvrier dans la production.
L'ouvrier est resté un simple exécutant, à qui les méthodes
bureaucratiques de direction de la production non simple-
ment dénient touts initiative, mais qu'elles transforment en
pur et simple appendice de la machine. « Travail de soldat
146
et de prisonnier », dit Gomulka en parlant des mineurs po-
lonais. Mais d'après Lange, cette situation est absolument
générale dans l'industrie polonaise : « Nous avons géré l'éco-
nomie avec les méthodes spécifiques de l' « économie de
guerre », c'est-à-dire à l'aide de méthodes consistant en pro-
clamations de caractère moral et politique et en ordres de
nature juridique et administrative, en moyens divers de con-
trainte extra-économique ».
De là résulte la résistance des ouvriers à la production
et à l'exécution des plans ressenties à juste titre comme de
l'exploitation pure et simple. Cette résistance se répercute
sur la productivité de l'économie de plusieurs façons, et
aboutit à une crise terrible de désorganisation :
a) La résistance à l'exploitation se traduit par une baisse
de la productivité comme effort de la part de l'ouvrier (au
sens le plus simple du mot effort); c'est là, par exemple, la
cause essentielle de la baisse du rendement dans les mines
constatée par Gomulka.
b) Elle se traduit en même temps comme disparition du
minimum de gestion et d'organisation collective et spontanée
de leur travail normalement et obligatoirement déployées par
les ouvriers. Aucune usine moderne ne pourrait fonctionner
pendant vingt-quatre heures sans cette organisation sponta-
née du travail qu'effectuent les groupes d'ouvriers indépen-
damment de la direction officielle de l'entreprise, en bou-
chant les trous des directives de production officielles, en
parant aux imprévus et aux défaillances régulières du maté-
riel, en compensant les erreurs de la direction, etc...
Dans les conditions « normales » de l'exploitation, les
ouvriers sont déchirés entre la nécessité de s'organiser aingi
pour effectuer leur travail
autrement cela se répercute
et leur désir naturel de le faire, d'un côté; et de
l'autre côté, la conscience que ce faisant ils ne servent que
les intérêts du patron, à quoi s'ajoutent d'ailleurs les efforts
continus de l'appareil de direction de l'usine visant à « di-
riger » tous les aspects de l'activité des ouvriers, qui n'ont
fréquemment comme résultat que de les empêcher de
s'organiser.
Il était réservé au ( socialisme » de la bureaucratie de
réaliser ce que le capitalisme n'avait jamais pu faire: tuer
presque complètement la créativité des ouvriers, supprimer
presque entièrement leur tendance à organiser spontanément
ces aspects de leur activité que personne d'autre qu'eux ne
peut jamais organiser. Voici ce qu'en dit Lange:
« Nous observons depuis plusieurs années déjà une indif-
férence croissante à l'égard du travail, dans l'appareil admi-
nistratif, de distribution et des services. Cette indifférence
paralyse notre vie quotidienne. Actuellement clle gagne éga-
lement les rangs de la classe ouvrière qui, étant la partie la
plus consciente – du point de vue social et politique — de
la nation, s'y était le plus longtemps opposée... L'attitude
sur eux
147
nihiliste d'une grande partie des travailleurs découle tant du
bas niveau de vie que du fait qu'ils doutent que la politique
économique qui exige des masses laborieuses de tels sacri.
fices soit juste et fondée. » (5)
c) La résistance à l'exploitation aboutit à une baisse de
la productivité qualitative : « ...Cette attitude psychologique
renforce le processus de distension dans l'économie nationale.
Dans l'industrie, le gaspillage et la mauvaise qualité des pro-
duits deviennent des graves problèmes économiques. Dans la
phase du début, cela se faisait sentir dans la fabrication des
articles de consommation. La baisse de la qualité de ces arti-
cles fut un important élément empêchant d'améliorer le ni-
veau de vie, sans freiner pourtant le processus de production.
Actuellement, la production d'articles défectueux a atteint la
fabrication des machines, des appareils, des outils, du maté-
riel de transport, des produits finis. Ce fait menace de freinsr
le cycle technique de production, de désarticuler la base pro-
ductive de l'économie nationale ». (6)
d) Le résultat combiné de tout ce qui précède, s'est
l'effondrement du plan bureaucratique, et la crise de la pro-
ductivité considérée comme rendement d'ensemble de l'appa-
reil économique : ce sont « les arrêts de la production et l'uti-
lisation partielle du potentiel productif existant, le gaspil-
lage de capital et de matières premières, le mauvais appro-
visionnement de la population », constatés par Lange dans un
passage déjà cité de son article.
Nous n'avons considéré jusqu'ici que l'incapacité de la
bureaucratie de planifier rationnellement en tant qu'elle ré-
sulte de la résistance des ouvriers à l'exploitation. C'est en
effet dans cette résistance que se trouve la cause fondamentale
de l'échec de tout plan, de toute direction imposée de l'exté-
rieur aux producteurs. Mais à cette cause s'en ajoutent
d'autres, qui tiennent à la nature même de la bureaucratie.
Nous n'en mentionnerons que deux.
D'abord, la planificution est impossible sans une infor.
mation exacte et rapide, en particulier sur les résultats de la
production en cours. Or, dans un système bureaucratique, la
situation des bureaucrates individuels ou de groupes de bu-
reaucrates occupant telle ou telle place dans l'appareil de
production, dépend des résultats qu'« ils » ont obtenus -
an réalité ou en apparence. Et, à moins d'installer un sys.
tème de contrôles se prolongeant à l'infini, la bureaucratia
centrale est obligée la plupart du temps de se contenter des
résultats apparents. Tout au plus peut-elle contrôler la quan-
tité, nais non la qualité de la production. Il en résulte une
tendance ineluctable des bureaucrates dirigeant les usines on
les secteurs particuliers de l'économie à gonfler les résulta:s
(5) Ib., pp. 73, 78.
(6) Ib., p. 73.
L48
qu'ils ont obtenus de sorte que la planification centrale
s'appuie pour une large part sur des données imaginaires.
Voilà ce qu'en dit 0. Lange :
« Il faut en finir avec la course aux indices purement
quantitatifs obtenus au détriment de la qualité, qui laisse à
désirer, et à des prix de revient trop élevés. Cela aboutit en
effet à des résultats purement fictifs, à la consommation de
matières premières et de travail humain pour une production
ne donnant pas l'effet économique cherché ni même, fré-
quemment, l'effet technique attendu (par exemple, ces ma-
chines agricoles qui après quelques semaines, sont hors:
d'usage) ». (7)
Deuxièmement, le système bureaucratique étant un sys-
tème « fonctionnarisé », le problème de la nomination des
individus à divers postes et de leur promotion devient un pro-
blème fondamental. Or, la bureaucratie ne dispose d'aucune
méthode « objective pour résoudre ce problème. Par contre,
une grande partie de l'activité des bureaucrates comme indi-
vidus consiste à essayer par tous les moyens de résoudre leur
problème personnel. Il en résulte que le fonctionnement de
cliques et de clans acquiert une importance sociologique et
économique fondamentale, et qu'il vicie radicalement toute
la « politique du personnel » de haut en bas de l'économie
nationale donc cette économie nationale elle même. Dans
l'article déjà cité, Lange affirme que la politique du person-
nel est en Pologne « entièrement indépendante des résultats
professionnels d'un travailleur donné », qu'elle se base sur
une « appréciation bureaucratique s'étayant sur des enquêtes
et tenant compte des coteries et des amitiés », qu'elle aboutit
à « remplacer des techniciens expérimentés par des gens sans
qualification professionnelle, dont la loyauté politique n'était
souvent qu'apparente et souvent même par des
gens
de mora-
lité douteuse ». Constatant qu'il y a eu « un abaissement
général du niveau des cadres dans tous les domaines de
l'économie nationale », Lange demande qu'on liquide le
« piston » et le « copinage ».
Ceux qui ont la moindre expérience du fonctionnement
d'une grosse entreprise capitaliste savent que l'appareil
bureaucratique qui la dirige souffre exactement des mêmes
vices, aussi bien quant à l' «information » que quant à la
« politique du personnel ».
La situation dans les usines russes
La résistance des ouvriers des pays satellites à l'exploi-
tation et la mise en échec de la planification bureaucratique
qui en résulte sont, on l'a vu, reconnues aujourd'hui par les
porte-paroles officiels de la bureaucratie. On ne dispose pas
de documents d'une portée comparable pour ce qui est de
(7) Ib.,
p.
74.
149
la Russie. Mais une analyse attentive des compte-rendus du
XXe Congrès du P.C.U.S. conduit à des conclusions analogues.
La bureaucratie russe, tout en se félicitant de l' « en-
thousiasme » et du « labeur héroïque » de ses ouvriers,
insiste à mille reprises, par la bouche de ses représentants
qualifiés, sur la nécessité absolue d'intéresser matérielle-
ment les ouvriers individuels aux résultats de la production,
de lier les salaires à la « qualité et la quantité » du travail
fourni etc. Elle s'inflige ainsi à elle même le plus violent des
démentis; car, si l' « enthousiasme » des ouvriers pour la
production était tellement grand, point ne serait besoin de
s'acharner sur la nécessité du salaire au rendement. Celui-ci
prouve, en Russie comme dans les
pays occidentaux, que
l'ou-
vrier est foncièrement hostile à l'accroissement de la produc-
tion, car il voit dans celui-ci un accroissement de son exploi-
tation, et que le seul moyen de l'y intéresser, c'est l'appât
de la prime. Mais en même temps, la bureaucratie est obligée
d'avouer que le système des primes individuelles est cons-
tamment mis au rancard sous la pression des ouvriers. Ainsi
Kroutchev se plaint de ce que « l'on constate dans le sys-
tème des salaires et des tarifs beaucoup de désordre et de
confusion... Il arrive fréquemment que les salaires soient
uniformisés... Il faut appliquer avec conséquence le principe
de l'intéressement matériel personnel des travailleurs... Il est
nécessaire... de faire dépendre directement le salaire de la
qualité du travail fourni par chaque travailleur et d'utiliser
à fond le puissant levier de l'intéressement matériel pour
augmenter la productivité du travail. » (8). Il critique cer-
taines tendances « utopiques », chez lesquelles « on a vu
fleurir le dédain envers le principe socialiste selon lequel
le travailleur doit être matériellement intéressé au résultat
de son labeur ». (9)
Boulganine dit froidement: « Au fond, les normes sont
actuellement définies non par le niveau technique et d'orga-
nisation du travail, mais par le désir de les adapter à un
niveau de salaires déterminé. » (10) Kaganovitch explique:
« Le caractère désuet du système des tarifs est le principal
défaut de l'organisation des salaires. Les tarifs qui sont à la
base des salaires ont particulièrement vieilli dans la plupart
des branches de l'industrie. Entre 1940 et 1955 les salaires
moyens des ouvriers et des employés ont plus que doublé. Or,
les taux n'ont presque pas changé. Il en a résulté un gros
décalage entre le salaire accru et le tarif des salaires des ou-
vriers. Pour maintenir le niveau des salaires atteint, on main-
tient les tâches à un bas niveau. Ainsi, le tarif des salaires et
les normes de production ne constituent plus le principe orga-
(8) Rapport d'activité de N. Kroutchev. a XX° Congrès du P.C.U.S. »,
éd. des Cahiers du Communisme, p. 78.
(9) Ib., p. 116.
(10) Ib.
9. 164.
150
nisateur essentiel dans les questions d'accroissement du ren-
dement du travail et celles des salaires, la moitié environ du
salaire étant obtenue au compte du dépassement des tâches,
des primes et d'autres payements supplémentaires. En raison
des multiples modifications qui y ont été introduites depuis
vingt ans, le barême contient des éléments de nivellement. Le
décalage qui existe entre les bas taux de salaire et les salaires
réels est une des causes qui font que dans notre industrie les
normes de travail sont mal établies ». (11)
Enfin, Chvernik dit:
« Il convient d'introduire plus résolument des « tâ nes »
justifiées par le rendement de l'outillage, de renoncer à la
fixation des tâches basée sur l'esprit de camaraderie, et de
les revoir en fonction de l'évolution des procédés de fabri-
cation, de l'organisation de la production et des autres amé-
liorations des conditions de travail qui assureront l'accrois-
sement de la productivité du travail » (12)
Ni Taylor, ni un patron capitaliste quelconque n'éprou-
veraient la moindre difficulté à signer ces phrases. On n'y
constate pas seulement que la bureaucratie russe, pas plus
que le capitalisme français, anglais ou américain, ne peut
s'appuyer sur l' « enthousiasme » des ouvriers pour la pro-
duction, et que le seul moyen dont elle dispose sont les pri-
mes au rendement. On voit en même temps que, exactement
comme dans l'usine capitaliste traditionnelle, ces primes sont
utilisées comme une gigantesque fraude. On dit d'abord aux
ouvriers : si vous dépassez de 20 % la norme, votre salaire
sera de 20 % plus élevé. Une fois que la norme est dépassée,
sous prétexte que l'outillage a été modifié ou sans prétexte,
on dit: il a été démontré que tout le monde peut réaliser
120 %, donc il est « techniquement justifié » que la norme
soit portée désormais à 120 %. Bien entendu, ceux qui réali.
seront 20 % de plus de la nouvelle norme, seront payés en
conséquence. C'est exactement ce que disent Kaganovitch et
Chvernik dans les citations données plus haut. Et les argu-
ments concernant les « améliorations de l'outillage » ne va-
lent pas plus dans ce cas que lorsqu'ils sont mis en avant par
les capitalistes. Car cet outillage, ce sont encore les ouvriers
qui l'ont produit, et ce sont les ouvriers qui l'ont payé - avec
la partie non rémunérée de leur travail; si donc il améliore
le rendement, il n'y a que les ouvriers qui doivent en profiter.
Mais il y a beaucoup plus. La bureaucratie prétend diri-
ger l'économie, et en particulier, fixer les salaires par le
moyen de tarifs de base et de primes au rendement. En fait,
on s'aperçoit à la lumière de ces citations qu'elle ne parvient
à diriger que très partiellement. Depuis vingt-cinq ans, elle
proclame que le salaire doit être adapté au rendement indi-
viduel; elle invente le stakhanovisme, elle crée des « héros
(11) Ib., p. 345.
(12) Ib., p.
402.
151
avec
du travail », etc. Et que voit-on? Que la pression ouvrière
dans les entreprises est telle, que « les normes sont actuelle.
ment définies non par le niveau technique et d'organisation
du travail, mais par le désir de les adapter à un niveau de
selaires déterminé ». « Le tarif des salaires et les normes de
production ne constituent plus le principe organisateur essen-
tiel dans les questions d'accroissement du rendement du tra-
vail et celles de salaires », dit Kaganovitch. Il vaudrait autant
qu'il dise: Depuis vingt-cinq ans, nous n'avons fait que battre
du vent quant à l'organisation du travail et des salaires. Com-
ment une « planification » basée sur un tarif donné de sa-
laires et des normes données de production peut-elle fons
tionner, si ce tarif et ces normes « ne sont plus le principe
organisateur essentiel » ? Ce que Chvernik appelle poliment
« la fixation des tâches basée sur l'esprit de camaraderie »,
signifie en clair ceci: ni les primes au rendement, ni le
stakhanovisme, ni le Guépéou, ni les camps de concentration
ne donnent au directeur d'usine russe les moyens de disci.
pliner les ouvriers et de leur imposer purement et simplement
des normes et des taux de rémunération. Il est obligé de
composer eux. Et c'est évident pourquoi. Il suffit
que les ouvriers sabotent systématiquement et en y mettant
les formes la production, pour que l'entreprise ne réalise
pas son « plan » et que le directeur y perde sa tête ou sa
place. Le directeur fait donc obligatoirement des concessions,
et par contre-coup il triche avec le « plan ». Ce que vaut la
« planification » dans ces conditions du point de vue
strictement technique, s'entend - ne se comprend que trop
facilement.
Un autre aspect fondamental de la lutte ouvrière, c'est
l'uniformisation dont se plain Kroutchev, « les éléments de
nivellement qui rendent malheureux Kaganovitch. Cela
signifie en clair: non seulement le directeur de l'usine sou-
vent (13) ne parvient pas à contrôler la masse totale des
salaires dans l'entreprise, - c'est-à-dire les ouvriers exigent
une rémunération globale donnée, à un rythme de travail
donné, que le directeur ensuite « justifie » devant les auto-
rités supérieures en inventant des normes de travail qui y
correspondent mais il ne réussit pas à déterminer non
plus la répartition de ce salaire au sein de l'entreprise. Visi-
blement les ouvriers réussissent que la fixation des normes
se fasse de telle façon, que tout le monde dans la production
(les traitements des bureaucrates sont une autre affaire) ait
à peu près le même salaire en faisant un travail « honnête ».
7
13) Combien souvent, on ne peut pas dire. Pour que ces idées re-
viennent comme une obsession dans les principaux discours des dirigeants,
il faut que la situation réelle qu'ils veulent combattre atteigne des sec-
teurs considérables de la production. C'est ce que nous sommes incités à
penser. Mais pour ce que nous voulons montrer, l'étendue du phénomène
a relativement peu d'importance; son existence, irrefutablement prouvée
par les discours 'officiels, suffit.
152
On constate donc que dans l'usine russe la lutte des ouvriers
contre les différenciations de salaire va aussi loin, sinon plus,
que dans l'usine française ou américaine. On connaît l'impor-
tance que les revendications dirigées contre la hiérarchie ont
pris en Pologne et dans la révolution hongroise.
La stagnation du niveau de vie des ouvriers
et les revenus des bureaucrates
au
Les statistiques officielles de la bureaucratie annoncent,
année après année, des augmentations importantes du niveau
de vie de la population. Un des thèmes favoris de la propa-
gande stalinienne en France et ailleurs est qu'en Russie et
dans les « démocraties populaires » le niveau de vie s'élève
rapidement, tandis qu'il stagnerait ou même reculerait dans
les pays capitalistes.
En fait, le développement rapide du niveau de vie (ra-
pide par comparaison aux périodes antérieures de l'histoire
économique) est un phénomène général des économies mo-
dernes, en particulier des pays industriels développés. Les
statistiques le démontrent amplement; et c'est un fait que
l'expérience individuelle permet à chacun de constater. La
différence sous ce rapport entre les pays du capitalisme privé,
et les pays de capitalisme bureaucratique, si elle est réelle,
ne peut être qu'une différence de degré. Mais même comme
telle, il est douteux qu'elle existe. Pour 1955, les chiffres
officiels concernant le
« volume des ventes détail
des magasins d'Etat et des coopératives » donnent les
accroissements suivants par rapport à 1954: Russie, 5 %;
Allemagne orientale, 6 %; Bulgarie, 12 %; Hongrie, 5 %;
Pologne 11 %; Roumanie, 5 %; Tchécoslovaquie, 11 %;
(C.E.E., ib., p. 34-35). Dans la mesure où ces chiffres laissent
en dehors les « ventes du marché libre », qui concernent
essentiellement une partie des produits alimentaires et doi.
vent donc augmenter plus lentement au fur et à mesure que
le niveau de vie s'élève, ils surestiment plutôt l'augmentation
de la consommation totale. Quoiqu'il en soit, il suffit de les
comparer avec les pourcentages d'augmentation de la consom-
mation privée dans les pays occidentaux pour constater qu'ils
n'ont rien d'exceptionnel : d'après le Bulletin Statistique
l'O.E.C.E. (septembre 1956, pp. 103-118), la consommation
privée pendant la même période augmentait de 10 % en
Autriche, 1 % en Belgique, 7,5 % en France, 11% en Alle-
magne occidentale, 4% en Italie, 7,5 % aux Pays-Bas,
3 % en Suède et au Royaume-Uni, 7 % au Canada, 7,5 % aux
Etats-Unis. Une comparaison rigoureuse devrait embrasser
plusieurs années et tenir compte de divers autres éléments
mais la similitude fondamentale des situations est in-
contestable.
153
En deuxième lieu, les pourcentages globaux d'augmenta-
tion de la consommation publiés par les pays de l'Est mas-
quent tout autant que ceux publiés par les pays capita-
listes - le fait que la progression de certaines catégories de
revenus, et plus précisément des revenus des catégories privi.
légiées, peut être plus rapide que celle des salaires ouvriers.
On reviendra plus loin sur l'importance de la différenciation
des revenus dans les pays bureaucratiques. Il suffit de rap-
peler qu'une augmentation globale de la « consommation »
de 5 % peut signifier une augmentation de 0 % de la con-
sommation des ouvriers et de 20 % de la consommation des
bureaucrates.
Mais le plus important est que les chiffres publiés par
la bureaucratie sont pour la plus grande part faux. Ils sont
souvent faux en partie dans les pays capitalistes, notamment
du fait que les indices de prix utilisés ne sont pas représen-
tatifs ou sont même délibérément manipulés (c'est ce qui se
passe en ce moment en France). Mais ils ne le sont pratique-
ment jamais au degré où ils le sont dans le cas des pays
d'Europe orientale. Il a fallu la crise polonaise pour qu'on se
rende compte de l'étendue de ces falsifications.
D'après Gomulka, l'augmentation de 27 % des salaires
réels en Pologne pendant la période du Plan sexennal (1949-
1955) était « une simple jonglerie de chiffres, qui n'a trompé
personne et n'a fait qu'irriter davantage les gens ». Cela si-
gnifie que l'augmentation de 11 % en 1955 indiquée plus haut
pour ce pays est en grande partie ou totalement imaginaire.
Voilà d'ailleurs ce qu'en disait, six mois avant Gomulka, la
Commission Economique pour l'Europe : « Pendant les six
années qui vont de 1949 à 1955, le salaire nominal moyen en
Pologne a augmenté de 130 % et l'indice officiel des prix de
détail de 80 %. Si l'on rapproche ces deux chiffres, on arrive
à la conclusion que le salaire net c'est-à-dire réel - P. Ch.) a
augmenté de 28 %; cependant, cette proportion... est certai-
nement trop élevée... Si l'on calcule grosso modo le prix
d'achat des marchandises et services choisis jusqu'en 1949
pour l'établissement de l'indice du coût de la vie, on obtient
un pourcentage de hausse de 130 %, ce qui correspond à peu
près à la hausse du salaire nominal moyen. Mais, là encore, il
se peut que ce résultat soit assez éloigné de la vérité, ne se-
rait-ce qu'à cause du choix des marchandises qui entrent dans
le budget familial et qui n'est pas très satisfaisant. Quoi qu'il
en soit, on ne peut guère éviter de conclure que le salaire
réel dans les branches d'activité les moins favorisées semble
avoir baissé non seulement par rapport aux autres branches,
mais aussi en valeur absolue » (Bulletin Economique, mai
1956, p. 33-34).
Autrement dit: sur la base de l'indice des prix utilisé
jusqu'en 1949, et qui déjà n'était pas « très satisfaisant »,
l'augmentation du salaire réel pendant six and en Pologne
a été nulle. Et, plus forte que Ramadier, la bureaucratie polo-
154
naise a confectionné un indice truqué, pour persuader les
gens... qu'ils vivaient mieux.
D'autre part, le niveau de vie se détériore en fonction
d'un facteur qui n'a pas de représentation statistique: la crise
de la productivité se traduisant par la baisse de la qualité des
marchandises. Lange dit : « la baisse de la qualité des articles
de consommation fut un important élément empêchant d'amé.
liorer le niveau de vie. » (p. 73) La Commission Economique
pour l'Europe écrit (Bulletin d'août 1956, p. 34): « La pro-
blème du choix et de la qualité - la Tchécoslovaquie peut-
être exceptée - continue à être d'une importance extrême
pour le consommateur, malgré des améliorations récentes...
En Hongrie, pendant les six dernières années, la qualité de
nombre de biens de consommation s'est détériorée, par suite
d'un effort exagéré visant les résultats quantitatifs. Comme
dans ces conditions le renouvellement des achats avec une fré-
quence plus grande est devenu nécessaire, cause de la qua-
lité inférieure des marchandises, les salaires réels ont été en
fait réduits d'autant (citation du Szabad Nep du 19 juin 56)».
A côté de cette situation des ouvriers, la consommation
des couches bureaucratiques privilégiées s'est développée sans
frein. Nous ne pouvons pas nous étendre ici sur cette question,
car le caractère fragmentaire des données statistiques exige-
rait une analyse trop détaillée. Il nous suffit de citer Lange,
qui constate qu' « un appareil bureaucratique pléthorique a
proliféré dans tous les domaines de l'économie nationale. Cet
appareil freine le bon fonctionnement de l'économie et
absorbe de façon non productive une partie excessive du
revenu national. » (p. 78). Mais nous pouvons affirmer ceci:
compte tenu du fait que les revenus des capitalistes dans les
pays occidentaux sont destinés pour une grande partie à fi-
nancer l'investissement, qui est, dans les pays bureaucratiques,
financé
par
l' « Etat », la distribution des revenus consomma-
bles dans ces derniers ne semble guère moins inégale que
dans les premiers. Lorsqu'un bureaucrate jouit, comme cela
arrive fréquemment, d'un revenu (qui combine son salaire
officiel et les divers « avantages en nature » dont il bénéficie)
vingt, trente ou cinquante fois supérieur au salaire moyen de
l'ouvrier, il faut penser que ce revenu est consacré exclusive-
ment à sa consommation, et le comparer non pas au revenu
d'un capitaliste français ou anglais, mais à la consommation
de ce dernier,
Le sens de la critique des ouvriers
Les staliniens, en France et ailleurs, veulent expliquer
la révolte ouvrière en Pologne et en Hongrie par le bas
niveau de vie absolu, et ce dernier, à son tour, par
la
pau-
vreté de ces pays, leur caractère arriéré, les destructions de
la guerre, etc...
155
Ici encore, comme dans toute leur propagande, les stali-
niens sont de plus en plus réduits à des absurdités. La classe
ouvrière ne se révolte pas contre le bas niveau de vie comme
tel, dans l'absolu notion qui n'a d'ailleurs guère de sens.
La classe ouvrière se révolte contre la stagnation de son ni.
veau de vie au bout de plusieurs années de travail inhumain;
elle se révolte contre sa misère comparée au luxe des para-
sites bureaucratiques; elle se révolte enfin et surtout contro
le gaspillage immense que crée la bureaucratie dans les usines
et dans l'économie, contre le fait qu'on lui rogne des demi..
secondes sur les temps alloués sous prétexte d'augmenter la
production, pendant qu'au même moment, des millions
d'heures de travail social sont purement et simplement dé-
truites par l'anarchie et l'incapacité des chefs géniaux.
Les revendications ouvrières en Hongrie, principalement
dirigées contre la hiérarchie et visant la gestion ouvrière des
usines, le montrent clairement.
L'EVOLUTION POLITIQUE ET
LA « DESTALINISATION »
La bureaucratie se prétend « communiste ». Elle a orga-
nisé l'économie de façon soi-disant « socialiste »; elle a natio-
nalisé les usines, elle a soumis la production à un «. plan ».
Mais elle n'a rien changé à la situation réelle des ouvriers.
Dans la production, les ouvriers restent soumis au pouvoir
total de l'appareil de direction de l'usine. De cet appareil de
direction, le personnel seul a été changé - et pas toujours;
mais son esprit, ses méthodes et son rôle restent exactement
les mêmes que sous le capitalisme privé: extraire le plus de
travail possible aux ouvriers, en combinant la contrainte
directe, l'accélération des cadences, les primes au rendement;
dénier aux ouvriers le moindre droit quant à l'organisation
et au rythme de leur travail. Tout comme l'ouvrier français,
anglais ou américain, l'ouvrier polonais, tchèque ou hongrois
est transformé en un simple écrou de la machine, en un corps
sans âme qui n'a rien à dire ni sur son propre travail, ni sur
celui de son atelier ou de son usine. Sans droit de faire
grève, la grève étant qualifiée de « crime contre l'état
socialiste »); sans droit de former une organisation pour dé-
fendre ses intérêts — l'organisation syndicale officielle n'étant
qu'une succursale de la direction de l'usine, ayant comme
fonction essentielle de pousser à l'augmentation du rende-
ment; livré à l'arbitraire du moindre contremaître ou du
moindre cadre du parti, l'ouvrier a vu l'exploitation s'abattre
sur lui aussi lourde qu'auparavant, sinon davantage.
Il a vu aussi que son exploitation servait les mêmes buts
que sous le régime capitaliste privé: d'un côté, construire
toujours plus de nouvelles usines et de nouvelles machines;
156
d'un autre côté, permettre une existence privilégiée à une
couche de parasites qui n'étaient plus les anciens patrons,
mais les bureaucrates dirigeants des usines, techniciens,
militaires, intellectuels, dirigeants des syndicats, du parti et
de l'Etat.
Le prolétariat a vu que ce régime, se prétendant « com-
muniste », n'était qu'une autre forme du régime capitaliste,
dans laquelle la bureaucratie avait pris la place des patrons
privés; que la « nationalisation » et la « planification »
n'avaient rien changé à sa situation. La dictature totalitaire
l'empêchait de s'organiser, de discuter librement, de lire ou
d'écouter à la radio autre chose que les mensonges officiels.
Mais la dictature totalitaire ne pouvait et ne pourra jamais
empêcher les ouvriers de voir la réalité dans laquelle ils
vivent: leur asservissement perpétuel à une couche de diri.
geants qui ne font la plupart du temps que gaspiller leur tra-
vail, toute la production organisée en vue de leur extorquer
encore plus de rendement, leur misère opposée au luxe des
parasites ni de ressentir comme le plus infâme des affronts
les discours des dirigeants présentant tout cela comme le
o socialisme » et le « règne de la classe ouvrière ».
La dictature totalitaire ne pouvait pas non plus, et ne
pourra jamais, empêcher les ouvriers de lutter contre l'ex-
ploitation par le moyen qui est toujours à la disposition des
exploités : le refus de coopérer à la production, manifesté
d'une infinité de manières. L'industrie moderne ne peut
absolument pas fonctionner sans un minimum de coopéra.
tion des ouvriers, sans le déploiement de leur initiative et
de leurs capacités d'organisation qui dépassent de loin ce que
les ouvriers sont officiellement supposés faire et qu'il est
impossible de leur extorquer par la contrainte. Dès 1950, la
résistance des ouvriers au sein de la production atteignait un
tel degré d'intensité que l'économie des pays satellites entrait
dans une crise terrible, dont on ne mesure qu'aujourd'hui la
profondeur.
Cette situation n'est pas, répétons-le, exclusive aux pays
satellites. Elle sévit également en U.R.S.S.. Mais elle est forcé-
ment plus grave là où la bureaucratie est la plus récente, là
où elle a été implantée le plus artificiellement; et surtout,
là où elle se trouve devant un proletariat qui, ayant une
existence plus ancienne, une conscience de classe plus formée,
se laisse faire beaucoup moins facilement et réagit plus fer-
mement à l'exploitation. En Russie, sous le régime stalinien,
malgré l'incohérence et l'incapacité de la bureaucratie, il n'y
a pas eu, de 1928 à 1941, de crise ouverte, essentiellement
parce que le prolétariat était constamment dilué par un afflux
énorme de jeunes paysans absorbés par l'industrie, pour qui
l'entrée en usine signifiait objectivement et subjectivement un
important progrès économique et social. Mais sans doute
depuis la guerre, la tension monte dans les usines russes ;
157
c'est ainsi, comme on l'a vu, qu'au XXe Congrès les dirigeants
de la bureaucratie ont été obligés de reconnaître que la plu-
part du temps les directeurs d'usine en opposition à toutes les
règles officielles étaient incapables de déterminer les normes
de travail et que ces normes étaient en fait le résultat
d'un compromis, en même temps d'ailleurs que les salaires
distribués. Après la mort de Staline, la nouvelle équipe diri-
geante a compris qu'elle ne pourrait plus pendant longtemps
continuer à diriger par les vieilles méthodes autoritaires, et
a essayé de prévenir un conflit par un certain nombre de
concessions. C'était là le sens de la « déstalinisation ». (14)
Elle y était poussée par la situation russe ; mais elle
l'était autant par la situation dans les pays satellites, en par-
ticulier ceux où un prolétariat ayant l'expérience du capi-
talisme, ne confondait pas la construction de nouvelles usines
avec le socialisme, savait que l'accumulation des instruments
de production a été constamment le souci principal des pa-
trons, et savait aussi, ce que le paysan bulgare ou ro
roumain,
transformé en ouvrier, est en train de découvrir et ce que le
paysan chinois saura aussi d'ici quinze ou vingt ans, que
quel que soit le rythme de progrès de la production et les
miracles de l' « accumulation socialiste », son corps et son
esprit sont de plus en plus asservis au rythme infernal des
machines.
Et c'est précisément dans ces pays satellites où une classe
ouvrière avec une expérience du capitalisme existait déjà,
que la révolte des ouvriers contre la bureaucratie a explosé
ouvertement: En Allemagne orientale, où les ouvriers se sou-
levaient en juin 1953, combattaient les armes à la main les
bureaucrates soi-disant communistes, proclamaient : « les
(C
...une autre
(14) Nous écrivions dans cette revue, il y a trois ans:
relation, moins apparente, est beaucoup plus importante: c'est le rôle
qu'a joué dans le ralentissement du cours vers la guerre l'opposition du
proletariat à l'exploitation, et en tout premier lieu l'opposition du pro-
létariat russe. C'est parce qu'elle sentait son régime craquer sous l'oppo-
sition des ouvriers, que la bureaucratie russe, Staline mort ou pas, était
obligée d'accorder des concessions, qui entraînaient nécessairement une
diminution des dépenses militaires et donc aussi une politique extérieure
plus conciliante. Que cette opposition n'ait jamais pu se manifester av
grand jour, ne change rien à l'affaire; les concessions de la bureaucratie
russe, réelles ou apparentes, manifestent sa virulence, comme aussi après
coup les luttes ouvrières en Tchécoslovaquie et en Allemagne orientale ».
(Socialisme ou Barbarie, n° 13, janvier-mars 1954, p. 1). Bien entendu,
la « déstalinisation » est un phénomène complexe, déterminé par une
foule de facteurs. Si ces facteurs résultent tous en dernière analyse de
la crise d'une société construite sur la scission radicale entre dirigeants
et exécutants et sur leur opposition donc en fin de compte de la lutte
des ouvriers contre la bureaucratie il n'en reste pas moins que cette
crise présente divers aspects, parmi lesquels l'incapacité de la bureau-
cratie à régler ses propres structures, les relations de ses institutions et
de ses couches entre elles, est un des plus importants. Pour un examen
approfondi des problèmes de la « déstalinisation », voir l'article de
Claude Lefort, Le totalitarisme sans Staline L'U.R.S.S. dans une nou-
velle phase, dans le n° 19 de cette revue, pp. 1 à 72.
158
se
vrais communistes, c'est nous », et demandaient « un gouver-
nement de métallurgistes ». Presqu'en même temps, des grè-
ves et des émeutes ouvrières avaient lieu en Tchécoslovaquie.
Aussi bien la bureaucratie russe que celle des pays satel-
lites, essaya dès ce moment d' « adoucir » son cours. Sentant
ses arrières rien moins que sûrs, elle se rapprocha des impé-
rialistes occidentaux; elle réalisa un accord tacite avec eux
sur un arrêt de la course aux armements, et, limitant sa pro-
duction militaire, essaya d'apaiser les ouvriers par quelques
concessions sur le niveau de vie. Puis, elle essaya de changer
Bon visage politique: elle a voulu présenter Staline comme
individuellement responsable de toute l'exploitation et de
tous les crimes qu'elle avait commis, et affirma qu'elle allait
( démocratiser ». C'était là le sens politique du XXe
Congrès.
Si elle a pu ainsi tromper quelques intellectuels déso-
rientés et diverses espèces d'épaves politiques, elle n'a pas
trompé les ouvriers des pays qu'elle domine. Pour les ou-
vriers, la « démocratie » n'a jamais signifié et ne signifiera
jamais autre chose que cela : le droit de s'organiser eux-mêmes
comme ils l'entendent, de pouvoir se réunir et s'exprimer
librement. Tout le reste est pour eux, à juste titre, du bavar-
dage. On en était et on en est toujours très loin, dans
les pays bureaucratiques. La situation réelle n'était pas
changée, ni de ce point de vue ni du point de vue économi-
que. D'autre part, les ouvriers sentirent que la bureaucratie
ne faisait pas ces concessions par bonne volonté, qu'elle ,
avait été effrayée par la révolte de Berlin-Est et les événe-
ments de Thécoslovaquie, qu'elle ne cédait quelques bribes,
que dans la mesure où les ouvriers l'avaient combattu ouver-
tement et avaient essayé de la renverser. La leçon de 1953
n'avait pas été perdue pour les ouvriers d'Europe orientale :
que seule la lutte paye, qu’une révolte d'un jour, même
battue, fait plus pour améliorer le sort des ouvriers que dix
ans de « planification » et de bavardages sur les « lende-
mains qui chantent ». Les quelques « concessions » de la bu-
reaucratie et les déclarations du XXe Congrès, les ouvriers les
ont à juste titre interprétées pour ce qu'elles étaient: le signe
d'une énorme faiblesse.
Une effervescence extraordinaire s'empara dès lors de la
plupart des
pays satellites. Longtemps contenue dans les
usines, la réaction ouvrière commença à percer au grand jour.
Elle se refléta parmi tous les milieux sociaux, en particulier
la jeunesse, - elle s'introduisit dans la base des organisations
bureaucratiques, partis et syndicats, qu'elle commença à
corroder.
La bureaucratie se trouva rapidement incapable de mai-
triser la révolte de la société. Par des mesures spasmodiques,
réhabilitant les anciens « traîtres », promettant plus de li-
berté, reconnaissant pitoyablement ses « erreurs », changeant
son personnel dirigeant et le remplaçant par des bureaucrates
159
qui pouvaient faire figure des « gauchistes » ou d' « oppo.
sants », elle essaya d'apaiser la population, de montrer que
quelque chose était « réellement changé ». Le voyage de
Kroutchev à Belgrade en juin, celui de Tito à Yalta en octo-
bre, essayaient de démontrer que la Russie était désormais
capable de reconnaître dans les faits l' « indépendance » des
pays satellites, mais aussi, exprimaient l'angoisse crois-
sante des bureaucrates de Moscou comme de ceux de Bel.
grade devant le développement d'une révolte dont les uns
et les autres sentent qu'il leur sera presque impossible d'évi-
ter les répercussions chez eux.
LA CRISE POLONAISE ET GOMULKA
Rien n'y fit. En juillet, à Poznan, les ouvriers de l'usine
Staline donnaient le signal d'une révolte ouverte contre le
régime; ils défiaient les blindés, dont ils s'emparaient d'ail-
leurs peu après en partie, avec la complicité des soldats et
des cadres inférieurs de l'armée, il essayaient d'occuper les
bâtiments gouvernementaux. Leurs mots d'ordre, simples et
profonds, « du pain », « démocratie », « liberté », « c'est
notre révolution », « à bas les bonzes » démontraient à la
fois
que
la « déstalinisation » n'avait rien changé dans la
réalité, et que les ouvriers, ayant fait l'expérience de la bu.
reaucratie, étaient parfaitement capables d'identifier les
hommes et le système responsables de l'exploitation.
La révolte de Poznan fut battue; mais sa répercussion
dans le pays et dans les autres pays satellites fut énorme.
La bureaucratie polonaise, russe, yougoslave, les menteurs
éhontés de L'Humanité essayèrent de la présenter comme un
soulèvement d'éléments réactionnaires soutenus par les Ame-
ricains. Mais personne dans les pays satellites n'a cru les
mensonges de la bureaucratie sur la révolte de Poznan. L'at-
titude des Yougoslaves, taisant systématiquement les procès
de Poznan le montre clairement, s'il le fallait. Au con.
traire. A la fois tous les signes visibles, et tout ce qu'on peut
déduire des changements d'attitude de la bureaucratie, mon-
trent que la révolte de Poznan a sonné un passage à l'attaque
des ouvriers dans plusieurs pays en Pologne et en Hongrie
en tout premier lieu.
De juillet en octobre, la Pologne a vécu dans un état
d'effervescence extraordinaire. Les masses commencèrent à
envahir la scène politique. L'appareil bureaucratique stali.
nien, qui avait déjà perdu avec la déstalinisation sa cohésion
intérieure et beaucoup de postes de contrôle décisifs – par
exemple la police politique se retournait contre lui
trouva absolument incapable de dominer la situation.
Les meetings se succédaient contredisant les mots d'ordre
officiels, exprimant la méfiance des travailleurs face છે
se
160
tous les bavardages habituels, demandant des changements
réels. La base de l'appareil bureaucratique, les « militants >>
du rang et les petits cadres, perdait toute sa cohésion. Subis-
sant la pression énorme de la masse ouvrière, s'étant aperçu
que toute l'idéologie sur laquelle elle avait vécu pendant des
décennies s'écroulait (les dirigeants = chefs géniaux et in-
faillibles, l'opposition = trahison, le parti = parti de la
classe ouvrière, la nationalisation + la planification = socia-
lisme, etc...) elle devenait sensible aux revendications ou-
vrières. Elle transmettait cette pression à l'intérieur de l'appa.
reil bureaucratique, dont les sommets, eux-mêmes décom.
posés, saisis de peur, déchirés entre plusieurs lignes à suivre,
n'ayant plus confiance dans Moscou où Kroutchev accu.
mulait gaffe après gaffe, avec la résolution du C.C. du P.C.U.S.
du 20 juillet d'abord, son voyage-éclair à Varsovie avec qua.
torze généraux à la fin - ont pataugé pendant trois mois
avant de trouver la a solution »: rappeler Gomulka, seule
couverture « à gauche » possible en ce moment, à cause de
son opposition à la tendance dominante depuis 1949, de son
pessé « polonais » (chef du P.C. polonais depuis 1943 dans la
clandestinité et de ce fait opposé aux émigrés de Moscou
revenus en 1945) et « pro-titiste », de ses origines ouvrières.
En rappelant Gomulka au pouvoir, la bureaucratie polo-
naise savait qu'elle allait se heurter à Moscou, qui, plein de
rage impuissante, voyait la situation échapper de plus en
plus à son contrôle. Mais elle ne pouvait pas faire autrement.
La liquidation de la fraction la plus compromise de la direc-
tion stalinienne du parti, de l'Etat et de l'économie, était le
minimum indispensable pour essayer de contenir le mouve.
ment des masses qui était en train de prendre une ampleur
extraordinaire. On sait maintenant que pendant la séance du
Comité Central du parti polonais, le 20 et 21 octobre, qui
rappela Gomulka au pouvoir, toute la population, ouvriers et
étudiants en tête, était sur pied de guerre et prête à se battre
contre un coup d'Etat de la fraction stalinienne. L'efferver.
cence monta à son comble avec la nouvelle de l'arrivée de
Kroutchev et de ses quatorze généraux à Varsovie. Les ou-
vriers restèrent dans les usines, prêts à intervenir en masse
contre un coup de force des Russes et de leur instrument, le
maréchal Rokossowski. Des sections de l'armée et de la police
politique étaient déjà sur pied de guerre. Les Russes com-
prirent qu'il ne s'agirait pas dans ces conditions d'une simple
« opération de police », encore moins d'un « coup d'Etat »
d'une fraction polonaise contre une autre, et qu'ils devraient
entreprendre des opérations militaires à l'échelle d'une véri.
table guerre. Pensant pouvoir garder un minimum de con-
trôle sur la situation en Pologne par l'intermédiaire du
parti — ce qui s'avéra totalement impossible deux semaines
plus tard à Budapest - ils opérèrent ce qu'ils pensaient sans
doute être un recul tactique,
161
La situation révolutionnaire actuelle en Pologne
et les contradictions du gomulkisme.
La situation actuelle en Pologne, pour être historique-
ment inédite, n'en est pas moins clairement une situation
révolutionnaire. Les crimes odieux du régime antérieur sont
étalés au grand jour, le caractère exploiteur et oppresseur de
la bureaucratie au pouvoir pendant dix ans est devenu cons-
cience commune, toute tentative de retour vers un régime
même lointainement similaire est radicalement exclue, les
tendances « restaurationnistes » (bourgeoises) sont prati.
quement inexistantes. Des meetings d'ouvriers et d'étudiants
se déroulent constamment, que personne ne pourrait inter-
dire, où personne ne peut être empêché de dire ce qu'il pense.
Des revendications y sont constamment formulées, et discu-
tées, sur la hiérarchie des salaires, sur la gestion ouvrière des
usines, sur la démocratie.
D'autre part, on n'assiste pas encore à la formation
d'organismes soviétiques des masses, de Conseils d'ouvriers ou
de Comités analogues. Mais il y a une transformation extrê-
mement profonde des organisations politiques et syndicales
existantes. Le caractère du parti communiste
du parti
ouvrier unifié de Pologne — est changé. Quelles que soient
les survivances du passé par endroits les noyaux staliniens
pouvant subsister dans telle ou telle organisation du parti,
les restes de mentalité bureaucratique un peu partout
les
militants et les cadres moyens du parti polonais dans leur
grande majorité se situent actuellement sur un terrain com-
muniste. L'effondrement du régime et de l'idéologie stali.
nienne, la compréhension, dans la pratique, de ses origines et
de ses conséquences, l'opposition à l'impérialisme russe, la
leçon de la révolution hongroise, et par-dessus tout, la pres-
sion et les exigences des masses ouvrières polonaises ont déjà
complètement transformé la mentalité de ces militants. Ces
facteurs sont extraordinairement renforcés par l'entrée de
nouveaux éléments ouvriers dans le parti, porteurs de la men-
talité et des exigences prolétariennes. Ces changements ne
sont pas seulement psychologiques : ils s'inscrivent d'ores et
déjà dans des faits objectifs, qui ne sont certes pas « irréver-
sibles », mais qui ne pourraient être remis en question que
par une longue évolution et au prix de nouveaux conflits :
pour la première fois depuis 1927, la discussion est libre au
sein d'un parti communiste. C'est là un fait d'une portée
énorme. Dès maintenant, au sein du parti polonais, les gens
repoussent la stupide théorie du « culte de la personnalité »
et des « erreurs » de Staline ou de Béria : ils demandent que
soit analysé le stalinisme c'est-à-dire en fait le capitalisme
bureaucratique comme système total et cohérent, comme un
tout économique, politique, social et idéologique. Des analyses
allant dans ce sens que l'on peut juger timides de Paris,
mais qui ont le mérite d’exister et d'être faites par des gens
162
ayant une expérience vécue du système bureaucratique
paraissent déjà dans la presse polonaise. Des discussions
commencent à avoir lieu même sur la conception léniniste du
parti, et les critiques que formulait dès 1918 une révolution-
naire polonaise, Rosa Luxembourg, contre la dictature du Co.
mité Central sur le parti et du parti sur les masses, sont reti-
rées des oubliettes staliniennes. Dans ces conditions, quels que
soient le passé et les intentions subjectives des membres de la
dirction du Parti, de Gomulka, d'Ochab, de Cyrankiewitz,
il est évident qu'ils ne peuvent diriger que dans la mesure
où ils marchent avec ce courant irrésistible.
Des transformations analogues ont lieu au sein du mou-
vement syndical. Depuis les journées d'octobre de Varsovie,
le caractère des organisations syndicales se modifie. L'appa-
reil bureaucratique des syndicats, dont la fonction sous le
régime stalinien était de pousser les ouvriers au rendement,
est en voie de liquidation. Les réunions syndicales, aupara-
vant désertées, sont envahies par les ouvriers; et l'on a pu
voir, lors du Congrès des Syndicats à Varsovie en novembre,
les 120 délégués officiels composant théoriquement le Con-
grès mis à l'écart par un millier de délégués envoyés sponta-
nément par la base, qui ont bouleversé l'ordre du jour et le
contenu du Congrès, ont imposé l'ouverture des « livres de
comptes » au sens le plus total du terme des syndicats et ont
transformé le Congrès en un réquisitoire implacable contre
les méfaits de la bureaucratie syndicale.
Autant les différences des situations en Pologne et en
Hongrie sont importantes, autant leurs analogies profondes
sont incontestables. Le mouvement des masses éduquées
par l'expérience du capitalisme bureaucratique montre dans
les deux cas une force extraordinaire. En Hongrie, cette
force s'est traduite par la destruction de toutes les institu-
tions existantes et le conflit ouvert avec l'impérialisme russe ;
en Pologne, elle s'exprime par une transformation poussée
du caractère des institutions les plus importantes, parti et
syndicat, et par le recul infligé à l'impérialisme russe.
La situation est donc entièrement ouverte en Pologne, et
l'avenir du parti communiste l'est tout autant. En même
temps, la révolution polonaise – et la politique du parti
polonais sont prises dans une série de contradictions objec-
tives. Mettre en lumière ces contradictions, essayer de les
analyser dans la clarté, est la première condition pour pou-
voir les surmonter.
D'un côté, la révolution polonaise conduit à la des-
truction de la domination de l'impérialisme russe
pays; en même temps, elle forme une plaie ouverte au flanc
du monde bureaucratique. Sa puissance de contagion est
énorme; elle a déjà donné le signal à la révolution hongroise.
Tous les exemplaires de Tribuna Ludu sont vendus quelques
minutes après leur arrivée à Moscou, que la bureaucratie russe
sur le
163
ne peut pas interdire. Mais en même temps, la révolution
polonaise ne peut pas défier ouvertement la Russie. La bureau-
cratie russe guette la révolution polonaise, prête à l'étrangler
d'une façon ou d'une autre à la première occasion.
La direction du parti polonais est obligée dans ces con-
ditions de composer avec le Kremlin. L'accord russo-polonais
signé lors du dernier voyage de Gomulka à Moscou présente,
comme tout compromis, des côtés positifs et négatifs. En
signant l'accord, la bureaucratie russe se rend beaucoup plus
difficile une intervention ultérieure; elle a été obligée de
reconnaître qu'elle a exploité la Pologne de 1945 à 1953;
elle renonce à cette exploitation pour l'avenir et s'engage à
fournir un aide économique. D'autre part, Gomulka est obligé
d'accepter le stationnement des troupes russes en Pologne,
qui contient des menaces pour l'avenir; et il signe une
phrase approuvant en fait, quoique de façon indirecte, l'écra-
sement de la révolution hongroise par les Russes (l'accord ne
parle pas de l'intervention russe ni de Kadar, mais de l'appui
des deux gouvernemenents polonais et russe « au gouverne-
ment ouvrier et paysan de Hongrie »). C'est là déjà une con-
cession sur les principes, qui peut se retourner un jour ou
l'autre contre la Pologne elle-même.
Le but de tout compromis est de gagner du temps. Dans
les circonstances présentes, la révolution polonaise doit ga-
gner du temps, d'un côté parce que la crise de la bureaucra-
tie met d'ores et déjà la révolution prolétarienne à l'ordre
du jour en Russie et ailleurs et de toute façon limite les possi.
bilités d'intervention du Kremlin, d'un autre côté parce
qu'elle doit pouvoir se continuer, s'étendre et s'approfondir
en Pologne même. Et c'est surtout de ce dernier point de vue
que le compromis passé avec la bureaucratie russe prendra
sa signification définitive: il aura été positif, s'il aura permis
le développement de la révolution dans le pays.
Ce développement se trouve placé devant des contra-
dictions tout aussi profondes que celles des relations exté-
rieures. La situation économique léguée par le régime stali-
nien est chaotique; la coordination des divers secteurs de
production est à reprendre à partir de zéro; l'intégration de
la paysannerie dans le circuit énocomique, après dix ans de
spoliation du paysan par le moyen des livraisons obligatoires,
de collectivisation forcée, présente des difficultés énormes. Sur
le plan politique, et, plus profondément, de l'organisation de
la vie sociale sous tous ses aspects, des organismes de masse
n'existent pas
quoique, comme on l'a vu, le caractère du
parti communiste ait subi des transformations profondes. La
bureaucratie stalinienne est constamment éliminée des postes
dirigeants de l'économie et de l'Etat. Mais un appareil de
direction « épuré » continue à gérer l'économie. L'appareil
d'Etat a changé de personnel, mais non de caractère objectif;
il reste un appareil séparé, formé par une bureaucratie per-
manente et en principe inamovible.
164
Il faut s'arrêter ici et essayer d'approfondir l'examen de
ces contradictions à partir du problème qui est le plus essen-
tiel et qui de ce fait échappe à la vue de ceux qui aujourd'hui
bavardent à la périphérie de la révolution polonaise - le
problème de la gestion ouvrière de l'économie.
La gestion ouvrière de la production est la conclusion
évidente, indiscutable, consciente et explicite que les ouvriers
des pays d'Europe orientale tirent de l'expérience du capita-
lisme bureaucratique. Personne évidemment n'a, parmi eux,
pensé un instant au retour des patrons privés. Mais personne
non plus ne peut avoir désormais confiance en aucune sorte
de bureaucratie dirigeante, même « démocratique >>, même
« révolutionnaire ». Cette bureaucratie, nous la dénonçons
ici depuis longtemps à partir de documents, de statistiques
et de raisonnements. Mais l'ouvrier hongrois ou polonais en
a fait l'expérience dans sa peau. Il en a fait l'expérience, non
seulement comme d'une couche exploiteuse, mais comme
d'une couche incapable de gérer la production. C'est la
gestion bureaucratique de l'économie qui a fait faillite aux
yeux du prolétariat d'Europe orientale. Dans la mesure où
il agit, celui-ci est donc poussé inéluctablement à cette con-
clusion : il ne reste d'autre solution que l'organisation de la
production par les producteurs eux-mêmes.
Le parti ouvrier polonais reconnaît cette situation et les
demandes correspondantes des ouvriers. Il hésite cependant
et il se propose d'instaurer, à titre pourrait-on dire expéri-
mental, une sorte de gestion õuvrière dans certaines usines.
Mais il ne peut pas s'agir d'expérimentation; dans la situation
polonaise, la gestion ouvrière est la seule possibilité de re-
mettre en marche rapidement l'économie et la production
autrement au bout d'une période de chaos, il faudra revenir
sous une forme ou sous une autre à un système bureaucra-
tique pur et simple. Il ne peut pas s'agir non plus de limiter
la gestion à quelques usines, ni de la limiter aux usines
laissant les fonctions de coordination et de gestion de l'en-
semble de l'économie à un appareil bureaucratique.
D'un côté, si la gestion ouvrière est effective au sein des
usines particulières — et non une mystification, comme la
« co-gestion » de Tito - les ouvriers supprimeront la hiérar-
chie, et ils supprimeront les normes de travail. La discipline
de production sera établie par les ouvriers eux-mêmes et
sera d'autant plus efficace. Mais cela ne peut pas se faire
dans chaque usine sans coordination avec les autres ; car toute
rationalisation de l'ensemble du processus productif devien-
drait impossible. Cette rationalisation suppose, une fois la
« concurrence » et le « marché ».capitaliste supprimés, qu'une
règle générale est appliquée à toutes les unités de production
particulières. Cette règle générale, il n'y a que deux façons
de l'établir: ou bien par des normes de production abstraites
et impersonnelles qui doivent être définies et imposées de
en
165
l'extérieur et c'est la fonction d'un appareil bureaucrati-
que séparé; ou bien elle se fera par des assemblées de repré-
sentants des Conseils d'ouvriers de chaque entreprise, qui, par
branches d'industrie, tâcheront d'uniformiser et de rationali.
ser les méthodes et le rythme de production de façon vivante
et en tenant compte des conditions concrètes de chaque
entreprise.
D'un autre côté, le Conseil ouvrier gérant une usine par-
ticulière est obligé de s'occuper du reste de l'économie. Son
approvisionnement en machines et matières premières, l'écou.
lement de sa production en dépendent. Il distribuera des
salaires, dont le pouvoir d'achat dépend de ce qui se passe
partout ailleurs dans l'économie (et en particulier dans le
secteur agraire). Le problème d'une direction centralisée de
l'économie se pose ainsi dans toute son acuité. Lui aussi peut
être résolu de deux façons : ou bien, les Conseils d'ouvriers
se formeront, se fédéreront sur le plan national, compren-
dront des représentants de Conseils de paysans par village ou
par district, et assumeront l'ensemble des tâches de direction
de l'économie, y compris les fonctions de « planification »,
seule voie conduisant au socialisme. Ou bien, les tâches de
direction centrale resteront entre les mains d'une bureau-
cratie séparée des producteurs, auquel cas une inversion du
processus sera à la fin inévitable, et la gestion ouvrière des
usines particulières elle-même perdra son contenu et se trans-
formera en un moyen d'attacher les ouvriers à une producton
sur laquelle ils n'auront à nouveau aucun pouvoir.
Pour l'instant, le parti polonais a sur cette question une
attitude hésitante et contradictoire. D'un côté, il affirme que
son objectif final est la gestion ouvrière ; d'un autre côté, il
hésite à s'engager dans sa voie. Le programme économique
adopté par
le Vſe Plenum de son Comité Central, en juillet (et
dont les éléments se trouvent dans l'article de 0. Lange que
nous avons cité à plusieurs reprises) n'était rien de plus qu'un
programme d'assainissement et de mise en ordre de l'économie
bureaucratique. Il entendait dépasser la crise de la produc-
tion, le fameux « nihilisme » des ouvriers, par la réintro-
duction des procédés typiquement capitalistes de l' « inté-
ressement matériel » et des « stimulants économiques »
clair par le travail au rendement. Il entendait dépasser l'anar-
chie de la planification par la rationalisation de la hiérarchie
qui devrait désormais être basée sur l' « efficacité économi-
que » et non sur les « clans et les intrigues politiques ». Dans
ce contexte, les appels à un « élargissement considérable de
la participation des travailleurs à la direction des entrepri-
» perdaient objectivement toute signification : tous les
régimes d'exploitation en sont là aujourd'hui, depuis que la
faillite de la direction bureaucratique de la production est
devenu évidente aux yeux des exploiteurs eux-mêmes. Les
comptes rendus du XXe Congrès du parti russe sont remplis
d'appels aux dirigeants des usines visant à « associer les tra-
en
ses
166
vailleurs au fonctionnement des entreprises », et, en Occident,
le capitalisme essaye à son tour de persuader les ouvriers qu'ils
devraient lui faire connaître leur avis sur la production. Et
toutes ces entreprises échouent, car les ouvriers savent que la
gestion ne leur appartient pas et que leur collaboration est
utilisée en fin de compte par les dirigeants pour les intégrer
davantage à la production et les exploiter encore plus; de
même que les « stimulants économiques >> échouent devant la
résistance de plus en plus forte que les ouvriers opposent au
travail au rendement et à la différenciation des salaires.
Le programme du VIe Plenum est dépassé par les faits
mais reste le programme officiel du parti polonais. Il est
pourtant clair que la voie des « stimulants économiques »,
du travail au rendement, des normes fixées par une bureau-
cratie séparée de la production c'est la voie du retour, à
plus ou moins long terme, à la domination économique de la
bureaucratie.
ou
Les mêmes contradictions se retrouvent sur le plan « po-
litique » qui est en fait le plan de la vie sociale globale.
Le parti a changé de caractère mais il reste en fait et en
droit l'instance suprême du pouvoir. Un parti, quel que soit
son caractère, peut-il conduire la société au socialisme
bien ce passage implique-t-il la prise de leur sort entre leurs
mains par les masses organisées dans les Conseils ou d'autres
organismes soviétiques? La dictature du proletariat peut-elle
être la dictature d'un parti? Ce ne sont pas là des questions
théoriques, ni des subtilités de doctrinaires. Ce sont les ques-
tions suprêmes de notre époque, et le sort de la révolution
polonaise dépend, de la façon la plus pratique et la plus
immédiate, de la réponse qui leur sera donnée.
Nous pensons que toute l'expérience des quarante der-
nières années, et l'analyse de la situation actuelle, permettent
de répondre de la façon la plus catégorique à cette question.
Le pouvoir ouvrier ne peut être rien d'autre que le pouvoir
des organismes ouvriers de masse. La dictature du proletariat
n'est pas la dictature d'un parti, mais le pouvoir des Conseils
ouvriers, qui réalisent en même temps la démocratie proléta-
rienne la plus large. Le parti, l'appareil d'Etat et l'appareil
de direction de l'économie dépérissent en étant résorbés par
les organismes de masse qui assument les fonctions diri.
geantes sur tous les plans ou bien se séparent des masses,
les réduisent au silence et se développent suivant leur
propre logique vers une bureaucratie totalitaire, quelles qu'en
soient les formes. Le problème du rôle du parti dans la dicta-
ture du prolétariat est le problème de la réunification de la
vie sociale indispensable pour la réalisation du socialisme.
Que se passe-t-il en ce moment en Pologne ? Que risque-t-il de
se passer, de façon beaucoup plus nette, demain? D'un côté,
la vie réelle des gens, dans la production et ailleurs; d'un
autre côté, un appareil dirigeant l'économie, qui doit, pour
167
donne pas
-
diriger efficacement, être formé par les représentants des
producteurs, et qui en fait ne l'est pas; en troisième lieu, un
appareil d'Etat qui est lui aussi séparé de ceux qu'il doit
administrer; et, coiffant le tout, le parti, qui essaie de coor-
donner tout cela tant bien que mal, et qui est une contra-
diction vivante : car ou bien c'est effectivement lui qui coor-
donne et alors il est la seule instance de pouvoir et tout
le reste n'est que fantôme et décoration; ou bien il ne coor.
et alors il est superflu comme organisme de
gouvernement (non pas, bien entendu, comme regroupement
« politique » et « idéologique »).
En d'autres termes : ou bien la vie réelle de la société,
sous tous ses aspects, s'identifiera avec la vie d'un seul réseau
d'institutions, les Conseils; ou bien, les institutions tradition-
nelles - parti, Etat, direction de l'économie et des usines
séparées de la masse des hommes et par la même de leur vie
réelle, s'élèveront à nouveau au-dessus de la société et, rede-
venues l'incarnation d'une catégorie sociale particulière, la
domineront.
De ce point de vue, finalement le plus important, la
situation polonaise contient des éléments négatifs très lourds.
Tout d'abord, le mouvement des masses n'a pas jusqu'ici
abouti à la formation de Conseils; le parti l'a canalisé, non
seulement « idéologiquement » et « politiquement » mais
aussi organisationnellement. On ne sait pas dans quelle me-
sure il n'a pas contribué à empêcher la formation de Con-
seils
ce qui de toute façon prouverait qu'on pouvait l'em-
pêcher. Aussi bien, il ne peut pas être question pour le parti
de créer des Conseils par décret. Il est certain que le mouve-
ment spontané des masses est resté jusqu'ici en deça de la
constitution d'organismes de pouvoir.
Mais l'attitude même du parti, par son ambiguité, con-
tient une foule de dangers. Le parti se trouve dans une situa-
tion unique dans l'histoire : la masse de ses membres vient
d'accomplir, l'espace de quelques mois, un progrès immense ;
ses structures sont régénérées ; ses liens avec les travailleurs
se renforcent. Et, en dehors de lui, il n'y a pas d'organismes
représentatifs de la classe ouvrière. Dans cette situation, il
peut tâcher de contribuer par tous les moyens dont il dispose
au développement du mouvement des masses; ou il peut se
replier sur lui-même, considérer que la réalisation du socia-
lisme c'est son affaire et qu'il trouvera en lui-même toutes
les solutions.
Il ne faut pas cacher qu'une foule d'indications montrent
que le parti penche dangereusement vers la deuxième solu-
tion. Lorsque Gomulka dit : « le processus de démocratisa-
tion ne peut être dirigé que par le parti ouvrier unifié », il
n'y a pas là seulement la contradiction dans les termes d'une
démocratisation dirigée par un parti unique (unique en fait).
Cela traduit en même temps la volonté de maintenir au parti
le monopole du pouvoir — et par là même, compromet les
168
chances du développement du mouvement des masses. Lors-
que le parti reste dans l'expectative sur la question cruciale de
la gestion ouvrière, les chances d'une nouvelle bureaucratisa-
tion sont renforcées. Lorsque la constitution d'organisations
politiques ouvrières demeure interdite, aussi large que soit
la démocratie à l'intérieur du parti, les possibilités de con-
trôle du prolétariat sur la situation restant dangereusement
limitées.
Personne ne peut donner des leçons à la révolution polo-
naise, et il faudrait être aveugle pour ne pas voir les diffi-
cultés énormes devant lesquelles se trouvent les communistes
polonais, le courage dont ils font preuve en les attaquant. Ces
problèmes sont à l'heure actuelle discutés intensément en
Pologne et le mouvement révolutionnaire dans les autres
pays a le droit et le devoir de connaître à la fois la force de
la révolution polonaise et les dangers, extérieurs et intérieurs,
qui la guettent.
L'AVENIR DE LA REVOLUTION HONGROISE
Après la deuxième intervention russe, et la constitution
du gouvernement fantoche de Kadar, le véritable caractère
de la révolution hongroise, prolétarienne et socialiste, s'est
manifesté avec encore plus de clarté qu'auparavant. Comme
on l'a dit, les boutiquiers étaient sortis de leurs boutiques
lors de deuxième semaine de l'insurrection; ils y sont défini-
tivement rentrés après la troisième. La seule force réelle exis-
tant dans le pays, à part les blindés russes, la force des
ouvriers organisés dans leurs Conseils, est restée là, a organisé
la grève générale, et a maintenu ses revendications lorsqu'elle
ne les a pas approfondies.
Les demandes posées par les Conseils à Kadar à divers
moments depuis le 11 novembre comprennent:
La gestion ouvrière des usines (bien que Kadar l'ait
déjà « décrétée»);
La constitution de Conseils des travailleurs dans
toutes les branches de l'activité nationale, y com-
pris les administrations de l'Etat ;
Le droit des Conseils de publier leurs journaux;
Le retrait des troupes russes ;
La constitution de milices ouvrières ;
La reconnaissance des Conseils comme organes repré-
sentatifs de la classe ouvrière;
La reconnaissance du rôle politique des Conseils ;
Le retour de Imre Nagy au pouvoir, donc la démis-
sion du gouvernement actuel.
La portée de ces revendications n'a pas besoin d'être
analysée. Il faut simplement souligner qu'en les posant, au
moment où tout dans le pays se plie devant la terreur russe,
7
169
et en en présentant certaines plutôt que d'autres suivant la
situation tactique du moment, les Conseils ont montré leur
capacité de se placer au point de vue de la population dans
son ensemble, et par là même d'être la seule direction de la
société,
Dès son premier jour, les gens s'empressèrent d'enterrer
la révolution hongroise. Ces lignes sont écrites le 9 décembre
et cette révolution qui dure depuis 48 jours est aussi vivante
que jamais. Malgré les déportations et les arrestations noc-
turnes des membres des Conseils, ceux-ci n'abandonnent pas
la résistance. La lutte plus ou moins ouverte cesserait-elle
d'ailleurs pour quelque temps, qu'il n'y aurait pas davantage
de solution pour les Russes et pour Kadar. Désormais, le
régime en Hongrie est considéré par toute la population
comme provisoire au même titre que l'occupation nazie
l'était pendant la guerre
et cela détermine aussi bien
l'attitude des gens face à Kadar que l'incapacité de celui-ci à
rétablir une machine d'Etat fonctionnant à un degré satis-
faisant. Les Russes sont placés devant un dilemme insoluble :
partir, c'est avouer une défaite énorme et montrer à tous les
peuples qu'ils oppriment qu'il suffit de se battre avec suffi-
samment de détermination pour vaincre. C'est aussi ouvrir la
voie à la révolution prolétarienne et au socialisme en Hon.
grie et à l'appel irrésistible que son exemple fournirait aux
autres pays de l'Est. Rester, ce n'est pas seulement maintenir
dans le pays un chaos qui ne mène nulle part; c'est en fin
de compte importer la révolution en Russie, car les soldats
russes stationnés en Hongrie sont successivement contaminés
par ce qui s'y passe et, par leur intermédiaire, une fraction
chaque jour croissante de la population russe. Et cela à un
moment où les manifestations de la crise du régime en Russie
même vont croissant; où Kroutchev reconnaît que l'attitude
de la jeunesse russe face au régime ne diffère pas tellement
de l'attitude de la jeunesse hongroise; où des avertissements
de plus en plus sévères sont adressés aux intellectuels qui ne
comprennent pas les limites de leur rôle d'amuseurs de la
bureaucratie; et où, à ces signes infaillibles de l'orage qui
approche, s'ajoutent les grondements souterrains de la colère
ouvrière qu'on ne peut plus étouffer, d'un proletariat qui
compte quarante millions d'individus et qui considère,
comme est obligé de l'écrire l'organe officiel des syndicats
russes, que « notre administration n'est que bureaucratie, nos
syndicats que des assemblées de fonctionnaires ».
La révolution prolétarienne contre la bureaucratie vient
de commencer. Pour la première fois depuis la révolution
espagnole de 1936, la classe ouvrière crée à nouveau en Hon-
grie ses organismes autonomes de masse. Dès son premier
jour, cette révolution se situe à un niveau plus élevé que les
révolutions précédentes. Le régime bureaucratique est cor-
battu de l'intérieur, par les travailleurs qu'il prétendait frau-
170
duleusement représenter, au nom du véritable socialisme qu'il
a si longtemps prostitué. L'emprise des organisations bureau-
cratiques sur le mouvement ouvrier des pays capitalistes occi-
dentaux ne se relèvera jamais du coup qu'elle vient de subir.
Notre tâche est d'abord et avant tout aujourd'hui de pro-
pager le programme de la révolution hongroise, d'aider le
prolétariat français dans sa lutte contre sa propre bureau-
cratie, indissociable de
sa lutte
contre l'exploitation
capitaliste.
Elle est aussi de travailler au regroupement, sous toutes
les formes, des ouvriers et des militants qui reconnaissent
dans la lutte et le programme des ouvriers hongrois, leur
lutte et leur programme.
Pierre CHAULIEU.
i
- 171
con
Les Impérialismes
et l'Egypte de Nasser
L'expédition contre l'Egypte a donc eu lieu. Mais pas
tout à fait comme l'imaginaient nos petits Napoléons Mollets.
Pas de balayage-éclair d'Hitler-Nasser. Pas d'entrée triom-
phale des magnifiques troupes françaises et de nos braves
alliés au Caire. Pas de coup de chapeau des nations subju-
guées par la mâle initiative franco-britannique... Non, rien
de tout cela. Des cadavres, oui plus de 5.000 civils tués
rien qu'à Port-Saïd des blessés, des brûlés, des familles
errant dans les ruines des quartiers populaires détruits... et
l'échec complet de la France et de l'Angleterre. Nous savions
déjà que les dirigeants socialistes étaient des valets fidèles de
la bourgeoisie française, personne ne pouvait imaginer qu'ils
étaient crétins à ce point.
Nous ne nous étendrons pas sur le bilan catastrophique
de l'expédition: retraite piteuse devant la pression des Deux
Grands, isolement à l'O.N.U., maintien de Nasser, canal de
Suez obstrué pour de longs mois, disparition définitive des
possibilités d'exportation et d'investissement de capitaux au
Moyen-Orient, probable liquidation des investissements exis-
tants, aggravation de la situation économique en France par
suite des restrictions sur le pétrole et l'essence, dépendance
plus grande des Etats-Unis, accroissement de l'influence russe
dans cette région. Le passif est si évident que la bourgeoisie
française elle-même aussi décrépite, inibécile et lâche soit-
elle — ne peut plus le nier. Dans les arrières-boutiques poli-
tiques, les anciens et futurs ministres « qui n'étaient-au-cou-
rant-de-rien » pestent contre les Tartarins maladroits, les ban-
quiers s'inquiètent, les industriels s'affolent... Bien entendu,
ce n'est pas si facile que cela que de mettre ce Mollet à la
porte : l'arithmétique parlementaire, n'est-ce pas...
La tentative aventureuse de la France et de l'Angleterre
de conserver par la force leur influence au Moyen-Orient a
donc lamentablement avorté. L'affaire est entrée maintenant
dans la phase du marchandage et le rôle principal dans ·
l'épreuve est tenu par les Deux Grands, les Etats-Unis et
l'U.R.S.S. C'est dire qu'il n'y a pas de solution rapide en
vue. La crise n'est pas terminée et des rebondissements im.
prévus ne sont pas à exclure. Mais le recul de la France et
172
de la Grande-Bretagne est, lui, bel et bien définitif. Le Moyen-
Orient est perdu pour la France et il échappe de plus en
plus à l'Angleterre.
Or, l'affaire d'Egypte n'est qu'une défaite de plus dans
une retraite générale. C'est tout leur système traditionnel de
domination des pays arriérés qui est en pleine décomposition.
La domination directe — les glorieux Empires des Churchill
et des Lyautey
s'écroule visiblement. La domination par
personne interposée est également mise en cause presque
partout. Parce que les personnes interposées, les gouverne-
ments fantoches, sont de plus en plus fantoches, impuissants
à maintenir les vieux rapports avec ces anciennes grandes
puissances, parce que celles-ci sont de moins en moins capa-
bles de les soutenir et, surtout, parce que l'énorme supériorité
économique et militaire des Deux Grands entraîne tout natu.
rellement Washington et Moscou à se substituer peu à
peu
à
ces puissances.
Or, l'expédition franco-britannique, qui mettait en dan-
ger l'équilibre précaire tacitement accepté par l'Amérique
et l'U.R.S.S., devait obligatoirement les amener à intervenir
et à précipiter par là même la dégringolade de Paris et de
Londres.
Cette intervention, plutôt brutale, a démontré une fois
de plus l'impossibilité pour n'importe quel pays capitaliste
de prendre des initiatives tant soit peu indépendantes sans
qu'immédiatement soit posée la question des rapports entre
l'Est et l'Ouest. Mais son effet principal est de rendre ainsi
encore plus aigu le problème des rapports entre pays avancés
et pays arriérés, dont l'affaire d'Egypte vient de montrer le
caractère explosif.
Les déclarations anti-colonialistes des Deux Grands sout
bien connues ; leur amour pour les peuples opprimés est quo.
tidiennement proclamé au Kremlin et à la Maisou Blanche.
Mais quelle est leur position réelle vis-à-vis des pays
arriérés ?
En ce qui concerne l’U.R.S.S., on ne pouvait pas la con.
sidérer jusqu'ici comme une puissance « colonialiste »
sens classique du mot. Cependant, sa politique d'exploitation
pure et simple des pays arriérés satellites, son incapacité à
intégrer les économies de ces pays dans un vaste ensemble
suffisent pour montrer que ses rapports de grande puissance
industrialisée avec les pays d'Afrique ou d'Asie ayant une
économie arriérée, bien que différents à certains égards, ne
seraient pas fondamentalement distincts de ceux des autres
grandes nations industrielles et que, pas plus qu'en Rou.
manie ou qu'en Bulgarie, elle n'agirait en fonction des besoins
réels de ces pays.
Mais le candidat le plus probable à la succession de la
France et de l'Angleterre dans ces régions est actuellement
l'Amérique. Or, ce qui ressort finalement de la crise égyp-
tienne, c'est que, obligés par la force des choses à répudier
au
173
Je « colonialisme périmé » et ses méthodes de domination
directe, les Etats-Unis sont tout aussi incapables d'établir
d'une autre manière une emprise solide sur les pays qui
accèdent à l' « indépendance nationale ». Quant à l'orienta-
tion réelle de leur politique, l'installation des compagnies
pétrolières américaines au Moyen-Orient et l'utilisation des
promesses de financement d’Assouan comme moyen de pres-
sion sur l'Egypte montrent qu'elle ne diffère en rien, quant
à la substance, de celle des vieux pays impérialistes.
La politique classique des impérialistes a été de traiter
les pays arriérés comme des sources de matières premières
et des débouchés pour les marchandises des nations indus-
trialisées. S'ils y ont investi des capitaux, c'est surtout pour
développer les exploitations minières (ou de matières pre-
mières) et, à partir d'une certaine époque, l'industrie légère
et l'infrastructure (ports, routes, chemins de fer) nécessaire
au transport des marchandises. Ils ont créé dans ces pays des
bases militaires, pour asseoir leur propre domination
d'abord, pour lutter contre les impérialismes rivaux ensuite
(aujourd'hui : réseau de bases américaines en Arabie, Tur-
quie, Irak, Pakistan, complétant les bases anglaises ou les
remplaçant).
Ces territoires ont été reliés ainsi à l'économie capita-
liste, mais leurs structure sociale n'a pas subi de transforma-
tions profondes. Les impérialismes se sont appuyés sur la
ciasse dominante au pouvoir grands propriétaires ter-
riens, chefs religieux et militaires, fonctionnaires. Si la pro-
duction agricole a subi parfois des transformations dues au
développement d'une monoculture étroitement dépendante
du marché mondial, le structure pré-capitaliste des campagnes
s'est maintenue, les méthodes d'exploitation du sol sont res-
tées presque inchangées et les masses paysannes ont continué
de vivre dans une misère extrême. Pendant ce temps, la faible
bourgeoisie indigène ne disposait d'aucun pouvoir réel et,
tout en exploitant férocement ses propres ouvriers, regar-
dait avec rage et envie le développement de la grande pro-
duction dans les pays avancés.
Confortablement assis sur le dos de gouvernements cor-
rompus, distribuant aux couches dirigeantes quelques miettes
de leurs profits, les capitalistes occidentaux, solidement pro-
tégés par leurs cuirassés et leurs mercenaires, fondaient des
cuvres de bienfaisance et se plaignaient de la saleté des
indigènes.
Aujourd'hui ce bel édifice craque de partout. En dix ans,
de 1946 à 1956, les explosions se sont succédées : les Indes,
la Chine, l'Indochine, l'Indonésie, l'Afrique du Nord,
l'Egypte.
174
En ébranlant les structures traditionnelles, le dernier
conflit mondial a facilité l'irruption de forces sociales qui
luttent pour briser le vieux cadre économique et politique,
pour changer les anciens rapports entre pays avancés et pays
arriérés. L'opposition des classes se fait plus vive, mais se
mêle avec l'opposition à l'impérialisme étranger. Les paysans
pauvres réclament la terre, les ouvriers des meilleures condi-
tions de vie, les bourgeois indigènes des profits accrus, l'in-
dustrialisation, l'usine moderne, l'Etat moderne; les cadres
intellectuels et les militaires rêvent de planification, d'éner-
gie atomique. Mais le poids des bourgeoisies indigènes est
encore très faible et leurs liens avec les propriétaires fonciers
et les sociétés étrangères trop solides. Aussi leur attitude à
l'égard des puissances dominatrices consiste essentiellement
à marchander, à demander une partie plus grande des profits.
Pourtant, dans certains pays, dont l’Egypte, les éléments les
plus actifs de la bourgeoisie, alliés avec l'armée, les jeunes
cadres de l'industrie et de l'Etat, veulent diriger eux-mêmes
leurs propres affaires, être sur un pied d'égalité complète
avec les grandes nations. Les conditions locales et le degré
d'affaiblissement de l'impérialisme dominant le pays font
que ce mouvement reste au niveau du marchandage ou de-
vient lutte ouverte, lutte d'autant plus âpre alors, mais aussi
d'autant plus confuse, que les possibilités d’un développe-
ment économique indépendant sont très précaires. En effet,
aucun de ces pays ne peut se soustraire à la situation réelle
qui se caractérise par le gigantesque décalage existant entre
les énormes investissements exigés par l'industrialisation et
les faibles ressources en capital des régions arriérées. C'est
pourquoi les nations du Moyen-Orient désireuses de contre-ba-
lancer l'influence anglaise sont obligées de solliciter la péné-
tration du capital américain. C'est pourquoi l'Egypte doit
rechercher, tour à tour, l'aide des Etats-Unis et de l'U.R.S.S.
Cependant, devant la petitesse ridicule et l'inefficacité
de l' « aide économique » des grandes puissances et la poli-
tique à courte vue des monopoles internationaux, certains
groupes bourgeois indigènes essaient d'étendre l'industrie
en s'appuyant sur l'Etat, dont le rôle dans ce domaine de-
vient chaque jour plus important.
Or, ce n'est pas un hasard si cette tendance s'est mani.
festée plus fortement en Egypte qu'ailleurs, car elle est, après
Israël, la nation du Moyen-Orient où le développement de
l'industrie est le plus fort, bien que celle-ci ne représente
encore qu'une petite partie de l'économie du pays (i).
(1) « Quels que soient les progrès réalisés par l'industrie en Egypte,
la situation dans ce pays n'est nullement comparable à celle d'Israël.
Sans doute satisfait-elle ses besoins à peu près en sucre, 90 % pour la
175
Essentiellement agricole, l'économie égyptienne a été
dominée pendant des longues années par le problème du
coton. En effet, développée par l'Angleterre qui désirait assu-
rer à son industrie textile une source de matières premières
placée sous son contrôle, la production de coton, qui constitue
environ le tiers du revenu agricole de l'Egypte, alimento
une exportation capitale pour ce pays puisqu'elle représente
80 % de la valeur totale des exportations. S'il a considéra-
blement contribué à étendre et à perfectionner le réseau d'ir-
rigation, ce développement a placé l'économie égyptienne
sous la dépendance du marché mondial du coton et a obligé
ce pays à consacrer une bonne partie de ses ressources à
l'achat des céréales qui lui font défaut.
Favorable aux grands propriétaires fonciers et aux inter-
médiaires commerçants, cette situation constituait un obsta-
cle majeur au renforcement de l'industrie, qui étouffait sous
le poids de la concurrence étrangère et avait besoin de ma-
chines et de matières premières. Le développement de l'in.
dustrie dépendait donc dans une large mesure de la trans-
formation de l'agriculture, c'est-à-dire de la réduction des
surfaces de culture de coton, de l'accroissement des cultures
vivrières et de l'élevage, et n'avait aucune chance de s'accom.
plir sans un profond changement dans l'orientation générale
de l'Etat. Après la hausse due à la guerre de Corée, la chute
vertigineuse des prix du coton provoqua en 1952 la dété.
rioration rapide d'une situation économique déjà très fragile,
C'est dans ce cadre qu'eut lieu le coup d'Etat contre la mo.
narchie en juillet 1952.
Ecoulement des stocks de coton et réforme agraire fu.
rent les deux premières mesures du nouveau régime, qui passa
des accords avec l'Est portant sur le troc coton/produits in-
dustriels (mais bientôt: coton/armes !)
Le Gouvernement prit en même temps toute une série
de mesures destinées à favoriser les investissements privés (2),
chaussure, le ciment, le savon ; mais elle doit toujours importer, même
des cotonnades. Aussi bien l'industrie n'y représentait-elle, en 1951,
que 10 % du revenu national, contre 42 % à l'agriculture. Elle n'em-
ployait que 6 % de la population active (835.000 personnes) contre
53 % à l'agriculture (7.555.000). Elle est encore partiellement artisa-
nale puisqu'un tiers des établissements ne comportent qu'un ouvrier,
le propriétaire, et que 8 % seulement ont plus de 5 ouvriers. Mais
ces derniers emploient les deux tiers de la main-d'oeuvre. Le contraste
est donc brutal entre les grosses firmes à inonopole (sucre, ciment,
verre) ou celles qui sont groupées en cartels (textile, cigarettes, brasse-
ries) et les tout petits ateliers. Les entreprises les plus nombreuses,
celles dont la valeur de production nette était la plus élevée, en 1947,
étaient les industries textiles. (12.400 entreprises et 124.500 employés).
Ensuite venaient les industries alimentaires, l'égrenage du coton, l'indus-
trie chimique, puis l'industrie métallurgique. » BIROT ET DRESCH,
a La Méditerranée et le Moyen-Orient », p. 404.
(2) « On peut citer la suppression des droits de douane sur les
matières premières, la dét cation de 50 % des bénéfices exceptionnels
réinvestis, l'exemption d'impôts pour sept ans et proportionnellement
176
aussi bien ceux de la bourgeoisie égyptienne que des groupes
étrangers, et la concentration des entreprises. Il amorça la
transformation de la production agricole et l'introduction
des machines dans le travail des champs.
D'autre part, une série de projets fut élaborée pour
cccroître le potentiel industriel. Outre la création d'une
aciérie qui devait exploiter le minerai de fer de la région
d'Assouan et fabriquer des produits semi-finis (3), les prin-
cipaux projets portaient sur la construction de nouvelles cen.
trales thermiques et d'une centrale hydroélectrique sur le
barrage actuel d’Assouan, ainsi que sur l'augmentation de
la production d'engrais azotés. Il y avait enfin le fameux plan
du haut barrage d’Assouan qui devait permettre d'accroître
de 30 % la surface cultivable et de 900 % la production
d'électricité. Les péripéties qu'a subi ce dernier projet sont
bien connues.
Or, comme l'a montré justement l'affaire du haut bar-
rage d’Assouan, la question du financement était capitale
pour la réalisation de ces plans. Le Gouvernement essaya
d'abord de la résoudre par la participation du capital étran.
ger. Il obtint l'aide des Etats-Unis pour le financement des
chemins de fer et de l'irrigation (6,5 millions de livres et 10
millions de dollars respectivement), mais sa demande de
100 millions de livres à la Banque Internationale pour le
Développement et la Reconstruction resta en panne tout
comme l'ensemble des négociations concernant le haut bar-
rage. (Le coût de celui-ci est estimé à plus de 400 millions
de livres, c'est-à-dire 400 milliards de francs). D'autre part,
en dépit des affirmations de Nasser, il était généralement
admis, avant les derniers événements, que la nationalisation
du Canal (avec toutes les charges qu'elle entraîne: indemni.
sation aux anciens actionnaires, entretien, modernisation,
etc.), si elle pouvait, à longue échéance, constituer une
source de bénéfices appréciable pour l'Etat, n'aurait, pen-
dant une longue période, aucune valeur pour la réalisation
des projets envisagés. Il est vrai que ces projets, bien qu'es-
sentiels pour le développement de l'économie, n'étaient que
le prolongement spectaculaire d'une évolution vers l'indus.
trialisation que Nasser ne faisait qu'essayer d'accélérer et de
coordonner (4).
aux
nouveaux investissements pour les sociétés dans l'industrie, les
mines, l'hôtellerie, l'énergie et les terres, l'exemption de cinq ans d'in-
pôts et proportionnellement aux augmentations du capital pour les
sociétés qui augmentent leur capital, etc. » - a Economie et Politique »,
n° 26, août septenibre 1956.
(3) C'est la « Société Egyptienne pour le Fer et l'Acier fondée
en 1954, qui créera l'aciérie. 50 % du capital de cette société appar-
tient au Gouvernement, 30 % à la Banque Misr. La société allemande
Demag fournira le reste, 20 %, sous forme de matériel.
(4) « En Egypte, le capital des entreprises industrielles a doublé
entre 1945 et 1950 et la plus grosse part ne vient plus de l'étranger.
Alors que toutes les banques établies dans le pays perdant la deuxième
177
Mais si les efforts de l'Etat ont été indéniables, si l'oppo-
sition entre sa politique et les intérêts de certaines puissances
étrangères est indiscutable, cela ne signifie nullement que
le but du régime ait été d'améliorer le sort des paysans et
des ouvriers ou, pour parler comme Nasser, de « donner le
bonheur au peuple ».
La réforme agraire elle-même, tant vantée par les pro-
gressistes du monde entier, n'a pas été déterminée par
le
souci d'élever le niveau de vie du fellah. La loi promulguée
en septembre 1952 limite la surface des propriétés à 300
feddans (un hectare=deux feddans et demi). Le surplus est
confisqué par l'Etat contre indemnité, sous forme de bons du
Trésor, aux propriétaires dépossédés. La terre est distribuée
ensuite à des petits paysans, qui ont un délai de trente ans
pour acquitter le prix d'achat (majoré de 15 %). Leurs ver-
sements annuels sont, en outre, majorés d'un intérêt d'en-
viron 3 % et ils doivent payer les impôts supportés avant par
le propriétaire exproprié. La réforme ne touche qu'environ
500.000 feddans, soit un dixième à peine de la terre cultivée.
Sur une population paysanne totale d'environ 14 millions
(soit 66 % de la population totale de l'Egypte), elle ne tou-
chera, au plus, que quelques 800.000 individus. (5) Mais,
dans la réalité, les dispositions adoptées, qui ne concernent
pas les sociétés foncières, ont été tournées par des partages
fictifs entre membre d'une même famille de grands proprié-
taires ou des ventes directes des terres à des commerçants
des villes. La distribution aux petits paysans n'a pu se faire
que pour une petite partie. En effet, la plupart d'entre eux,
déjà endettés, ne disposaient pas des sommes nécessaires
pour l'achat de la terre et surtout des engrais et instruments
de travail. Ceux qui ont pu acheter de la terre, l'ont fait au
prix de nouvelles dettes, et seront vraisemblablement forcés
de la revendre à des riches paysans ou à des bourgeois. Le
résultat le plus clair de cette réforme réside donc, d'une part
moitié du xx siècle étaient des succursales de banques étrangères, la
banque Misr, banque d'affaires fondée en 1920, a groupé des capitaux
égyptiens et s'est intéressée à des secteurs de plus en plus variés de
l'économie, égrenage, filature et tissage du coton, tissage de lin et de
soie, industries de la rayonne, de produits pharmaceutiques, du tabac,
huileries, exploitation des mines et carrières, pêcheries, transports flu-
viaux, maritimes et aériens, imprimerie, théâtre et cinéma. Après la
guerre, en 1947, une loi a imposé aux sociétés anonymes une partici-
pation majoritaire de capital égyptien et une banque industrielle a
été fondée. Mais des mesures, à partir de 1952, ont été prises pour favo-
riser les investissements étrangers. Un accord d'assistance technique a
été signé avec les Etats-Unis (Point Quatre); de nouvelles entreprises
ont été créées par des capitaux anglais et surtout américains, ou avec
l'aide financière ou technique de sociétés américaines (usine de montage
automobile Ford, Coca-Cola, soie artificielle, engrais). A vrai dire, les
investissements nationaux ou étrangers sont lents. » BIROT ET DRESCII,
ouvrage cité, p. 398.
(5) En 1949, 38 % des terres cultivées appartenaient à 21.600 pro-
priétaires, 25 % à 134.500 propriétaires, 37 % à 2.547.000 propriétaires ;
des millions de paysans ne possédaient pas de terre.
178
dans l'appropriation par l'Etat d'une partie des terres, qu'il
exploite directement par le truchement du Comité pour la
Réforme Agraire, d'autre part dans la ponction opérée sur
la fortune des grands propriétaires pour les obliger à investir
dans l'industrie.
Pour les ouvriers égyptiens, la politique de Nasser ne
signifie pas non plus le « bien-être ». Politique de dévelop-
pement du secteur industriel, favorisant, comme nous l'avons
vu, l'investissement sous toutes ses formes, elle ne peut en
aucun cas admettre des augmentations de salaire qui, suivant
l'expression chère aux bourgeois, « grèveraient lourdement
le coût de production dans les usines ». Aussi bien les salaires
sont pratiquement bloqués et les grèves officiellement inter-
dites. La pendaison de deux ouvriers coupables d'avoir parti-
cipé à une grève illustre parfaitement les méthodes de
Nasser dans ce domaine. Les syndicats sont contrôlés par le
seul parti autorisé, l' « Union Nationale », et si des principes
« sociaux » ont été inscrits dans la Constitution (droit au tra-
vail, assurances sociales), toute liberté de mouvement est
interdite non seulement aux ouvriers, mais aux partis et orga-
nisations dits de gauche, qui ont été déclarés illégaux. Les
militants ouvriers et les intellectuels opposants connaissent
la prison, les camps de concentration et la torture. Le récent
procès contre le parti communiste égyptien prouve, en outre,
que le progressiste Nasser, tout en acceptant l'aide russe, ne
veut pas d'une collaboration que les staliniens lui offrent
tous les jours, mais qui risquerait d'introduire un élément
étranger dans l'édifice totalitaire qu'il essaie de construire.
Le régime a cherché pourtant à conserver la sympathie
populaire dont il bénéficiait dans la mesure où il se trou-
vait en opposition avec certaines catégories de privilégiés et
avec certains impérialismes étrangers. Nul doute que Nasser
n'ait songé à assurer aux ouvriers, en contre-partie d'un sa-
laire misérable, des « avantages sociaux » tels que la stabi.
lité de l'emploi ou les assurances sociales et que son emblème
« Union, discipline, travail » ne recouvre une orientation fort
semblable à celle que suivait Péron en Argentine. Mais, dans
la pratique, sa politique vis-à-vis des masses a consisté essen-
tiellement à canaliser leur mécontentement contre les an-
ciennes minorités privilégiées et surtout contre l'étranger.
Nasser a
recouru pour cela aux armes traditionnelles du
nationalisme et de la religion. Il a évoqué la perspective
démagogique d'un empire arabe allant de l'Océan Indien à
l'Atlantique. Il a exalté l'armée et le militarisme. Il a fait
prêcher la guerre sainte par les chefs religieux et, méthode
de lutte inattendue contre l'impérialisme, il a introduit l'en-
seignement obligatoire du Coran dans les écoles étrangères
d'Egypte. La petite bourgeoisie des villes, une partie de la
jeunesse, le suivaient enthousiasmées. Des dizaines de milliers
de personnes assistaient aux défilés et applaudissaient aux
discours. Mais quel était le sentiment profond des ouvriers
179
férocement exploités dans les usines, des fellahs courbés dans
les champs? Quelle sera maintenant leur réaction devant
l'inévitable aggravation de la situation économique, dont les
conséquences, comme toujours, retomberont sur le dos des
exploités?
A l'heure actuelle, il ne s'agit plus pour l'Egypte d'accé-
der à l'indépendance politique. Dans les limites imposées
aujourd'hui à toutes les nations par la suprématie des Deux
Grands, cette indépendance est acquise et n'est ni plus ni
moins réelle que, par exemple, celle de la Grèce ou de la
Turquie. Il s'agit, en réalité, de se développer dans un sens
capitaliste.
Le régime est pourtant progressiste, disent nos gens
de gauche, et les staliniens de préconiser, pour l'Egypte,
a l'union étroite de toutes les couches sociales attachées à la
sauvegarde de l'indépendance politique et à la construction
des bases de l'indépendance économique » (6). Oui, le régime
est progressiste. Il progresse dans la voie du capitalisme et,
vraisemblablement, dans celle d'un capitalisme fortement
étatisé. Mais la transformation, combien lente et hésitante,
des vieilles structures ne se fait qu'au bénéfice de la bour-
geoisie et des nouveaux privilégiés de l'Etat. Mais ni l'indus-
trialisation (très modeste), ni la réforme agraire (très insuf.
fisante), ni l'éviction de l'étranger (très relative) ne doivent
entraîner automatiquement une élévation du niveau de vie
des exploités des usines et des champs.
Quant à la classe ouvrière égyptienne, elle ne peut en
aucun cas, c'est l'évidence même, défendre un système « féo.
dal ». périmé ni s'opposer à l'extension d'une industrialisa-
tion qui, en accroissant sa propre force, lui permettra de
peser sur la marche des événements, de mieux (léfendre ses
intérêts et d'arriver ainsi à revendiquer ses buts finaux. Mais
ce n'est pas elle qui a la tâche
ni les moyens
d'opérer
cette industrialisation, c'est-à-dire de créer du capitalisme.
Et ce n'est pas une attitude de collaboration des ouvriers qui
poussera la bourgeoisie égyptienne à approfondir la transfoz.
mation du pays. Tout au contraire. C'est la lutte des ouvriers
et des paysans pauvres pour
leurs
propres intérêts salaires,
conditions de vie, distribution gratuite des terres et des ins.
truments de travail -c'est leur organisation autonome, qui
pousseront la bourgeoisie et l'Etat à chercher dans l'indus.
trialisation une solution (même si elle n'est que provisoire)
aux problèmes posés par les exploités.
Lieu de rencontre de l'usine moderne et de l'atelier du
Moyen-Age, de la culture industrielle et de la propriété
(6) « Economie et Politique », revue mensuelle stalinienne, n° 26,
août-septembre 1956.
180
féodale, l'Egypte est également un champ de bataille où
s'affrontent les intérêts des grandes puissances et un carre-
four stratégique de premier ordre. C'est pourquoi la crise
de Suez et l'expédition militaire franco-britannique sont à la
fois un épisode de la lutte qu'une partie de la bourgeoisie,
de l'armée et des cadres égyptiens mènent pour faire de ce
pays un Etat capitaliste moderne et un moment de la lutte
entre les Occidentaux et le Bloc russe, en même temps qu'une
illustration des rivalités internes du camp occidental.
En provoquant l'intervention de l'Amérique et de
I'U.R.S.S. par l'entremise de l'O.N.U., l'aventure militaire de
Paris et de Londres a eu comme principal effet de reposer au
niveau le plus élevé le double problème des rapports entre
pays avancés et pays arriérés et des rapports entre l'Est et
l'Ouest. Il ne fait aucun doute que ces deux questions consti-
tueront dans l'avenir immédiat les principaux thèmes de la
diplomatie et des rencontres des Chefs d'Etat.
Mais ce que personne ne songera à inscrire dans les
ordres du jour des marchandages entre les Grands de ce
monde c'est le sort
du fellah du Nil, de l'ouvrier
d'Alexandrie.
C'est pourquoi le point de vue des travailleurs ne peut
être en aucun cas celui des Gouvernements, à quelque camp
qu'ils appartiennent. C'est pourquoi il ne peut pas être non
plus celui des partis politiques directement ou indirectement
liés à ces Gouvernements. Car si la croisade anti-Nasser pre-
chée en France par la droite, les socialistes et une partie de
la « gauche libérale » exprimait la rage d'un impérialisme
battu, les applaudissements des staliniens au progressisme du
Caire ne visaient qu'à renforcer l'alliance provisoire de
l'U.R.S.S. et de la bourgeoisie égyptienne et leur opposition,
toute verbale, à la guerre était avant tout déterminée par la
position prise par Moscou.
Or, pour les travailleurs, le problème n'est pas de choisir
entre les anciens impérialismes et les nouveaux régimes dits
« progressistes », mais de mener la lutte pour leurs propres
intérêts. Pour les travailleurs français, il s'agit de refuser
foute espèce de guerre ou d'expédition militaire, pour les
travailleurs égyptiens d'organiser leur résistance à l'oppres-
sion « nassériste ».
R. MAILLE.
181
LE MONDE EN QUESTION
SUEZ
au
Ainsi, il aura suffi de quelques jours pour que la détente, et cette
atmosphère de paix à laquelle chacun s'était doucement habitué et qui
semblait remettre en question les perspectives les mieux établies, ne
soient plus qu'un souvenir. Fait étonnant, il semble que la bêtise de
quelques dirigeants irresponsables ait déclenché un processus sur lequel
l'analyse objective a peu de prises et dont l'issue est encore indécise.
Alors que le monde demeurait stupéfait devant la victoire des insurgés
hongrois, une poignée de ministres français, qu'appuyait un gouver-
nement britannique réticent, ont cru possible de remettre en question
à leur profit le statu-quo établi au Moyen-Orient.
Plus de trois mois furent nécessaires aux Conservateurs britanni-
ques et aux Socialistes français pour préparer la « promenade militaire »
en Egypte, et pour mettre au point le subtil engrenage des prétextes,
dont on se demande comment ces hommes ont pu croire un instant
qu'ils leur permettraient de camoufler les buts réels de l'expédition.
Mais ces prétextes ridicules et odieux, et la rapidité de la « réaction »
franco-britannique à l'attaque israélienne, s'ils n'en révélèrent que mieux
la préméditation, ont pu masquer durant quelques heures ce qui appa-
rut bientôt en plein lumière : la pusillanimité des conspirateurs, l'ab-
sence de toute entente profonde entre les protagonistes de l'affaire, les.
quels ne s'accordaient en fait que sur une fausse estimation de la
conjoncture international. L'U.R.S.S. était occupée en d'autres lieux et
certains indices donnaient à penser qu'elle n'interviendrait pas
Moyen-Orient, où elle semblait se soucier avant tout de maintenir
l'équilibre en ne favorisant pas exclusivement Nasser : le délégué sovié-
tique à l'O.N.U. ne venait-il pas d'appuyer la résolution demandant
que soit assuré le libre passage des navires israéliens à travers le canal ?
Quant aux Etats-Unis, on les savait paralysés par les élections présiden-
tielles, et l'on spéculait sur le désir des deux grands partis américains
de ne pas s'aliéner les voix de l'importante communauté juive. Le
moment était bien choisi pour agir et pour régler, d'un seul coup, tous
les problèmes, en récupérant le canal de Suez et en écartant Nasser.
Mais, derrière les visées immédiates, les dirigeants de Londres et de
Paris poursuivaient des rêves assez différents : les uns songeaient, de
longue date à modifier au profit de l'Irak le rapport de forces entre
pays arabes et à retirer à Nasser le leadership au Moyen-Orient pour
le confier à la dynastie hachémite, toute acquise au gouvernement de
Sa Majesté ; du même coup, ils prétendaient neutraliser la Jordanie,
où de récentes élections venaient de révéler les progrès considérables
de l'influence égyptienne. Quant à M. Mollet et à ses amis, ils confes.
saient modestement qu'ils attendaient de ce « retour à la virilité » un
renouveau du prestige de la France auprès des pays arabes, lesquels
comme chacun sait sont avant tout sensibles à la force et au
succès des armes, et par là-même la solution de tous les problèmes
en suspens en Afrique du Nord.
Sans doute est-il inutile d'insister sur l'étonnante attitude de chefs
de gouvernements « démocratiques », plaçant leurs parlements devant
le fait accompli. Eden se savait assuré de sa majorité. Quant à Guy
Mollet, il peut aujourd'hui tout se permettre, fût-ce de déclencher la
troisième guerre mondiale : le silence de l'Assemblée, paralysée par
la question algérienne, la
totale des partis « de gauche »
l'assurent d'une impunité dont il profite de la plus indécente façon.
La surprise fut extrême, mais on aperçut bien vite les limites d'une
carence
182
si belle audace : alors que les stratèges affirmaient que le coup pou-
vait réussir si ses auteurs faisaient preuve d'une détermination sans
défaillances et surtout s'ils procédaient rapidement, on vit le gouverne-
ment britannique hésiter dès les premières remontrances de l'O.N.U.
et, deux jours après l'ultimatum adressé à Nasser, envisager une modi-
fication des plans militaires. Et si l'on assignait pour cause à la lenteur
des opérations, les difficultés techniques considérables présentées par
celles-ci, nul ne faisait mystère des divergences entre a techniciens »
anglais et français.
En fait, les ministres français, qui n'avaient osé s'engager dans
une telle entreprise que forts de l'approbation et du concours des Bri-
tanniques, furent dès les premières heures lachés par leurs collègues
d'Outre-Manche. Le gouvernement anglais prit conscience bien plus
rapidement que
le gouvernement français des conséquences de l'inter-
vention en Egypte : en butte aux attaques d'une opposition libre de
ses mouvements, menacé de voir le Commonwealth se décomposer en
quelques jours, abandonné par quelques-uns de ses plus fidèles amis,
Eden comprit immédiatement l'étendue de la gaffe qu'il avait commise
et ne songea plus, dès lors qu'à se retirer de l'affaire le plus rapide-
ment possible. Il fut parmi les premiers à appuyer la proposition
canadienne de constitution d'une force internationale, et le premier à
exiger, après l'ultimatum russe, l'arrêt immédiat des opérations. Ce qui
ne l'empêche pas d'être à présent complètement discrédité.
Guy Mollet, quant à lui, est toujours bien en place. Ne disions-
nous pas que tout lui est permis, fût-ce de prétendre que l'expédition
d'Egypte ne s'est pas soldée par un échec total ? Il n'est pas besoin
de réfléchir beaucoup pour apprécier l'ampleur du désastre qui s'abat
aujourd'hui sur la France et sur la Grande-Bretagne, et pour mesurer
la dérobade extraordinaire de ces hommes qui partaient en guerre le
sourire aux lèvres. Il suffit de se référer au discours de Mollet, en
date du 30 octobre : ne s'agissait-il pas d'abord d'assurer le fonction-
nement régulier du canal, en occupant Port-Saïd, Ismaïlia et Suez ?
Aujourd'hui, le canal est bouché pour six mois au moins, et les franco-
britanniques vont évacuer la seule ville qu'ils aient osé occuper, sans
avoir reçu aucune assurance concernant le règlement d'ensemble de la
question de Suez.
Sans doute, sait-on à présent ce qu'il faut penser de force de
Nasser, qu'on nous peignait comme un nouvel Hitler. Mais qui a
sérieusement à la triste farce que nous ont jouée des hommes qui vou-
laient, à peu de frais, se poser en héros, en prétendant faire face à
une situation semble à celle que l'Europe connut lors de Munich ?
Cette comédie, ils n'ont même pas pu la jouer jusqu'au bout, et Nasser
est toujours en place, fort de l'appui conjugué de l'U.R.S.S. et des
U.S.A. : l’O.N.U. va lui réparer son canal, et voici qu'on reparle du
barrage d’Assouan. Jamais peut-être son prestige n'a été plus grand
dans les pays arabes. L'Angleterre peut se prétendre satisfaite des diri-
geants des pays arabes, mais derrière les hésitations de ceux-ci, les
masses semblent de plus en plus influencées par la politique soviétique.
Compte-t-on, pour les amener à composition, sur la paralysie de « l'éco-
nomie » des pays arabes du fait du tarissement des « royalties » versées
aux féodaux par les compagnies pétrolières ? Qui ne voit que, par
là-même, est mise en question la domination d'hommes vendus aux
impérialistes, et que les gouvernements occidentaux devront au contraire
consentir des sacrifices considérables pour les maintenir au pouvoir ?
On touche ici au plus grave de l'affaire, c'est-à-dire à ses conséquences
économiques. Le canal obstrué pour de longs mois, les pipes-lines de
l'Irak Petroleum Cº en feu, l'Europe va connaître une disette de pétrole
sans précédent, disette dont les effets, qui vont se combiner avec les
facteurs d'inflation et pénurie dont elle souffre sur le plan énergé-
tique, ne peuvent encore être mesurés. L'Europe guettée par la faillite
économique, la France et la Grande-Bretagne ridiculisées et à peu près
totalement isolées, l'O.N.U. bafouée par ses créateurs, oui Guy Mollet
a raison : il faudra du recul pour juger des résultats...
cru
183
Mais l'affaire de Suez et la débâcle des franco-britanniques ne sont
qu'un aspect mineur d'une crise plus vaste qui oblige à revoir les
perspectives qu'on avait pu fonder sur l'analyse des événements des
trois dernières années. Si l'affaire de Suez comme celle de Hongrie
ont mis au premier plan les contradictions dont souffre chacun des
deux blocs, et ont révélé leur tendance à la désintégration, elles ont
aussi permis de constater les limites de l'indépendance qui peut être
accordée aux pays secondaires. Si les chars soviétiques ont détruit le
mythe des voies autonomes vers le socialisme, l'Amérique tient aujour.
d'hui à sa merci les gouvernements occidentaux qui se flattaient de
leur « connaissance des pays arabes » et de leurs traditions. diploma-
tiques. Devant le fiasco complet des entreprises de leurs alliés, les
dirigeants américains ne font pas mystère de leur volonté d'user de
l'aide économique comme d'un moyen de chantage propre à persuader
les dirigeants français et anglais de marcher droit.
Voici donc à nouveau l'Amérique et l'Union Soviétique face à face.
Et le vent qui souffla sur le monde pendant plus de quinze jours,
n'est pas encore retombé : de toutes parts, on s'emploie à entretenir
l'inquiétude, à affoler « l'opinion ». Pour ce qui est des dirigeants fran.
çais, leur intérêt est clair : il s'agit pour eux d'abord de camoufler
leur mauvais coup, ensuite d'en masquer l'échec ; certes, nous n'avons
pas atteint nos objectifs, mais nous avons révélé au monde les prépa-
ratifs soviétiques au Moyen-Orient. Et chacun de trembler à la lecture
de informations concernant l'armemert recueilli dans la presqu'île du
Siraï. Les Américains, dont on sait cependant à quel point ils s'inquiè-
tent de toute ingérence russe au Moyen-Orient, ne paraissent pas parti.
culièrement effrayés. Le critique militaire du « Times » rappelle-t-il
qu'il avait, un mois plus tôt, donné tous les renseignements utiles sur
les fournitures soviétiques à l’Egypte, et découvre-t-on que les Mig 17
de M. Pineau sont en réalité des Vampires anglais, nul n'y prend garde
et chacun veut apercevoir dans les difficultés économiques que connaît
aujourd'hui l'Europe, non une conséquence directe de l'imbécilité de
ceux qui dirigent la France et l'Angleterre mais le signe de la gravité
de la situation internationale. Dans ce concert, Mendès France parvient
encore à faire entendre sa voix. Hué dès qu'il paraît en public, accusé
de défaitisme, abandonné de ceux qui l'appuyaient voici quelques jours
encore, il ne lui reste plus d'autre moyen d'attirer l'attention que de
recourir aux assertions les plus dramatiques et les plus spectaculaires.
Mais la campagne d'affollement menée par nos dirigeants a un autre
sens : de même qu'on veut nous faire croire que l'U.R.S.S. est décidée
à aller jusqu'au bout, on feint d'avoir songé à intervenir en Hongrie ;
ici, la mesure est à son comble, et M. Pineau n'est plus seulement
ridicule. Comment ne pas voir que les larmes que verse sur le sort
des hongrois la bourgeoisie française cachent en réalité son soulage-
ment devant l'écrasement de la révolution hongroise ? Ouel régime
bourgeois eut pû soutenir en effet une révolution qui a poussé aussi loin
que la révolution hongroise la mise en question des régimes d'exploi.
tion ? Ce n'est certes pas un hasard si les Occidentaux n'ont parlé
d'intervenir en Hongrie que lorsqu'ils ont cru, un peu trop tôt, que
cette révolution était totalement écrasée. Deux jours plus tard, la résis
tance continuant, plus personne ne parlait d'autre chose que de quêtes
en faveur de la Croix-Rouge et d'aide aux réfugiés. Si demain l’U.R.S.S.
intervenait en Pologne, ce qui est à présent bien improbable, il ne
fait aucun doute que les Occidentaux clameraient leur indignation ;
mais soyons assurés qu'ils en resteraient là.
A cette propagande, les bureaucrates staliniens font largement écho.
Il leur faut, en effet, détourner au plus vite l'attention du drame hon-
grois ; notons que les dirigeants français et anglais leur ont, à cet égard,
singulièrement facilité la tâche : le 5 novembre, au lendemain des
sanglants événements de Budapest, les grands titres des journaux fran-
çais étaient consacrés à l'affaire égyptienne. Quant à la presse stali-
184
nienne, elle n'a cessé de multiplier les déclarations alarmistes, témoi.
gnant ainsi à la fois du souci des dirigeants soviétiques d'effacer la
fâcheuse impression produite par la répression de la révolution hon-
groise, et de leur détermination de profiter jusqu'au bout des invrai-
semblables gaffes de MM. Mollet et Cie. Ainsi chacun s'efforce-t-il
d'affoler l'autre et ses propres partisans afin d'accroître une confusion
qui profite à tous. A présent, la situation est claire, affirme Mollet :
il n'y a que deux camps, l'Est et l'Ouest. Et les Staliniens : le choix
est, aujourd'hui, entre le fascisme et le socialisme. Ainsi s'unissent-ils
pour dissimuler leurs fautes et leurs crimes, et masquer leurs respon-
sabilités, et pour entraver toute réaction de classe au sein d'un prolé
tariat qu'ils s'emploient à désorienter en brandissant la menace d'un
conflit atomique. Et ceux-là mêmes qui prétendent renvoyer dos à dos
Soviétiques et Occidentaux en mettant sur le même plan l'affaire hon.
groise et l'expédition d'Egypte, participent, à leur manière, à cette
mystification. Car la portée et la signification des deux événements n'est
absolument pas comparables. En Hongrie, la révolution la plus radicale
des trente dernières années, que la bureaucratie « communiste » écrase
dans le sang. En Egypte, une entreprise impérialiste comme il y en a
eu des dizaines, un des derniers soubresauts de deux impérialismes
en déconfiture, gouvernés par des cervelles à leur image.
*
Si les Russes ont agi, dans toute cette affaire, avec le souci de
profiter des contradictions du bloc occidental et du crétinisme des
hommes d'Etat français et anglais, s'ils se sont efforcés de « déborder »
les chefs arabes Nasser lui-même était prêt à s'en remettre à l’O.N.U.
et d'affoler leurs adversaires en leur adressant, par le canal des
agences de presse, des ultimatums qui ne prenaient un sens cohérent
que lorsqu'on les réunissait pour les considérer comme un tout, et dans
lesquels les menaces elles-mêmes étaient ambiguës, n'allons pas croire
pour autant que toutes les initiatives du Kremlin ve relevaient que du
bluff. Objectivement, les lettres adressées aux Occidentaux ne contenaient
rien de plus que la menace d'une nouvelle guerre de Corée, guerre que
les Russes étaient, certainement, résolus à mener, le cas échéant.
La crise qui mûrit au Moyen-Orient, depuis plusieurs années, portée
à son paroxysme par l'agression franco-britannique, permet aux Russes,
à peu de frais, de pénétrer pour la première dans cette région, jus-
qu'alors chasse gardée des Occidentaux. En outre, l'action des franco-
britanniques coïncidant avec la brutale mise en question de la domi-
nation soviétique sur les démocraties populaires, rendait plus nette
encore aux yeux des dirigeants soviétiques l'alternative devant laquelle
ils se trouvaient placés. Et ce n'est pas une des moindres gaffes de
MM. Mollet et Eden que d'avoir, par leur geste plein de « virilité »,
saboté en quelques heures toutes les chances qui s'offraient aux impé-
rialistes occidentaux d'exploiter, face aux pays du groupe arabo-asiatique,
la crise qu'affrontait la Russie en Hongrie et en Pologne. Si l'on ne
peut faire que des hypothèses sur le point de savoir si l'ultimatum
adressé à Nasser a renforcé à Moscou la position des « durs », on est
de même réduit aux conjectures en ce qui concerne l'orientation future
de la politique russe. Bien que les problèmes qui ont rendu nécessaire
la déstalinisation et la politique de « détente » soient fondamentale-
ment les mêmes, et bien que les dirigeants soviétiques n'aient aucune
raison objective d'accepter aujourd'hui, le risque d'un conflit généra-
lisé qu'ils refusent depuis plusieurs années, la difficile situation de
l'appareil bureaucratique du Kremlin, agissant sous la pression impé-
rieuse d'événements dont certains le mettent directement en cause, est
susceptible de le pousser à des décisions aussi irraisonnées que celles
que peuvent prendre un Mollet ou un Eden. Sans doute les membres
de l'équipe dirigeante du Kremlin sont-ils conscients de ce fait, et
leur dernière note, qui contient des propositions nouvelles sur le désar-
185
mement, témoigne indéniablement du désir de ménager une pause qui
permette à tous de reprendre pied. Ce qui ne préjuge en rien de
l'avenir : assisterons-nous à la reprise de la guerre froide, laquelle
présenterait pour les Russes des avantages certains, et leur permettrait
de consolider leurs positions, ou verrons-nous, au contraire, se pour-
suivre la politique inaugurée au lendemain du XX° Congrès, politique
dont chacun connaît aujourd'hui le sens et les limites ? Pour l'instant,
la réponse dépend surtout de l'évolution des luttes du prolétariat à
l'intérieur du bloc russe.
Quoiqu'il en soit, les dirigeants soviétiques pouvaient d'autant mieux
se permettre de recourir aux menaces, et peut-être même de passer
à une action limitée, qu'ils étaient assurés de la relative passivité des
Etats-Unis. Les élections présidentielles n'étaient pas seules paralyser
le gouvernement américain, et le délégué des Etats-Unis au Conseil
de Sécurité a fort bien dit, après le véto contre la résolution américaine
demandant l'arrêt immédiat des hostilités en Egypte, qu'il s'agissait
d'abord pour l'Amérique de ménager « l'opinion » des pays arabo-
asiatiques. Jamais la diplomatie américaine n'a fait montre d'un tel
« tact », ni les dirigeants américains exprimé si clairement le désir,
où ils sont à l'heure actuelle, d'éviter à tout prix un conflit généralisé.
Si la question d'Egypte peut conduire à une reprise de la guerre froide,
les Etats-Unis ne se refuseraient pas, quant à eux, à un vaste règlement
d'ensemble, don Eisenhower lui-même a envisagé la possibilité et qui
ne pourrait que consacrer l'élimination définitive de la France et de
la Grande-Bretagne du rang des grandes puissances. De toute manière,
l'affaire ne sera pas facile à régler, et risque d'être fertile en rebon.
dissements. Mais Nasser lui-même semble aujourd'hui décidé à ne pas
pousser trop loin son avantage tandis que les Français et les Anglais
sont prêts à toutes les capitulations qu'exigeront d'eux les Etats-Unis,
soucieux avant tout de désamorcer la poudrière où MM. Mollet et Eden
se sont précipités la tête la première en fermant les yeux.
L'échec de l'entreprise franco-britannique était inévitable. Cet échec,
ce désastre, témoigne des limites de tout recours à la force dans la
conjoncture actuelle. Tant que les deux « Grands » seront résolus à
éviter une guerre générale, ils ne pourront eux-mêmes user de la force
que sur une échelle restreinte, si brutale que puisse être leur interven.
tion. Quant aux Etats d'importance secondaire, il ne leur appartient
pas de décider de la guerre ou de la paix, pas plus qu'il ne dépendait
de M. Mollet que son nom fût ou non attaché à la troisième guerre
mondiale. Français et Anglais ont prétendu user rapidement de la force
pour limiter le conflit. Ils ne sont parvenus qu'à élargir celui-ci et à
se voir contraints d'en abandonner la solution aux Etats-Unis et à
l'U.R.S.S.
M. Blin.
ALGERIE : DES HOMMES DE CONFIANCE
Un ministre résident qui clame, aujourd'hui encore, son optimisme
alors que la situation en Algérie se détériore chaque jour davantage; qui
quittait Paris, « encouragé par la confiance qu'on venait à nouveau de
lui témoigner », alors qu'en fait, de toutes parts, on travaillait à sa
chute ; un Président du Conseil qui s'affolait en apprenant, en plein
banquet, la nouvelle de l'arrestation des chefs du F. L. N., mais se
rassurait, le lendemain, à la lecture du « Figaro », et bombait le torse
à la tribune ; le Secrétaire d'Etat aux Affaires marocaines et tuni.
siennes démissionnaire ; une « équipe » dont les membres multipliaient
les déclarations contradictoires et intriguaient dans les coulisses : c'est
à ces hommes, qui devaient quelques jours plus tard, se lancer dans
l'aventure égyptienne, qu'une large majorité accorda en octobre sa
confiance, renouvelant ainsi le contrat par lequel elle se lie à eux.
186
a,
Jamais confiance ne fut plus méritée, disait-on à droite, où l'on se
félicitait de la démission de Savary, départ que Guy Mollet s'efforça
par tous les moyens d'empêcher. Nombreux étaient ceux qui envisa-
geaient sans effroi un conflit généralisé en Afrique du Nord, et qui
voyaient en Mollet le pantin prêt à s'y précipiter les yeux fermés.
Quant aux autres, qu'une telle perspective inquiétait et qui osaient
quelques timides remarques, ils n'en votèrent pas moins la confiance
en demandant au Président du Conseil, qui mettait au point l'agression
franco-britannique, de sauver la paix.
Au lendemain du vote, l’Express s'étonnait : « Au cours du débat
fleuve qui vient de s'achever au Parlement, les vrais problèmes ont été
constamment éludés, la définition d'une politique a été remplacée par
de nouvelles et imprudentes_ rotomontades ».
Mais qu'a fait Mendès-France, patron de l'Express ? « Sauvez la
paix ! Sauvez l’Afrique française en danger, la patrie en danger ! »
a-t-il clamé sur un ton mélodramatique, tout en accordant sa confiance
à ceux qui se disaient prêts à faire la guerre à « l'Islam » tout entier.
Qu'a fait l'opposition socialiste, sinon refuser d'exposer en public les
divergences qui divisent le P.S. ? La bourgeoisie « intelligente »
depuis longtemps, renoncé à affronter les injures de la droite. Mais
voici à présent davantage; elle n'a plus rien à proposer, et même la
tâche dérisoire que ses chefs lui assignaient, il y a quelques mois à
peine, lui paraît démesurée. Peut-être quelques-uns ont-ils compris qu'il
n'y a plus, aujourd'hui, aucune « politique » possible en Afrique du
Nord. Leur silence n'a rien d'étonnant, ni la démission du Parlement,
et la révision de la Constitution qui doit, paraît-il, assurer la stabilité
de l'exécutif est de nouveau à l'ordre du jour. Jamais cependant gou-
vernement ne fut assuré d'un plus large, d'un plus aveugle soutien :
qui aurait osé, en effet, le renverser ? Qui aurait voulu le remplacer ?
Sans compter que Mollet, Lacoste, Pineau, etc., avaient bien des
qualités. Rarement vit-on gouvernants plus soucieux de se donner les
apparences de l'action
comme ces malades, incapables des gestes les
plus simples et qui s'efforcent, par une gesticulation sans objet, de dissi-
muler leur déficience. Rarement vit-on gouvernants mieux disposés à
recourir aux maneuvres, aux astuces qui enchantent la droite et contrai.
gnent les autres au silence. Ainsi de l'arrestation des chefs du F.L.N.,
dont la plupart et le Monde tout le premier attendaient qu'elle
paralysât la rebellion. Le premier jour, on s'inquiéta quelque peu : un
« si beau coup » n'avait de sens que s'il s'insérait dans une perspec-
tive audacieuse. C'était tout juste si on ne parlait pas d'engager des
négociations avec les chefs rebelles incarcérés ; Mollet lui-même osa
prétendre que l'opération, à laquelle il voulut d'abord s'opposer, faisait
suite « à toute une action gouvernementale ». Mais le ton changea vite
et le coup des services de Lacoste fut ramené à ses vraies proportions :
celles d'une louche opération policière, favorisée par le hasard, comme
le fut la capture d'un navire « pirate » au large des côtes d'Algérie. La
presse bourgeoise se gargarisait des renseignements recueillis : à présent
on savait tout; tout sur la rebellion, tout sur le rôle de l'Egypte, sur
celui du Maroc, de la Tunisie, sur celui de Ben Bella, etc.; et les
« Actualités » ne nous laissèrent rien ignorer de l'arsenal découvert sur
l'« Athos ». Dur coup pour la rebellion, et dont on se demandait com.
ment celle-ci pourrait se relever...
Et pourtant, depuis l'été, la conjoncture parlementaire avait consi-
dérablement évolué : bien des Indépendants et le M.R.P. presque au
complet en étaient à réclamer une solution politique. Les Libéraux
d'Algérie élevaient la voix, et le Maire d'Alger n'hésitait pas à exiger
l'ouverture immédiate de négociations avec les véritables interlocuteurs,
c'est-à-dire, précisait-il, ceux avec lesquels on n'est pas d'accord et avec
qui on se bat. Les milieux d'affaires eux-mêmes et les bonnes âmes
du M.R.P. s'en lamentaient semblaient s'intéresser de inoins en moins
à une affaire si peu rentable à long terme, et dont les répercussions
étaient déjà sensibles dans tous les domaines. Talonné de tous côtés,
Lacoste était intarissable : la situation était chaque jour plus encou-
rageante, les rebelles plus désespérés. S'efforçait-il en brandissant ses
187
communiqués de victoire de « regonfler » la droite qui jusqu'ici avait
soutenu sa politique de guerre, de rassurer « l'opinion » en libérant, à
grand tapage, les rappelés ? Mais nul ne croyait plus à ses vantardises,
ni même au fameux « préalable égyptien », et la chute semblait proche.
La bourgeoisie française était-elle donc prête à agir réellement ? Il a
suffi de l'astuce de quelques policiers pour lui épargner cette peine,
si évidemment démesurée. Alors elle respira, et avec Guy Mollet, prit
des airs avantageux.
Ces hommes qui semblaient lassés d'une guerre sans issue, on les
vit soutenir un gouvernement qui provoquait le Maroc, insultait la
Tunisie, faisait massacrer ses ressortissants à travers toute l'Afrique du
Nord et envoyait la flotte française croiser en Méditerranée. Sans doute
s'agissait-il seulement pour eux de gagner du temps, de reculer encore
un peu l'échéance. Aujourd'hui, après la glorieuse campagne d'Egypte
et les retentissantes gifles qu'a reçues Mollet, son équipe est toujours
en place : Nasser aussi, mais celui-là il semble qu'on s'efforce à présent
de le faire oublier. Que faire d'autre après lui avoir donné l'occasion
de se repeindre à neuf des pieds à la tête ?
Un professeur arrêté, quelques journaux interdits, Lacoste acclamé
à Alger le 11 novembre, rien n'est changé et déjà le refrain reprend :
la situation s'améliore, le découragement gagne dans les rangs des
rebelles, une solution est vue. Mais nul ne s'y laisse prendre, et
le gouvernement lui-même reconnaît qu'aucune « solution » n'est actuel.
lement applicable. N'avait-on pas cependant proclamé jusqu'à satiété
qu'une solution devait être trouvée avant que l'Assemblée Générale de
10.N.U. n'ait à connaître de la question algérienne ? Le gouvernement
donne la nausée. Et comme tout le Parlement a été son complice, la
guerre risque de durer.
Ne sera-ce pas les Etats-Unis oui, profitant de ce qu'ils tiennent
inaintenant la France à leur merci, imposeront une solution du type
marocain ou tunisien dans laquelle ils n'oublieront pas leurs intérêts ?
en
M. Blin,
LA BOURGEOISIE NORD-AFRICAINE
cen-
L'article qui suit a été écrit avant les derniers événements qui
viennent de bouleverser les relations à peine établies entre la Tunisie,
le Maroc et la France. Il éclaire la situation dans laquelle s'est produite
l'arrestation des chefs du FLN. En un sens la nouvelle vague de nationu-
lisme peut permettre de faire passer au second plan les problèmes so-
ciaux qu'affrontaient les gouvernements marocains et tunisiens. Mais
en un autre sens, et nul doute que cet aspect de la situation ne l'em-
porte sur le premier, l'édifice politique fragile dressé par Bourguiba et
le sultan se trouve considérablement ébranlé. Leur orientation «
triste », comme dit Laborde, est remise en question sous la pression de
l'incroyable offensive lancée par le gouvernement français.
L'heure de la vérité sonne au Maroc: la bourgeoisie marocaine
n'accuse-t-elle pas publiquement « son prolétariat d'être cause du ma-
rasme où elle se débat? « Rappelez-vous, chers compatriotes, qu'il nous
avait fallu tout notre courage et toute notre foi en notre avenir, ainsi
que tout notre amour pour notre souverain vénéré, pour accepter de
gaîté de ceur des grèves de plusieurs mois qui ont eu sur le commerce
et l'industrie des répercussions profondes ». Et le président Bekkai,
auteur de ces pieuses paroles, ajoutait avec un désespoir réaliste: « Des
milliards de traites impayées ont encombré les guichets des banques,
des dizaines de milliards ont fui notre pays ». Avec une spontanéité à
laquell rendra hommage, la jeune bourgeoisie marocaine a
retrouver le ton paternel et vaguement croquemitaine des classes diri.
on
su
188
geantes devant l'agitation ouvrière. Du même coup elle a jeté bas le
masque de l'union nationale au moment où elle en a besoin de la façon
la plus pressante; les travailleurs marocains n'ont pas l'air pressés de
reprendre leur rôle dans la comédie nationaliste si l'on en juge par le
nombre des exhortations au « calme » et des appels à la « maturité »
dont ils sont journellement gratifiés. Même si le président Bekkaï
« n'accepte plus de gaîté de ceur » les grèves, il n'est pas certain que la
tendresse que lui portent les ouvriers lui épargnera de nouvelles mé-
lancolies.
La crise économique n'a en réalité surpris personne. Les Français
détenaient 90 % des investissements privés dans l'économie marocaine.
Il est clair que depuis le retour du sultan, et pour les plus prévoyants
depuis son exil, les bénéfices tirés de ces capitaux n'ont pas
été réinvestis: ils se sont évadés vers Tanger, la France, la Suisse,
ou bien ils ont été utilisés à des fins spéculatives, ou encore ils ont été
purement et simplement thésaurisés. D'autre part le gouvernement fran-
çais a suspendu son aide financière jusqu'à la signature de conventions
lui donnant des garanties suffisantes: or le budget marocain est évi-
demment déficitaire, la contribution métropolitaine seule permettait de
le boucher tant bien que mal lors du Protectorat. Par surcroît les
paysans ayant mis à la porte leurs percepteurs en la personne des
caids, manifestent une tendance regrettable à ignorer l'administration
fiscale de. Rabat. Comment équilibrer le budget? se demande le très
orthodoxe gouvernement Bekkaï. Et il a ce trait: il taxe l'électricité et
le pétrole.
De même que Napoléon III « par l'impôt sur le sel perdit son
sel révolutionnaire », de même Bekkaï perd son essence nationaliste
par l'impôt sur l'essence. Comme les transports sont routiers au Maroc,
68 % de taxes sur l'essence plus l'impôt sur l'électricité, cela suffit à
doubler les prix de la consommation. La capacité du marché intérieur,
déjà remarquablement faible, s'affaisse un peu plus. Les petites entre-
prises ferment; les chômeurs, plus de 100.000 dans la seule région de
Casablanca, commencent à assaillir les municipalités. Les ouvriers qui
ont du travail débraient pour obtenir des augmentations. C'est alors
que le sévère Bekkaï élève la voix pour demander « le travail dans
l'ordre, la paix et la sécurité des biens et des personnes ». Faute de
quoi il se démettrait, lui et son ministère de coalition.
De toute façon la coalition ministérielle est déja démise en fait,
comme le front national dans le pays. Le gouvernement Bekkai était
composé, grâce à un savant dosage, de ministres Istiqlal, P,D.I. (Parti
Démocratique de l'Indépendance) et indépendants. Comme ainsi tout
le monde est « indépendant d'une manière ou de l'autre, comme les
étiquettes n'ont pas fini d'être collées sur les personnages, comme les
programmes de chaque parti, voire de chaque « personnalité », demeu-
rent prudemment évasifs, comme la laïcité, le dirigisme, le monarchisme
ou le républicanisme, l'occidentalisme ou l'orientalisme ont déjà plu-
sieurs fois changé de camıp, il serait audacieux de camper la signifi-
cation sociale des partis au gouvernement. Toutefois la crise, nous
l'avons dit, démasque un peu plus chaque jour les vrais visages: la
majorité des ministres, Istiqlal, P.D.I. ou indépendants, est d'un libéra-
lisme bon teint, - y compris ces terroristes sanglants que la Résidence a
un peu mis au cachot les années dernières, Balafrej par exemple qui
vient d'apaiser de façon convaincante le capital international abrité à
Tanger. Cette majorité est flanquée sur sa droite de quelques représen.
tants de la classe caïdale, pas trop compromis avec les Français par
exception dont le chef est le caïd Lyoussi, ancien ministre de l'Inté.
rieur, actuellement ministre d'Etat et démarcheur de la cause anti-
partis dans les montagnes et dans le Sud. Enfin Bouabid, Istiqlal, repré-
sente, à gauche, la fraction du parti qui contrôle l'Union des Travail.
leurs Marocains: c'est le « progressiste » de l'équipe. Le tout se marche
réciproquement sur les pieds sous la houlette de sa majesté.
Il faut accorder à la perspicacité du monarque que cette singulière
macédoine politique reflète assez bien la réalité sociale du Maroc. Le
développement combiné de ce pays juxtapose en effet une société rurale
289
pré-capitaliste à peu près maintenue dans son organisation tribale par
les soins de l'administration française, et des noyaux d'économie capita-
liste fixant dans les ports, dans les mines et dans quelques usines les
germes d'un prolétariat moderne. En gros le problème qui se pose concrè-
tement à la bourgeoisie marocaine consiste à détruire l'aristocratie
caïdale sans se faire dévorer par les travailleurs. Il lui faut lutter sur
les deux fronts; et le reproche qu'elle fait à Bekkaï par la voix de l'Is-
tiqlal est de ne lutter que sur un seul, celui des ouvriers. De fait l'aris-
tocratie agrarienne a déjà pris l'offensive sous la conduite de Lyoussi,
avec le concours, désavoué mais objectivement efficace, de certains
groupes colonialistes, et le soutien officiel d'Ab-el-Krim; ici encore
singulière conjonction, qui éclairera sans doute les travailleurs marocains.
Si la classe caïdale passe à l'attaque (sous la bannière royale, comme
il se doit et comme tout le monde), c'est qu'elle est particulièrement
menacée non seulement par la situation présente, mais par l'évolution
historique elle-même.
La naissance de la nation marocaine signifie en effet la mort des
seigneurs du bled. Ces aristocrates, dont les quartiers de noblesse ne
remontaient souvent pas plus loin que Lyautey, subissaient une lente
mise à mort de ceux-là même qui les avaient élevés. La pénétration impé-
rialistc impliquait objectivement la condamnation de l'organisation tri-
bale et patriarcale que l'administration impérialiste entrenenait très
subjectivement. La conservation, de plus en plus artificielle, des structures
sociale traditionnelles contraignait les fellahs (les deux tiers de la popu-
lation marocaine) à une pratique agraire catastrophique: terres mor-
cellées à l'extrême par la coutume de l'héritage, utilisation de l'eau au
compte-goutte selon des rites ancestraux, outillages tragiquement déri-
soires à l'échelle de la propriété, épuisement des terres par des cultures
vivrières répétées, etc.,, Cette pittoresque civilisation « berbère », qui
n'intéressait plus, à défaut des « berbères ») eux-mêmes, que leurs
cards, non seulement tuait les paysans commes des mouches, non seule-
ment remplissait les bidouvilles d'un immense prolétariat en haillons,
mais encore interdisait le développement de l'économie urbaine, préci-
pitait la crise, rendait de plus en plus intolérables aux paysans les
grands agrariens profiteurs de cet état de choses. Il n'y avait pas, il n'y
a toujours pas de marché intérieur: les campagnes « vivent », si l'on
peut dire, presque en marge de l'économie monétaire. L'impérialisme s'en
faisait une raison: il spéculait sur les ventes de terres, d'immeubles,
sur les adjudications, sur les changes, fusillait ou déportait les mécon-
tents. Mais pour faire sauter le verrou de l'appareil politique français,
il a bien fallu que la bourgeoisie marocaine libère la force des paysans
exaspérés. L'Istiqlal a pénétré dans les campagnes sur la base de cette
situation, accélérant le pourrissement de la communauté tribale et son
déplacement par l'idée nationale ou en tout cas dynastique. Il y a
600.000 adhérents à l'U.T.M.: la moitié est rurale, preuve de cette
transformation. Autre preuve: beaucoup de tribus ont chassé leurs sei-
gneurs. Le roi leur a envoyé de nouveaux caïds pour les administrer au
nom de la nation. Mais c'étaient quelquefois les mêmes, repeints à
neuf, et de toute façon il a bien fallu qu'ils mettent un terme au « dé-
sordre »: ils persécutent donc les cellules rurales de l'Istiqlal, ouvrant
les hostilités sans phrases. Que vont faire les paysans?
Lyoussi prépare sa réponse: ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire ce
que leurs caïds leur ont toujours fait faire, descendre en armes sur les
villes pour imposer la volonté du bled, entendez de leurs seigneurs. Ce
Juin du Maroc indépendant lance « ses » paysans à l'assaut des villes
bourgeoises et ouvrières, pour imposer au roi une monarchie selon son
ceur, un Etat Féodal.
Peine perdue, si du moins notre appréciation de la situation dans
les campagnes est exacte. Car même si les paysans sont incapables d'or.
ganiser eux-mêmes leur force, leurs aspirations les poussent dans un
sens qui est contraire à celui que Lyoussi veut leur imposer. Les paysans
ne feront rien tout seuls, sauf le banditisme, mais on ne leur fera pas
faire n'importe quoi. En réalité la question de la révolution démocra-
190
tique est posée sinon dans leurs têtes, ce qui n'est même pas sûr, au
moins dans les faits.
Et l'on retombe ainsi sur la vieille affaire de la Révolution Perma.
nente: cette révolution dont les prémices sont apparues dans les cam.
pagnes, et qui permettrait à la bourgeoisie de constituer le marché inté-
rieur dont elle a besoin pour se consolider, la bourgeoisie elle-même
est-elle incapable de la faire, comme le pensait Trotski? En luttant
sur les deux fronts, la bourgeoisie marocaine est-elle vouée à l'échec?
Est-il vrai que « pour les pays arriérés le chemin vers la démocratie
passe par la dictature du prolétariat » ?
Sans vouloir trancher le problème dans sa généralité, on peut en
tout cas montrer qu'il est ici un faux problème. Le prolétariat marocain
n'est absolument pas en état de construire sa propre dictature. Il est
nombreux, bien sûr, mais l'appréciation des forces révolutionnaires n'est
pas une comptabilité, et ce n'est pas là l'essentiel. L'essentiel c’est qu'il
n'est pas en possession d'une conscience claire de ses objectifs propres
ni de ses moyens. Cette classe ouvrière n'est pas socialiste, et n'a pas
encore produit d'avant-garde. Elle commence tout juste à se désempêtrer
des oripeaux nationalistes dont la bourgeoisie marocaine l'a déguisée
pendant la résistance. Certes les ouvriers n'ont pas attendu que Bekkaï
les morigène pour s'apercevoir qu’un patron marocain face à une grève
différait peu d'un patron français. Sans doute les dirigeants Istiqlal ont
beau persister dans la ligne « nation contre nation », détourner la coni-
bativité ouvrière contre « Présence Française », l'armée française, les
frontières françaises, la police française, il reste que le mécontentement
des médinas gronde contre tous les affameurs, contre tous les spécula-
teurs, contre tous les flics. Cela dit, les 200 à 300.000 ouvriers dispersés
dans les villes marocaines ne sont pourtant pas concentrés dans de
grandes entreprises où le contact direct de chacun avec tous serait
constant; en fait les discussions se font dans les cellules Istiqlal, les
échanges sont toujours contrôlés, orientés par les responsables Istiqlal,
les mêmes que les ouvriers retrouvent au syndicat: car l’U.T.M. est à
l'Istiqlal ce que la C.G.T. est au P.C.F. Bien plus, le patron de la petite
boîte où ils travaillent, pour la plupart, est lui-même Istiqlal, à des
titres de résistance, sait parler, les désarme. Dans ces conditions, le déve.
loppement d'une conscience de classe est puissamment entravé par la
classe qui ne veut pas de conscience. C'est pourquoi la bourgeoisie « de
gauche » peut développer le thème: nous ferons ensemble l'industriali.
sation contre les caïds, les colons et les droitiers.
Est-ce possible? Si la dictature ouvrière est impossible, la dictature
bourgeoise l'est-elle aussi? Le programme actuellement développé par
la « gauche » bourgeoise est bel et bien celui d'une dictature jacobine:
il faut liquider toutes les traces de l'impérialisme: armée, police, admi.
nistration, etc...; soutenir à fond la lutte algérienne; détruire l'ennemi
de l'intérieur (colonialistes et caïds), l'exproprier et redistribuer ses
biens. La réalisation de ce programme exige une direction homogène,
que l'Istiqlal revendique, mais assez mollement en raison de son hété.
rogénéité interne. Cette ligne fournit-elle de quoi payer l'industriali-
sation? Certainement pas. Allal el Fassi estime qu'avec 600 milliards de
francs, le plan quinquennal est assuré. De leur côté les libéraux pensent
qu'il faut 200 milliards par an. Où trouver les fonds? Il est question
que la Frartce prête 30 milliards, quand les conventions seront signées.
Pour le reste on peut penser que les offres de services ne manqueront
pas, à l'Est et à l'Ouest. La question sera celle des garanties que le
capital exigera en échange. La « droite » est prête à freiner la lutte
contre la féodalité et l'impérialisme pour apaiser les bailleurs de fonds :
mais alors elle se condamne elle-même comme bourgeoisie locale. C'est
ce que la « gauche » comprend bien, qui veut au contraire placer les
prêteurs devant une bourgeoisie marocaine forte, c'est-à-dire poursuivre
d'abord la lutte nationale. Mais il faudrait qu'elle prenne appui sur le
monde paysan, qu'elle le forme, qu'elle le radicalise; or elle est
consciente du danger d'une telle opération. Allal el Fassi de déclarait-il
pas récemment: « Aujourd'hui nous sommes dans les campagnes en
191
présence d'une force semblable en tous points à la force chinoise » ? Sans
doute voulait-il seulement faire un peu frissonner les droitiers et les
libéraux: mais il a probablement réussi à se faire frissonner lui-même; si
l'on en juge par l'adoucissement récent de son attitude à l'égard du
problème du ministère. C'est que dans la voie d'une révolution paysanne,
la bourgeoisie irait ausi à sa propre perte: elle est trop liée à l'aristo-
cratie foncière. Et de toute façon, le voudrait-elle, qu'elle ne trouverait
pas à la compagne de quoi former une bourgeoisie rurale; il ne s'agit
nullement de partager les terres, mais au contraire de les collectiviser.
Il ne reste plus à la bourgeoisie marocaine que de faire son unité
autour d'un programme centriste impliquant: le ralentissement, puis
l'arrêt du cours révolutionnaire à la campagne sous le contrôle des admi.
nistrateurs du sultan, éventuellement avec la caution des anciens maqui-
sards pendant la transition, l'apaisement de l'opposition ouvrière par
un réformisme modéré, la mise en route d'un plan d'investissement
dont les hommes d'affaire marocains ont déja proposé au sultan les
grandes lignes et dont le capital anglo-saxon lui fournira l'indispen.
sable aliment. C'est ce centrisme que le Palais pratique avec système
depuis le retour de Mohamed ben Youssef. Comme dit son fils, le sultan
« peut seul résoudre les problèmes, car il est au-dessus de toutes les
tendances politiques ».
Alibi des caïds contre les bourgeois, alibi des impérialistes contre
les paysans et les ouvriers, alibi des impérialistes contre les travail.
leurs marocains, mais idole des paysans, le polymorphisme du de
Gaulle marocain n'a pas encore réussi à composer son rôle pour les
ouvriers: il lui manque le coup de gueule nlébéien de Thorez pour les
inviter efficacement à retrousser leurs manches. Mais en retour les petits
Thorez marocains ne lui manqueront bientôt pas pour faire cette beso-
gne: déjà les staliniens sont entrés individuellement à l'U.T.M., décidés
à s'y incruster coûte que coûte. Ils crieront bientôt: « Vive le Roi! »,
par dialectique.
A Tunis, qui est Rabat au' futur, Bourguiba a nis la barre au
centre depuis beau temps. Le gouvernement de coalition de Ben Amar,
préfiguration de celui de Bekkaï, ayant fait la preuve de son incapacité,
Bourguiba est lescendu dans l'arène et fait son numéro centriste en
expulsant les ultras et en domptant l'agitation sociale. Le presse fran-
çaise applaudit, l' « Express » en fait son « homme de la semaine ».
« Le gouvernement tunisien garantit aux propriétaires français le main-
tien de leurs biens et de 1 eurs entreprises privées », précise l'article 29
de la convention économique. Par les articles suivants le même gouver-
nement s'interdit d'intervenir dans le régime juridique des terres et des
sociétés françaises ou à majorité française. Et Bourguiba, très rassu-
rant, confirme: « Il n'est pas questions d'étendre la réforme agraire aux
grosses sociétés » (France-Observateur, nº. 30, Août 56). Les échanges
commercdeux garantissent un régime préférenciel aux produits français
entrant en Tunisie. Décidément cet interlocuteur-là était valable.
Mais la moitié des travailleurs est en chômage complet. Pour arrêter
les pillages, Bourguiba fait distribuer du pain, à défaut des terres. La
suite est connue: il faut trouver des capitaux? Les capitaux français ont
la préférence de Bourguiba. Pourquoi? Parce que ce capitalisme incer-
tain, tartarin et froussard en Méditerranée, est le moins dangereux des
prêteurs internationaux. Mais surtout parce que ce même capitalisme
éprouve en Algérie quelques déboires qui sont un peu aussi les déboires
de Bourguiba. Le petit calcul de ce grand homme est en effet de s'inter-
poser entre le F.L.N. et Mollet pour implanter le Bourguibisme en
Algérie: il sait bien qu'en se prolongeant, la lutte algérienne diminue les
médiocres chances qu'avait une bourgeoisie libérale déjà fort mince de
s'emparer du pouvoir. Ces chances s'étaient un peu
accrues quand
Ferrat Abbas s'était rallié au F.L.N.: les professionnels du nationalisme
allaient peut-être détrôner l'appareil militaire et politique formé dans
192
les maquis. Bourguiba reconnut aussitôt ce représentant qualifié pour
son sosie. Cependant les l uttes internes ne sont pas achevées au F.L.N.
On ne sait qui l'emportera. Mais Bourguiba sait qu'en abrégeant le
combat, il multiplie les chances d’Abbas, de ses pareils et du même coup
les siennes.
Arbitre d'une conférence conciliatrice, non seulement, il aurait sa
première victoire diplomatique, il étendrait son prestige jusqu'à Rabat,
il pourrait parler plus fort pour obtenir de Paris et d'ailleurs de
meilleures conditions financières, mais il en finirait avec les armes algé.
riennes et françaises ; il obtiendrait le départ des troupes françaises sta-
tionnées en Tunisie, et surtout il ferait lâcher pied aux maquisards algé.
riens. On remettrait les armes au ratelier, ce qui soulagerait fort notro
médiateur.
Pourquoi? Parce que les maquis algériens n'ont pas oublié qu'au
moment où ils se constituaient, le Néo-destour abandonnait de son côté
la lutte armée pour la négociation. On se souvient de la phrase de Ben
Bella: « la vigilance des combattants tuera dans l'auf le bourguibisme
en Algérie ». C'est à présent la vigilance de Bourguiba qui vúudrait bien
tuer ce qu'il appelle l' « extrêmisine » en Algérie. Amener les deux parties
à négocier, c'est faire passer iu premier plan les hommes qui savent
parler, l'intelligentsia, les globe-trotters de la cause, l'émigration, c'est
leur rendre la main sur la résistance intérieure, déborder les cadres
de l'organisation militaire.
Mais quelle est la basc du conflit opposant Bourguiba et les cadres
algériens du F.L.N.? Question de personnes? Bien sûr, mais encore?
Pour l'apprécier, il faut se replacer dans la situation qui a “récédé le
14 novembre 1954: les tergiversations de la direction M.T.L.D., les
conflits opposant Messali et les « centristes » avaient convaincu certains
éléments de la base de l'impuissance des dirigeants chevronnés à mener
à bien la lutte nationale. Bourguiba est longtemps resté pour ces élé.
ments, qui ont forıné les cadres des maquis, le synıbole ennemi de la
direction conciliatrice. Peut-étre n'a-t-il plus exactement cette signific
cation à leurs yeux, maintenant qu'il a obtenu l' « indépendance ». Mais
la réconciliation des hommes du F.L.N. avec les anciens leaders natio.
nalistes ne peut de toute façon se faire que par l'intégration de ceux-ci
à l'organisation frontiste, comme l'a montré le ralliement d’Abbas.
Cette hostilité repose-t-elle sur des bases sociales? On ne peut pas
douter
que
les éléments de la bourgeoisie libérale classique, comine
Balafrej ou Bourguiba, avaient perdu la direction en Algérie à la fin
de 1954,
Bourguiba veut la leur rendre; et il est vrai que la conjoncture
approche d'une phase qui leur sera favorable, celle de la lassitude
française. Mais ils ne représentent pas une force sociale: avorton de
bourgeoisie, produit centenaire d'une adıninistration tout à fait directe.
Si Bourguiba échoue, il pourrait finir par avoir quelques centaines de
kilomètres de frontières communes avec un régime déplaisant; à savoir,
un appareil politico-militaire procédant à quelques nationalisations
spectaculaires, à une réforme agraire un peu plus téméraire que celle
de la Tunisie, capable d'entraîner démagogiquement les masses beaucoup
plus que n e le fait le terne régime destourien, parce qu'il leur donnerait
le sentiment, à la fois illusoire et authentique, de participer directement
à la lutte pour l'« indépendance ». Il n'y a aucune raison de croire que
l'exemple de Nasser ne puisse devenir contagieux quand les conditions
objectives de cette « solution_» sont réunies. Le Destour pourrait alors
craindre de subir le sort du Wafd égyptien.
Nous ne voulons pas dire que demain Ben Bella sera le Nasser de
l'Algérie. Nous voulons seulement dire que la question de la nature du
pouvoir est pendante en Algérie, tandis qu'elle ne l'a jamais été en
Tunisie ni au Maroc, que la transformation de la lutte de classes sous
la forme de la consolidation d'un régime militaire serait capables de
faire rebondir cette même lutte dans les pays voisins, et que telle est
la crainte qui motive la politique ultra-centriste et conciliatrice à 100 %
que fait actuellement Bourguiba.
193
Cependant celui-ci occidentalise la famille, l'école, la Constitution
tunisiennes, tandis que les travailleurs commencent à attendre qu'on
désoccidentalise un peu le capital. Mais à ce dernier le Néo-destour ne
fera pas plus de peine que l'Istiqlal. Et pas plus que l’U.T.M., l’U.G.T.T.
n'y poussera: son réformisme n'est que la face sociale du Bourguibisme.
Demi-mesures, conciliation, réformes: dès que la lutte de classes
émerge du marécage nationaliste dans les pays arriérés, les nouvelles
classes dirigeantes cherchent à l'y engloutir de nouveau. Mais elles ne
peuvent empêcher que leurs efforts mêmes ne démystifient peu à peu
les travailleurs et ne les conduisent finalement à envisager la lutte selon
leurs propres intérêts.
F. LABORDE.
LE CONGRES DU HAVRE
bien que
(
Le Congrès du Havre de juillet dernier qui fut surnommé le Con.
grès de l'Ennui n'a pas fait surgir de changements dans le P.C.F.
Les procédés, différents de ceux employés autrefois, ont permis à
l'appareil du Parti de passer le cap de la crise provoquée
faiblement par le XX Congrès du P.C.P.S. Le cadre est plus sobre;
ni kermesse, ni fanfare. On aborde le nouveau cours >> réformiste
par un symbolisme qu'il n'est pas sans intérêt de souligner. A la place
des monumentales effigies de Staline, Thorez et tous les leaders passés
ou présents, on ne voit plus que Marx et Lénine, les anciens incontestés
et, faisant le pendant, Jaurès et Guesde pour le « socialisme à la fran-
çaise ». Si l'on ajoute à ceci un style des interventions plus discret, sans
les tirades dithyrambiques, les litanies du rite stalinien, on a un aperçu
superficiel mais significatif de la façon dont les dirigeants français ont
abordé la déstalinisation : en douceur.
On a déjà montré dans cette revue (1) quel embarras et quelle
confusion furent ceux du Bureau Politique pendant toute la période qui
suivit le XXe Congrès; le silence, la prudence, les hésitations dominèrent
la vie publique et intéricure du Parti.
Durant cette période les chefs ont utilisé leur astuce et leur métier
pour « chapeauter » les réactions des militants. Celles-ci, rappelons-le,
pouvaient se diviser en deux: d'une part, la protestation des intellectuels
sur la question du culte de la personnalité et des erreurs des dirigeants
eux-mêmes ; d'autre part, la sourde protestation des sympathisants et des
ouvriers du rang au sujet de la politique de soutien à Guy Mollet.
Tout d'abord le secrétaire général temporisa, puis noya le poisson
en mélangeant critiques et éloges de Staline. Et ce fut ensuite l'attente.
prudente des conséquences du processus de destalinisation en U.R.S.S.
et dans les démocraties populaires ainsi que dans les principaux P.C.
occidentaux.
On a pu dire de Thorez qu'il est le dernier stalinien; c'est certai-
nement le plus habile des bureaucrates et les circonstances l'ont assez
bien servi. En particulier les événements de Poznan ont amené un
durcissement de la position dite libérale de Kroutchev
ont
permis de mettre en sourdine le procès du passé. La résolution du C.C.
russe
de juillet faisant une « analyse marxiste du culte de la person.
nalité » et l'affirmation renouvelée et fort gratuite que « ce ne sont les
les bases du socialisme qui sont en cause » furent utilisées comme un
paravent par nos bureaucrates. La caution de Souslov au Havre, traitant
Thorez de « cher ami », a contribué à maintenir l'ordre dans les
rangs et à revaloriser les bonzes. L'orage était, pour le moment, passé et
notre Maurice pouvait tenir encore le gouvernail du Parti, se donner
une justification et la fournir aux militants.
et
(1) N° 19, p. 147-152.
194
Comment se passa la préparation du Congrès? On voulut donner au
Parti l'illusion qu'il discutait à fond les thèses du Comité Central. Les
cellules, sections, tédérations furent appelées à en débattre. Une tribune
de discussion fut ouverte dans l'Huma.
Dans les cellules, celle-ci fut vive, souvent violente. Elle porta plus
souvent sur la politique vis-à-vis de la guerre d'Algérie que sur le
rapport Kroutchev et les problèmes plus théoriques soulevés par le
tournant russe.
Au niveau des sections et des fédérations le ton change. On fait des
critiques de détail visant les carences du travail d'organisation et de
la politique d'unité d'action. Les ténors viennent donner de la voix
et coiffer de leur autorité les désaccords. Si on n'invoque plus Staline
et ses écrits, c'est à l'aide de citations de Marx et Lénine, savamment
tronquées, qu'on impose le silence à des assemblées de militants qui ont
désappris depuis des lustres ce qu'est la discussion politique. A la base
on continue d'« expliquer » aux camarades qui ne la comprennent pas
« la justesse de la ligne politique du P.C. ». Les conclusions sont rares
mais exemplaires. On ramène les brebis égarées sous la houlette bien-
veillante de son berger Maurice.
Chez les intellectuels c'est un peu différent. En ce qui concerne,
P. Hervé, dont la rebellion est loin d'avoir une signification révolution-
naire, c'est une question de tactique et de personnes. Lorsqu'on écarta
Trotsky, partisan d’intensifier l'industrialisation alors que Staline mar-
chait à pas de tortue pour adopter ensuite sa politique on procéda
en gros de la même façon que la direction du P.C. français vis-à-vis de
Lecaur et Hervé.
La comparaison ne vise, bien entendu, que la méthode bureaucra-
tique et non le contenu politique de la querelle sinon elle serait terri-
blement injuste pour Trotsky. Ce que nous voulons souligner, c'est que
Thorez ne peut supporter que d'autres postulent la direction du Parti
avec une politique qui sera en gros la sienne demain. Le cas des rebelles
Morgan et Baby est aussi plein de sens. Parce que celui-ci met en doute
les bases scientifiques de la soi-disant théorie de la paupérisation absolue
le fustige et le ridiculise; on le met sur la touche. Nous reviendrons
plus loin sur l'importence que revêt, pour la direction, cette question.
La tribune de l'Huma donne en outre la mesure de cette pseudo.
discussion. Elle est en réalité une tribune d'approbation, avec plus de
liberté dans la forme. Si quelques opinions divergentes sont publiées sur
la stagnation économique du capitalisme français, par exemple, c'est
pour permettre à un membre du C.C. de répondre que les camarades
n'ont pas compris et de fournir une explication. Ce faisant, d'ailleurs, en
passant à côté des objections les plus valables et sans les refuter le
moins du monde.
Enfin pour clore « ces larges discussions » il n'y a qu'à lire les
résolutions des fédérations: de la Corse, à la Seine-Maritime, ce n'est
qu’un concert de louanges. (1)
Au sujet de ce Congrès, il n'y a pas eu dans toute la presse de
( gauche » de plus grands illusionistes que l'équipe de Bourdet et
Martinet. A les en croire, était arrivée la période tant réclamée ou le
P.C. se démocratisait, où les divergences et les tendances seraient admises
dans le Parti. N'ont-ils pas parlé de changements radicaux dans celui-ci
et dans un sens révolutionnaire bien entendu. Il fallait maintenant faire
des critiques constructives et les anciens staliniens feraient . place à des
vrais ( communistes D.
Nous ne nions pas qu'il puisse y avoir des bouleversements. Ce n'est
certainement pas parce qu'une discussion large et ouverte pourrait se
dérouler. La possibilité de régénérer le P.C.F. est pour nous exclue.
(1) Voir L'Humanité du 1er au 18 juillet.
195
Seule, une poussée extraordinaire des masses mises en mouvement par
des événements, tels que coux qui se développent actuellement en Hou-
grie aurait des chances de le faire éclater. Jusque-là sous l'égide de la
couche bureaucratique régnante ou d'une autre direction de rechange
seules des désaffections individuelles ou de metits groupes peuvent être,
croyons-nous, enregistrées.
Pour tous les « enfants de cheur de la gauche française », le P.C.
est le parti du socialisme, le parti ouvrier par excellence. Peut-être est.
il mal dirigé, mal orienté? Il faut l'aider à retrouver une voie juste.
Cette mythologie est tenace, elle est encore très répandue dans la classe
ouvrière. En répétant que sans ce parti qui est l'expression de la grande
masse des travailleurs, rien ne peut être fait pour le socialisme, les
soi-disant progressistes renforcent et perpétuent les illusions les plus
néfastes. (1)
Si la préparation du Congrès ne modifia ni les thèses, ni la ligne
comme certains l'imaginaient, son déroulement lui-même fut aussi
tyraditionnel, dans le fond, que par le passé.
Les deux pièces maîtresses, le rapport de Thorez et celui de Duclos,
occupèrent l'attention et une bonne partie du temps des délégués. Le
premier, « Pour un avenir de progrès social, de paix et de grandeur na-
tionale », dont le titre est déjà tout un programme, est la tentative de
justifier idéologiquement l'action du P.C.; l'autre, « Les municipalités
au service des masses laborieuses », prépare l'activité néo-réformiste, met
en avant la volonté de légalisme, le souci de_bien gérer, dans le cadre
du régime existant, les communes de la IV° République.
Les ténors de second plan n'intervinrent que comme spécialistes
illustrant et commentant des points particuliers du rapport du chef.
Garaudy défendit la culture française, Kanapa parla des irtellectuels
vis-à-vis du Parti, Marcel Servin de l'organisation, Jeannette Vermeersch
de l'unité d'action. Ce fut une bonne orchestration et chacun tint sa
partition avec discipline.
Du long rapport de Thorez il nous semble que trois idées clés ont
retenu l'attention. La première, qui fait suite à l'examen habituel des
succès économiques de l'U.R.S.S. et, partant, de la stagnation de l'éco.
nomie capitaliste française, introduit les fameuses « thèses sur la pau-
périsation absolue et relative (sic) » de la classe ouvrière. En second lieu,
Thorez, s'appuyant sur la force garndissante du camp de la Paix, démon.
tre que la coexistence pacifique est une politique à long terme et que
la guerre n'est pas fatale; ce qui lui permel d'exposer les nouvelles
voies vers le socialisme. Ensuite le problème de l'unité d'action est pré.
senté comme la charnière de la politique communiste dans la période
actuelle et il renouvelle à ce sujet les positions de soutien, guidées par
le souci de « l'intérêt national ».
Après avoir fait le panégyrique de l’U.R.S.S., l'énoncé des mirobo.
lantes perspectives du Vi plan quinquennal et le tableau des rythmes
d'accroissement très élevés de la production, le secrétaire général n'en est
que plus à l'aise pour annoncer les catastrophes qui attendent le monde
capitaliste. Ce qui jusque-là ne nous étonne guère. Décrire l'agonie du
système colonial présenter la stagnation économique de la France
comme absolue est ensuite un jeu pour ce maître.
Sanz aller au fond de l'analyse, on peut dire que l'expansion de ma
production en France est ralentie et le sera vraisemblableinent plus par
la perte de privilèges coloniaux. Que les rythmes d'expansion soient plus
(1) « Pourquoi, demandent certains communistes, pourquoi cette
sollicitude constante pour le sort de notre parti? » La plupart des
hommes de gauche répondent généralement: « Parce que ce parti a la
confiance de millions de travailleurs et qu'aucune politique progressiste
pe peut être faite sans lui. » Il en existe déjà un certain nombre qui
ajoutent: « ...et parce que, tôt ou tard, nous nous retrouverons, les uns
et les autres, au sein d'un même parti »! Gilles MARTINET (France.
Observateur).
196 -
grands en U.R.S.S. qu'aux U.S.A. et que, dans ce dernier pays, ils soient
plus forte qu'en France, ne veut pourtant pas dire qu'ils n'existent pas
dans les puissances occidentales. Ce que ne dit pas Thorez c'est qu'en
ce qui concerne l'U.R.S.S., cette accélération tend aussi à se ralentir et
qu'il n'est nullement évident qu'elle puisse dépasser le niveau atteint par
les Etats-Unis. Ce qu'oublie encore de mentionner Thorez, c'est que le
formidable essor qu'a connu l'Union Soviétique a été largement favorisé
par le retard qu'elle avait par rapport aux pays les plus avancés. Ce
retard ratrappé, l'U.R.S.S. fait face aux difficultés que rencontrent toutes
les économies développées et le XX° Congrès révèle clairement qu'elle
est loin de les avoir surmontées.
Quant aux bases économiques malsaines et fragiles dont parle
Thorez, toute son argumentation revient à dire: l'économie est mal
gérée en France et les secteurs qui devraient recevoir en priorité des
investissements n'en reçoivent pas. Seuls les communistes sont capa-
bles de gérer convenablement et de planifier l'économie.
Bien entendu, il est vrai que le capitalisme ne fait pas face à ses
tâches de gestion, qu'il est tenaillé par des contradictions insurmon.
tables. Mais cela ne veut nullement dire qu'il y ait stagnation absolue
de l'économie.
Si, comme le dit Kroutchev lui-même, en répudiant ce qu'il aprelle
« les analyses schématiques de Staline », la production capitaliste peut
encore progresser, qui doit-on croire de Thorez ou de Kroutchev? Et
quand le « camarade Mikojan » déclare: « La théorie de la stagnation
absolue du capitalisme est étrangère au marxisme-leninisme. On ne sau.
rait admettre que la crise générale du capitalisme aboutit à l'arrêt de
l'essor de la production dans les pays capitalistes », faut-il l'accuser,
lui aussi, d'opportunisme et de déviationisme? La vérité est que
Mikoian et Kroutchev ne peuvent plus, comme Thorez, falsifier aussi
grossièrement les notions incontestées de l'analvse économique marxiste.
Car l'un et l'autre affrontent dans la réalité la tâche de « rattrapper
et dépasser les normes de productivité du régime capitaliste » et ils sont
obligés de dissiper certains mensonges idéologiques, pour agir efficace-
ment dans leur société. Mais le leader du P.C. nous entraîne dans cette
galère pour démontrer que sa thèse de la paupérisation absolue de la
classe ouvrière est juste. Celle-ci ne vise pas seulement à renforcer son
autorité de théoricien et de guide éclairé, mais à préparer une poli-
tique à long terme. Et de même ru'il n'y a pas de stagnation absolue de
la production il n'y a pas paupérisation absolue.
Toute une série de chiffres donnés dans plusieurs interventions du
Congrès veulent prouver que le travailleur français est plus, pauvre dans
l'absolu qu'en 1938, ce qui fait dire à Thorez: « l'ouvrier français
d'aujourd’hui mange moins de viande que sous le second Empire ». Cette
argumentation est d'autant plus démagogique, si on pense aux positions
qu'affichaient les staliniens jusqu'à leur départ du gouvernement en
1947, et qui visaient précisénient à démontrer le contraire.
Et, pourtant, la vérité se suffit à elle-même. Etant donnés l'aug.
mentation du revenu national, de la productivité, du volume des produits
et de l'accumulation, il est clair que, même si la masse des salaires a
augmenté relativement, la classe exploitée n'a pas sa part. Malgré sa ré.
sistance, ses luttes revendicatives (d'ailleurs en grande partie freinées et
édulcorées par les staliniens), l'ouvrier subit un taux d'exploitation
plus élevé. Mais dire que dans l'absolu il s'est appauvri est une contre-
vérité, et c'est en outre escamoter le problème fondamental de l'exploi.
tation. Car la politique des hauts salaires aux U.S.A., pour prendre un
exemple, n'empêche pas le prolétariat d'être exploité, d'être dépouillé
de toute activité proprement humaine, d'être dépossédé du sens de son
travail.
A quoi rime donc tout ce fatras sur la paupérisation?
S'il n'y a, en fin d'analyse, entre l’U.R.S.S. et les pays occidentaux
ques des différences de rythme dans l'expansion, le schéma de Thorez
ne sert plus sa politique. Cela revient à dire: en France les travailleurs
ont beau lutter pour de meilleures conditions de vie, ils s'appauvris-
197
sent constamment tandis qu'en U.R.S.S., pays du socialisme, sans lutter
le bien-être augmente et augmentera régulièrement.
Il nous semble que la position révolutionnaire consisterait à dire:
En France comme ailleurs dans le monde, U.R.S.S. y compris, l'exploi-
tation du travail humain est en augmentation constante sans pour cela
que la paupérisation soit absolue et les travailleurs, en attendant de
briser le pouvoir étatique par des voies révolutionnaires, obligatoirement
violentes, doivent (et le font d'ailleurs) mettre en avant des revendi-
cations qui les conduisent peu à peu, même quand elles portent sur 25
francs de l'heure à la gestion totale de la société.
Ce n'est pas, bien entendu, ni de près ni de loin, le langage de
Thorez. Une autre partie importante du discours de celui-ci se référa
à la paix et à la coexistence pacifique.
Il commença par un amalgame honteux de la position révolution-
naire de Lénine et de l'action du « Camp de la Paix ». Lénine dit aux
ouvriers de lutter contre la guerre par l'action révolutionnaire, les par-
tisans de la Paix, eux, par des bulletins de signatures et des colombes.
Le chef ex-stalinien dit que le développement des forces de paix a enfin
imposé la coexistence pacifique et la fin de la guerre froide.
De toute évidence, il oublie de rappeler l'antagonisme explosif qui
a, jusqu'en 1953, opposé son « Camp de la Paix » au bloc impérialiste
occidental et les provocations régulières et réciproques, qui faillirent
mettre le feu aux poudres. Cela n'aboutit pas à la guerre mondiale
pour des raisons qui sont loin d'être l'existence de l'appel de Stockolm
et « le renforcement du camp des pays démocratiques dans le monde ».
Mais c'est bien plutôt la conscience des deux blocs d'arriver au bord de
l'abîme, de n'être plus absolument aîtres des forces productives et
des forces de destruction. Ce n'est pas la lutte révolutionnaire, mais
cependant les révoltes ouvrières de juin 1953 à Berlin-Est, les grèves
aux Etats-Unis, en Angleterre et en France, et bien d'autres mouve-
ments ouvriers qui contribuèrent à imposer aux deux blocs la
coexistence- pacifique. Ce n'est pas l'attitude des P.C. dans ces mouve-
ments qui imposa aux exploiteurs cette trèye mais ces révoltes et
grèves qu'on a appelées « sauvages » à défaut d'un meilleur terme.
Dans cette perspective pacifique à long terme, le P.C. français,
comme la bureaucratie russe, doit rechercher son mode d'existence.
Il le trouve en paraissant reprendre les positions de K. au XX
Congrès, mais, en fait, en remettant sur le tapis ses déclarations
de 1946 :
« Déjà en 1946 dans l'interview au journal anglais Times, j'avais
pu expliquer que les communistes français, en se fondant sur le
développement sans précédent des forces démocratiques dans le monde,
sur l'affaiblissement de la bourgeoisie capitaliste après la deuxième
guerre mondiale, envisageaient, pour la marche de la France au socia-
lisme, d'autres chemins que la voix suivie trente ans plus tôt par nos
camarades russes. Nous affirmions que le peuple de France, riche d'une
gloricuse tradition politique, saurait faire preuve d'initiative créatrice
et trouver lui-même sa route ».
Cette déclaration a, pour Thorez, un double objectif. Le premier
est d'affirmer son accord avec K.; le second, à usage des querelles inter-
bureaucratiques, est de préciser qu'il avait soutenu de telles idées il y
a belle lurette. Mais l'ironie de l'histoire est vraiment cruelle. Car pour
Thorez, prétendre en 1946 accéder « à la société socialiste par des voies
démocratiques » cela était basé sur la conscience du P.C. d'être dominant
en influence dans la classe ouvrière et de se croire capable en cas d'ex-
tension du bloc russe de « Faire le coup de Prague ». Les socialistes
auraient de gré ou de force, pour sauver les apparences, fait partie du
Parlement Populaire. Aujourd'hui cette citation dont Thorez n'a pas
besoin
pour une fois
de changer un seul mot, n'a pas la même
signification historique.
Le
coup
de Prague ne se fera pas en France et les voies démocra.
tiques que suggère Thorez sont vraiment celles de la conquête pacifique du
Parlement bourgeois. Une différence importante existe néammoins entre
les deux époques: les communistes ne peuvent espérer convaincre les
198
« camarades » .socialistes par la présence des tanks de K. à Paris ou
dans les environs. Les chefs réformistes n'en veulent à aucun prix.
Quant au côté théorique de la question, là comme ailleurs les
citations ne font pas défaut.
A quoi sert le long passage critiquant la a démocratie bourgeoise
menteuse », l'absence de liberté réelle (seul passage qui reproduit fidè
lement l'argumentation léniniste), sinon d'alibi révolutionnaire pour
faire absorber le reste ? La citation d’Engels (critique du Programme
d'Erfurt) selon laquelle « dans les pays de très grande liberté on peut
concevoir une marche pacifique au socialisme » est tronquée et dépouil-
lée de tout sens. Engels y parle de la démocratie anglaise au XIXe siècle
où précisément l'Etat et toute la bureaucratie étaient loin d'avoir
atteint la rigidité et la force cærcitive qu'a atteint le plus démocratique
(en apparence) des Etats capitalistes modernes. Ensuite, précisons que
l'expérience réelle et non plus seulement les textes des penseurs socia-
listes aussi autorisés soient-ils, à prouvé au proletariat en 1917 en
particulier que la voie démocratique dite réformiste devait être dépas.
sée par la révolution violente et la rupture du pouvoir de classe existant
si on voulait qu'un pas quelconque soit fait dans le sens du socialisme.
Il est particulièrement irritant de constater que dans le chaos idéo-
logique que nous traversons les bureaucrates se donnent tous des titres
de théoriciens du mouvement ouvrier international, que ce soit Krout.
chev, Tito ou Thorez, alors qu'ils font preuve d'une pauvreté idéolo-
gique croissante.
La théorie des voies nouvelles conduisant au socialisme permet au
guide éclairé de la classe ouvrière d'introduire le problème de l'unité
d'action et du Front Populaire. Réclamer plus de démocratie dans le
fonctionnement de la République, démontrer aux socialistes qu'eux,
a communistes », sont aussi des gérants loyaux du régime, donner des
gages de paix sociale qui les feraient rentrer dans la communauté natio-
nale, sont les soucis primordiaux de la bureaucratie thorezienne.
Le malheur est que les socialistes ne l'entendent pas de cette oreille.
Ils sont trop conscients de l'habileté des ex-Staliniens, et de plus leur
base sociale a bien évolué vers la petite bourgeoisie; ils ne subissent
donc pas la pression que cette propagande pourrait exercer.
En second lieu, les fondements, même limités, de cette politique de
Front Populaire n'existent pas dans la classe ouvrière. Certes, il y a une
confuse nostalgie des mouvements unitaires de 1936. Mais il y a plus:
une expérience de ce qu'ont fait les partis dits ouvriers lorsqu'ils étaient
unis (36 à 39 et 45 à 47). O se rappelle qu'ils ont freiné les luttes
ouvrières et leur ont ôté, dès que c'était possible, l'orientation révolu-
tionnaire qu'elles prenaient pour leur substituer une expression républi-
caine et nationaliste.
Le rapport reproduit aussi, sans rien y changer, l'interprétation des
votes du groupe parlementaire communiste, malgré les remous évidents
que ceux-ci avaient causé dans le Parti. Là réside une contradiction
qu'il aura du mal à surmonter : Il ne peut aller plus avant dans le
soutien à Guy Mollet et à la guerre d'Algérie sans perdre un peu plus
la confiance des ouvriers. Il ne peut espérer progresser dans sa politique
de collaboration avec la S.F.I.O. en vue d'une politique néo-reformiste
commune, s'il développe ou même laisse se développer une action vigou-
reuse contre la politique guerrière et anti-ouvrière de Mollet.
Le Front populaire n'est donc pas à l'ordre du jour. Et, récemment,
le vote hostile à Mollet a bien démontré quelles étaient les limites de
manæuvre du P.C.
Quant à la déstalinisation, elle fut l'objet d'un escamotage en règle.
Thorez prit seulement le soin de spécifier qu'elle n'avait pas sa place on
France: « Dans la discussion, les camarades ont estimé que la critique
du culte de la personnalité ne saurait en aucun cas être transférée méca.
niquement chez nous, appliquée telle quelle à notre Parti qui n'a pas eu
à subir de défauts semblables ».
199
Il est vrai que Thorez jouit, par rapport aux leaders des démocra-
ties populaires, d'une situation privilégiée. Les transformations drama-
tiques auxquelles nous assistons dans les démocraties populaires sont
imposées à la bureaucratie par la réalité sociale. Les ouvriers font chaque
jour, dans ces pays, l'amère et cruelle expérience de ce qu'est le faux
communisme. En revanche, en France ou en Italie, les dirigeants peuvent
encore salver la face à l'aide d'une légère modification des formes, car
ceux qui les soutiennent n'ont pas vu s'exercer dans la réalité les
méthodes d'exploitation bureaucratique. Nous doutons d'ailleurs, que les
militants du P.C., à part les intellectuels (ou, du moins, une fraction de
ceux-ci) aient discuté à fond les problèmes du 20*Congrès. L'éteignoir mis
sur le rapport Kroutchev en est une preuve. Et il est significatif que
dans l'Humanité on ne parle que d'un rapport « attribué au camarade
Kroutchey » comme si l'origine en demeurait douteuse.
Nous avons toujours pensé que les ouvriers feront plus encore leur
expérience de la véritable signification des « communistes français »
dans leurs luttes. Celles-ci, dès qu'elles auront un caractère unitaire anti.
bureaucratique, anti-hiérarchique, forceront le P.C. et les autres courants
soi-disant ouvriers à se dévoiler dans leur affreuse nudité.
Les moyens actuels de faire à fond le point sur les multiples trahi.
sons de chefs staliniens manquent aux travailleurs. Car la mystification
pèse encore lourdement sur leur conscience. La remise en question de
tout le passé n'est pas encore faite dans les rangs des ouvriers militants.
L'habileté maneuvrière de l'équipe Thorez n'est pas un mot mais
une réalité vécue par tous ceux qui passèrent dans le P.C. Les bureau-
crates ont sur les réformistes la supériorité d'être toujours restés en
contact avec la classe ouvrière, au prix de quelles acrobaties, virages,
tripotages de textes historiques.
Toutefois, on peut penser que l'orientation néo-réformiste que
cherche à prendre le P.C. français contribuera à la démystification des
masses.
De fait, maintenant qu'ils ne peuvent plus s'agripper au roc de la
science stalinienne, maintenant qu'ils ne peuvent plus justifier toutes
leurs manæuvres par l'impératif absolu de la défense inconditionnelle de
l'U.R.S.S., les staliniens français sont obligés de jouer à fond le jeu
d'une politique nationaliste, « démocratique » et néo-réformiste.
Comment seraient-ils candidats sérieux à une nouvelle participation
à la vie politique nationale s'ils ne donnaient des gages de leur volonté
de paix sociale et de transformation pacifique des institutions ? Tout
au plus cherchent-ils à se différencier de la S.F.1.0., théoriquement, par
la thèse de la paupérisation absolue et relative dans laquelle ils voient
un moyen de se présenter comme les représentants « historiques »de la
classe ouvrière. Mais toute leur propagande est axée sur la nécessité d'un
travail loyal dans le cadre du régime existant.
Des contradictions dans lesquelles on voit le P.C. s'enfermer, il
serait sans doute dangereux de déduire qu'il est exposé dans la période
prochaine à des bouleversements radicaux. Mais il nous paraît non moins
douteux que se détacheront de lui un nombre croissant de ceux qui ont
jusqu'ici continué de le soutenir en espérant, malgré tous les signes con-
traires, qu'il se rénoverait et renouerait avec une politique révolu.
tionnaire. (1)
A. GARROS
(1) Ce texte était déjà composé lorsque la crise polonaise et la révo.
lution hongroise éclatèrent. Celles-ci ont provoqué, comme on sait, une
crise de la bureaucratie du P.C.F., sur laquelle nous reviendrons.
200
MARCINELLE
causes
MARCINELLE ! Une épreuve supplémentaire pour le prolétariat. Une
fois encore la classe ex-loitée, dépossédée de sa force de travail par
le capital, paye, en plus, de son sang. Ceci, nous ne le soulignerons
jamais assez. Mais nous ne pouvons comprendre le sens particulier de
cette catastrophe, ensevelissant 265 hommes au travail, qu'en la plaçant
dans son
contexte réel. Il s'agit de saisir le degré d'aliénation du
mineur sous son aspect le plus profond. Politiser, comme l'ont fait à
l'époque les Staliniens et autres, non seulement n'explique rien, mais
devient à proprement parler indécent devant l'ampleur de la catastrophe.
Il est peut-être naturel de rechercher les
dans les
cadences, la sécurité insuffisante, le rendement, les comparaisons
de pourcentage d'accidents d'un pays à l'autre ou d'une mine à l'autre.
Mais les arguments employés, le plus souvent valables, ne font pas
avancer d'un pas et se perdent dans des polémiques stériles, ce qui,
di fait, arrange bien tout le monde, en l'occurrence : patrons belges,
C.E.C.A.(1), syndicats. Et il suffit de faire déclarer au vice-président
de la C.E.C.A., Frantz Etzel, que la catastrophc est due à des défail.
lances du personnel pour que tout ce « petit et grand monde » ait résolu
la question.
« Il y a des consignes de travail, elles sont affichées partout, tout
le monde les connaît, si elles ne sont pas appliquées, qui la faute ?... »
Voilà ce qui est toujours dit en pareil cas. Tous les ouvriers connais.
sent ce genre d'arguments et tous voient, à longueur d'année, cette
affiche disposée dans les ateliers français, invitant à ne jamais passer
sous. une charge suspendue. Seulement, dans la pratique, on ne sait
où passer. Il n'y a pas d'allée évitant le pont roulant, et il a toujours
des charges en mouvement. Attendre que la charge soit au sol ? Et les
temps morts ?
Mais pour quelles raisons, de telles défaillances entraînent-elles la
mort de 265 hommes, en une seule journée, à l'époque où le dévelop.
pement technique permet des « protections » de toute sorte ?
Pourquoi ont-elles provoqué celle de près de 450 mineurs allemands
en 1945, dans les conditions de Marcinelle (catastrophe dont on n'a
jamais parlé)? Pourquoi 600 mineurs italiens sont-ils morts en Belgique
depuis dix ans dans des accidents individuels ? Pourquoi 629 de leurs
camarades belges ont également péri de la même façon et dans le
même temps ? Pourquoi tant de morts dans le monde de la mine ?
Manque de sécurité, improbabilité, enchaînement de circonstances,
« coup de pouce du destin » répond J. CALLEN dans France-Observateur.
Bien sûr que dans la mire le danger est permanent. Bien sûr qu'à
chaque mètre l'éboulement est possible, le grisou présent. Bien sûr
que l'imprévisible règne en maître. Il faut, dit J. CALLEN, atteindre en
Europe le pourcentage américain d'accidents. Ceci dit, la question paraît
résolue.
Seulement, répondre de cette façon, c'est oublier un facteur, de
notre point de vue, le plus important : l'exploitation. La première
chose qui apparaît, à un examen un peu plus profond, c'est que dans
une mine quelconque, vétuste ou non, les consignes de sécurité n'exis-
tent partout qu'à l'état théorique. Leur non-application est dissimulée
en permanence, avec l'accord de tout le monde, Direction comprise.
Et on ne s'en souvient pour les appliquer qu'au moment où l'initiative
individuelle pourrait résoudre plus efficacement certains problèmes (dans
le sauvetage, par exemple).
Dans le cas particulier de Marcinelle, il faut rappeler l'état des
mines belges. Elles sont parmi les plus profondes et les plus dange-
reuses d'Europe. Mais, comme France-Observateur le fait remarquer,
(1) Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier (Pool Schu
mann).
201
« la Belgique n'est pas mal placée dans la comparaison internationale
des taux d'accidents » (0,98 pour les U.S.A., 0,66 pour la Belgique
pour 100.000 journées de travail).
En fait, le problème se circonscrit dans l'opposition Sécurité-Ini..
tiative, opposition qui se situe, elle-même, dans l'antagonisme de classe :
Direction-Exécution. La direction administrative et technique (cadres
divers et ingénieurs de surface) s'ingénie à imposer, de différentes
manières, les normes de travail indispensables à la bonne marche de
l'exploitation. Pour cette catégorie d'individus, la sécurité fait d'abord
partie des moyens nécessaires à l'extraction rationnelle du charbon. De
ce point de vue, il n'y a pas d'incompatibilité entre Sécurité et Rende
ment. Les consignes s'intégrant dans cette perspective sont respectées
jusqu'à un certain point. Au-delà, elles deviennent, pour l'homme du
fond, des entraves à la façon de produire et à la production elle-même.
Leur existence étant nécessaire, elles sont donc affichées et même divul.
guées de différentes façons. Des contrôles périodiques sont pratiqués au
fond par les ingénieurs de surface, de façon à veiller à leur bonne
exécution. Ces individus, complètement étrangers à la vie et au travail
à 1.000 mètres au-dessous du niveau du sol, se trouvent devant la situa-
tion suivante : ou bien la non-application des règlements est flagrante,
et ils ferment les yeux (parce qu'ils sont incapables de trouver une
solution de rechange à une question déterminée), ou bien ils ne peuvent
constater les entorses faites car, de l'ingénieur de fond au mineur de
taille, en passant par les porions ou chefs porions, tout le fond maquille
la réalité. Tous cachent astucieusement les combines de toutes sortes
tournant le règlement. En fait, tout le monde dans les mines sait que
l'application des règlements de sécurité correspondrait à une grève du
zèle d'une efficacité exceptionnelle.
Le caractère propre de la mine, son travail dur et dangereux, en
font non seulement le creuset par l'excellence de l'exploitation de
l'homme par l'homme, au sens humain et économique du terme, mais
aussi celui de la contradiction totale de cette exploitation. A propos
de la sécurité dans les mines, c'est presque tout le problème de notre
société qui surgit. D'un côté, la direction patronale ou bureaucratique,
qui d'abord se sert des consignes de sécurité pour améliorer le rende
ment (à la limite, il faut bien donner de l'air aux mineurs), ensuite
se protège sur le plan juridique et enfin se met à l'abri contre des
attaques diverses sur ce sujet. Des articles de caractère législatif sont
donc élaborés et « destinés à protéger le mineur ». A l'avance, on sait
ces textes inapplicables, compte tenu des exigences de production, ou
inadequats en regard des investissements qui seraient nécessaires pour
les rendre efficaces. Quels sont les résultats de cet état de choses?
Bien entendu, on voit les ouvriers, pour qui la seule solution est le
système D, prendre toujours plus de risques pour tenir les cadences ;
les services d'entretien, négliger certains travaux au profit d'autres ;
les « responsables », laisser faire, ce qui aboutit à une conjugaison de
tous contre les services de contrôle ou, plutôt, contre leur inutilité du
double point de vue de la Direction et de la Sécurité. On comprend,
dans ces conditions, l'existence des « coups de pouce du destin » provo-
quant aux enchaînements d'accidents aux conséquences catastrophiques.
De la sorte, on peut constater la multiplication des chances qu'a la
roche se détachant subitement de trouver un homme à écraser sous elle.
L'image de cette situation a été donnée à Marcinelle comme sous
un verre grossissant. Et c'est dans le contraste des conditions journa.
lières du travail que nous venons de décrire et celles du sauvetage,
que cette image est la plus claire. Nous venons de le dire : la seule
façon d'être efficace dans le travail de la mine, c'est de passer au-dessus
des règlements de sécurité, et ceci à tous les instants. Mais la Direction,
qui à tout autre moment fait seulement semblant d'appliquer ces règles,
se rend prisonnière de celles régissant le sauvetage. Ainsi, à Marci.
nelle, on a prétendu être efficace en respectant, d'une façon stricte,
les consignes appropriées au sauvetage et si, dans l'obscurité de la
besogne de tous les jours, « on » tolérait les initiatives personnelles,
dans la lumière de la catastrophe, les sauveteurs ont été impérativement
202
débarrassés de cette initiative et ont dû, pendant les premiers jours du
moins, obéir aveuglément aux principes établis. Cette comparaison per-
met, à priori, de supposer que le sauvetage, laissant jouer l'esprit d'ini.
tiative à plein, aurait peut-être permis de tirer quelques vies humaines
de cet immense cercueil en flammes. Car se serait ajouté, dès le début,
an courage des sauveteurs, l'esprit de solidarité se concrétisant dans
des actes dépassant le rationnel. Le divorce entre l'émotion humaine
qui libère des forces insoupçonnées et les règles sociales, se serait alors
réalisé au profit des camarades en voie d'asphyxie. Ainsi la trentaine
de sauveteurs (sur 130) originaires de Marcinelle ou connaissant bien
la fosse, ayant un membre de leur famille ou un ami au fond, aurait
peut-être fait plus que les 100 autres étrangers au puits. Ceci, s'il leur
avait été possible d'agir dès les premières minutes sur la base de leur
expérience journalière. Au lieu de cela, on a vu une tentative de sau-
vetage procédant de méthodes scientifiques certes, mais de méthodes
ralenties par leurs modalités d'application. Pourquoi ? Parce que les
principes régissant le sauvetage et ordonnant une attitude déterminée
devant un cas précis sont élaborés par des gens de surface qui n'ont,
du danger et des accidents, qu'une vue du dehors. Les sauveteurs, eux-
mêmes, malgré leur courage, établissent forcément, entre eux et les
emmurés, le rapport impliquant en fin de compte le choix : lui ou moi.
Ainsi, dans leur lutte contre les éléments, ils choisissent d'abord leur
vie propre. Tandis que l'homme, comme par exemple ce chef porion
(dont on a par ailleurs beaucoup parlé), sạchant son fils en péril de
mort, verra ses forces dans une certaine mesure se décupler.
Ce fossé entre Direction et Exécution explique et porte la respon.
sabilité de la mort des 265 mineurs de Marcinelle et de bien d'autres
mineurs et travailleurs. Il s'est exprimé au grand jour pendant les
semaines qui ont suivi la catastrophe. D'un côté : Van den Heuvel,
directeur général de la mine du Bois du Cazier, s'enferme peureusement
dans son bureau protégé par la police et informe les familles et la
population de temps à autre (et quelquefois faussement) par de laco-
niques communiqués. De l'autre : les familles, les mineurs du Borinage
en grève contre l'avis syndical, réclamant des informations, exigeant
des comptes, et que Van den Heuvel, par son infâme pusillanimité en
matière d'informations, fait passer par d'atroces alternances d'espoir et
de désespoir. Et entre les deux, les forces de police, parfaite image
de l'Etat, « protégeant » le carreau, l'entrée du puits, escortant les
sauveteurs jusqu'au bureau du patron de crainte d'indiscrétion pouvant,
à tout moment, provoquer « la colère de la foule ». Quelle image plus
claire de notre société !
Tous les travailleurs de Marcinelle ont, dans cette tragédie, montré
un courage sans bornes. Dans la douleur et le désespoir, ils ont mani.
festé un degré de solidarité et de conscience exceptionnel. Ils ont su
démontrer qu'ils n'étaient pas dupes et qu'ils savaient où étaient les
vrais responsables. Dans le calme muet qui, la plupart du temps, carac-
térisait leur attitude, des moments de colère ont trouvé leur manifes.
tation dans des « invectives violentes lancées contre la Direction » (lo
Monde), la distribution de quelques coups, à titre d'avertissement, à
des photographes de journaux à sensation manquant de discrétion, la
prise à parti du roi Baudoin, lors de sa visite ce qui l'a amené à
se faire représenter, par la suite et surtout, le renvoi violent dans
leurs églises des curés qui, profitant toujours de ce genre de situations,
voulaient officier en plein air. Ces derniers, devant le porion Hendrickx
dénonçant le caractère spectaculaire de la messe, n'ont pu que ranger
leurs instruments au plus vite.
Enfin, il faut souligner l'attitude des mineurs du Borinage. Tous
ont développé la grève de solidarité contre les syndicats. Et ceux-ci,
incitant, dans un pareil moment, les mineurs à produire, se sont dénoncé
eux-mêmes. Leur impudeur risque, dans l'avenir, de leur coûter cher.
R. NEUVIL.
203
LA LUTTE DES SYNDICATS AUTOUR
DU COMITE D'ENTREPRISE RENAULT
се
Nous publions deux articles parus dans Tribune Ouvrière au sujet
du différend qui éclata entre la C.G.T. et la direction des Usines Renault
à propos du Comité d'entreprise. La direction ayant refusé d'octroyer uile
somme supplémentaire de 110 millions aux services sociaux du Comité
d'entreprise, la C.G.T., qui en détenait le contrôle, protesta et appela les
autres syndicats et les ouvriers à la soutenir. A cet effet, de nombreux
tracts édités par les syndicats circulèrent dans l'usine.
Voici l'article tiré du numéro 27 de Tribune Ouvrière publiée en
septembre dernier.
L'Unité syndicale est un mythe qui est souvent brandi mais le mythe
résiste mal à la réalité.
Chez Renault le mythe de l'unité s'arrête là où commence la course
aux bons postes du Comité d'Entreprise. La majorité cégétiste y a cou.
quis de haute lutte les organismes sociaux: cantine, colonies de vacan-
ces, etc... Elle y planque une armée de réserve qui, le cas échéant, sort
toute fraîche, ou pour organiser une grève ou pour la saboter. Elle
peut récompenser un bon militant en lui donnant un bon poste dans ses
services, un directeur de cantine est aussi grassement payé que dans
n'importe quelle cntreprise capitaliste. — D'organisation syndicale, elle
devient organisation patronale et elle demande à ses employés non selu
lement leur force de travail, mais aussi leur dévouement à la cause. ''e
privilège est évidemment convoité par les centrales concurrentes qui
sont traîtées en parents pauvres.
Ces centrales F.0, C.F.T.C., S.I.R., C.G.C., dénoncent souvent
Comité d'Entreprise car elles voient toutes les possibilités qu'elles pour-
raient en tirer si elles le détenaient elles-mêmes.
Dernièrement, nous avons assisté à un marchandage de ce genre.
Devant les offres d'unité d'action de la C.G.T., les autres centrales
syndicales lui demandaient une place à la Direction des Services Sociaux
donnant, donnant!
Pour réaliser cette unité-là, il ne s'agissait plus d'échanger des
paroles, il fallait troquer des slogans d'unité d'action contre la gérance
de 350 millions de francs.
La C.G.T. a jugé que l'unité d'action à laquelle elle semblait atta-
cher le plus grand prix en parole, ne valait pas jusqu'à sacrifier les
bonnes places et le contrôle du magot. Alors ce fut la comédie habi.
tuelle. Les tracts se sont sucédés, la C.G.T. a dénoncé les concurrents et
les concurrents ont pleurniché et ont aussi dénoncé.
La Direction peut se féliciter de la chose. Il lui suffit de prendre
350 milions sur le salaire des travaileurs et de les distribuer au C.E.
pour voir aussitôt la discorde s'établir entre les syndicats autour de
l'argent.
Cette discorde arrive à passionner certains ouvriers, laisse indiffé-
rents d'autres, mais elle occupe les syndicats et permet de distraire les
ouvriers de leurs véritables problèmes de classe.
Pendant cette querelle il y avait aux fonderies 300 ouvriers qui
faisaient grève. S'ils se battaient eux, ce n'était pas pour se partager
les bonnes places mais pour se défendre contre ce que la direction vou-
lait leur prendre. Il y avait 300 ouvriers qui faisaient la grève mais le
bruit de leur lutte était savamment étouffé par le bruit de la dispute
entre les Centrales syndicales. Là encore la Direction pouvait se frotter
les mains.
Si l'unité syndicale s'arrête dès qu'il s'agit d'avoir de bons postes ou
de partager la gérance d'une véritable entreprise, on peut imaginer ce
qu'elle serait demain si l'enjeu était plus important.
La lutte autour du C.E. chez Renault est un cxemple typique d'une
lutte syndicale étrangère aux luttes ouvrières. Les syndicats intervien.
nent dans les luttes ouvrières, approuvent ou désapprouvent ces luttes,
204
concilient, aident ou sabotent ces luttes. Dans le cas présent, il s'agit
d'un problème tout différent : les ouvriers n'appellent pas les syndicats
pour les défendre contre la direction, ce sont les syndicats qui appellent
les ouvriers pour défendre leur propriété. Et là le puissant édifice de la
force syndicale laisse voir ses lézardes. C'est l'envers du décor qui appu.
raît. Malgré les tracts et l'agitation que fait la C.G.T. demandant Gilx
ouvriers de s'organiser pour la soutenir, les travailleurs ne volent pas
au secours du syndicat qu'ils ont pourtant élu à la tête du C.E. La
force syndicale chez Renault apparaît dans de telles circonstances souls
son véritable jour. La force syndicale, ce sont les milliers de bouts de
papier que sont les bulletins de vote, ce sont les textes de loi bour.
geoise, ce ne sont même plus les timbres syndicaux qui se font de plus
en plus rares sur les cartes. Les bonzes ont beau se pavaner dans des
congrès, prétendre représenter des milliers d'ouvriers, ils ne représen.
tent ni leur volonté ni leur combativité.
Les ouvriers ne venant pas aider la C.G.T. dans cette affaire et la
direction ne voulant pas céder, il ne restait plus qu'une solution: la
C.G.T. finit par céder et consentit à partager les postes de direction
des services sociaux du C.E.
L'importance de ces postes pour la bureaucratie syndicale se com-
prend facilement. D'après les chiffres publiés dans Le Monde du 2 no.
vembre et que la C.G.T. n'a pas contesté à ce jour le directeur
des services sociaux louchait comme salaire mensuel de base 205.977 fr.,
plus des primes au coefficient 800; le directeur adjoint, un salaire men-
suel de base de 154.937 fr.; le chef du bureau du club sportif, 137.900 fr.;
un « agent technique » de la contine, surnommé par les ouvriers le
a goûteur de sauces », 85.800 fr. Au total, la bureaucratie de la C.G.T.
disposait de 250 à 300 postes, par rapport auxquels elle agissait en
véritable patron
la qualification principale des employés devant être,
bien entendu, la fidélité totale à l'égard de l'appareil bureaucratique.
Voici un deuxième article tiré de Tribune Ouvrière n° 28 du mois
d'octobre, paru après cet accord et qui traite de la question générale elu
Comité d'Entreprise.
Depuis le retour des vacances, nous sommes inondés de tracts nous
informant de la bagarre qui se joue entre les organisations syndicales
et la Direction autour du Comité d'Entreprise.
Nous ne voulons pas rentrer dans le détail des polémiques sordides
qui se développent autour de l'assiette au beurre.
Nous voulons seulement profiter de cette « bagarre » pour nous
remettre en mémoire le véritable rôle des Comités d'Entreprises.
Le 22 février 1945, le gouvernement provisoire institua les Comises
d'Entreprises (Ordounance 45280). Que nous apprend l'exposé des motifs'
de cette ordonnance? « Le grand mouvement qui a libéré la France je
l'ennemi n'a pas été seulement un mouvement de libération nationale;
il a été également un mouvement de libération sociale. » Et plus loin:
« aussi bien, dès la libération du pays des comités de production ou des
comités de gestiou se sont-ils constitués spontanément dans de nome
breuses usines ».
Bien sûr, le plus souvent ces comités étaient dirigés par des représ
sentants qui n'avaient nullement l'intention de les conduire dans une
voie révolutionnaire. Mais tant que ces comités n'étaien! régis par alicu.79
loi, il existait toujours une possibilité pour que les travailleurs chasse!it
les mauvais dirigeants et se servent des comités qu'ils avaient formes
pour mener eux-mêmes leur propre lutte sociale. C'est pourquoi l'exposé
des motifs précise: « Le moment semble venu de légaliser et de géne.
raliser l'existence de ces organismes ». Contrôler les Comités d'usinag
existants ou ceux qui pourraient se former en les ein prisonnant dans le
cadre de textes légaux qui n'avaient même pas force de loi puisqu'ils
émanaient d'un gouvernement provisoire qui n'avait pas étéélu par !
suffrage universel, voilà à quoi visait l'ordonnance du 22-2-45.
Cette ordonnance définit clairement les attributions du C.E.: « Ces
comités ne sont pas, dans le domainc économique, des organismes de lé.
205
resser
oision. Les Comités d'Entreprises ne seront que consultatifs sauf en ce
qui concerne la gestion des œuvres sociales ».
L'exposé des motifs insiste sur les droits (sic) des C.E. qui peuvent
proposer des mesures tendant à améliorer le rendement et accroître la
production; il insiste également sur le fait que le Comité d'Entreprise
ne saurait avoir un caractère revendicatif et il termine en indiquant
« qu'il est indispensable d'associer les organisations syndicales à la
grande æuvre de rénovation de l'industrie française ).
Un peu plus d'un an plus tard, fut votée la loi 46.1065 du 16-5-46
qui modifiait quelque peu l'ordonnance du 22-2-45. On présenta cette loi
aux ouvriers comme un élargissement des droits des Comités d'Entre-
prises. En effet, cette loi supprimait l'exclusivité antérieure en ce qui
concerne les questions de salaires. Désormais, les C.E. pourront s'inté-
aux problèmes des salaires de l'entreprise mais ainsi que ie
faisait remarquer M. A. Croizat dans sa circulaire d'application ilu
31-7-46: « il doit se placer sur le plan de l'entreprise et aborder les
questions de salaires sous leur aspect économique. C'est en tenant
compte des possibilités économiques et financières de l'entreprise et
aussi des conditions techniques dans lesquelles elle fonctionne que le
Comité sera amené à étudier les questions de salaires ». Ainsi, M. Ĉroizat
imposait au C.E. de se placer du point de vue de la marche de l'en-
treprise c'est-à-dire du point de vue du patron et non du point de vue
des ouvriers.
Tant que, grâce à l'appui du « produire d'abord », les « dirigeants »
ouvriers aidèrent le patronat à reconstruire ses industrie, celui-ci favo-
risa au maximum la marche des Comités d'Entreprises. A cette époque,
plus encore qu'aujourd'hui, le matériel du C.E. servit à répandre des
tracts dans l'usine. Mais comme ces tracts demandaient aux ouvriers de
retrousser les manches, M. Lefaucheux, ne s'en plaignit jamais. « L'accé.
lérateur », journal du C.E. fu tmême écrit et imprimé avec l'aide de
la Direction.
En 1947, les ouvriers ne purent plus se contenter des slogans publi.
citaires du C.E. et des syndicats. Il leur fallut entrer en lutte pour
riposter à la diminution constante de leur pouvoir d'achat. Les saltini-
banques du C.E. et des syndicats furent impuissants à endiguer la lutte
des ouvriers bien que, malheureusement, ils réussirent à la freiner consi-
dérablement. Mais à ce moment-là, la Direction jugea que ses valets ne
remplissaient plus leur rôle et elle les écarta de plus en plus.
Le rôle du Comité d'Entreprise fut alors limité au rôle de gestion
des cuvres sociales, et en 1951, la Direction rogna les attributions finan.
cières du C.E. au minimum que lui imposait la loi. La Direction aurait
pu trouver des artifices légaux pour retirer aux syndicats la gestion des
cuvres sociales. La preuve, c'est que chez Citroën la Direction gère elle-
même ses peuvres sociales et le Comité d'Entreprise peut toujours proa:
tester contre cette illégalité, cela ne change rien. Chez Renault, la Di-
rection jugea qu'elle pouvait encore utiliser le C.E. pour mener
politique et elle s'en servit.
D'abord pourquoi la Direction s'ennuierait-elle a gérer des cuvres
sociales ? Ce n'est pas une activité rentable. Et puisque c'est elle qui
tient la clé du coffre-fort que risque-t-elle?
Ne vaut-il pas mieux pour la Direction que quelques dizaines de
militants s'occupent des cuvres sociales plutôt que des revendications
ouvrières? Si ces militants sont sincères et honnêtes, il vaut mieux pour
la direction qu'ils utilisent leur sincérité et leur honnêteté à gérer des
organismes qu'elle serait bien obligée de faire fonctionner si ces mili-
tants ne s'en chargeaient pas. Et si dans la quantité, certains se corrom.
pent dans la course aux bonnes places, c'est encore la direction qui
gagne spéculant l'incapacité la malhonnêteté des
a responsables ».
Dans l'affaire qui vient d'éclater à la R.N.U.R., la Direction reproche
au Comité d'Entreprise d 'avoir dépensé en neuf mois ce qu'il aurait dû
dépenser en douze. Le C.E. rétorque que les sommes allouées étaieat.
insuffisantes et que ce qui a été dépensé a profité aux ouvriers,
sa
en
sur
ou
206
Dans sa lettre au personel, M. Dreyfus ne manque pas de souligner
la mauvaise gestion des oeuvres sociales. Voilà ce que c'est que d'accepter
d'être le gérant des activités improductives du patron. On fait le travail
à la place du patron et en remerciement, il vous flanque son pied an
derrière.
Nous avons montré au début de cet article que le rôle des C.E. avait
été de détourner le mouvement de libération sociale des travailleurs verg
la reconstitution des biens économiques du patronat,
La gestion des oeuvres sociales par les Comités d'Entreprises permet
aux patrons de discréditer la capacité de gestion des ouvriers. Certains
prétendent que dans les C.E., des ouvriers font l'apprentissage de la
gestion. Nous n'avons pas à apprendre à gérer les affaires des capi-
talistes. Nous devons apprendre à gérer nos propres affaires. Cela ne
peut pas se faire en collaboration avec la bourgeoisie, mais contre elle.
LA FUREUR DE VIVRE
Nous détachons d'une étude d'amis des Etats-Unis sur la civilisation
ainéricaine le fragment suivant, à propos du film La fureur de vivre, pro-
jeté ce printemps à Paris. La rupture profonde entre la société établie
et la jeunesse, analysée dans ce texte à propos des Etats-Unis, a éclaté
depuis deux mois avec la violence qu'on sait en Europe orientale.
« Il est d'abord nécessaire de comprendre la situation singulière des
a classes moyennes » aux Etats-Unis, ces gens économiquement puissants,
dont le revenu va de dix à vingt mille dollars par an (1). Dans un pays
comme la Grande-Bretagne, à un niveau de revenu quelque peu inférieur,
les gens de cette catégorie ont maintenu en politique, dans les arts et en
général dans la vie sociale, des principes de patriotisme, de culture, de
sobriété et d'honnêteté au service de la société capitaliste, de l'Empire
et des traditions, tout en se montrant en même temps assez souples pour
adapter leurs principes aux revendications croissantes de la classe ouvrière.
Aux Etats-Unis, cependant, ces couches de la population ne jouent aucun
rôle important. Leurs porte-parole essayent de créer une théorie nouvelle
du conservatisme, mais en vain; le mot lui-même est tellement contraire
aux aspirations passées et présentes du pays, que leur tentative échoue,
et que même ceux qui voudraient le plus passionnément croire à cette
théorie sont obligés d'admettre qu'elle n'a de sens ni pour le pays, ni
pour eux-mêmes. Leur défaite la plus grande, la plus frappante, c'est qu'ils
n'arrivent même pas à amener leurs enfants à y croire.
Les enfants des classes moyennes sont peut-être l'exemple le plus
dramatique de l'effondrement rapide de la société américaine d'aujour-
d'hui. Dans La fureur de vivre (2) on les voit prêts à répondre à la moin-
dre provocation par des coups de couteau, à régler leurs différends par des
épreuves de résistance nerveuse, comme les sauvages les plus primitifs
dans la jungle; sauf que, là où les sauvages ne se servaient que de leurs
couteaux, eux se servent de couteaux et d'automobiles. Depuis des années,
et spécialement depuis la guerre, ces jeunes ont fait de leurs « courses
à la cocotte », de leurs jeux avec la mort, leurs clubs « anti-vierge »,
leur usage de narcotiques, un sujet banal de la conversation américaine.
Peu importe de connaître le pourcentage de ceux qui se livrent à ces
pratiques révoltantes. L'essentiel est qu'ils sont reconnus comme une partie
constituante de cette classe de la population et que tout prouve que la
situation ne fait qu'empirer.
Les auteurs du film, en montrant tant de jeunes, garçons et filles,
participant à cette orgie de cruauté et de bestialité, sans qu'aucun parmi
eux manifeste une répulsion instinctive envers un comportement si peu
civilisé, ont trahi le fait que, à leurs yeux d'adultes, ce comportement
était normal chez les jeunes ; leur tentative d'en jeter la responsabilité
sur les parents était aussi grossière qu'inacceptable.
La raison véritable de cette dégénérescence, c'est la corruption de la
société américaine, et en particulier de son système politique et de sa
207
vie publique. Cette jeunesse n'est pas différente de la jeunesse des autres
pays: pleine d'idéalisme, méprisant le danger et l'intérêt personnel, iinpa.
tiente à mettre à l'épreuve son être et son caractère au profit de causes
sans rapport avec des avantages matériels. Elle a, de plus, cette vitalité
particulière à la jeunesse américaine, une maturité physique el psycho-
logique survenant plus tôt que dans d'autres sociétés plus tradinionna.
listes; elle a la liberté et les moyens matériels (l'absence de contraintes
et les automobiles) qui lui permettent d'entrer très tôt en contact avec
la vie sur plusieurs plans. Mais les Etats-Unis n'offrent à ces jeunes ancun
moyen de se développer et de satisfaire leurs instincts d'une façon
sociale, et ceci dans un monde où les conceptions sociales doninent de
plus en plus la pensée publique et privée. En Europe, ils auraient été
disciplinés par une tradition sociale, politique et culturelle, bonne ou
mauvaise, ils l'auraient défendue ou combattue; ils auraient trouvé, à
un niveau inférieur, la tradition soigneusement maintenue de la loyauté
envers l'école, qui révèle à sa façon une vie sociale ordonnée. En Amé.
rique, leurs maîtres ne .leur ont préparé rien d'autre que l'accumulation de
richesses. En Europe, en Asie, en Amérique latine, la jeunesse iles classes
moyennes, secouée par un monde en transition, se porte en inasse vers
la politique des partis travaillistes, des partis nationalistes vu encore,
comme en France et en Italie, des partis « communistes », formant l'aile
ia plus radicale et la plus idéaliste de ces organisations. Même lorsqu'elle
se maintient dans les milieux traditionnels, elle essaie de rajeunir les
vieux partis et associations.
Aux Etats-Unis, la jeunesse des classes moyennes n'a pas ces possi.
bilités, essentielles pour ceux qui sont nés et ont grandi dans ce inondo
moderne où la conscience politique et sociale atteint une telle intensité.
Les deux hoas de la vie politique, le parti Démocrate et le parti Ripus
blicain, sont pleins de corruption et d'avidité; les anciennes méthodes
des organisations politiques indépendantes domaine ou l'Amérique a
été à la tête de tous les autres pays disparaissent et ces organisations
sont englouties par des voraces organisations bureaucratiques étatiques.
Coupée de tous les débouchés normaux qui auraient pu satisfaire ses üspi.
rations et absorber sa vigueur, la jeunesse des classes moyennes ne peut
que retourner son idealisme et son besoin d'une vie aventurcuse contro
elle-même. Elle corrompt l'aptitude technique naturelle des Américains
en faisant des automobiles les instruments d'épreuves dangereuses; son
inquiétude recherche des sensations nouvelles dans l'intensification des
rapports personnels et dans l'usage de nioyens anorinaux d'excitation. Elle
ne peut rien trouver à quoi elle puisse appartenir, rien sauf rez handles
ou groupes de relations personnelles, tous dominés par la même inquié.
Inde. Les Américains n'ont jamais été un peuple à mentalité impérialiste;
le patriotisme fanatique de pays souvent envahis et belliqueux, come la
France et l'Allemagne, leur est inconnu, et la propagande frénétique de ces
dernières années sur la nécessité d'assumer la direction du monde laisse
cette jeunesse indifférente, lorsqu'elle ne la fait pas ricaner. Le coup de
grâce est donné à ces jeunes par leurs parents, lorsque ceux-ci, privés de
tout moyen de distinction sociale autre que l'argent, essaient de frire de
leurs enfants les représentants et les agents publicitaires de leur siluation
financière et 's'efforcent, à celte fin, de détruire la facilité des rapports et
le mélange des classes sociales différentes qui est encore un des ineilleurs
aspects de la vie américaine.
Cette démoralisation de quelques-unes des forces les plus précienses
de la nation ne doit pas être confondue avec la délinquanre juvénile pure
et simple. Lorsque les enfants des pauvreg volent, ils le font p.our avoir
des choses qui leur manquent. Lorsque les enfants des classes morennes
volent, ils le font parce que cela les excite, et aussi pour voir s'ils peuvent
riussir le coup. Les enfants des pauvres n'ont pas tellement d'argent à
dépenser, ni du temps à perdre, car le travail les attend à la maison. Mais,
ce qui rst le plus important de tout, ils appartiennent à un groupo
sncial qui a ses principes établis, sa discipline, son unité quant aux buts,
tout ce qui est compris sous le terme travail. Les enfants (les pauvres
appartiennent à une communauté. »
208
TABLE DES MATIÈRES
1
66
85
R. Berthier: Une expérience d'organisation ouvrière :
le Conseil du Personnel des Assurances Géné.
rales-Vie
Questions aux militants du P.C.F.
Claude Lefort: L'insurrection hongroise
Ph. GUILLAUME : Comment ils se sont battus
D. MOTHÉ: Chez Renault on parle de la Hongrie
Pierre CHAULIEU: La révolution prolétarienne contre
la bureaucratie
R. MAILLE: Les impérialismes et l’Egypte de Nasser
117
124
134
172
LE MONDE EN QUESTION:
Suez. – Algérie : des hommes de confiance. --- La
bourgeoisie nord-africaine. Le Congrès du
Havre. Marcinelle. La lutte des syndicats
autour du Comité d'Entreprise Renault.
La fureur de vivre
par M. BLIN, A. GARROS, F. LABORDE, R. NEUVIL.
182
Les textes « Questions aux militants du P.C.F. » et « L'insurrection
hongroise » ont été tirés à part en une brochure de 48 pages. On peut
adresser les commandes à Socialisme ou Barbarie, 42, rue René-Bou-
langer (Paris-10), en joignant 100 francs (en timbres, mandat ou chè.
que postal: C.C.P. 11987-19) par exemplaire commandé.
Les lecteurs de Socialisme ou Barbarie sont frater-
nellement invités à la
REUNION PUBLIQUE
qui se tiendra le
SAMEDI 5 JANVIER 1957
à 20 h. 30 au
PALAIS DE LA MUTUALITE
(Métro : Maubert-Mutualité)
A l'ordre du jour:
LE PROLETARIAT FACE A LA CRISE
DU STALINISME
La salle de la réunion sera affichée au tableau.
" IMPRIMERIE CARACTÈRES", 5, rue Gît-le-Coeur, · PARIS-66