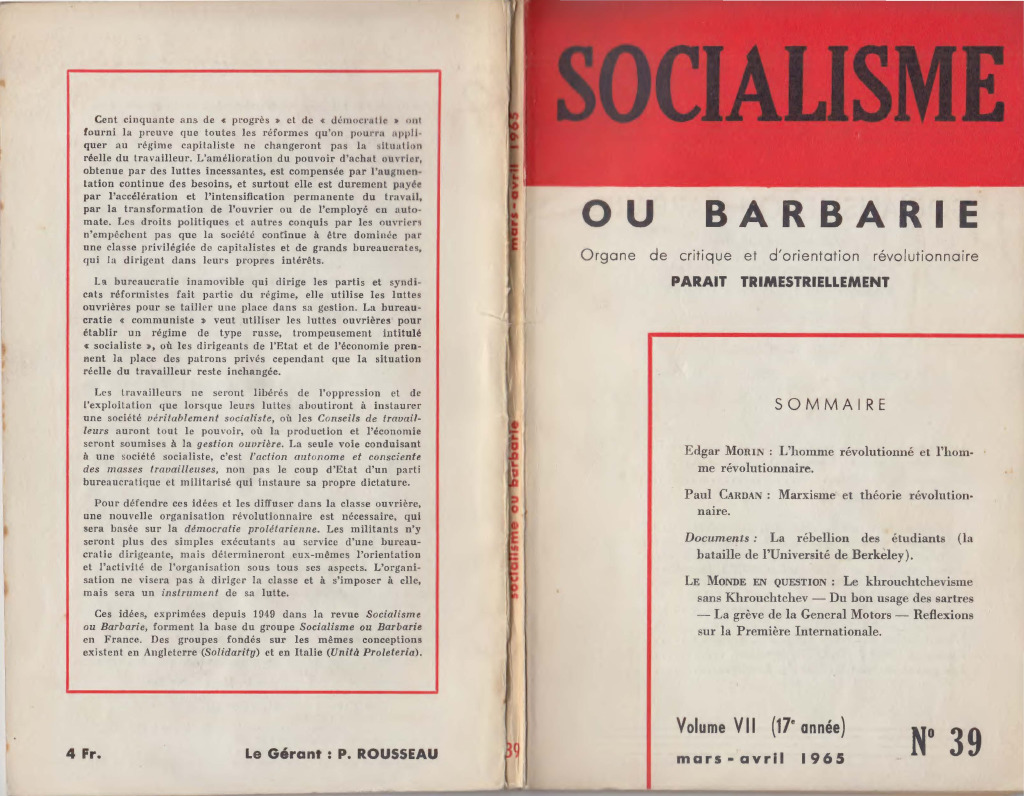MORIN, Edgar: L'homme révolutionné et l'homme révolutionnaire 39:1-15
CARDAN, Paul: Marxisme et théorie révolutionnaire (IV) 39:16-66 = FR1965A*
DOCUMENTS:
La rébellion des étudiants. La bataille de l'Université de Berkeley (traduction d'une brochure de Solidarity) 39:67-74
La mentalité de Clark Kerr (traduction d'une analyse paru dans le journal Solidarity, de la brochure The Mind of Clark Kerr de Hal Draper) 39:75-78
LE MONDE EN QUESTION:
CANJUERS, P.: La Khrouchtchevisme sans Khrouchtchev 39:79-83
Grand film sur la pêche sous-marine 39:83
TIKAL, Paul: Du bon usage des Sartres 39:83-85
LAIROT, Michel: Deux bals, deux manières 39:85-86
Des médecins et des grèves 39:86
"Apprenez le geste qui sauve..." ou l'humanisme occidental en quatre leçons 39:86-87
La grève de la General Motors annonce-t-elle de nouvelles luttes sociales? (d'après l'hebdomadaire américain Nation) 39:87-88
Surpopulation absolue et relative 39:88-89
BOURDET, Yvon: Réflexions sur la Première Internationale 39:89-91
Du bon usage de l'ethnologie, des sous-développés et des courses à pied 39:92
ANNONCE: Cercle de conférences de Socialisme ou Barbarie 39:93
PUBLICITÉS: Arguments, Présence Africaine 39:94
À nos abonnés et à nos lecteurs 39:95
Librairies qui vendent Socialisme ou Barbarie 39:95
BULLETIN D'ABONNEMENT 39:[96]
[DÉCLARATION DES PRINCIPES]
Socialisme ou Barbarie - NO. 39 (MARS-AVRIL 1965)
Table des matières
SOCIALISME OU BARBARIE
1
Paraît tous les trois mois
16, rue Henri-Bocquillon PARIS-15e
Règlements au C.C.P. Paris 11 987-19
Comité de Rédaction :
P. CARDAN
A. GARROS
D. MOTHE
Gérant : P. ROUSSEAU
Le numéro
Abonnement un an (4 numéros)
Abonnement de soutien
Abonnement étranger
4 F.
12 F.
24 F.
18 F.
nos
os 7-12,
Volumes déjà parus (I, nºs 1-6, 608 pages ; II,
464 pages ; III, nºs 13-18, 472 pages : 5 F. le volume ;
IV, nºs 19-24, 1 112 pages ; V, nºs 25-30, 760 pages : 7 F.
le volume ; VI, nºs 31-36, 662 p., 10 F.). La collection com-
plète des nºs 1 à 36, 4 078 pages : 30 F. Numéros séparés :
de 1 à 18, 0,75 F. le numéro : de 19 à 30, 1,50 F. le numéro,
de 31 à 36, 2 F. le numéro ; les suivants, 4 F. le numéro.
L'insurrection hongroise (Déc. 56), brochure
Comment lutter ? (Déc. 57), brochure
Les grèves belges (Avril 1961), brochure
1,00 F.
0,50 F.
1,00 F.
SOCIALISME OU BARBARIE
L'homme révolutionné
et l'homme révolutionnaire
(L'homme marxien, l'homme freudien et la
révolution du XX° siècle)
L'ANTHROPOLOGIE RESTREINTE DE MARX
Marx approfondit la politique philosophée du 18e siècle,
la politique révolutionnée par la révolution française, lors-
qu'il fonde une politique pour que le genre humain trouve
(retrouve ?) la vérité de sa nature. Aussi pose-t-il à la base
de sa conception l'homme générique. Celui-ci accomplit son
histoire comme recherche productrice de son propre être
mais à travers perte de substance (aliénation) et déchirement
(exploitation). Marx conçoit une politique anthropologique
qui puisse supprimer l'exploitation et réduise l'aliénation.
C'est la politique révolutionnaire du prolétariat industriel
dans la société capitaliste. Je ne reviens pas sur des thèmes
archiconnus.
A) Le principe anthropologique.
De sa critique de la philosophie, Marx fait sortir un
homme générique armé de pied en cap. C'est un Prométhée,
bâtard de l’Esprit du Monde hégélien et du bipède proprié-
taire-jouisseur-du-monde de l'humanisme bourgeois. Il porte
au poing le feu du forgeron, mais sa flamme est toute tournée
vers les ténèbres extérieures. Il souffre d'une imbécillité qui
le fait secréter rêves, mythes, institutions, dans lesquels il
aliène sa substance. Marx annonce qu'il réduira son imbécil-
lité en prenant possession de la nature.
L'homme générique de Marx n'est pas simple. Il embrasse
de multiples dimensions anthropologiques. Mais son noyau,
auquel tout le reste s'ordonne, est simple par insuffisance.
.
(N. D. L. R.) Les idées de ce texte ne sont pas nécessairement
celles de Socialisme ou Barbarie.
1
1. – Ce qui manque au regard de Marx sur l'homme, c'est
l'étonnement sur la condition humaine. « Quelle chimère est-
ce donc que l'homme ! Quelle méchanceté ! Quel chaos !
Quel sujet de contradictions ! Juge de toutes choses, imbécile
ver de terre dépositaire du vrai, amas d'incertitudes, monstre
incompréhensible ». L'interrogation de Pascal soumet au cen-
tre de la pensée la difficulté du problème humain. La pensée
n'a pas cessé de se briser sur cette interrogation. Il est si
terrible de penser vraiment l'homme que Pascal tombe lui
aussi d'une vertigineuse chute d'Icare, vers le gouffre céleste.
Certes l'interrogation de Pascal est historiquement et idéologi-
quement déterminée. Il y a une idéologie dans le caractère
exclamatif, pathétique, interrogatif, suspensif de la phrase.
Mais toute pensée forte attaque aussitôt la surface historique
où elle est née et atteint le tuf humain. La phrase de Pascal
ouvre le problème de l'homme dans sa multidimensionnalité et
son étrangeté, plus largement et intensivement que ne l'a fait
encore nulle anthropologie. Elle doit être la question première
de toute recherche, non seulement anthropologique, mais poli-
tique. La politique qui se fonde sur un homme amputé, sché-
matisé, idéologisé sera une politique amputée, schématisée,
idéologisée, qui réalisera une œuvre étrangère aux fins qu'elle
se proposait.
2. Tout s'articule, chez l'homme de Marx, autour du
noyau producteur. L'homme producteur ne considère que
comme satellites dérivés ou aliénés l'homme jouisseur-
consommateur, l'homme ludique, l'homme imaginaire, l'hom-
me mythologique. L'aliénation, où se situent rêves et mythes,
est conçue comme déperdition ; le rêve est conçu coinme disso-
lution seulement, jamais comme revitalisation du réel ; l'alié-
nation est toujours dérive ; dérivation à sens unique, jamais
échange, participation. L'affirmation d'un pouvoir, l'aména-
gement d'une technique, semblent toujours plus vrais, authen-
tiques, « réels » à l'homme marxien qu'une extase ou
adoration.
Il manque à l'homme générique de Marx un second noyau
le noyau de la psyche - qui vienne s'accoler au noyau de
l'homo faber. C'est en la psyche que confluent pour s'ordonner
et se désordonner, les puissances affectives et la puissance
mentale. Mais Marx ne cherche rien de radical ni de cardinal
dans le gouffre psycho-affectif. Et sont absentes de l'homme
générique : l'angoisse (concept cardinal qui traversera la pen-
sée moderne de Kirkegaard à Freud et Heidegger), la volonté
de puissance (toujours implicite dans la vision historique de
Marx, jamais émergée), la poésie, la folie, le mystère.
L'amour et la haine, l'imaginaire et l'inconscience sont
pour « l'homme générique », des données, non des problèmes
ou des catégories structurales. Marx ne les ignore pas, mais il ne
une
2
cherche pas à élucider l'expérience de l'amour ni à élucider
l'expérience du rêve.
L'homme de Marx n'est pas simple. Sa dualité s'exprime
à travers la dialectique qui le pousse à acquérir sa liberté par
le chemin de la servitude, à chercher son unité à travers la
division du travail, à marcher vers la plénitude par la voie
du déchirement. Etre dialectique, l'homme de Marx porte la
contradiction en lui. Mais cette contradiction semble plus
logique qu’existentielle. Mais la dualité, voire la multiplicité,
voire encore la multidimensionnalité ne sont pas conçues
comme structures nucléaires de l'être humain. La dualité de
la conscience et de l'inconscience est posée comme devant se
résorber dans les progrès de la conscience - la désaliénation,
et non comme duplicité fondamentale. Le « je est un autre »
pourrait être admis comme formulation poétique de l'alié-
nation, non comme structure de la personne. En un mot
l'homme dialectique de Marx ne se regarde jamais au miroir,
ne s'inquiète jamais de son ombre ; ne plonge pas aux profon-
deurs de l'homo duplex (et multiplex).
Marx dit admirablement le rapport dialectique de
l'homme avec la nature, la continuité-discontinuité entre l'his-
toire naturelle et l'histoire humaine. Mais si l'homme est
posé à la fois comme héritier et maître de la nature, comme
être biologique et être culturel, le rapport anthropo-cosmo-
logique n'est pas posé comme osmose ; l'affectivité étant cons-
tamment sous-estimée, c'est le rapport poétique de l'homme
avec le cosmos qui est négligé.
L'homme générique de Marx se meut dans le concret, le
réel. C'est l'homme réel, concret. Mais ce concret et ce réel
sont singulièrement étroits. La géniale critique de Marx a omis
de critiquer la notion même du réel. Le réel pratique de
Marx est celui de l'optique bourgeoise ; la science moderne en
a fait un île entre microcosme et macrocosme, le surréalisme
en a fait une banlieue. Marx ne se meut que dans un réel
restreint. C'est pourquoi chez lui l'homme imaginaire est un
dérivé-dégradé de l'homme réel, mais ne s'inscrit pas dans la
réalité de l'homme.
3
3. --- L'homme générique de Marx est à mi-chemin entre
un homme philosophique et l'homme empirique des sciences
de l'homme. D'où sa richesse potentielle, car il maintient la
communication entre recherche particulière et pensée géné-
rale sur l'homme. D'où aussi sa pauvreté relative : il garde
quelque chose de l'abstraction philosophique et il n'est pas
assez enrichi par les alluvions des sciences humaines.
Ainsi, l'homme de Marx, qui ouvre la voie à l'anthropo-
logie générale, demeure à demi-abstrait, demi-concret, à demi-
engagé dans sa gangue philosophique. Et surtout, il lui man.
3
un
que
deuxième noyau
ou plutôt un deuxième pôle
nucléaire...
Il y a chez Marx des avancées géniales dans la voie d'une
anthropologie totale -- notamment la thèse du fétichisme -
mais que l'appareil mononucléaire ne permet pas d'exploiter.
B) La dialectique de l'histoire.
Marx arrête trop tôt son prodigieux effort anthropolo-
gique. La fulgurante thèse sur Feuerbach qui répudie la
compréhension du monde au profit de la transformation
constitue comme le « pleur de joie » de Marx, Marx dès lors
cesse son effort pour comprendre l'homme dans le monde,
selon un mouvement quasi-pascalien où la « praxis » rem-
placera le Dieu d'Abraham.
L'entreprise transformatrice – révolutionnaire - s'ap-
puiera sur une notion atrophiée de l'homme, privilégiant
tout ce qui concerne la production.
La clé de la dialectique se situera dans les processus de
production et la clef de la libération de l'homme se trouvera
dans l'appropriation collective des moyens de production.
Mais en fait, implicitement, le génie de Marx pose un pro-
blème plus vaste, une contradiction dramatique.
D'une part, la solution socialiste suppose qu'il suffirait
de briser l'infrastructure de la société capitaliste pour que
se libère, une « bonté » de l'homme, qui ferait progresser
l'histoire par le bon côté.
Mais d'autre part, Marx remarque constamment que le
progrès historique s'est effectué par le « mauvais côté », c'est-
à-dire à travers l'exploitation et l'aliénation. La vision
marxienne de l'histoire est pessimiste dans son optimisme (du
progrès, du développement) puisque rien n'a pu encore
contester la prédominance du mauvais côté du progrès.
Aussi le problème des aptitudes de l'homme à la
« bonté », c'est-à-dire à faire progresser l'histoire du bon côté,
est le problème qui crie silencieusement dans toute l'oeuvre
de Marx.
Le problème des aptitudes à la bonté renvoie au pro-
blème psycho-affectif classiquement dit de la « nature
humaine », celui-là même qu'omet la recherche anthropolo-
gique de Marx, mais que pose - implicitement sa dialec-
tique de l'histoire. Peut-être, inconsciemment, Marx n'a-t-il
osé pénétrer dans la profondeur anthropologique de l'exploi.
tation de l'homme par l'homme (ce que Hegel tenta, mais
dans un sens seulement, à travers le rapport maître-esclave de
la Phénoménologie de l'Esprit), de crainte de trouver un os
irréductible ?
Implicitement, l'homme est bon-mauvais chez Marx.
Implicitement le lien entre le bon et le mauvais côté de l'his-
4
cours nouveau
toire, si variable soit-il, est indissoluble. Implicitement, et
même explicitement le chemin de l'aliénation et celui de la
désaliénation ne sauraient être dissociés. Comment dès lors
espérer un
ce que Marx appellera la fin
de la préhistoire humaine ?
Certes, on pourrait ainsi lever la contradiction : l'exploi-
tation est la donnée cardinale de l'histoire humaine, mais
parce que cette histoire a été dominée
été dominée par la pénurie
et la rareté, par le sous-développement économique (pour
prendre les mauvais mots à la mode qui permettent la
rapide communication des idées approximatives) ; le déve-
loppement des forces productives, provoqué par le capita-
lisme et le provoquant, provoquant par conséquence dialec-
tique le socialisme, permettra d'abolir l'exploitation en abolis-
sant sa cause profonde : le faible développement des forces
productives.
Cette réponse confond la cause et la condition de l'exploi-
tation. La condition de l'exploitation a peut-être été le sous-
développement, ou la rareté, mais la cause tient ailleurs. Il
faut se demander pourquoi la rareté ou le sous-développement
ont provoqué l'exploitation plutôt que la solidarité, pourquoi
les formes autoritaires, aliénantes, dominatrices, ont presque
toujours prévalu sur les formes coopératrices, libertaires,
égalitaires d'organisation sociale, lesquelles seraient les répon-
ses logiques, rationnelles au dénuement beaucoup plus qu'à
l'abondance. Pour Marx, il semble logique, « normal » qu'un
groupe ne cherche qu'à exploiter un autre. Cette constatation
à la Rochefoucauld, Marx ne peut la submerger que par une
espérance titanesque. Marx reste inconsciemment conscient
de la difficulté du problème de l'exploitation, puisqu'il n'en
voit de solution que dans une conjoncture historique-sociolo-
gique particulièrement favorable (développement et crise du
capitalisme) dominée par le rôle démiurgique d'une classe
exceptionnellement douée de « bonté » historique : le prolé-
tariat industriel. Il ne faut pas qu'il y ait faille dans l'en-
chainement et l'interdépendance entre le développement capi-
taliste, la radicalisation de la lutte des classes, l'aliénation
extrême du travail, le développement du prolétariat industriel
comme classe majoritaire consciente du processus historique,
porteuse de la revendication universelle du genre humain,
vouée à révolutionner la société, apte à gérer collectivement
et démocratiquement les forces productrices... Ce qui signifie
que la solution au problème de l'humanité est extrêmement
hasardeuse ; il suffirait pour la compromettre en toute ortho-
doxie marxiste, soit que le développement capitaliste modifie
son cours, soit que le progrès technique modifie la structure
industrielle et la situation de la classe ouvrière, soit que le
prolétariat n'ait pas le privilège, bien que victime de la pire
exploitation, de la conscience lucide, soit qu'il cesse d'être
5
1
victime de la pire exploitation, soit qu'il soit inapte à conqué-
rir le pouvoir, soit que l'appropriation collective des moyens
de production puisse donner lieu à une nouvelle exploitation,
soit que cette appropriation collective ne soit pas l'élément-clé
de la révolution...
D'où, immanquablement, la grande question. Le proléta-
riat fait-il le poids historique pour faire basculer du « bon
côté » le développement humain ? Est-il à ce point différent
par la conscience et l'efficience de toutes les autres classes
opprimées ayant existé ? Marx a-t-il chargé le prolétariat
d'une espérance pratique ou d'un rêve messianique ?
L'incertitude sur la conjoncture et l'incertitude sur le
fond, celà bien des marxistes l'ont obscurément ressenti, qui,
à la fin de la première guerre mondiale et lors de la grande
crise de 29-36, ont tenté la révolution comme chance fantas-
tique exceptionnelle, qu'il fallait forcer à tout prix ! Tandis
que d'autres, travaillés dans le secret par la même incerti-
tude, faisaient désormais confiance à l'Etat incarnation du
prolétariat, et non plus à la dialectique propre au monde
capitaliste.
Et, peut-être, la fragile et prodigieuse espérance née de
la dialectique marxienne a-t-elle déjà très tôt chaviré au
profit d'une foi messianique dans le prolétariat, qui s'est elle-
même cristallisée fétichisée dans la foi religieuse dans
le Parti.
Si l'on supprime dans Marx l'espérance dans la mission
du prolétariat, on revient à l'optimisme-pessimisme dialecti-
que, et au cheminement historique progressif qui s'effectue
par le mauvais côté : le cours actuel du monde occidental,
celui du monde de l'Est, fourniraient deux illustrations anti-
thétiques de ce progrès s'effectuant par le mauvais côté
l'exploitation de l'homme par l'homme, l'aliénation.
Sans l'espérance messianique, le marxisme serait, comme
le freudisme, un diagnostic passionné ; ce serait un optimisme
tragique ; un pessimisme seulement compensé, mais profon-
dément compensé, par l'idée du progrès.
Or, l'histoire n'a pas correctement rempli le schéma révo-
lutionnaire fixé par Marx. La classe ouvrière dans les pays
occidentaux s'est laissée ou diviser, ou embourgeoiser, ou
dominer ou mythifier (y compris par le stalinisme). Les
classes ouvrières les plus concentrées, les plus nombreuses se
sont inscrites dans la société des grands pays capitalistes, cette
insertion transformant la société, mais ne la révolutionnant
pas. En U.R.S.S. et dans les démocraties populaires, les classes
ouvrières ont dû subir le travail disciplinaire. La collectivi-
sation des moyens de production a été une étatisation qui n'a
pas empêché la domination de l'homme sur l'homme. Nulle
part le prolétariat n'a pu remplir sa mission « historique ».
Pour croire qu'il remplit cette mission, il faut transférer l'es-
6
sence du prolétariat hors du prolétariat réel, sur le parti. Il
faut confier au Parti la mission du proletariat. Il faut voir
dans le parti la conscience désaliénée, le pouvoir capable
d'opérer la révolution authentique. La foi dans le parti consa-
cre, pour mieux la dissimuler, la mort de la foi dans la classe
ouvrière. L'homme aliéné dans le parti prétend être l'homme
désaliéné.
Toutes les transformations, déformations, réformations du
marxisme, toutes ses incarnations, social-démocrates, stali-
niennes, trotskystes, font douter que la réalisation du marxis-
me dans l'histoire soit effectivement la réalisation de l'histoire
dans le marxisme. Le triomphe institutionnel et idéologique
du marxisme a été son effondrement humain. Le marxisme
a vaincu par son mauvais côté.
La lacune anthropologique du marxisme a été colmatée
par l'espérance messianique. L'excès de la promesse venait
de l'insuffisance de la théorie... Puis la dogmatisme a coagulé,
durci l'espérance messianique : ainsi les fois deviennent
églises...
La crise du marxisme victorieux et flétri est d'autant
plus féconde qu'elle nous amène à redécouvrir l'homme mysti-
que, magique, religieux, messianique au coeur même de la
citadelle qui prétendait lutter au nom et avec les armes de
la raison, de la science, etc... Elle sera d'autant plus féconde
qu'elle amène à une reconsidération de l'homme, une nouvelle
découverte de l'homme non seulement les évidences que le
« marxisme-leninisme » avait occulté, mais la profondeur des
racines du problème anthropologique. Celà, à condition de
ne pas occulter à son tour le noyau marxien...
L'HOMME FREUDIEN
Il faut à la fois remédier à l'insuffisance marxienne et
renverser la suffisance marxiste. On recourra d'abord à Freud,
complément explosif à Marx, car le couple Marx-Freud fait
exploser à la fois marxisme dogmatique et psychanalyse dog-
matique (d'où la quasi impossibilité des synthèses au niveau
marxisme-freudisme, bien qu'il y ait une extraordinaire
complémentarité Marx-Freud).
Unir Freud à Marx c'est conjoindre au noyau de l'homo
faber le noyau de l'anima. L'âme est ici la notion protoplas-
mique colloïdale, où communiquent la nature affective de la
vie et la nature psychique de l'homme ; c'est la plaque tour-
nante du complexe psycho-affectif. L'âme n'est donc pas une
donnée ultime mais un complexe en mouvement, difficile à
définir.
Les deux noyaux constituent
une bipolarité
autour de laquelle s'ordonne le phénomène humain. Ils fon-
dent deux infrastructures, l'une produisant l'outil, l'autre
comme
7
secrétant le rêve. Ces deux infrastructures dépendent mutuel-
lement l'une de l'autre, se trouvent souvent en communication
étrange, mais on ne saurait les réduire l'une à l'autre.
Le fantastique jaillissement de barbarie au cœur de la
civilisation occidentale qu'ont constitué deux guerres, les
fascismes et le stalinisme, nous oblige à regarder la tête et
le coeur de l'homme.
Pour Freud comme pour Marx, mais plus explicitement,
l'homme est fondamentalement et dialectiquement bon-mau-
vais. Fondamentalement car l'homme est le sujet d'un conflit
radical, et que ce conflit est le foyer de ses progressions comme
de ses régressions, mieux, d'un perpétuel mouvement progres-
sif-régressif. Dialectiquement, le bon peut naître du mauvais,
le mauvais du bon. La nature du bon-mauvais est instable,
car le moi est instable, formé génétiquement et travaillé cons-
tamment, non seulement par l'antagonisme d'Eros et Thana-
tos, mais aussi par la lutte permanente entre la pulsion et la
répression, le Soi et le Surmoi. Les dérivations sublimées des
conflits (l'art, la culture, la civilisation), sont en principe
« bonnes », mais comportent leur poison et leur insuffisance ;
les régressions névrotiques et pyschotiques sont en principe
« mauvaises », mais les mécanismes qui se bloquent dans la
névrose ne sont-ils pas ceux qui entretiennent la « santé » de
la vie normale ? Le plus remarquable, dans l'axe de l'anthro-
pologie freudienne, est que l'homme (mauvais-bon) est consti-
tutionnellement névrosé-sain. L'homme vit une situation
névrotique permanente qui est la condition de sa santé. Dès
l'origine, la conscience de la mort lui est un traumatisme qui
le suit toute sa vie, et cristallise la religion comme « névrose
obsessionnelle de l'humanité» ; dès l'origine le rapport avec
le monde et avec autrui l'amène à doubler son rapport pra-
tique (l'outil, le travail) d'un rapport magique (le rite, le
fétiche, la possession) ; dès l'origine la répression fondamen-
tale --- le tabou - qui établit la règle sociale, le stabilise et
le détraque à la fois, et refoule une part torrentueuse de lui-
même dans l'imaginaire. Ainsi l'homme social est inadapté à
sort biologique d'être mortel ; l'homme biologique est
inadapté à son sort social d'être réprimé. Cette double inadap-
tation projette l'homme dans les délires, mais en même temps
le catapulte dans le devenir.
Les permanents déchirements à l'intérieur des groupes,
les guerres entre les groupes, les déchaînements de foi, de
ferveur, de haine, les destructions et exterminations qui cons-
tituent comme le tissu shakespearien de l'histoire humaine
nous montrent que sous un certain angle l'histoire est patho-
logie en devenir. Ceci ne doit pas nous masquer le logos qui
cherche à s'ébaucher dans l'histoire, mais le Logos ne doit
pas nous masquer l'Hybris. A vrai dire, l'histoire est folle raison-
nable (dans l'excès des ruses de la raison il y a folie, mais
.
son
8
dans toute folie, il y a quelque raison), névrotique-saine. L'his-
toire, à la différence de la névrose qui est blocage, fixation, et
répétition, est aussi changement et déséquilibre. C'est par cette
histoire pleine de bruit et de fureur que l'homme échappe
finalement à la vraie folie, qui est verrouillage sans recours.
Le devenir est le déséquilibre équilibrant, l'équilibre-déséqui-
libre. La santé affective, mentale, morale, (énergie, volonté,
amour, curiosité), naît du déséquilibre (le changement, les
ruptures, les aventures, les paroxysmes). Les grandes névroses
obsessionnelles collectives (les idolâtries nationales, religieu-
ses, les boucs émissaires) procurent la santé individuelle.
J'ai déjà traité ce thème de la structure saine-névrotique
de l'existence et de l'histoire (1), et il faudra que j'y revienne
plus loin, que j'aille plus loin. Ce qu'il faut voir, et ici Marx
et Freud sont d'accord, mais Marx ne veut voir que dérivation,
aliénation, état historique, alors que pour Freud c'est aussi
état anthropologique, ce qu'il faut voir c'est l'homme
moderne entouré de totems, idoles invisibles mais pesant de
toute leur intimidation, qui se nomment Etat, Nation,
Famille ou qu'il appelle Valeurs, c'est qu'il a toujours besoin
de cérémonies et de rites, c'est que sa substance psycho-
affective vit toujours sauvagement de la substance d'autrui,
que les âmes se dévorent et s'enlacent comme des pieuvres,
que notre modernité plonge dans l'archaïsme fondamental.
L'homme est toujours cet être qui s'agite, trépigne, danse
quand on frappe sur un tambour, qui frémit, s'exalte quand
sonne le clairon ; que les ombres épouvantent ou irritent ;
qui croit voir l'éternel dans ce qui passe, qui met l'essence
dans l'apparence ; qui commerce avec l'invisible et l'inexis-
tant ; ses colères, ses peurs, ses amours, sont hors de propor-
tion avec leur objet, ou sont dénués d'objet. S'il obéissait à
ses rêves ou seulement les laissait percevoir, il aurait honte
et on aurait peur. Il se bat toute son existence contre sa
son malheur ou son bonheur dépendent de
drames d'enfance minuscules qu'il aura vécu comme cataclys-
mes. Il ne sait pas encore aimer vraiment, mais l'amour gicle-
rait de partout s'il se libérait, comme giclerait de partout la
haine. Il lui faut un long, constant, terrible effort pour perce-
voir exactement ce qu'il voit et concevoir ce qu'il ressent.
Le problème de l'homme, le problème des rapports
humains, est ainsi un problème anthropologique général qui
nous renvoie à la structure conflictuelle, névrotique-saine de
l'homme. L'aliénation n'a pas sa racine dans un état donné
des forces productives, mais renaît potentiellement, perpé-
tuellement, sous des formes, nouvelles ou non, de cette structure.
Dans ce sens, l'exploitation de l'homme par l'homme, où Marx
(1) L'Homme et la mort, Corréa, 1951.
9 -
avait situé la clé et la clef du problème des rapports humains,
ne correspond pas seulement à des conditions historiques don-
nées. Elle correspond aussi aux structures névrotiques de
l'existence, aux rapports névrotiques d'homme à homme, ce
qu'indiquait déjà la perspicace psychanalyse faite par Hegel
du rapport maître-esclave, où le maître est acharné à se faire
reconnaître comme sujet-dieu, où la névrose du maître est
posée comme possibilité de l'espèce humaine. N'est-ce pas cette
névrose du maître que Marx offre à l'espèce humaine, en lui
proposant de régner sur une Nature esclavagisée, objectivée... ?
Marx a cru que l'homme pouvait trancher gordiennement
le rapport maître-esclave, celui de l'exploitation de l'homme
par l'homme, au niveau de la propriété de la production, alors
qu'il s'agit d'un des noeuds du problème multidimensionnel
de l'être humain. Il n'a pas entrepris de démêler, de dénouer
le noeud gordien, mais il a tranché en-dessous, ignorant,
oubliant, ce que Fourrier et Proudhon avaient senti dans leur
infantile génie, que les rapports humains doivent être traités
dans leur double infrastructure... On peut même désormais
penser que la solution marxienne, ignorant la bipolarité du
problème humain, risque d'accroître le déséquilibre, en per-
mettant des développements cancérigènes, autour précisément
des moyens de production. Nous avons pu découvrir avec une
stupeur qui témoigne de notre simplicité d'esprit, qu'il
pouvait y avoir pire que le chancre capitaliste sur la produc-
tion industrielle.
Marx espère que la solution gordienne apportée au pro-
blème de l'exploitation va permettre à l'homme de domesti-
quer l'histoire, mais peut-être contribue-t-elle de façon inédite
à son dérèglement ?...
Comment, dès lors, envisager une révolution anthropo-
logique ? Alors que Marx dépasse son pessimisme par le mes.
sianisme (la grande espérance des grands pessimistes) Freud
reste muet, parce qu'une telle révolution supposerait une
transformation structurelle et multidimensionnelle dont il ne
croit pas tenir les clefs (cf. Malaise dans la Civilisation) préci-
sément parce qu'il en a localisé les clés. Freud est même très
pessimiste sur la civilisation, ce minimum humain policé, dont
il connaît la fragilité extrême. Il ne prône même pas la libé-
ration sexuelle, qui sera le thème de quelques épigones dissi-
dents. Il craint au contraire la liberté des pulsions ; il sait
que la civilisation est nécessairement répressive, qu'elle dérive
d'une répression. Il connaît les forces terribles enchaînées par
le sur-moi et il ne tient pas à ce qu'elles se déchaînent. Il
est, dans un sens, du côté de la répression. S'il avait à formu-
ler une politique, elle serait double : « libérer et enchaîner ».
Et pourtant ce n'est pas un esprit timide (bien qu'il ait vécu
et senti, nous dit Sperber, en petit bourgeois). C'est le plus
irrespectueux des penseurs de ce siècle. Le freudisme, c'est une
10
prudence. Dévoilant le problème humain dans son ampleur
et sa profondeur, il n'apporte aucun enchantement qui puisse
faire oublier la découverte. Le freudisme se déclare impuis-
sant à fournir une praxis révolutionnaire. Il ne s'en dégagera
finalement qu'une pratique « réformiste » de l'adaptation
individuelle à la vie sociale. La psychanalyse institutionna-
lisée, racornie, oubliera, perdra la dimension anthropologi-
que de Freud (exception faite de grands penseurs, dissidents
ou orthodoxes, de Jung, Rank à Lacan) et ne visera qu'à
adapter l'homme à la vie sociale, à le guérir de ce qui l'em-
pêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne dits nor-
maux, dans une civilisation donnée.
Mais quiconque veut aborder à nouveau le grand pro-
blème politique doit se tremper dans le pessimisme calme de
Freud comme dans le pessimisme-optimisme de Marx. C'est
parce qu'il plonge plus à fond que Marx dans le tuf anthro-
pologique que Freud ne voit pas de réponse. Mais n'a-t-il pas
négligé la science, la technique, "l'homme producteur ? A
Freud, il manque l'homo faber. A Marx la psyche. Ces deux
noyaux de l'homme attendent encore de se rejoindre, pour
qu'on puisse fonder une politique qui ne soit pas mutilée de
naissance.
Celle-ci sera-t-elle révolutionnaire ? Si l'on arrache au
marxisme sa sécrétion messianique, on découvre un grand
silence de Marx sur le problème de la révolution qui rejoint
celui de Freud. Il faut reprendre ce problème, dans sa double
dimension, la double polarité, la double infrastructure, et
le confronter au monde actuel ; en évitant, cette fois, que de
l'excès de pessimisme, naisse inconsciemment, irrésistiblement,
le contre-courant le salut messianique. C'est du nihilisme que
naît la foi frénétique...
LA REVOLUTION.
La conception d'une politique de l'homme, qui émerge
avec Rousseau et Marx, devient révolutionnaire dès qu'elle
accentue sa progressivité, sa radicalité ou sa religiosité (je
veux dire la religion de l'homme).
A) La crise de la révolution.
Mais l'espérance révolutionnaire profonde, celle de chan-
ger les rapports humains (j'essaierai de voir plus loin ce que
peut signifier cette formule) n'est-elle pas découragée par la
réflexion anthropologique ? Ne faut-il pas méditer à nouveau
sur le pourrissement des révolutions, leur corruption par le
pouvoir, le détournement des fins proclamées par des forces
inconscientes? Ne faut-il pas ajouter, à la liste des révolu-
tions qui ont cru changer le sort de l'humanité, la révolution
11
d'origine marxiste et d'intention communiste ? La faillite
humaine du communisme stalinien, la faillite par embour-
geoisement du social-démocratisme posent la question du
socialisme comme révolution anthropologique. Le marxisme a
porté l'une des plus ardentes espérances de toute l'histoire de
l'humanité, la plus grande espérance profane, terrestre... Cette
espérance, faut-il l'abandonner ? Et n'avaient-ils pas déjà en
fait abandonné l'espérance, ceux qui l'avaient transformée en
foi inconditionnelle ?...
Certes, nous assistons à des révolutions de développement,
qui renversent des tyrannies, s'efforcent vers l'avenir (qui
connaissent aussi, par rapport à leur idée-mère, leur idée-
force, sclérose, ou déviation, ou putréfaction, ou régression)...
Elles tendent par l'idée, elles pré-tendent vers et se prétendent
la révolution. Mais la révolution, celle de l'homme, et non
celle des systèmes, celle que Marx et Lénine ont voulu réaliser
à travers la révolution des systèmes, elle est en crise. Elle est
balayée à l'Ouest par l'évolution, dénaturée à l'Est par la
régression, engluée dans l'archaïsme du Tiers-Monde.
B) La crise révolutionnaire.
La révolution est en crise dans le monde. Mais au même
moment, c'est le monde qui est en crise révolutionnaire. Au
moment où il faut sonner le glas de la révolution, il faut
sonner le glas du conservatisme et de l'évolutionnisme. Car
si nous ne vivons pas la révolution annoncée par les révo-
lutionnaires nous vivons la plus fantastique révolution de
l'histoire de l'homme. Nous ne vivons pas la révolution de
civilisation, nous vivons la révolution sauvage provoquée,
conduite, accélérée par les développements de la science.
Sauvage parce que dépourvue d'idées-guides et de régulateurs,
échappant à tout contrôle, à commencer par celui des savants,
qui contrôlent aussi peu la cause, le mouvement que l'exploi-
tation de leurs découvertes (quel extraordinaire paradoxe
que les hommes en théorie porteurs de la science soient en
fait les médiums des forces occultes qui les ont élus pour se
déverser en torrent dans le monde !).
La révolution scientifique, qui se répercute en révolution
technique, puis de proche en proche perturbe, modifie,
transforme tout le corps social, est une révolution déchaînée.
Cette révolution d'abord orientée sur le milieu naturel,
s'est rapprochée en cercles concentriques de l'être humain,
l'enveloppant, le ceinturant, pénétrant brusquement dans son
âme par le flux des mass media, s'apprêtant à pénétrer dans
les arcanes génétiques, le Saint des Saints où précisément
repose le pouvoir de transformer, biologiquement l'homme...
L'homme d'ores et déjà est potentiellement transmutable
-- chimiquement, génétiquement et celà au moment où
12
s'annonce la possible transmutation de ses rapports avec le
cosmos. Nous devinons les possibilités de révolutions inouïes,
inimaginables aux esprits les plus révolutionnaires des décen-
nies précédentes, -mais qui ne portent nullement la certitude
du monde meilleur, c'est-à-dire de l'homme meilleur.
La planète est livrée à une révolution déchaînée. Désin-
tégration ? Nouvelle genèse ? Métamorphose ?
En même temps qu'elle vit cette révolution, la planète
appelle une révolution du simple fait qu'elle appelle son
unité ; l'unité planétaire est l'exigence rationnelle minima
d'un monde rétréci et interdépendant. Mais l'unité planétaire
ne saurait se réaliser qu'au prix d'une transformation géné-
rale des structures (mentales, nationales, sociales, économi-
ques) existantes, c'est-à-dire, pratiquement, une révolution
générale.
Ce monde est impossible et la révolution y est impos-
sible. Cette contradiction appelle un cataclysme général, ou
une solution générale, mais peut-être aussi la contradiction
générale continuera-t-elle, cahin-caha...
Pas éternellement, car le développement de l'espèce
humaine qu'il faudra bien de moins en moins envisager
comme seulement économique sera tôt ou tard, par un bord
ou par l'autre, de plus en plus lié à la fois comme cause et
effet à l'idée de révolution. C'est du reste pourquoi les grands
penseurs planétaires de l'époque, comme Perroux, Berque,
débouchent non seulement sur une anthropolitique, mais sur
une vision révolutionnaire... (Ce qui a vieilli dans Marx, ce
n'est pas l'idée de révolution comme le croient les esprits
badernes, c'est l'étroitesse d'où l'erreur du schéma révolu-
tionnaire. La révolution marxiste est morte. Aussi bien de son
échec (à l'Ouest) que dans son triomphe (à l'Est). Cela ne
liquide pas le problème révolutionnaire. Au contraire cela le
met d'autant plus à l'ordre du jour).
Le monde vit dans une révolution et appelle une révo-
lution. Mais il y a un gouffre entre la révolution folle que
nous vivons et la folle espérance révolutionnaire. Comment
faire ? L'anthropolitique ne peut éviter la révolution comme
problème et réalité cruciales. Mais elle ne peut plus consi-
dérer qu'il y ait des solutions pré-élaborées...
C) Que serait la révolution ?
Il faut repartir à la recherche, interroger à nouveau
l'appel révolutionnaire, le reconnaître, le confronter à l'an-
thropologie générale et aux processus du XXe siècle...
On ne peut partir que du désabusement. Le désabuse-
ment n'est pas le désespoir. C'est la mise à mort de l'idée
d'un salut sur terre, de la révolution devenue foi et dogme.
La renaissance de l'espoir se fait sur la mort de l'idée d'homme
13
comme
total désaliéné, sur l'abandon du rêve d'abolir la contradiction
dans l'être.
La prémisse cosmo-logique est celle-ci : le principe de
synthèse n'éteint nullement le principe d'antagonisme. La
synthèse absolue serait la mort. Il ne saurait y avoir dans le
cosmos une possibilité d'unité annulatrice des antagonismes ;
sur le plan anthropologique, cela signifie qu'il ne saurait
exister un salut, un havre historique où les conflits essentiels
seraient résolus. La limitation et l'aliénation sont constitutives
de la vie humaine.
Mais cette même dialectique qui nous interdit le salut
nous introduit à l'espoir. Il n'est nullement interdit de conce-
voir une nouvelle étape dans l'humanisation de l'homme ; ni
de la
concevoir
une étape d'importance capitale.
L'ambition d'un progrès décisif peut être à nouveau formulée
aujourd'hui. Ce progrès peut prendre la forme d'une mue.
Ane certes celui qui croit que l'homme a déjà changé là où
règnent les fonctionnaires-prêtres obèses. Mais âne aussi celui
qui ignore que le problème de la mue de l'homme a déjà
germé et ne cesse de croître.
Mais quel serait le progrès ? Comment le définir ?
C'est négativement qu'a été formulée – et avec quelle
force - la revendication révolutionnaire : extirper l'exploi-
tation de l'homme par l'homme, et plus largement, résorber
« l'aliénation » humaine...
Mais l'on voit que le problème de l'exploitation est lié
à celui de l'inégalité, de la hiérarchie, de l'autorité, de la
volonté de puissance, de la force, de la ruse... Ici, le problème
est beaucoup plus profond que ne l'avait perçu Marx. Freud
dit « l'obstacle le plus grand rencontré par la civilisation (est)
l'agressivité constitutionnelle contre autrui » (Malaise dans
la civilisation) ; il met le doigt sur l'une des difficultés, et
sur la nature quasi-biologique — générique de la difficulté.
Au plus profond de l'homme naissent la propriété, la hiérar-
chie, la domination, l'exploitation, le sacrifice d'autrui (bouc
émissaire)... Bien sûr, la nature et la nature humaine - les
mêmes -- pratiquent l'entr'aide, la solidarité, la coopération,
mais dans une dialectique intimement mêlée à l'agression, au
rapt, au meurtre. L'éducation, le prêche, la loi, la prohi-
bition, l'incitation, la restructuration (de la société) peuvent
permettre provisoirement, dans un cadre donné, et dans une
limite donnée, la suprématie du « meilleur » sur le « pire >>
de l'homme. Mais toutes ces réformes sont impuissantes à
vraiment révolutionner les rapports humains ; la moindre
scène de ménage est déjà en elle-même aussi potentiellement
sanglante que la bataille d'Eylau...
L'abolition de l'exploitation de l'homme par l'homme à
vrai dire, supposerait, non tant la réalisation de l'homme
14
générique que la modification générique de l'homme. Il s'agit
moins d'hominiser davantage que de surhomininiser ; il s'agit
de résoudre le problème de carences constitutives, d'un désé-
quilibre constitutionnel, de reviser le problème de l'auto-
régulation de l'homme. Autrement dit, la révolution comme
suppression des vices fondamentaux dans les rapports humains,
impliquerait une réforme de l'être humain. Est-elle conce-
vable, est-elle possible, est-elle souhaitable ? Gigantesques
questions qui jaillisent en même temps, mais qui jaillissent,
car la possibilité concrète de la modification générique de
l'homme se dessine aux horizons de notre siècle. La grenouille
qui gigote entre les pinces d’un vieil homme moustachu nous
annonce que le changement génétique de l'homme sera possi-
ble. Ici, nous sommes renvoyés à l'âme, au moteur effectif de
la révolution que nous vivons : la science.
Peut-on définir positivement l'ambition de la révolution,
au-delà de l'abolition de l'exploitation ?
La révolution est libératoire, mais sa fin n'est pas la
liberté. La liberté absolue se confond avec la désintégration
de tout lien social, avec le crime, comme l'avait dit Hegel,
avec le coup de revolver tiré au hasard dans la rue, comme
l'avait vu Breton. C'est la négativité absolue qui n'aurait plus
rien à nier, donc se nierait en tant que négativité...
Est-ce l'individu ? Obscurément nous sommes poussés à
réaliser la royauté de l'homme-individu, à l'affranchir de
toutes contraintes que ne nécessite pas absolument le lien
social, à le libérer même de l'esclavage du phylum - l'espèce
biologique dite humaine. N'est-ce pas dès l'origine que l'honi-
me nie mythiquement la loi phylétique de la mort en posant
la survie ou la renaissance ? Ne peut-on envisager (je l'ai
envisagé, souhaité dans mon livre l'Homme
et
la
mort) que la science permette effectivement à l'homme d'at-
teindre l'immortalité ? Autre hypothèse dans le même sens
anti-phylétique : ne peut-on supposer que la fin de l'homme
serait de se dépasser en un être non biologique, qu'ébauchent
actuellement les machines cybernétiques, qu'ont déjà rêvé les
science-fictions ?
Mais peut-être l'individualisme n'est-il qu'une des pola-
rités, qu'un des tropismes de l'humanité, qu'exagèrent cer-
taines conditions historiques et une certaine civilisation, la
nôtre...
L'homme c'est une totalité individu-société-espèce, tota-
lité contradictoire et une. L'aspiration profonde de la révolu-
tion serait sans doute de développer à la fois l'individua-
lisme, la participation sociale et la participation biolo-
gique (1).
Edgar MORIN.
(1) Ce texte est extrait d'un ouvrage à paraître : Introduction à
une politique de l'homme (aux éditions du Seuil).
15
Marxisme
et théorie révolutionnaire
V. BILAN PROVISOIRE (*)
LOGIQUE DU PROJET REVOLUTIONNAIRE.
La révolution socialiste vise la transformation de la
société par l'action autonome des hommes, et l'instauration
d'une société organisée en vue de l'autonomie de tous. C'est
un projet. Ce n'est pas un théorème, la conclusion d'une
démonstration indiquant ce qui doit inéluctablement arriver ;
l'idée même d'une telle démonstration est absurde. Mais ce
n'est pas non plus une utopie, un acte de foi, un pari
arbitraire.
Le projet révolutionnaire trouve ses racines et ses points
d'appui dans la réalité historique effective, dans la crise de
la société établie et sa contestation par la grande majorité
des hommes qui y vivent. Cette crise n'est pas celle que le
marxisme avait cru discerner, la « contradiction entre le déve-
loppement des forces productives et le maintien des rapports
de production capitalistes ». Elle consiste en ceci, que l'orga-
nisation sociale ne peut réaliser les fins qu'elle se propose qu'en
mettant en avant des moyens qui les contredisent, en faisant
naître des exigences qu'elle ne peut satisfaire, en posant des
critères qu'elle est incapable d'appliquer, des normes qu'elle
est obligée de violer. Elle demande aux hommes, comme pro-
ducteurs ou comme citoyens, de rester passifs, de se cantonner
à l'exécution de la tâche qu'elle leur impose ; lorsqu'elle
constate que cette passivité est son cancer, elle sollicite l'ini-
tiative et la participation, pour découvrir aussitôt qu'elle ne
peut les supporter davantage, qu'elles mettent en question
l'essence même de l'ordre existant. Elle doit vivre sur une
double réalité, diviser un officiel et un réel qui s'opposent
irréductiblement. Elle ne souffre pas simplement d'une opposi-
tion entre des classes qui resteraient extérieures l'une à l'au-
tre ; elle est conflictuelle en soi, le oui et le non coexistent
comme intentions de faire dans le noyau de son être, dans
* Les parties précédentes de ce texte ont été publiées dans les
nº36 (pp. 1 à 25), 37 (pp. 18 à 53) et 38 (pp. 43 à 86) de cette revue.
16
les valeurs qu'elle proclame et qu'elle nie, dans son mode
d'organiser et de désorganiser, dans la socialisation extrême
et l'atomisation extrême de la société qu'elle crée. De même,
la contestation dont nous parlons n'est pas simplement la lutte
des travailleurs contre l'exploitation, ni leur mobilisation
politique contre le régime. Manifeste dans les grands conflits
ouverts et les révolutions qui jalonnent l'histoire du capita-
lisme, elle est constamment présente, d'une façon implicite et
latente, dans leur travail, dans leur vie quotidienne, dans
leur mode d'existence.
On nous dit parfois : vous inventez une crise de la
société, vous baptisez crise un état qui a toujours été là. Vous
voulez coûte que coûte découvrir une nouveauté radicale dans
la nature ou l'intensité des conflits sociaux actuels, car cela
Genl vous permettrait de prétendre qu'un état radicalement
nouveau se prépare. Vous nommez contestation de l'essence
des rapports sociaux quelque chose qui a toujours existé, du
fait des intérêts différents et opposés des groupes et des clas-
ses. Toutes les sociétés, du moins les sociétés historiques, ont
été divisées et cela ne les a conduites qu’à produire d'autres
sociétés, également divisées.
Nous disons en effet qu'une analyse précise montre que
les éléments profonds de la crise de la société contemporaine
sont spécifiques et qualitativement uniques. Il y a, sans doute,
des pseudo-marxistes naïfs qui, encore aujourd'hui, ne savent
qu'invoquer la lutte des classes et se gargarisent avec, oubliant
que la lutte des classes dure depuis des millénaires et qu'elle
ne pourrait nullement fournir, en elle-même, un point d'appui
au projet socialiste. Mais il y a aussi des sociologues pseudo-
objectifs et tout autant naïfs qui, ayant appris qu'il
faut se méfier des projections égocentriques et « épocho-
centriques » et refuser notre tendance à privilégier notre
époque comme quelque chose d'absolument à part, en restent
là, aplatissent la réalité historique, et enterrent sous une
montagne de méthodologie en papier le problème central de
la réflexion historique, à savoir la spécificité de chaque société
en tant que spécificité de sens et de dynamique de ce sens,
le fait incontestable, même si mystérieux, sans lequel il n'y
aurait pas d'histoire, que certaines sociétés introduisent des
dimensions inexistantes auparavant, du nouveau qualitatif,
dans un sens autre que descriptif. Il n'y a pas d'intérêt à
discuter ces arguments pseudo-philosophiques. Celui qui ne
peut pas voir qu'entre le monde grec et le monde égypto-
assyro-babylonien ou même entre le monde médiéval et le
monde de la Renaissance il y a, quelles que soient les conti-
nuités et les causations évidentes, une autre différence, un
autre type, degré et sens de différence qu'entre deux arbres
ou même deux individus humains de la même époque
celui-là est infirme d'un sens essentiel pour la compréhension
17
bref, que
de la chose historique, et ferait mieux de s'occuper d'entomo-
logie ou de botanique.
C'est une telle différence que l'analyse montre entre la
société contemporaine et celles qui l'ont précédée, prises
globalement. Et cela, c'est précisément tout d'abord l'abou-
tissement d'une description sociologique rigoureuse qui res.
pecte son objet et le fait vraiment parler, au lieu de l'écraser
sous une métaphysique à bon marché affirmant que tout
revient toujours au même. Que l'on considère le problème du
travail : c'est une chose que l'esclave ou le serf s'opposé à
son exploitation, c'est-à-dire refuse un effort supplémentaire
ou demande une plus grande part du produit, combatte les
ordres du maître ou du seigneur sur le plan pour ainsi dire
de la « quantité ». C'est une chose radicalement différente,
que l'ouvrier soit obligé de combattre les ordres de la direc-
tion pour pouvoir les appliquer, que non plus la quantité seule
du travail ou du produit, mais aussi son contenu et la façon
de le faire soient l'objet d'une lutte incessante --
le processus du travail ne fasse plus surgir un conflit exté-
rieur au travail lui-même, mais doive s'appuyer sur une
contradiction interne, l'exigeance simultanée d'exclusion et de
participation à l'organisation et à la direction du travail.
Que l'on considère le problème de la famille et de la
structure de la personnalité. C'est une chose, que l'organisa-
tion familiale ait toujours contenu un principe répressif, que
les individus aient toujours été obligés d'intérioriser un conflit
entre leurs pulsions et les exigences de l'organisation sociale
donnée, que chaque culture, archaïque ou historique, ait pré-
senté, dans sa « personnalité de base », une teinte « névro-
tique » particulière. C'est une chose radicalement différente,
qu'il n'y ait plus de principe discernable à la base de l'orga-
nisation ou plutôt de la désorganisation familiale actuelle,
ni de structure intégrée de la personnalité de l'homme
contemporain. Il est certes stupide de penser que les Floren-
tins, les Romains, les Spartiates, les Mundugumor ou les
Kwakiutl étaient « sains », et que nos contemporains sont
« névrosés ». Mais il n'est guère plus intelligent d'oublier que
le type de personnalité du Spartiate, ou du Mundugumor,
quelles qu'aient pu être ses composantes « névrotiques »,
était fonctionnellement adéquat à sa société, que l'individu
lui-même se sentait adapté à elle, qu'il pouvait la faire fonc-
tionner d'après ses exigences et former une nouvelle géné-
ration qui fasse de même ; tandis que les ou la « névrose >>
des hommes d'aujourd'hui se présentent essentiellement, du
point de vue sociologique, comme des phénomènes d'inadap-
tation, non seulement vécus subjectivement comme un mal-
heur, mais surtout entravant le fonctionnement social des
individus, les empêchant de s'insérer adéquatement aux exi-
gences de la vie telle qu'elle est, et se reproduisant comme
18
une
ce
inadaptation amplifiée à la deuxième génération. La « névro-
se » du Spartiate était ce qui lui permettait de s'intégrer à sa
société la « névrose » de l'homme moderne 'est ce qui
l'en empêche. Il est superficiel de rappeler, par exemple, que
l'homosexualité a existé dans toutes les sociétés humaines
et d'oublier qu'elle a été chaque fois quelque chose de socia-
lement défini : une déviance marginale tolérée, ou méprisée,
ou sanctionnée ; coutume valorisée, institutionalisée,
possédant une fonction sociale positive ; un vice largement
répandu ; et qu'elle est aujourd'hui --- quoi au fait ? Ou de
dire que les sociétés ont pu s'accommoder d'une immense
variété de différents rôles de la femme
pour
oublier et faire
oublier
que la société actuelle est la première où il n'y ait
pour
la femme aucun rôle défini et par voie de conséquence
directe et immédiate, pour l'homme non plus.
Que l'on considère, enfin, la questions des valeurs de la
société. Explicite ou implicite, il y a eu dans toute société
un système de valeurs, – ou deux, qui se combattaient mais
étaient présents. Aucune coercition matérielle n'a jamais pu
être durablement c'est-à-dire socialement - efficace, sans
« complément de justification » ; aucune répression psy-
chique n'a jamais joué de rôle social sans ce prolongement au
grand jour, un sur-moi exclusivement inconscient n'est pas
concevable. La société a toujours supposé des règles de con-
duite, et les sanctions à ces règles n'étaient ni seulement
inconscientes, ni seulement matérielles - juridiques, mais
toujours aussi des sanctions sociales informelles, et des « sanc-
tions >> méta-sociales (métaphysiques, religieuses, etc. - bref,
imaginaires, mais cela n'en diminue en rien l'importance).
Dans les cas, rarissimes, où ces règles étaient ouvertement
transgressées, elles ne l'étaient que par une petite minorité
(au XVIIIsiècle français par exemple, par une partie de
l'aristocratie). Actuellement, les règles et leurs sanctions sont
presqu'exclusivement juridiques et les formations inconscien-
tes ne composent plus des règles, au sens sociologique, soit
que, comme certains psychanalystes l'ont dit, le sur-moi subisse
un affaiblissement considérable (1), soit que la composante
(et donc la fonction proprement sociale) du sur-moi s'effrite
dans la pulvérisation et le mélange des situations et des
* types de personnalité » qui croissent dans la société moderne.
Au-delà des sanctions juridiques, ces règles ne trouvent, la
plupart du temps, aucun prolongement de justification dans
la conscience des gens. Mais le plus important n'est pas l'affais-
sement des sanctions entourant les règles-interdits : c'est
la disparition presque totale de règles et de valeurs positives.
(1) V.,. par exemple, Allen Wheelis, The Quest for Identity,
London (Victor Gollancz), 1959, en particulier pp. 97 à 138. C'est
également le sens des analyses de David Riesman dans The Lonely
Crowd (Yale University Press), 1950.
19
La vie d'une société ne peut se fonder seulement sur un réseau
d'interdits, d'injonctions négatives. Les individus ont toujours
reçu de la société où ils vivaient des injonctions positives, des
orientations, la représentation de fins valorisées à la fois
formulées universellement et « incarnées » dans ce qui était,
pour chaque époque, son « Idéal collectif du Moi ». Il n'existe,
à cet égard, dans la société contemporaine, que des résidus de
phases antérieures chaque jour mités davantage et réduits à
des abstractions sans rapport avec la vie (la « moralité » ou
une attitude « humanitaire »), ou bien des pseudo-valeurs
plates dont la réalisation constitue en même temps une auto-
dénonciation (la consommation comme fin en soi, ou la mode
et le « nouveau »).
On nous dit : même en admettant qu'il y a cette crise
de la société contemporaine, vous ne pouvez pas poser légiti-
mement le projet d'une nouvelle société ; car d'où pouvez-
vous en tirer un contenu quelconque, sinon de votre tête, de
vos idées, de vos désirs ---- bref, de votre arbitraire subjectif ?
Nous répondons : si vous entendez par là que nous ne
pouvons pas « démontrer » la nécessité ou l'excellence du socia-
lisme, comme on « démontre » le théorème de Pythagore ; ou
que nous ne pouvons pas vous montrer le socialisme en train
de croître dans la société établie, comme on peut montrer
un poulain en train de grossir le ventre d'une jument, vous
avez sans doute raison, mais aussi bien vous faites semblant
d'ignorer qu'on n'a jamais à faire avec ce genre d'évidences
dans aucune activité réelle, ni individuelle, ni collective, et
que vous-mêmes vous laissez de côté ces exigences dès que
vous entreprenez quelque chose. Mais si vous voulez dire que
le projet révolutionnaire ne traduit que l'arbitraire subjectif
de quelques individus, c'est que vous avez d'abord choisi
d'oublier, au mépris des principes que vous invoquez par
ailleurs, l'histoire des derniers cent cinquante ans, et que le
problème d'une autre organisation de la société a été constam-
ment posé, non pas par des réformateurs ou des idéologues,
mais
par
des mouvements collectifs immenses, qui ont changé
la face du monde, même s'ils ont échoué par rapport à leurs
intentions originaires. C'est ensuite parce que vous ne voyez
pas que cette crise dont nous avons parlé n'est pas simple-
ment « crise en soi », cette société conflictuelle n'est pas une
poutre qui pourrit avec le temps, une machine qui se rouille
ou s'use ; la crise est crise du fait même qu'elle est en même
temps contestation, elle résulte d'une contestation et la nour-
rit constamment. Le conflit dans le travail, la destructuration
de la personnalité, l'effondrement des normes et des valeurs
ne sont pas et ne peuvent pas être vécus par les hommes
comme des simples faits ou des calamités extérieures, elles
font aussitôt surgir des réponses et des intentions, et celles-ci,
20
ou
en même temps qu'elles finissent par constituer la crise comme
véritable crise, vont au-delà de la simple crise. Il est certes
faux et mythologique de vouloir trouver, dans le « négatif »
du capitalisme, un « positif » qui se constitue symétriquement
millimètre pour millimètre, soit selon le style objectiviste de
certaines formulations de Marx (lorsque par exemple le
« négatif » de l'aliénation est vu comme se déposant et sédi-
mentant dans l'infrastructure matérielle d'une technologie et
d'un capital accumulé qui contiennent, avec leur corrolaire
humain inévitable, le prolétariat, les conditions nécessaires et
suffisantes du socialisme), soit selon le style subjectiviste de
quelques marxistes (qui voient la société socialiste pour ainsi
dire d'ores et déjà constituée dans la communauté ouvrière
de l'usine et dans le nouveau type de rapports humains qui
s'y font jour). Aussi bien le développement des forces pro-
ductives que l'évolution des attitudes humaines dans la société
capitaliste présentent des significations qui ne sont pas sim-
ples, qui ne sont même pas simplement contradictoires au
sens d'une dialectique naïve qui procéderait par juxtaposition
des contraires – des significations que l'on peut appeler, à
défaut d'un autre terme, ambiguës. Mais l'ambigü au sens
que nous entendons ici, ce n'est
pas
l'indéterminé l'indé-
fini, le n'importe quoi. L'ambigü n'est ambigü que par la
composition de plusieurs significations susceptibles d'être
précisées, et dont aucune ne l'emporte pour l'instant. Dans
la crise et dans la contestation des formes de vie sociale par
les hommes contemporains, il y a des faits lourds de sens
l'usure de l'autorité, l'épuisement graduel des motivations
économiques, l'atténuation de l'emprise de l'imaginaire, la
non-acceptation de règles simplement héritées ou reçues,
qu'on ne peut organiser qu'autour de l'une ou l'autre de
ces deux significations centrales : ou bien d'une sorte de
décomposition progressive du contenu de la vie historique, de
l'émergeance graduelle d'une société qui serait à la limite
extériorité des hommes les uns aux autres et de chacun à soi,
désert surpeuplé, foule solitaire, non plus même cauchemar
mais anesthésie climatisée ; ou bien, nous aidant surtout de
ce qui apparaît dans le travail des hommes comme tendance
vers la coopération, l'auto-gestion collective des activités et la
responsabilité, nous interprétons l'ensemble de ces phénomè-
comme le surgissement dans la société de la possibilité
et de la demande d'autonomie.
On dira encore : ce n'est là qu'une lecture que vous
faites ; vous convenez qu'elle n'est pas la seule possible. Au
nom de quoi la faites-vous, au nom de quoi prétendez-vous
que l'avenir que vous visez est possible et cohérent, au nom
de quoi, surtout, choississez-vous ?
Notre lecture n'est pas arbitraire, d'une certaine façon
elle n'est que l'interprétation du discours que la société con-
nes
21
avons
temporaine tient sur elle-même, la seule perspective dans
laquelle deviennent compréhensibles la crise de l'entreprise
aussi bien que de la politique, l'apparition de la psychanalyse
aussi bien que de la psychosociologie, etc. Et nous
essayé de montrer qu'aussi longtemps que nous pouvons voir,
l'idée d'une société socialiste ne présente aucune impossibilité
ou incohérence (2). Mais notre lecture est aussi, effectivement,
fonction d'un choix : une interprétation de ce type et à cette
échelle n'est possible, en dernier ressort, qu'en relation à un
projet. Nous affirmons quelque chose qui ne s'impose pas
« naturellement » ou géométriquement, nous préférons un
avenir à un autre et même à tout autre.
Ce choix est-il arbitraire ? Si l'on veut, au sens où tout
choix l'est. Mais, de tous les choix historiques, il nous semble
le moins arbitraire qui ait jamais pu exister.
Pourquoi préférons-nous un avenir socialiste à tout autre ?
Nous déchiffrons, ou croyons déchiffrer, dans l'histoire effec-
tive une signification, la possibilité et la demande d'au-
tonomie. Mais cette signification ne prend tout son poids
qu'en fonction d'autres considérations. Cette simple donnée
« de fait » ne suffit pas, ne pourrait pas comme telle s'im-
poser à nous. Nous n'approuvons pas ce que l'histoire contem-
poraine nous offre, simplement parce qu'il « est » ou qu'il
« tend à être ». Arriverions-nous à la conclusion que la ten-
dance la plus probable, ou même certaine, de l'histoire
contemporaine est l'instauration universelle de camps de
concentration, nous n'en conclurions pas que nous avons à
l'appuyer. Si nous affirmons la tendance de la société contem-
poraine vers l'autonomie, si nous voulons travailler à sa réali-
sation, c'est que nous affirmons l'autonomie comme mode
d'être de l'homme, que nous la valorisons, nous y reconnais-
sons notre aspiration essentielle et une aspiration qui dépasse
les singularités de notre constitution personnelle, la seule qui
soit publiquement défendable dans la lucidité et la cohérence.
Il y a donc ici un double rapport. Les raisons pour les-
quelles nous visons l'autonomie sont et ne sont pas de l'épo-
que. Elles ne le sont pas, car nous affirmerions la valeur de
l'autonomie quelles que soient les circonstances, et plus profon-
dément, car nous pensons que la visée de l'autonomie tend
inéluctablement à émerger là où il y a homme et histoire,
que, au même titre que la conscience, la visée d'autonomie
c'est le destin de l'homme, que, présente dès l'origine, elle
constitue l'histoire plutôt qu'elle n'est constituée par elle.
Mais ces raisons sont également de l'époque, de mille
façons si visibles qu'il serait oiseux de les dire. Non seule-
(2) V. la partie précédente de ce texte, S. ou B., nº 38, pp. 66 à 80.
V. aussi, dans le no 22 de S. ou B., P. Chaulieu, Sur le contenu du
socialisme.
22
ment parce que les enchaînements par lesquels nous et d'au-
tres parvenons à cette visée et à sa concrétisation le sont.
Mais parce que le contenu que nous pouvons lui donner, la
façon dont nous pensons qu'elle peut s'incarner, ne sont possi-
bles qu'aujourd'hui et présupposent toute l'histoire précé-
dante, et de plus de façons encore que nous ne soupçonnons.
Tout particulièrement, la dimension sociale explicite que nous
pouvons donner aujourd'hui à cette visée, la possibilité d'une
autre forme de société, le passage d'une éthique à une poli-
tique de l'autonomie (qui, sans supprimer l'éthique, la
en la dépassant), sont clairement liés à la phase
concrète de l'histoire que nous vivons.
conserve
nous
On peut enfin demander : et pourquoi donc pensez-vous
que cette possibilité apparaît juste maintenant ? Nous disons :
si votre pourquoi est un pourquoi concret, nous avons déjà
répondu à votre question. Le pourquoi, se trouve dans tous
ces enchaînements historiques particuliers qui ont conduit
l'humanité où elle est maintenant, qui ont fait notamment de
la société capitaliste et de sa phase actuelle cette époque sin-
gulièrement singulière que nous essayions de définir plus haut.
Mais si votre pourquoi est un pourquoi métaphysique, s'il
revient à demander : quelle est la place exacte de la phase
actuelle dans une dialectique totale de l'histoire universelle,
pourquoi la possibilité du socialisme émergerait-elle en ce
moment précis dans le plan de la Création, quel est le rap-
port élaboré de ce constituant originaire de l'histoire qu'est
l'autonomie avec les figures successives qu'il assume dans le
temps -- nous refusons de répondre ; car, même si la question
avait un
sens, elle serait purement spéculative et
considérons absurde de suspendre tout faire et non-faire, en
attendant que quelqu'un élabore rigoureusement cette dialec-
tique totale, ou découvre au fond d'une vieille armoire le plan
de la Création. Nous n'allons pas tomber dans l'hébétude par
dépit de ne pas posséder le savoir absolu. Mais nous refusons
la légitimité de la question, nous refusons qu'il y ait un sens
à penser en termes de dialectique totale, de plan de Création,
d'élucidation exhausitive du rapport entre ce qui se fonde
avec le temps et ce qui se fonde dans le temps. L'histoire a
fait naître un projet, ce projet nous le faisons nôtre car nous
y reconnaissons nos aspirations les plus profondes, et nous pen-
sons que sa réalisation est possible. Nous sommes ici, à cet
endroit précis de l'espace et du temps, parmi ces hommes-ci,
dans cet horizon. Savoir que cet horizon n'est pas le seul
possible ne l'empêche pas d'être le nôtre, celui qui donne
figure à notre paysage d'existence. Le reste, l'histoire totale,
de partout et de nulle part, c'est le fait d'une pensée sans
horizon, qui n'est qu'un autre nom de la non-pensée.
23
SENS DE L'AUTONOMIE
L’INDIVIDU
Si l'autonomie est au centre des objectifs et des voies
du projet révolutionnaire, il est nécessaire de préciser et
d'élucider ce terme. Nous tenterons cette élucidation d'abord
là où elle paraît le plus facile : à propos de l'individu, pour
passer ensuite au plan qui intéresse surtout ici, le plan collec-
tif. Nous essayons de comprendre ce qu'est un individu auto-
nome, et ce qu'est une société autonome ou non aliénée.
Freud proposait comme maxime de la psychanalyse « Où
était ça, Je dois advenir » (Wo Es war, Ich soll werden) (3).
Je est ici, en première approximation, le conscient en général.
Le ça, à proprement parler origine et lieu des pulsions (« ins-
tincts »), doit être pris dans ce contexte comme représentant
l'inconscient au sens le plus large. Je, conscience et volonté,
dois prendre la place des forces obscures qui, « en moi »,
dominent, agissent pour moi -- « m'agissent >> comme disait
G. Groddec (4). Ces forces ne sont pas simplement – ne
sont pas tellement, nous y reviendrons plus loin - les pures
pulsions, libido ou pulsion de mort ; c'est leur interminable,
fantasmatique et fantastique alchimie, c'est aussi et surtout
les forces de formation et de répression inconscientes, le Sur-
moi et le Moi inconscient. Une interprétation de la phrase
devient aussitôt nécessaire. Je dois prendre la place de Ça
cela ne peut signifier ni la suppression des pulsions, ni l'éli-
mination ou la résorption de l'inconscient. Il s'agit de prendre
leur place en tant qu'instance de décision. L'autonomie, ce
serait la domination du conscient sur l'inconscient. Sans pré-
judice de la nouvelle dimension en profondeur révélée par
Freud (5), c'est le programme de la réflexion philosophique
sur l'individu depuis vingt-cinq siècles, le présupposé à la
fois et l'aboutissement de l'éthique telle que l'ont vue Platon
ou les stoïciens, Spinoza ou Kant. (Il est d'une immense
(3) Le passage où se trouve cette phrase, à la fin de la 3e
(21° dans la numérotation consécutive adoptée par Freud) des
« leçons » de la Nouvelle série de leçons d'introduction à la psycha-
nalyse, est ainsi : « Leur objet (des efforts thérapeutiques de la
psychanalyse) est de renforcer le Je, de le rendre plus indépendant
du Sur-moi, d'élargir son champ de vision et d'étendre son organisa-
tion de telle façon qu'il puisse s'emparer de nouvelles régions du
Ça. Où était ça, Je dois advenir. C'est un travail de récupération,
comme l'assèchement de la Zuyder Zee. » Jacques Lacan rend le
Wo es war, soll Ich werden par « Là où fut ça, il me faut advenir »
(L'Instance de la lettre dans l'inconscient, in La Psychanalyse, nº 3,
Paris, P. U. F., 1957, p. 76); et ajoute, sur la « fin que propose à
l'homme la découverte de Freud » : « Cette fin est de réintégration
et d'accord, je dirai de réconciliation (Versöhnung) ».
(4) Dans Das Buch vom Es (1923), trad. française sous le titre
Au fond de l'homme, Cela, Paris (Gallimard), 1963.
(5) Il serait plus équitable de dire : de l'explicitation et de
l'exploration de la dimension profonde de la psyché, que ni Héra-
clite ni Platon certes n'ignoraient, comme une lecture même superfi-
cielle du Banquet permet de le voir.
24
importance en soi, mais non pour cette discussion, que Freud
propose une voie efficace pour atteindre ce qui était resté
pour les philosophes un « idéal » accessible en fonction d'un
savoir abstrait) (5 a). Si à l'autonomie, la législation ou régu-
lation par Boi-même, on oppose l'hétéronomie, la législation ou
la régulation par un autre, l'autonomie, c'est ma loi, opposée
à la régulation par l'inconscient qui est une loi autre, la loi
d'un autre que moi.
En quel sens on peut dire que la régulation par l'in-
conscient c'est la loi d'un autre ? De quel autre s'agit-il ?
D'un autre littéral, non pas d'un « autre Moi » inconnu, mais
d'un autre en moi. Comme dit Jacques Lacan, « L'inconscient,
c'est le discours de l'Autre » ; c'est pour une part décisive, le
dépôt des visées, des désirs, des investissements, des exigen-
ces,
des attentes des significations dont l'individu a été
l'objet, dès sa conception et même avant, de la part de ceux
qui l'ont engendré et élevé (5b). L'autonomie devient alors :
mon discours doit prendre la place du discours de l'Autre, d'un
discours étranger qui est en moi et me domine : parle par
moi. Cette élucidation indique aussitôt la dimension sociale
du problème (il importe peu que l'Autre dont il s'agit au
départ c'est l'autre « étroit », parental ; par une série d'arti-
culations évidentes, le couple parental renvoie finalement à
la société entière et à son histoire).
Mais quel est ce discours de l'Autre non plus quant
à son origine, mais quant à sa qualité ? Et jusqu'à quel point
peut-il être éliminé ?
La caractéristique essentielle du discours de l’Autre, du
point de vue qui intéresse ici, c'est son rapport à l'imaginaire.
C'est que, dominé par ce discours, le sujet se prend pour
quelque chose qu'il n'est pas (qu'en tout cas il n'est pas néces-
sairement pour lui-même) et que pour lui, les autres et le
monde entier subissent un travestissement correspondant. Le
sujet ne se dit pas, mais est dit par quelqu'un, existe donc
comme partie du monde d'un autre (certainement travesti
à son tour). Le sujet est dominé pas un imaginaire vécu
comme plus réel que le réel, quoique non su comme tel,
précisément parce que non su comme tel (6). L'essentiel de
(5 a) le noyau de notre être, ce n'est pas tant cela que
Freud nous ordonne de viser comme tant d'autres l'ont fait avant
lui par le vain adage du « Connais-toi toi-même », que ce ne sont
les voies qui y mènent qu'il nous donne à reviser ». Jacques Lacan,
1. c., p. 79.
(5 b) V. Jacques Lacan, Remarques sur le rapport de D. Lagache,
in La Psychanalyse, n° 6 (1961), p. 116. « Un pôle d'attributs, voilà
ce qu'est le sujet avant sa naissance (et peut-être est-ce sous leur
amas qu'il suffoquera un jour). D'attributs, c'est-à-dire de signifiants
plus ou moins liés en un discours... », ib.
(6) C'est évidemment là la distinction essentielle avec d'autres
formes de l'imaginaire (comme l'art ou l'usage « rationnel » de
l'imaginaire en mathématiques par exemple). qui ne s'autonomisent
pas comme telles. Nous y reviendrons longuement par la suite.
25
me
l'hétéronomie ou de l'aliénation, au sens général du ter-
au niveau individuel, c'est la domination par un imagi-
naire autonomisé qui s'est arrogé la fonction de définir pour
le sujet et la réalité et son désir. La « répression des pulsions »
comme telle, le conflit entre le « principe de plaisir » et le
« principe de réalité », au sens fonctionnel ou « économique »
(7) ne constituent pas l'aliénation individuelle qui est au fond
l'empire presqu'illimité d'un principe de dé-réalité. Le conflit
important à cet égard, n'est pas celui entre pulsions et réalité
(si ce conflit suffisait comme cause pathogène, il n'y aurait eu
jamais une seule résolution même approximativement nor-
male du complexe d'adipe depuis l'origine des temps, et
jamais un homme et une femme n'auraient marché sur cette
terre). Il est celui entre pulsions et réalité, d'un côté, et l'éla-
boration imaginaire au sein du sujet, de l'autre côté (8).
Le Ça, dans cet adage de Freud, doit donc être compris
comme signifiant essentiellement cette fonction de l'incong-
cient qui investit de réalité l'imaginaire, l'autonomise et lui
confère pouvoir de décision — le contenu de cet imaginaire
étant en rapport avec le discours de l'Autre (« répétition »,
mais aussi transformation amplifiée de ce discours).
C'est donc là où était cette fonction de l'inconscient, et
le discours de l'Autre qui lui fournit son aliment, que Je dois
advenir. Cela signifie que mon discours doit prendre la place
du discours de l'Autre. Mais qu'est-ce que mon discours ?
Qu'est-ce qu'un discours qui est mien ?
Un discours qui est mien, est un discours qui a nié le
discours de l'Autre ; qui l'a nié, non pas nécessairement dans
son contenu, mais en tant qu'il est discours de l'Autre ; autre-
ment dit qui, en explicitant à la fois l'origine et le sens de
(7) Au sens où Freud par exemple parlait d' « économie » de la
libido.
(8) « Dès le début, notre vue a été que les hommes tombent
malades par suite du conflit entre les demandes de leurs pulsions
et la résistance intérieure qui s'établit contre elles » S. Freud, New
Introductory Lectures on Psycho-analysis, Londres (Hogarth Press),
1957, p. 78. Il ne s'agit pas de la « réalité » ou des « exigences de la
vie en société », comme telles, mais de ce que ces exigences devien-
nent dans le discours de l'Autre (qui n'en est d'ailleurs nullement,
à son tour, le neutre véhicule) et dans l'élaboration imaginaire de
celui-ci par le sujet.
Cela ne nie évidemment pas l'importance capitale, pour le contenu
du discours de l'Autre et pour l'allure spécifique qu'en prendra l'éla-
boration imaginaire, de ce qu'est concrètement la société considérée,
ni l'importance, quant à la fréquence et la gravité des situations
pathogènes, du caractère excessif et irrationnel de la formulation
sociale de ces « exigences » : là-dessus, Freud était bien clair (cf. en
particulier Malaise dans la civilisation). Mais à ce niveau là, à nou-
veau, on rencontre ce fait que les « exigences » de la société ne se
réduisent ni aux exigences de la « réalité », ni à celles de la « vie
en société » en général, ni même finalement à celles d'une « société
divisée en classes », mais vont au-delà de ce que ces exigences impli-
queraient rationnellement. Nous trouvons là le point de jonction
entre l'imaginaire individuel et l'imaginaire social sur lequel nous
revenons plus loin.
26
ce discours, l'a nié ou affirmé en connaissance de cause, en
rapportant son sens à ce qui se constitue comme la vérité
propre du sujet comme ma vérité propre.
Si l'adage de Freud, sous cette interprépation, était pris
absolument, il proposerait un objectif inaccesible. Jamais mon
discours ne sera intégralement mien au sens défini plus haut.
C'est qu'évidemment, je ne pourrais jamais tout reprendre,
serait-ce simplement pour le ratifier. C'est aussi -- on y revien-
dra plus loin que la notion de vérité propre du sujet est
elle-même un problème beaucoup plus qu'une solution.
Cela est tout autant vrai du rapport avec la fonction
imaginaire de l'inconscient. Comment penser à un sujet qui
aurait totalement « résorbé » sa fonction imaginaire, com-
ment pourrait-on tarir cette source au plus profond de nous-
mêmes d'où jaillissent à la fois fantasmes aliénants et créa-
tions libres plus vraies que la vérité, délires déréels et poèmes
surréels, ce double fond éternellement recommencé de toute
chose sans lequel aucune chose n'aurait de fond, comment
éliminer ce qui est à la base de, ou en tout cas inextricable-
ment lié à, ce qui fait de nous des hommes notre fonction
symbolique, qui présuppose notre capacité de voir et de pen-
ser en une chose ce qu'elle n'est pas ?
Pour autant donc qu'on ne veut pas faire de la maxime
de Freud une simple idée régulatrice définie par référence ü
un état impossible donc une nouvelle mystification
il y a un autre sens à lui donner. Elle doit être comprise
comme renvoyant non pas à un état achevé, mais à une situa-
tion active ; non pas à une personne idéale qui serait devenue
Je pur une fois pour toutes, livrerait un discours exclusive-
ment sien, ne produirait jamais des fantasmes
mais à une
personne réelle, qui n'arrête pas son mouvement de reprise
de ce qui était acquis, du discours de l'Autre, qui est capa-
ble de dévoiler ses fantasmes comme fantasmes et ne se laisse
pas finalement dominer par eux à moins qu'elle ne le
veuille bien. Ce n'est pas là un simple « tendre vers », c'est
bien une situation, elle est définissable par des caractéristi-
ques qui tracent une séparation radicale entre elle et l'état
d'hétéronomie. Ces caractéristiques ne consistent pas en une
« prise de conscience » effectuée pour toujours, mais en un
autre rapport entre conscient et inconscient, entre lucidité et
fonction imaginaire, en une autre attitude du sujet à l'égard
de soi-même, en une modification profonde du mélange acti-
vité-passivité, du signe sous lequel celui-ci s'effectue, de la
place respective des deux éléments qui le composent. Com-
bien peu il s'agit, dans tout cela, d'une prise du pouvoir par
la conscience au sens étroit, le montre le fait que l'on pour-
rait compléter la proposition de Freud par son inverse : Où
Je suis, ça doit surgir (Wo Ich bin, soll Es auftauchen). Le
désir, les pulsions qu'il s'agisse d'Eros ou de Thanatos
27
su
c'est moi aussi, et il s'agit de les amener non seulement à la
conscience, mais à l'expression et à l'existence (9). Un sujet
autonome est celui qui se sait fondé à conclure : cela est bien
vrai, et : cela est bien mon désir.
L'autonomie n'est donc pas élucidation sans résidu et
élimination totale du discours de l'Autre non su comme tel.
Elle est institution d'un autre rapport entre le discours de
l'Autre et le discours du sujet. L'élimination totale du discours
de l'Autre non su comme tel est un état non-historique. Le
poids du discours de l'Autre non comme tel, on peut
le voir même chez ceux qui ont tenté le plus radicalement
d'aller au bout de l'interrogation et de la critique des présup-
posés tacites - que ce soit Platon, Descartes, Kant, Marx
ou Freud lui-même. Mais il y a précisément ceux qui
comme Platon ou Freud
ne se sont jamais arrêtés dans
ce mouvement ; et il y a ceux qui se sont arrêtés, et qui se
sont parfois, de ce fait, aliénés à leur propre discours devenu
autre. Il y a la possibilité permanente et en permanence
actualisable de regarder, objectiver, mettre à distance, déta-
cher et finalement transformer le discours de l'Autre en
discours du sujet.
Mais ce sujet, qu'est-ce que c'est ? Ce troisième terme
de la phrase de Freud, qui doit advenir là où était ça, n'est
certainement pas le Je ponctuel du « je pense ». Ce n'est pas
le sujet-activité pure, sans entrave ni inertie, ce feu follet
des philosophies subjectivistes, cette flamme débarrassée de
tout support, attache et nourriture. Cette activité du sujet
qui « travaille sur lui-même » rencontre comme son objet la
foule des contenus (le discours de l'Autre) avec laquelle elle
n'a jamais fini ; et, sans cet objet, elle n'est tout simplement
pas. Le sujet est aussi activité, mais l'activité est activité sur
quelque chose, autrement elle n'est rien. Elle est donc
co-déterminée par ce qu'elle se donne comme objet. Mais cet
aspect de l'inhérence réciproque du sujet et de l'objet
l'intentionalité, le fait que le sujet n'est que pour autant qu'il
pose un objet – n'est qu'une première détermination, rela-
tivement superficielle, c'est ce qui porte le sujet au monde,
c'est ce qui le met en permanence dans la rue. Il y en a une
autre, qui ne concerne pas l'orientation des fibres intention-
nelles du sujet, mais leur matière même, qui porte le monde
dans le sujet et fait entrer la rue dans ce qu'il pourrait croire
son alcôve. Car ce sujet actif qui est sujet de..., qui évoque
devant lui, pose, objective, regarde et met à distance, qu'est-
il - est-il pur regard, capacité nue d'évocation, mise à dis-
tance, étincelle hors du temps, non-dimensionalité ? Non, il
est regard et support du regard, pensée et support de la pensée,
(9) « Une éthique s'annonce... par l'avenue non de l'effroi mais
du désir ». Jacques Lacan, ib., p. 147.
28
il est activité et corps agissant corps matériel et corps
métaphorique. Un regard dans lequel il n'y a pas déjà du
regardé ne peut rien voir ; une pensée dans laquelle il n'y a
pas déjà du pensé ne peut rien penser (10). Ce que nous
avons appelé support ce n'est pas le simple support biolo-
gique, c'est qu'un contenu quelconque est toujours déjà présent
et qu'il est non pas résidu, scorie, encombrement ou matière
indifférente mais condition efficiente de l'activité du sujet.
Ce support, ce contenu, n'est ni simplement du sujet, ni sim-
plement de l'autre (ou du monde). C'est l'union produite et
productrice de soi et de l'autre (ou du monde). Dans le
sujet comme sujet il y a le 'non-sujet, et toutes ces trappes
où elle tombe elle-même, la philosophie subjectiviste les
creuse à l'oubli de cette vérité fondamentale. Dans le sujet
il y a certes comme moment « ce qui ne peut jamais devenir
objet », la liberté inaliénable, la possibilité toujours présente
de tourner le regard, de faire abstraction de tout contenu
déterminé, de mettre entre parenthèses tout, y compris soi,
sauf en tant que soi est cette capacité qui résurgit comme
présence et proximité absolue à l'instant où elle se met à
distance elle-même. Mais ce moment est abstrait, il est vide,
jamais il n'a produit et ne produira autre chose que l'évi-
dence muette et inutile du cogito sum, la certitude immédiate
d'exister comme pensant, qui ne peut même pas
s'amener
légitimement à l'expression par la parole. Car dès que la
parole même non prononcée ouvre une première brèche, le
monde et les autres s'infiltrent de partout, la conscience est
inondée par le torrent des signifiants qui vient, si l'on peut
dire, non pas de l'extérieur mais de l'intérieur. Ce n'est que
par le monde que l'on peut penser le monde. Dès que la pen-
sée est pensée de quelque chose, le contenu résurgit, non
seulement dans ce qui est à penser, mais dans ce par quoi il
est pensé (darin, wodurch es gedacht wird). Sans ce contenu,
on ne trouverait à la place du sujet que son fantôme. Et dans
ce contenu, il y a toujours l'autre et les autres, directement
ou indirectement. L'autre, est tout autant présent dans la
forme et dans le fait du discours, comme exigence de confron-
tation et de vérité (ce qui ne veut évidemment pas dire que
la vérité se confond avec l'accord des opinions). Enfin, il
n'est qu'en apparence éloigné de notre propos de rappeler
que le support de cette union du sujet et du non sujet dans
(10) Ce n'est pas là une description des conditions empiriques,
psychologiques du fonctionnement du sujet, mais une articulation de
la structure logique (transcendantale) de la subjectivité : il n'y a
de sujet pensant que comme disposition de contenus, tout contenu
particulier peut être mis entre parenthèses mais non un contenu
quelconque comme tel. La même chose est vraie pour le problème
de la génèse du sujet, considéré sous son aspect logique : à tout
instant le sujet est un producteur produit, et « à l'origine », le sujet
se constitue comme donnée simultanée d'emblée de Soi et de
l'Autre.
29
1
es
le sujet, la charnière de cette articulation de soi et de l'au.
tre, c'est le corps, cette structure « matérielle » grosse d'un
sens virtuel. Le corps, qui n'est pas aliénation
cela ne
voudrait rien dire mais participation au monde et au sens,
attachement et mobilité, pré-constitution d'un univers de
significations avant toute pensée réfléchie.
C'est parce qu'elle « oublie » cette structure concrète du
sujet que la philosophie traditionnelle, narcissisme de la
conscience fascinée par ses propres formes nues, ravale au rang
de conditions de servitude aussi bien l'autre que la corporalité.
Et c'est parce qu'elle veut se fonder sur la liberté pure d'un
sujet imaginaire, qu'elle se condamne à retrouver l'aliénation
du sujet réel comme problème insoluble ; de même que,
voulant se fonder sur la rationalité exhaustive, elle doit cong-
tamment buter sur l'impossible réalité d'un irrationnel irré-
ductible. C'est ainsi qu'elle devient finalement une entreprise
irrationnelle et aliénée ; d'autant plus irrationnelle, qu'elle
cherche, creuse, épure indéfiniment les conditions de sa ratio-
nalité ; d'autant plus aliénée, qu'elle ne cesse d'affirmer sa
liberté nue, alors que celle-ci est à la fois incontestable et
vaine.
Le sujet en question n'est donc pas le moment abstrait
de la subjectivité philosophique, c'est le sujet réel pénétré
part en part par le monde et par les autres. Le Je de l'auto.
nomie n'est pas Soi absolu, monade qui nettoie et polit sa
surface extero-interne pour en éliminer les impuretés appor-
tées par le contact d'autrui ; c'est l'instance active et lucide
qui réorganise constamment les contenus en s'aidant de ces
mêmes contenus, qui produit avec un matériel et en fonction
de besoins et d'idées eux-mêmes mixtes de ce qu'elle a trouvé
déjà là et de ce qu'elle a produit elle-même.
Il ne peut donc s'agir, sous ce rapport non plus, d'élimi-
nation totale du discours de l'autre non seulement parce
que c'est une tâche interminable, mais parce que l'autre est
chaque fois présent dans l'activité qui l' « élimine ». Et c'est
pourquoi il ne peut non plus exister de « vérité propre » du
sujet en un sens absolu. La vérité propre du sujet est toujours
participation à une vérité qui le dépasse, qui s'enracine et
l'enracine finalement dans la société et dans l'histoire, lors
même que le sujet réalise son autonomie.
de
DIMENSION SOCIALE DE L'AUTONOMIE
Nous avons parlé longuement du sens de l'autonomie
pour l'individu. C'est que, d'abord, il était nécessaire de dis-
tinguer clairement et fortement ce concept de la vieille idée
philosophique de la liberté abstraite, qui a perpétué ses
résonances jusque dans le marxisme.
C'est, ensuite, que seule cette conception de l'autonomie
30
et de la structure du sujet rend possible et compréhensible
In praxis telle que nous l'avons définie (11). Dans toute autre
conception cette « action d'une liberté sur une autre liberté »
reste une contradiction dans les termes, une impossibilité per-
pétuelle, un mirage ou un miracle. Ou alors, elle doit se
confondre avec les conditions et les facteurs de l'hétéronomie,
puisque tout ce qui vient de l'autre concerne les « contenus
de conscience », la « psychologie », est donc de l'ordre des
causes ; l'idéalisme subjectiviste et le positivisme psychologiste
se rencontrent finalement dans cette vue. Mais en réalité, c'est
parce que l'autonomie de l'autre n'est pas fulgurance absolue
et simple spontanéité, que je peux viser son développement.
C'est parce que l'autonomie n'est pas élimination pure et
simple du discours de l'autre, mais élaboration de ce discours,
où l'autre n'est pas matériau indifférent mais compte pour
le contenu de ce qu'il dit, qu’une action inter-subjective est
possible et qu'elle n'est pas condamnée à rester vaine ou à
violer par sa simple existence ce qu'elle pose comme son
principe. C'est pour cela qu'il peut y avoir une politique de
la liberté, et qu'on n'est pas réduit à choisir entre le silence
et la manipulation, ni même à la simple consolation : « après
tout, l'autre en fera ce qu'il voudra ». C'est pour cela que
je suis finalement responsable de ce que je dis (et de ce que
je tais) (12).
C'est enfin parce que l'autonomie, telle que nous l'avons
définie, conduit directement au problème politique et social.
La conception que nous avons dégagée montre à la fois que
l'on ne peut vouloir l'autonomie sans la vouloir pour tous,
et que sa réalisation ne peut se concevoir pleinement que
comme entreprise collective. S'il ne s'agit plus d'entendre par
ce terme, ni la liberté inaliénable d'un sujet abstrait, ni la
domination d'une conscience pure sur un matériel indifférencié
et essentiellement « le même » pour tous et toujours, obstacle
brut que la liberté aurait à surmonter les « passions »,
l' « inertie », etc.); si le problème de l'autonomie est que le
sujet rencontre en lui-même un sens qui n'est pas sien et qu'il
a à le transformer, en l'utilisant ; si l'autonomie est ce rap-
port dans lequel les autres sont toujours présents comme alté-
rité et comme ipséité du sujet alors l'autonomie n'est
concevable, déjà philosophiquement, que comme un problème
et un rapport social.
Cependant ce terme contient plus que nous n'en avons
explicité, et révèle aussitôt une nouvelle dimension du pro-
blème. Ce à quoi nous sommes directement référés
nous
(11) Comme le faire qui vise l'autre ou les autres comme êtres
autonomes. V. le No 38 de cette revue, p. 61 et suiv.
(12) Il y a un deuxième fondement de la praxis politique,
que l'on retrouvera plus loin : la possibilité d'institutions qui favo-
risent l'autonomie.
31
jusqu'ici, c'est l'inter-subjectivité, même si nous l'avons prise
dans une extension illimitée, – le rapport de personne à
personne, même s'il est articulé à l'infini. Mais ce rapport se
place dans un ensemble plus vaste, qui est le social propre-
ment dit.
En d'autres termes : que le problème de l'autonomie ren-
voie aussitôt, s'identifie même, au problème du rapport du
sujet et de l'autre - ou des autres ; que l'autre ou les autres
n'y apparaissent pas comme obstacles extérieurs ou malédic-
tion subie « l'Enfer, c'est les autres » (13) « il y a comme
un maléfice de l'existence à plusieurs » -, mais comme consti-
tutifs du sujet, de son problème et de sa solution possible,
rappelle ce qui après tout était certain dès le départ pour
qui n'est pas mystifié par l'idéologie d'une certaine philoso-
phie ; à savoir que l'existence humaine est une existence à
plusieurs et que tout ce qui est dit en dehors de ce présupposé
(lors même qu'on s'efforce péniblement de ré-introduire
« autrui » qui, se vengeant d'avoir été exclu au départ de la
subjectivité « pure », ne se laisse pas faire), est frappé de
non-sens. Mais cette existence à plusieurs, qui se présente
aussi comme inter-subjectivité prolongée, ne reste pas, et à
vrai dire n'est pas, dès l'origine, simple inter-subjectivité. Elle
est existence sociale et historique, et c'est là pour nous la
dimension essentielle du problème. L'inter-subjectif est, en
quelque sorte, la matière dont est fait le social, mais cette
matière n'existe que comme partie et moment de se social
qu'elle compose, mais qu'elle présuppose aussi.
Le social-historique (14) n'est ni l'addition indéfinie des
réseaux inter-subjectifs (bien qu'il soit aussi cela), ni, certai-
nement, leur simple « produit ». Le social-historique, c'est le
collectif anonyme, l'humain-impersonnel qui remplit toute
formation sociale donnée, mais l'englobe aussi, qui enserre
chaque société parmi les autres, et les inscrit toutes dans une
continuité où d'une certaine façon sont présents ceux qui ne
sont plus, ceux qui sont ailleurs et même ceux qui sont à
naître. C'est, d'un côté, des structures données, des institutions
et des oeuvres « matérialisées », qu'elles soient matérielles ou
non ; et, d'un autre côté, ce qui structure, institue, matéria-
sans
un
(13) L'auteur de cette phrase était doute certain qu'il
ne portait rien en lui-même qui fût d'un autre (sans quoi il aurait
pu tout aussi bien dire que l'Enfer c'était lui-même). Il a d'ailleurs
récemment confirmé cette interprétation, en déclarant qu'il n'avait
pas de Sur-moi. Comment pourrions-nous y objecter, nous qui avons
toujours pensé qu'il parlait des affaires de cette terre comme
être surgi d'ailleurs.
(14) Nous visons par cette expression l'unité de la double
multiplicité de dimensions, dans la « simultanéité » (synchronie) et
dans la « succession » (diachronie). que dénotent habituellement les
termes société et histoire. Nous dirons parfois le social ou l'histo-
rique, sans préciser, selon que nous voudrons mettre l'accent sur
l'un ou l'autre de ces aspects.
32
liste. Bref, c'est l'union et la tension de la société instituante
et de la société instituée, de l'histoire faite et de l'histoire se
faisant.
L'HETERONOMIE INSTITUEE : L'ALIENATION COMME
PHENOMENE SOCIAL
L'aliénation trouve ses conditions, au-delà de l'inconscient
individuel et du rapport inter-subjectif qui s'y joue, dans le
monde social. Il y a, au-delà du « discours de l'autre », ce qui
charge celui-ci d'un poids indéplaçable, et qui limite et rend
presque vaine toute autonomie individuelle (15). C'est ce qui
se manifeste comme masse de conditions de privation et
d'oppression, comme structure solidifiée globale, matérielle
et institutionnelle, d'économie, de pouvoir et d'idéologie,
comme induction, mystification, manipulation et violence.
Aucune autonomie individuelle ne peut surmonter les consé-,
quences
de cet état de choses, annuler les effets sur notre vie
de la structure oppressive de la société où nous vivons (16).
C'est que l'aliénation, l'hétéronomie sociale, n'apparaît
pas simplement comme « discours de l'autre »,
celui-ci y joue un rôle essentiel comme détermination et
contenu de l'inconscient et du conscient de la masse des indi-
vidus. Mais l'autre y disparaît dans l'anonymat collectif,
l'impersonnalité des « mécanismes économiques du marché >>
ou de la « rationalité du Plan », de la loi de quelques-uns
présentée, comme la loi tout court. Et, conjointement, ce qui
représente désormais l'autre n'est plus un discours : c'est une
mitraillette, un ordre de mobilisation, une feuille de paye et
des marchandises chères, une décision de tribunal et une
prison. L « autre » est désormais « incarné » ailleurs
que
dans
i'inconscient individuel – même si sa présence par déléga-
tion (17) dans l'inconscient de tous les concernés (celui qui
bien que
(15) Dans une société d'aliénation, même pour les rares indi-
vidus pour qui l'autonomie possède un sens, elle ne peut que rester
tronquée, cay elle rencontre, dans les conditions matérielles et dans
les autres individus, des obstacles constamment renouvelés dès
qu'elle doit s'incarner dans une activité, se déployer et exister socia-
lement ; elle ne peut se manifester, dans leur vie effective, que
dans des interstices aménagés à coups de chance et d'adresse, à
cotes toujours mal taillées.
(16) Il est à peine nécessaire de rappeler que l'idée d'autonomie
et celle de fresponsabilité de chacun pour sa vie peuvent facilement
devenir des mystifications si on les détache du contexte social et
si on les pose comme des réponses se suffisant à elles-mêmes.
(17) Cette délégation pose des problèmes multiples et complexes,
qu'il est impossible d'évoquer ici. Il y a évidemment à la fois
homologie et différence essentielle entre le rapport « familial » et
les relations de classe, ou de pouvoir, dans la société. L'apport
fondamental de Freud (Totem et tabou ou Psychologie collective et
analyse du Moi), celui de W. Reich (La fonction de l'orgasme), les
nombreuses contributions des anthropologues américains (notamment
Kardiner et M. Mead) sont loin d'avoir épuisé la question, pour
autant notamment que la dimension proprement institutionnelle s'y
trouve relativement reléguée au second plan.
33
tient la mitraillette, celui pour qui il la tient, et celui face à
qui il la tient) est condition nécessaire de cette incarnation :
l'inverse est également vrai, la détention des mitraillettes par
quelques-uns est sans aucun doute condition de l'aliénation
perpétuée, à ce niveau la question de la priorité de l'une ou
de l'autre condition n'a pas de sens, et ce qui nous importe
ici c'est la dimension proprement sociale (18).
L'aliénation apparaît donc comme instituée, en tout cas
comme lourdement conditionnée par les institutions (le mot
pris ici au sens le plus large, y compris notamment la struc-
ture des rapports réels de production). Et son rapport aux
institutions se présente comme double.
En premier lieu, les institutions peuvent être, et sont
effectivement, aliénantes dans leur contenu spécifique. Elles
le sont pour autant qu'elles expriment et sanctionnent une
structure de classe, plus généralement une division antago-
nique de la société, et, concurremment, le pouvoir d'une caté-
(18) Si les ouvriers d'une usine voulaient mettre en question
l'ordre existant, ils se heurteraient à la police et, si le mouvement
se généralisait, à l'Armée. On sait, par l'expérience historique, que
ni la police ni l'Armée ne sont immunes face à des mouvements
généralisés ; et peuvent-elles tenir contre l'essentiel de la population ?
Rosa Luxembourg disait : « Si toute la population savait, le régime
capitaliste ne tiendrait pas 24 heures ». Peu importe la résonance
«intellectualiste » de la phrase ; donnons à savoir toute sa profon-
deur, lions-le au vouloir. N'est-elle pas vraie d'une vérité aveuglante ?
Oui et non. Le oui est évident. Le non découle de cet autre fait, égale-
ment évident, que le régime social empêche précisément la population
et de savoir et de vouloir. A moins de postuler une coïncidence mira-
culeuse de spontanéités positives d'un bout à l'autre d'un pays, tout
germe, tout embryon de ce savoir et de ce vouloir qui peut se mani-
fester en un endroit de la société est constamment entravé, combattu,
à la limite écrasé par les institutions existantes. C'est pour cela que
la vue simplement « psychologique » de l'aliénation, celle qui cherche
les conditions de l'aliénation exclusivement dans la structure des
individus, leur « masochisme », etc., et qui dirait à la limite : si les
gens sont exploités, c'est qu'ils veulent bien l'être, est unilatérale,
abstraite et finalement fausse. Les gens sont cela et autre chose,
mais dans leur vie individuelle le combat est monstrueusement inégal,
car l'autre chose (la tendance vers l'autonomie) doit faire face à
tout le poids de la société instituée. S'il est essentiel de rappeler que
l'hétéronomie doit chaque fois trouver aussi ses conditions dans
chaque exploité, elle doit les trouver tout autant dans les structures
sociales, qui rendent les « chances » (au sens de Max Weber) des
individus de savoir et de vouloir pratiquement négligeables. Le
savoir et le vouloir ne sont pas pure affaire de savoir et de vouloir,
on n'a pas affaire à des sujets qui ne seraient que volonté pure
d'autonomie et responsabilité de part en part, s'il en était ainsi il
n'y aurait aucun problème dans aucun domaine. Ce n'est pas
seulement que la structure sociale est « étudiée pour » instiller dès
avant la naissance passivité, respect de l'autorité etc. C'est que les
institutions sont là, dans la longue lutte que représente chaque vie,
pour mettre à tout instant des butées et des obstacles, pousser les
eaux dans une direction, finalement sévir contre ce qui pourrait se
manifester comme autonomie. C'est pourquoi celui qui dit vouloir
l'autonomie et refuse la révolution des institutions ne sait ni ce
qu'il dit ni ce qu'il veut. L'imaginaire individuel, comme on le verra
plus loin, trouve sa correspondance dans un imaginaire social incarné
dans les institutions, mais cette incarnation existe comme telle et
c'est aussi comme telle qu'elle doit être attaquée.
34
gorie sociale déterminée sur l'ensemble. Elles le sont égale-
ment de façon spécifique pour chacune des classes ou couches
d'une société donnée. Ainsi l'économie capitaliste — produc-
tion, répartition, marché, etc. – est aliénante en tant que
consubtantielle à la division de la société en prolétaires et
capitalistes ; elle l'est aussi de façon spécifique pour chacune
des deux classes en présence, pour les prolétaires bien entendu,
mais pour les capitalistes aussi ; nous avons rectifié autrefois
la vue marxiste simple des capitalistes comme simples jouets
des mécanismes économiques (19), il ne faudrait pas évidem-
ment tomber dans l'erreur contraire et rêver de capitalistes
libres à l'égard de « leurs >> institutions.
Mais au-delà de cet aspect et d'une façon plus générale,
car cela vaut aussi pour des sociétés qui ne présentent
pas de division antagonique, comme beaucoup de sociétés
archaïques il y a une aliénation de la société toutes classes
confondues à ses institutions. Nous n'entendons pas par là les
aspects spécifiques qui affectent « également » les diverses
classes, le fait que la loi, même si elle sert la bourgeoisie, la
lie également. Nous visons ce fait, autrement plus important,
que l'institution une fois posée, semble s'autonomiser, qu'elle
possède son inertie et sa logique propre, qu'elle dépasse, dans
sa survie et dans ses effets, sa fonction, ses « fins » et ses
« raisons d’être ». Les évidences se renversent ; ce qui pouvait
être vu « au départ » comme des institutions au service de la
société, devient une société au service des institutions.
LE « COMMUNISME » DANS SON ACCEPTION MYTHIQUE
Le dépassement de l'aliénation sous ces deux formes a été
comme on sait, une idée centrale du marxisme. La révolution
prolétarienne devrait aboutir, après une période de transition,
à la « phase supérieure du communisme » et ce passage mar-
querait « la fin de la pré-histoire de l'humanité et l'entrée
dans sa véritable histoire », « le saut du royaume de la néces-
sité au royaume de la liberté ». Ces idées sont restées impré-
cises (20), et nous ne tenterons pas ici de les exposer systé-
matiquement, ni de les discuter à la lettre. Il nous suffit de
rappeler qu'elles ont connoté, plus ou moins explicitement,
certain que
(19) V. Le mouvement révolutionnaire sous le capitalisme moderne,
dans le No 32 de cette revue, notamment pp. 94 et suiv.
(20) Il est, de plus, très difficile d'apprécier le rôle effectif
qu'elles ont joué auprès des ouvriers ou même des militants. Il est
les uns et les autres ont toujours été beaucoup plus
préoccupés par les problèmes que leur posait leur condition et leur
lutte, que par le besoin de définir un objectif « final >> ; mais aussi
que quelque chose comme l'image d'une terre promise, d'une rédemp-
tion radicale a toujours été présent chez eux, avec la signification
ambiguë d'un Millenium eschatologique, d'un Royaume de Dieu sans
Dieu et du désir d'une société où l'homme ne serait plus le principal
ennemi de l'homme.
35
non seulement l'abolition des classes, mais l'élimination de la
division du travail (« il n'y aura plus de peintres, il y aura des
hommes qui peindront »), une transformation des institutions
sociales qu'il est difficile de distinguer, à la limite, de l'idée
de la suppression totale de toute institution (« dépérissement
de l'Etat », élimination de toute contrainte économique) et,
sur le plan philosophique, l'émergeance d'un « homme total »
et d'une humanité qui désormais « dominerait son histoire ».
Ces idées, malgré leur caractère vague, lointain, presque
gratuit, non seulement traduisent un problème, elles surgis-
sent inéluctablement sur le chemin de la réflexion politique
révolutionnaire. Dans le marxisme, il est incontestable qu'elles
bouclent sa philosophie de l'histoire, indéfinissable sans elles.
Ce que l'on peut regretter n'est pas que Marx et Engels en
aient parlé, mais qu'ils n'en aient pas parlé suffisamment ; non
pas pour donner des « recettes pour la cuisine socialiste de
l'avenir », non pas pour s'adonner à une définition et une
description utopique d'une société future, mais pour tenter
d'en cerner le sens par rapport aux problèmes présents, et
notamment par rapport au problème de l'aliénation. La praxis
ne peut pas éliminer le besoin d'élucider l'avenir qu'elle veut.
Pas plus que la psychanalyse ne peut évacuer le problème de
la fin de l'analyse, la politique révolutionnaire ne peut esqui-
ver la question de son aboutissement et du sens de cet
aboutissement.
Peu nous importe l'exégèse et la polémique, concernant
un problème qui jusqu'ici est resté dans le vague. Dans les
intuitions de Marx concernant le dépassement de l'aliénation,
il y a une foule d'éléments d'une vérité incontestable : en
tout premier lieu évidemment, la nécessité d'abolir les classes,
mais aussi l'idée d'une transformation des institutions à un
point tel qu'effectivement une distance immense les séparerait
de ce que les institutions ont représenté jusqu'ici dans l'his-
toire ; et tout cela présuppose et entraîne à la fois un boule-
versement dans le mode d'être des hommes, individuellement
et collectivement, dont il est difficile d'apercevoir les limites.
Mais ces éléments ont subi, parfois chez Marx et Engels eux-
mêmes, et en tout cas chez les marxistes, un glissement vers
une mythologie mal définie mais finalement mystificatrice, qui
nourrit une polémique ou une anti-mythologie également
mythologique chez les adversaires de la révolution. Une déli-
mitation par rapport à ces deux mythologies, qui du reste
partagent une base commune, est nécessaire pour elle-même,
mais nous permettra également d'avancer dans la compréhen-
sion positive du problème.
Si par communisme (« phase supérieure ») on entend une
société d'où serait absente toute résistance, toute épaisseur,
toute opacité ; une société qui serait pour elle-même pure
36
ne
transparence ; où les désirs de tous s'accorderaient spontané-
ment ou bien, pour s'accorder, n'auraient besoin que d'un
dialogue ailé que n'accrocherait jamais la glu du symbolisme ;
une société qui découvrirait, formulerait et réaliserait sa
volonté collective sans passer par des institutions, ou dont les
institutions ne feraient jamais problème — si c'est de cela qu'il
s'agit, il faut dire clairement que c'est là une rêverie inco-
hérente, un état irréel et irréalisable dont la représentation
doit être éliminée. C'est une formation imaginaire, équivalente
et analogue à celle du savoir absolu, ou d'un individu dont la
K conscience » a résorbé l'être entier.
Jamais une société sera totalement transparente,
d'abord parce que les individus qui la composent ne seront
jamais transparents à eux-mêmes, puisqu'il ne peut être queg-
tion d'éliminer l'inconscient. Ensuite, parce que le social
n'implique pas seulement les inconscients individuels, ni
même simplement leurs inhérences inter-subjectives récipro-
ques, les rapports entre personnes, conscients et inconscients,
qui ne pourraient jamais être donnés intégralement comme
contenu à tous, à moins d'introduire le double mythe d'un
savoir absolu également possédé par tous ; le social impli-
que quelque chose qui ne peut jamais être donné comme tel.
La dimension sociale-historique, en tant que dimension du
collectif et de l'anonyme, instaure pour chacun et pour tous
un rapport simultané d'intériorité et d'extériorité, de partici-
pation et d'exclusion, qu'il ne peut être question d'abolir ni
même de « dominer » dans un sens tant soit peu défini de
ce terme. Le social est ce qui est tous et qui n'est personne,
ce qui n'est jamais absent et presque jamais présent comme
tel, un non être plus réel que tout être, ce dans quoi nous
baignons de part en part mais que nous ne pouvons jamais
appréhender « en personne ». Le social est une dimension
indéfinie, même si elle est enclose à chaque instant ; une
structure définie et en même temps changeante, une articu-
lation objectivable de catégories d'individus et ce qui par-
delà toutes les articulations soutient leur unité. C'est ce qui
se donne comme structure forme et contenu indissociables
- des ensembles humains, mais qui dépasse toute structure
donnée, un productif insaississable, un formant informe, un
toujours plus et toujours aussi autre. C'est ce qui ne peut se
présenter que dans et par l'institution, mais qui est toujours
infiniment plus que l'institution, puisqu'il est, paradoxale-
ment, à la fois ce qui remplit l'institution, ce qui se laisse
former par elle, ce qui en surdétermine constamment le
fonctionnement et ce qui, en fin de compte, la fonde : la crée,
la maintient en existence, l'altère, la détruit. Il y a le social
institué, mais celui-ci presuppose toujours le social instituant.
« En temps normal », le social se manifeste dans l'institution,
mais cette manifestation est à la fois vraie et en quelque sorte
37
sens.
C'est un
fallacieuse comme le montrent les moments où le social
instituant fait irruption et se met au travail les mains nues,
les moments de révolution. Mais ce travail vise immédiate-
ment un résultat, qui est de se donner à nouveau une insti-
tution
pour y exister de façon visible et dès que cette insti-
tution est posée, le social instituant se dérobe, il se met à
distance, il est déjà aussi ailleurs.
Notre rapport à ce social et à l'historique, qui en
est le déploiement dans le temps — ne peut pas être appelé
rapport de dépendance, cela n'aurait aucun
rapport d'inhérence, qui comme tel n'est ni liberté, ni
aliénation, mais le terrain sur lequel seulement liberté el
aliénation peuvent exister, et que seul le délire d'un narcis-
sime absolu pourrait vouloir abolir, déplorer, ou voir comme
une « condition négative ». Si l'on veut, à tout prix, chercher
un analogue ou une métaphore pour ce rapport, c'est dans
notre rapport à la nature qu'on le trouvera. Cette apparte-
nance à la société et à l'histoire, infiniment évidente et infi-
niment obscure, cette consubstantialité, identité partielle, par-
ticipation à quelque chose qui nous dépasse indéfiniment, n'est
pas une aliénation
pas plus que ne le sont notre spatialité,
notre corporalité, en tant qu'aspects « naturels » de notre exis-
tence, qui la « soumettent » aux lois de la physique, de la chi-
mie ou de la biologie. Elles ne sont aliénation que dans les
fantasmes d'une idéologie qui refuse ce qui est au nom d'un
désir qui vise un imaginaire - la possession totale ou le sujet
absolu, qui en somme n'a pas encore appris à vivre, ni même
à voir, et donc ne peut voir dans l'être que privation et déficit
intolérables, à quoi elle oppose l'Etre (imaginaire).
Cette idéologie, qui ne peut pas accepter l'inhérence, la
finitude, la limitation et le manque, cultive le mépris de ce
réel trop vert qu'elle ne peut atteindre, sous
une double
forme : par la construction d'un imaginaire « plein », et par
l'indifférence quant à ce qui est et ce qu'on peut en faire.
Et cela se manifeste, sur le plan théorique, par cette exigence
exorbitante, de récupération intégrale du « sens » de l'histoire
passée et à venir ; et sur le plan pratique, par cette idée non
moins exorbitante, de l'homme « dominant son histoire »
maître et possesseur de l'histoire, comme il serait sur le point
de devenir, semble-t-il, maître et possesseur de la nature. Ces
idées, pour autant qu'on les trouve dans le marxisme, tradui-
sent sa dépendance de l'idéologie traditionnelle ; de même
que traduisent leur dépendance par rapport à l'idéologie tra-
ditionnelle et au marxisme, les protestations symétriques et
dépitées de ceux qui, à partir de la constatation que l'histoire
n'est pas objet de possession ni transformable en sujet absolu,
concluent à la pérénité de l'aliénation. Mais appeler l'inhé-
rence des individus ou de toute société donnée à un social
et à un historique qui les dépassent dans toutes les dimen-
38
2
« sens >>
sions, appeler cela aliénation cela n'a de sens que dans la pers:
pective de la « Misère de l'homme sans Dieu ».
La praxis révolutionnaire, parce qu'elle est révolution-
naire et qu'elle doit oser au-delà du possible, est « réaliste »
au sens le plus vrai et commence par accepter l'être dans ses
déterminations profondes. Pour elle un sujet qui serait délié
de toute inhérence à l'histoire - serait-ce en en récupérant
le « sens intégral >> qui aurait pris la tangente par rap-
port à la société
serait-ce en « dominant » exhausti.
vement son rapport à elle n'est pas un sujet autonome,
c'est un sujet psychotique. Et mutatis mutandis, la même
chose vaut pour toute société déterminée, qui ne peut, serait-
elle communiste, émerger, exister, se définir, que sur le fond
de ce social-historique qui est au-delà de toute société et de
toute histoire particulière et les nourrit toutes. Elle sait, non
seulement qu'il n'est pas question de récupérer un
de l'histoire passée, mais qu'il n'est pas question de « domi-
ner », dans le sens admis de ce mot, l'histoire à venir à
moins de vouloir cette fin, du reste et heureusement irréali-
sable, que serait la destruction de la créativité de l'histoire.
Pour rappeler, comme simple image, ce que nous avons dit
sur le sens de l'autonomie pour l'individu, pas plus que l'on
ne peut éliminer ou résorber l'inconscient, on ne peut éliminer
ou résorber ce fondement illimité et insondable sur quoi
repose toute société donnée.
Il ne peut être question non plus d'une société sans insti-
tutions, quel que soit le développement des individus, le pro-
grès de la technique, ou l'abondance économique. Aucun de
ces facteurs ne supprimera les innombrables problèmes que
pose constamment l'existence collective des hommes ; ni donc
la nécessité d'arrangements et de procédures qui permettent
d'en débattre et de choisir, à moins de postuler une muta-
tion biologique de l'humanité, qui réaliserait la présence
immédiate de chacun en tous et de tous en chacun (mais
déjà les auteurs de science-fiction ont vu qu'un état de télé-
pathie universelle n'aboutirait qu'à un immense brouillage
- généralisé, ne produirait que du bruit et non pas de l'infor-
mation). Il ne peut pas être question non plus d'une société
qui coïnciderait intégralement avec ses institutions, qui serait
exactement recouverte, sans excès ni défaut, par le tissu insti.
tutionnel, et qui, derrière ce tissu, n'aurait pas de chair, une
société qui ne serait qu'un réseau d'institutions infiniment
plates. Il y aura toujours distance entre la société instituante
et ce qui est, à chaque moment, institué et cette distance
n'est pas un négatif ou un déficit, elle est une des expres-
sions de la créativité de l'histoire, ce qui l'empêche de se
figer à jamais dans la « forme enfin trouvée » des rapports
sociaux et des activités humaines, ce qui fait qu'une société
39
contient toujours plus que ce qu'elle présente. Vouloir abolir
cette distance, d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas
sauter de la préhistoire à l'histoire ou de la nécessité à la
liberté, c'est vouloir sauter dans l'absolu immédiat, c'est-à-
dire dans le néant. De même que l'individu ne peut saisir ou
se donner quoi que ce soit pas plus le monde que soi-
même en dehors du symbolique, une société ne peut se
donner quoi que ce soit en dehors de ce symbolique au
second degré, que représentent les institutions. Et, pas plus
que je ne peux appeler aliénation mon rapport au langage
comme tel
dans lequel je peux à la fois tout dire, et non
n'importe quoi, devant lequel je suis à la fois déterminé et
libre, par rapport auquel une déchéance est possible, mais
non inéluctable - il n'y a pas de sens d'appeler aliénation le
rapport de la société à l'institution comme telle. L'aliénation
apparaît dans ce rapport, mais elle n'est pas ce rapport
comme l'erreur ou le délire ne sont possibles que dans le
langage, mais ne sont pas le langage.
L'INSTITUTION :
LA VUE ECONOMIQUE-FONCTIONNELLE.
L'aliénation n'est ni l'inhérence à l'histoire, ni l'existence
de l'institution comme telles. Mais l'aliénation apparaît comme
une modalité du rapport à l'institution, et, par son intermé-
diaire, du rapport à l'histoire. C'est cette modalité qu'il nous
faut élucider, et pour cela, mieux comprendre ce qu'est
l'institution.
Dans les sociétés historiques, l'aliénation apparaît comme
incarnée dans la structure de classe, et la domination par une
minorité, mais en fait elle dépasse ces traits. Le dépasse-
ment de l'aliénation présuppose évidemment l'élimination de
la domination de toute classe particulière, mais va au-delà
de cet aspect. (Non pas que les classes puissent être éliminées,
et l'aliénation subsister, ou l'inverse ; mais les classes ne
seront effectivement éliminées, ou empêchées de renaître, que
parallèlement au dépassement de ce qui constitue l'aliénation
proprement dite). Il va au-delà, car l'aliénation a existé dans
des sociétés qui ne présentaient pas une structure de classe,
ni même une différenciation sociale importante ; et que, dans
une société d'aliénation la classe dominante elle-même est en
situation d'aliénation : ses institutions n'ont pas avec elle la
relation de pure extériorité et d'instrumentalité que lui attri-
buent parfois des marxistes naïfs, elle ne peut mystifier le
reste de la société avec son idéologie sans se mystifier en même
temps elle-même. L'aliénation se présente d'abord comme
aliénation de la société à ses institutions, comme autonomi-
sation des institutions à l'égard de la société. Qu'est-ce qui
s'autonomise là-dedans, pourquoi, et comment — voilà ce qu'il
s'agit de comprendre.
40
Ces constatations amènent à mettre en question la vue
courante de l'institution, que nous appellerons la vue écono-
mique-fonctionnelle (21). Nous entendons par là la vue qui
veut expliquer aussi bien l'existence de l'institution que ses
caractéristiques (idéalement, jusqu'aux moindres détails) par
la fonction que l'institution remplit dans la société et les
circonstances données, par son rôle dans l'économie d'ensemble
de la vie sociale (22). Peu importe, du point de vue qui est
ici le nôtre, si cette fonctionalité a une teinte « causaliste »
ou « finaliste » ; peu importe également le processus de nais-
sance et de survie de l'institution qui est supposé. Que l'on
dise que les hommes, ayant compris la nécessité que telle
fonction soit remplie, ont créé consciemment une institution
adéquate ; ou que l'institution ayant surgi « par hasard »
mais se trouvant être fonctionnelle, a survécu et a permis à la
société considérée de survivre ; ou que la société ayant besoin
que telle fonction soit remplie, s'est emparé de ce qui se
trouvait là et l'a chargé de cette fonction ; ou que Dieu, la
raison, la logique de l'histoire ont organisé et continuent
d'organiser les sociétés et les institutions qui leur correspon-
dent on met l'accent sur une et la même chose, la fonctio-
nalité, l'enchaînement sans faille des moyens et des fins ou
des causes et des effets sur le plan général, la correspondance
(21) Ainsi, d'après Bronislaw Malinowski ce dont il s'agit c'est
l'explication des faits anthropologiques à tous les niveaux de
développement par leur fonction, par le rôle qu'ils jouent dans le
système intégré de la culture, par la manière dont ils sont reliés
à l'intérieur du système, et par la manière dont ce système est relié
au milieu naturel... La vue fonctionaliste de la culture insiste donc
sur le principe que dans chaque type de civilisation, chaque coutume,
objet matériel, idée et croyance remplit une fonction vitale, a une
tâche à réaliser, représente une partie indispensable au sein d'un
tout qui fonctionne (within a working whole)». « Anthropology »,
Encyclopaedia Britannica, Suppl. Vol. I, New York and London, 1936,
pp. 132-133. V. aussi A.R. Radcliffe Brown, Structure and Function in
Primitive Society, London 1952.
(22) C'est finalement aussi la yue marxiste, pour laquelle les
institutions représentent chaque fois les moyens adéquats par lesquels
la vie sociale s'organise pour se mettre en accord avec les exigences
de l'« infrastructure ». Cette vue est tempérée par plusieurs consi-
dérations : a) La dynamique sociale repose sur le fait que les
institutions ne s'adaptent pas automatiquement et spontanément à
l'évolution de la technique, il y a passivité, inertie et « retard »
récurrent des institutions par rapport à l'infrastructure (qui doit
être chaque fois brisé par une révolution) ; b) Marx voyait claire-
ment l'autonomisation des institutions comme l'essence de l'aliénation
mais avait finalement une vue < fonctionnelle » de l'aliénation
elle-même ; c) les exigences de la logique propre de l'institution,
qui peuvent se séparer de la fonctionalité, n'étaient pas ignorées ;
mais leur rapport avec les exigences du système social chaque fois
considéré, et notamment avec « les besoins de la domination de la
classe exploiteuse » reste obscur, ou bien est intégré (comme dans
l'analyse de l'économie capitaliste par Marx) dans la fonctionalité
contradictoire du système. Nous revenons plus loin sur ces divers
points. Ils n'empêchent pas que la critique du fonctionalisme esquis-
sée dans les pages qui suivent, et qui se situe à un autre niveau, vaut
aussi pour le marxisme.
41
ne
la vue
stricte entre les traits de l'institution et les besoins « réels »
de la société considérée, bref, sur la circulation intégrale et
ininterrompue entre un « réel » et un « rationnel-fonctionnel ».
Nous contestons pas
fonctionaliste pour
autant qu'elle attire notre attention sur ce fait évident mais
capital, que les institutions remplissent des fonctions vitales
sans lequelles l'existence d'une société est inconcevable. Mais
nous la contestons pour autant qu'elle prétend que les insti-
tutions se réduisent à cela, et qu'elles sont parfaitement com-
préhensibles à partir de ce rôle.
Rappelons, d'abord, que la contre-partie négative de la
vue contestée, indique quelque chose d'incompréhensible
pour elle : la foule de cas où l'on constate dans des sociétés
données des fonctions qui « ne sont pas remplies » (bien
qu'elles pourraient l'être au niveau donné de développement
historique), avec des conséquences tantôt mineures, tantôt
catastrophiques pour la société en question.
Nous contestons la vue fonctionaliste, surtout, à cause
du vide qu'elle présente là où devrait être pour elle le point
central : quels sont les « besoins réels » d'une société, que les
institutions sont supposées n'être là que pour servir ? (23)
N'est-il pas évident que, une fois que l'on a quitté la compagnie
des singes supérieurs, les groupes humains se sont constitué
des besoins autres que biologiques ? La vue fonctionaliste
ne peut accomplir son programme que si elle s'octroie un
critère de la « réalité » des besoins d'une société ; où le
prendra-t-elle ? On connaît les besoins d'un être vivant, de
ſ'organisme biologique, et les fonctions qui leur correspon-
dent ; mais c'est que l'organisme biologique n'est rien d'autre
que la totalité des fonctions qu'il accomplit et qui le font
vivre. Un chien mange pour vivre, mais on peut tout aussi
bien dire qu'il vit pour manger : vivre, pour lui (et pour
l'espèce chien) n'est rien d'autre que manger, respirer, se
reproduire, etc. Mais cela ne signifie rien pour un être
humain, ni pour une société. Une société ne peut exister que
si une série de fonctions sont constamment accomplies (pro-
duction, enfantement et éducation, gestion de la collectivité,
règlement des litiges, etc.), mais elle ne se réduit pas à cela,
ni ses façons de faire face à ses problèmes ne lui sont dictées
une fois pour toutes par sa « nature », elle s'invente et se
définit aussi bien des nouveaux modes de répondre à ses
besoins que des nouveaux besoins. Nous reviendrons longue-
ment sur ce problème.
Mais ce qui doit fournir le point de départ de notre
recherche, c'est la manière d'être sous laquelle se donne l'ins-
titution --- à savoir, le symbolique.
(23) Ainsi Malinowski dit : « La fonction signifie toujours la
satisfaction d'un besoin » (« The Functional Theory », in A Scientific
Theory of Culture, Chapel Hill, N.C., 1944, p. 159).
42
L'INSTITUTION ET LE SYMBOLIQUE
ment
Tout ce qui se présente à nous, dans le monde social-
historique, est indissociablement tissé au symbolique. Non
pas qu'il s'y épuise. Les actes réels, individuels ou collectifs
— le travail, la consommation, la guerre, l'amour, l'enfante-
les innombrables produits matériels sans lesquels
aucune société ne saurait vivre un instant, ne sont pas (pas
toujours, pas directement) des symboles. Mais les uns et les
autres sont impossibles en dehors d'un réseau symbolique.
Nous rencontrons d'abord le symbolique, bien entendu,
dans le langage. Mais nous le rencontrons également, à un
autre degré et d'une autre façon, dans les institutions. Les
institutions ne se réduisent pas au symbolique, mais elles ne
peuvent exister que dans le symbolique, elles sont impossibles
en dehors d'un symbolique au second degré, elles constituent
chacune son réseau symbolique. Une organisation donnée de
l'économie, un système de droit, un pouvoir institué, une reli-
gion existent socialement comme des systèmes symboliques
sanctionnés. Ils consistent à attacher à des symboles (à des
signifiants) des signifiés (des représentations, des ordres, des
injonctions ou incitations à faire ou à ne pas faire, des consé-
quences, — des significations, au sens lâche du terme), et à
les faire valoir comme tels, c'est-à-dire à rendre cette attache
plus ou moins forcée pour la société ou le groupe considéré.
Un titre de propriété, un acte de vente est un symbole du
« droit », socialement sanctionné, du propriétaire de se livrer
à un nombre indéfini d'opérations sur l'objet de sa propriété.
Une feuille de paye est le symbole du droit du salarié d'exi-
ger une quantité donnée de billets qui sont le symbole du
droit de leur possesseur de se livrer à une variété d'actes
d'achat, chacun desquels serait à son tour symbolique. Le
travail lui-même qui est à l'origine de cette feuille de paye,
bien qu'éminemment réel pour son sujet et dans ses résultats,
est bien entendu constamment parcouru par des opérations
symboliques (dans la pensée de celui qui travaille, dans les
instructions qu'il reçoit, etc.). Et il devient symbole lui-même
lorsque, réduit d'abord en heures et minutes affectées de tels
coefficients, il entre dans l'élaboration comptable de la feuille
de paye ou du compte « résultats d'exploitation » de l'entre-
prise ; lorsqu'aussi, en cas de litige, il vient remplir des cases
dans les premisses et les conclusions du syllogisme juridique
qui le tranchera. Les décisions des planificateurs de l'écono-
mie sont symboliques (sans et avec ironie). Les arrêts du
tribunal sont symboliques et leurs conséquences le sont pres-
qu'intégralement jusqu'au geste du bourreau qui, réel par
excellence, est immédiatement aussi symbolique à un autre
niveau.
43
Toute vue fonctionaliste connaît et doit reconnaître le
rôle du symbolisme dans la vie sociale.
Mais ce n'est que rarement qu'elle en reconnaît l'impor-
tance et elle tend alors à la limiter. Ou bien le symbolisme
est vu comme simple revêtement neutre, comme instrument
parfaitement adéquat à l'expression d'un contenu pré-existant,
de la « vraie substance » des rapports sociaux, qui n'y ajoute
ni n'en retranche rien. Ou bien l'existence d'une « logique
propre » du symbolisme est reconnue, mais cette logique est
vue exclusivement comme l'insertion du symbolique dans un
ordre rationnel, qui impose ses conséquences qu'on l'ait voulu
ou non (24). Finalement, dans cette vue, la forme est toujours
au service du fond, et le fond est « réel-rationnel ». Mais il
n'en est pas ainsi, en réalité, et cela ruine les prétentions
interprétatives du fonctionalisme.
Soit cette institution si importante dans toutes les sociétés histo-
riques, la religion. Elle comporte toujours (nous ne discuterons pas
ici les cas-limites) un rituel. Considérons la religion mosaïque. La
définition de son rituel du culte (au sens le plus large) comporte
une prolifération de détails sans fin (25) ; ce rituel, fixé avec beaucoup
plus de détails et de précision que la Loi proprement dite, découle
directement de commandements divins et de ce fait d'ailleurs tous ses
détails sont mis sur le même plan. Qu'est-ce qui détermine la spéci-
ficité de ces détails ? Pourquoi sont-ils mis tous sur le même
plan ?
A la première question, on ne peut donner qu'une série de répon-
ses partielles. Les détails sont en partie déterminés par référence
à la réalité ou au contenu, (dans un temple fermé il faut des candé-
labres ; tel bois ou métal est le plus précieux dans la culture consi-
dérée, donc digne d'être utilisé mais déjà dans ce cas le symbole
et toute sa problématique de la métaphore directe ou par opposition
apparait : aucun diamant n'est assez précieux pour la tiare du
Pape, mais le Christ a lavé lui-même les pieds des Apôtres). Les
détails ont une référence non pas fonctionnelle, mais symbolique
au contenu (soit de la réalité, soit de l'imaginaire religieux : le
candélabre a sept lampes). Les détails peuvent enfin être déter-
minés par les implications ou conséquences logiques - rationnelles
des considérations précédentes.
Mais ces considérations ne permettent pas d'interpréter de
façon satisfaisante et intégrale un rituel quelconque. D'abord, elles
laissent toujours des résidus ; dans le quadruple réseau croisé du
fonctionnel, du symbolique et de leurs conséquences, les trous sont
(24) « Dans un Etat moderne il faut non seulement que le droit
corresponde à la situation économique générale et soit son expres-
sion, mais encore qu'il en soit l'expression systématique qui ne
s'inflige pas un démenti propre par ses contradictions internes. Et,
pour y réussir, il reflète de moins en moins fidèlement les réalités
économiques ». Fr. Engels, Lettre à Conrad Schmidt du 27 octobre
1890.
(25) Dans l'Exode, la Loi est formulée dans quatre chapitres
(20 à 23) mais le rituel et les directives concernant la construction,
de la Demeure en occupent onze (25 à 30 et 36 à 40). Les injonctions
concernant le rituel reviennent d'ailleurs tout le temps ; cf. Lévi-
tique, 1 à 7; Nombres, 4, 7-8, 10, 19, 28-29, etc. La construction
de la Demeure est aussi décrite avec un grand luxe de détails à
plusieurs reprises dans les livres historiques.
44
:
plus nombreux que les points recouverts. Ensuite, elles postulent
que la relation symbolique va de soi, alors qu'elle pose des problè-
mes immenses
pour commencer, le fait que le « choix » d'un
symbole n'est jamais ni absolument inéluctable, ni purement aléa-
toire. Un symbole ni ne s'impose avec une nécessité naturelle, ni
ne peut se priver dans sa teneur de toute référence au réel (ce n'est
que dans quelques branches de la mathématique que l'on pourrait
essayer de trouver des symboles totalement « conventionnels »
et encore, une convention qui a valu quelque temps cesse d'être
pure convention). Enfin, rien ne permet de déterminer dans cette
affaire les frontières du symbolique. Tantôt, du point de vue du
rituel, c'est la matière qui est indifférente, tantôt c'est la forme,
tantôt aucune des deux : on fixe la matière de tel objet, mais pas
de tous ; de même pour la forme. Un certain type d'église byzantine
est en forme de croix ; on croit comprendre (mais on est obligé
de se demander aussitôt pourquoi toutes les églises chrétiennes ne
le sont pas). Mais ce motif de la croix, qui pourrait être reproduit
dans les autres éléments et sous-éléments de l'architecture et de la
décoration de l'église, ne l'est pas ; il est repris à certains niveaux,
mais pour d'autres niveaux valent d'autres motifs, et il y a encore
des niveaux totalement neutres, simples éléments de support ou
de remplissage. Le choix des points dont le symbolisme s'empare
pour informer et « sacraliser » au second degré la matière du sacré
semble en grande partie (pas toujours) arbitraire. La frontière passe
presque n'importe où ; il y a la nudité du temple protestant et la
jungle luxuriante de certains temples hindous ; et soudain, là où
le symbolisme semble s'être emparé de chaque millimètre de ma-
tière, comme dans certaines pagodes au Siam, on s'aperçoit qu'il s'est
du coup vidé de contenu, qu'il est devenu pour l'essentiel simple
décoration (26).
Bref, un rituel n'est pas une affaire rationnelle et cela
permet de répondre à la deuxième question que nous posions :
pourquoi tous les détails y sont-ils placés sur le même plan ? Si un
rituel était une affaire rationnelle, on pourrait y retrouver cette
distinction entre l'essentiel et le secondaire, cette hiérarchisation
propre à tout réseau rationnel. Mais dans un rituel il n'y a aucun
moyen de distinguer, d'après des considérations de contenu quel-
conques, ce qui compte beaucoup et ce qui compte moins. La mise
sur le même plan, du point de vue de l'importance, de tout ce qui
compose un rituel est précisément l'indice du caractère irrationnel
de son contenu. Dire qu'il ne peut pas y avoir des degrés dans le
sacré, c'est une autre façon de dire la même chose : tout ce dont
le sacré s'est emparé est également sacré (et cela vaut aussi pour
les rituels si fréquents dans les névroses obsessionnelles).
Mais les fonctionalistes, marxistes ou non, n'aiment pas beau-
coup la religion, qu'ils traitent toujours comme si elle était, du point
de vue sociologique, une pseudo-super-structure, un épiphénomène
des épiphénomènes. Soit donc une institution sérieuse comme le
droit, directement reliée à la « substance » de toute société, qui est,
nous dit-on, l'économie, et qui n'a pas affaire à des fantômes, à des
candélabres et à des bondieuseries mais à ces relations sociales
réelles et solides qui s'expriment dans la propriété, les transactions
et les contrats. Dans le droit, on devrait pouvoir montrer que le
symbolisme est au service du contenu et n'y déroge que pour autant
que la rationalité l'y force. Laissons aussi de côté ces primitifs
VL
(26) Cela est une conséquence de cette loi fondamentale que tout
symbolisme est diacritique ou agit « par différence >> : un signe ne
peut émerger comme signe que sur fond de quelque chose qui n'est
pas signe ou qui est signe d'autre chose. Mais cela ne permet pas de
déterminer où doit passer chaque fois la frontière.
45
farfelus dont on nous rebat les oreilles et chez qui du reste il serait
fort pénible de distinguer les règles proprement juridiques des
autres. Prenons une bonne et belle société historique et réfléchissons
dessus.
On dira ainsi qu'à telle étape de l'évolution d'une société
historique apparaît nécessairement l'institution de la propriété pri-
vée, car celle-ci correspond au mode fondamental de production.
La propriété privée une fois établie, une série de règles doivent
étre fixées : les droits du propriétaire devront être définis, les
attaques contre ceux-ci sancti ées, les cas-limites tranchés (un
arbre pousse sur la frontière entre deux champs ; à qui appartien-
nent les fruits ?) Pour autant que la société donnée se développe
économiquement, que les échanges se multiplient, la transmission
libre de la propriété (qui au départ ne va nullement de soi et n'est
pas forcément reconnue, notamment pour les biens immeubles) doit
être réglementée, la transaction qui l'effectue doit être formalisée,
acquérir une possibilité de vérification qui minimise les litiges pos-
sibles. Ainsi dans cette institution qui reste un monument éternel
de rationalité, d'économie et de fonctionalité, équivalent institution-
nel de la géométrie euclidienne, nous voulons dire le droit romain,
s'élaborera pendant les dix siècles qui vont de la Lex Duodecim
Tabularum à la codification de Justinien, cette véritable forêt, mais
bien ordonnée et bien taillée, de règles qui servent la propriété, les
transactions et les contrats. Et, en prenant ce droit dans sa forme.
finale, on pourra montrer pour chaque paragraphe du Corpus
que la règle qu'il porte ou bien sert le fonctionnement de l'économie,
ou bien est exigée par d'autres règles qui le font.
On pourra le montrer et on n'aura rien montré quant à notre
problème. Car non seulement au moment où le droit romain y par-
vient, les raisons d'être de cette fonctionalité élaborée reculent,
la vie économique subissant une régression croissante depuis le
III° siècle de notre ère ; de telle sorte que, pour ce qui concerne le
droit patrimonial, la codification de Justinien apparaît comme
monument inutile et en grande partie redondant relativement à la
situation réelle de son époque (27). Non seulement, ce droit élaboré
dans la Rome des consuls et des Césars, retrouvera de façon parado-
xale sa fonctionalité dans beaucoup de pays européens à partir de la
Renaissance, et restera le Gemeines Recht de l'Allemagne capitaliste
jusqu'à 1900 (ce qui s'explique, jusqu'à un point, par son extrême
« rationalité » donc universalité). Mais surtout en mettant l'accent
sur la fonctionalité du droit romain, on escamoterait la caractéris-
tique dominante de son évolution pendant dix siècles, ce qui en
fait un exemple fascinant du type, des rapports entre l'institution
et la « réalité sociale sous-jacente » : cette évolution a été un long
effort pour parvenir précisément à cette fonctionalité, à partir d'un
état qui était loin de la posséder. Au départ, le droit romain est un
fruste ensemble de règles rigides, où la forme écrase le fond à un
degré qui dépasse de loin ce que pourraient justifier les exigences
de tout droit comme système formel. Pour ne citer qu'un exemple,
du reste central, ce qui est le noyau fonctionnel de toute transaction,
la volonté et l'intention des parties contractantes, joue pendant long-
temps un rôle mineur à l'égard de la loi ; ce qui domine, c'est le
rituel (28) de la transaction, le fait que telles paroles ont été pronon-
cées, tels gestes accomplis. Ce n'est que graduellement qu’on admettra
Un
(27) Cette fonctionalité excessive, redondante, est en fait une
dysfonctionalité, et les empereurs byzantins seront obligés à plusieurs
reprises de réduire la codification encombrante de Justinien en la
résumant.
(28) Le mot rituel s'impose ici, car le tégument religieux des
transactions au départ est incontestable.
46
que le rituel ne peut avoir des effets légaux que pour autant que la
vraie volonté des parties les visait. Mais le corrolaire symétrique de
cette proposition, à savoir que la volonté des parties peut constituer
des obligations indépendamment de la forme que prend son expres-
sion, le principe qui est le fondement du droit des obligations
moderne et qui en exprime vraiment le caractère fonctionnel : pacta
sunt servanda, ne sera jamais reconnu (29). La leçon du droit romain,
considéré dans son évolution historique réelle, n'est pas la fonctio-
nalité du droit, mais la relative indépendance du formalisme ou du
symbolisme à l'égard de la fonctionalité, au départ ; la conquête
lente, et jamais intégrale, du symbolisme par la fonctionalité,
ensuite.
L'idée que le symbolisme est parfaitement « neutre » ou
bien ce qui revient au même totalement « adéquat » au
fonctionnement des processus réels est inacceptable et, à vrai
dire, privée de sens.
Le symbolisme ne peut être ni neutre, ni totalement
adéquat, d'abord parce qu'il ne peut pas prendre ses signes
n'importe où, ni n'importe quels signes. Cela est évident pour
l'individu qui rencontre toujours devant lui un langage déjà
constitué (30), et qui, s'il charge d'un sens « privé » et parti-
culier tel mot, telle expression, ne le fait pas
dans une
liberté illimitée mais doit s'emparer de quelque chose qui
« se trouve là ». Mais cela est également vrai pour la société,
quoique d'une façon différente. La société constitue chaque
fois son ordre symbolique, dans un sens tout autre que l'indi-
vidu ne peut le faire. Mais cette constitution n'est pas « libre ».
Elle doit aussi prendre sa matière dans « ce qui se trouve déjà
là ». Cela est d'abord la nature et comme la nature n'est
pas un chaos, comme les objets naturels sont liés les uns aux
autres, cela entraîne des conséquences. Pour une société qui
connaît l'existence de cet animal, le lion signifie la force. Du
coup la crinière prend pour elle une importance symbolique
qu'elle n'a probablement jamais eu chez les Esquimaux. Mais
cela est aussi l'histoire. Tout symbolisme s'édifie sur les ruines
des édifices symboliques précédants, et utilise leurs matériaux
même si ce n'est que pour remplir les fondations des
nouveaux temples, comme l'ont fait les Athéniens après les
guerres médiques. Par ses connexions naturelles et historiques
virtuellement illimitées, le signifiant dépasse toujours l'atta-
chement rigide à un signifié précis et peut conduire à des lieux
(29) « Ex nudo pacto inter cives Romanos actio non nascitur ».
Sur les acrobaties par lesquelles les préteurs ont réussi à assouplir
considérablement cette règle, mais sans jamais oser l'écarter complète-
ment on peut voir n'importe quelle histoire du droit romain, p. ex.
R. von Mayr, Römische Rechtsgeschichte, Leipzig (Göschenverlag),
1913, Vol. II, 2, II, pp. 81-82, Vol. IV, p. 129, etc.
(30) « Il y a une efficacité du signifiant qui échappe à toute
explication psychogénétique, car cet ordre signifiant, symbolique, le
sujet ne l'introduit pas, mais le rencontre ». Jacques Lacan, Semi-
naire 1956-57, Compte rendu par J.B. Pontalis, Bulletin de Psychologie,
Vol. X, No 7, avril 1957, p. 428.
47
totalement inattendus. La constitution du symbolisme dans la
vie sociale et historique réelle n'a aucun rapport avec les défi-
nitions « closes » et « transparentes » des symboles le long
d'un ouvrage mathématique (qui d'ailleurs ne peut jamais
se fermer sur lui-même).
Un bel exemple, qui concerne à la fois le symbolisme du langage
et celui de l'institution est celui du « Soviet des Commissaires du
peuple ». Trotsky relate dans son autobiographie, que lorsque les
bolchéviks se sont emparés du pouvoir et ont formé un gouverne-
ment, il a fallu lui trouver un nom. La désignation « ministres » et
« Conseil des ministres » déplaisait fort à Lénine, parce qu'elle rap-
pelait les ministres bourgeois et leur rôle. Trotsky a propasé « commis-
suires du peuple » et, pour le gouvernement dans son ensemble,
« Soviet des commissaires du peuple ». Lénine en a été enchanté il
trouvait l'expression « terriblement révolutionnaire >> et ce nom
à été adopté. On créait un nouveau langage et, croyait-on, de nouvelles
institutions. Mais jusqu'à quel point tout cela était-il nouveau ?
Le nom était nouveau ; et il y avait, en tendance tout au moins, un
nouveau contenu social à exprimer : les Soviets étaient là, et c'était
en accord avec leur majorité que les bolchéviks avaient « pris le
pouvoir » (qui pour l'instant n'était, lui aussi, qu’un nom). Mais
au niveau intermédiaire qui allait se révéler décisif, celui de l'insti-
tution dans sa nature symbolique au second degré, l'incarnation du
pouvoir dans un collège fermé, inamovible, sommet d'un appareil
administratif distinct des administrés, à ce niveau-là, on
restait en fait aux ministres, on s'emparait de la forme déjà créée
par les rois d'Europe occidentale depuis la fin du Moyen Age. Lénine,
que les événements avaient forcé d'interrompre la rédaction de «L'Etat
et la Révolution » où il démontrait l'inutilité et la nocivité d'un
gouvernement et d'une administration séparés des masses organisées,
lorsqu'il s'est trouvé devant le vide créé par la révolution, et malgré
la présence de nouvelles institutions (les Soviets), n'a pu que ressortir
la forme institutionnelle qui était déjà là dans l'histoire. Il ne
voulait pas le nom « Conseil des ministres », mais c'est un Conseil
des ministres qu'il voulait et il l'a eu, à la fin. (Bien entendu
cela vaut aussi pour les autres dirigeants bolchéviks et pour l'essentiel
des membres du parti). La révolution créait un nouveau langage, et
avait des choses nouvelles à dire ; mais les dirigeants voulaient dire,
avec des mots nouveaux des choses anciennes.
Mais ces symboles, ces signifiants, déjà lorsqu'il s'agit du
langage, mais infiniment plus s'il s'agit des institutions, ne
sont pas totalement asservis au « contenu » qu'ils sont sup-
posés véhiculer pour une autre raison aussi. C'est qu'ils appar-
tiennent à des structures idéales qui leur sont propres, qu'ils
s'insèrent dans des relations quasi-rationnelles (31). La société
rencontre constamment le fait qu'un système symbolique quel-
conque doit être manié avec cohérence ; qu'il le soit ou qu'il
ne le soit pas, il surgit de cela une série de conséquences qui
en
(31) Quasi-rationnelles : rationnelles pour une grande partie, mais
comme dans l'usage social (et non pas scientifique) du symbolisme
le « déplacement » et la « condensation » comme disait Freud (la
métaphore et la métonymie, comme dit Lacan) sont constamment
présents, on ne peut pas identifier purement et simplement la logique
du symbolisme social avec une « logique pure », ni même avec la
logique du discours lucide.
48
s'imposent, qu'elles aient été ou non sues et voulues comme
telles.
On fait souvent mine de croire que cette logique symbo-
lique, et l'ordre rationnel qui lui correspond en partie, ne
posent pas des problèmes pour la théorie de l'histoire. En
fait, ils en posent d'immenses. Un fonctionaliste peut consi-
dérer comme allant de soi que, lorsqu'une société se donne
une institution, elle se donne en même temps comme possé-
dables toutes les relations symboliques et rationnelles que
cette institution porte ou engendre ou qu'en tout cas il ne
saurait y avoir de contradiction ou d'incohérence entre les
« fins » fonctionnelles de l'institution et les effets de son fonc-
tionnement réel, que chaque fois qu'une règle est posée, la
cohérence de chacune de ses conséquences innombrables avec
l'ensemble des autres règles déjà existantes et avec les fins
consciemment ou « objectivement » poursuivies est garantie. Il
suffit d'énoncer clairement ce postulat pour en constater l'ab-
surdité ; il signifie que l'Esprit absolu préside à la naissance
ou à la modification de chaque institution qui apparaît dans
l'histoire (qu'on l'imagine présent dans la tête de ceux qui
créent l'institution ou caché dans la force des choses ne
change rien à l'affaire) (31 a).
L'idéal de l'interprétation économique-fonctionnelle est
que les règles instituées doivent apparaître soit comme fonc-
tionnelles, soit comme réellement ou logiquement impliquées
par les règles fonctionnelles. Mais cette implication réelle ou
logique n'est pas donnée d'emblée, et n'est pas automatique-
ment homogène à la logique symbolique du système. L'exem-
ple du droit romain est là pour montrer qu'une société (portée
par prédilection sur la logique juridique, comme l'événement
l'a montré) a mis dix siècles pour dévoiler ces implications
et leur soumettre approximativement le symbolisme du
système. La conquête de la logique symbolique des institu-
tions, et sa « rationalisation » progressive sont elles-mêmes
des processus historiques (et relativement récents). Dans l'in-
tervalle, aussi bien la compréhension par la société de la logi-
que de ses institutions que sa non-compréhension sont des
facteurs qui pèsent lourd sur son évolution (sans parler de
leurs conséquences sur l'action des hommes, groupes, classes,
(31 a) Il faut évidemment être un esprit simple, comme Einstein,
pour écrire : « C'est un véritable miracle que nous puissions accom-
plir, sans rencontrer les plus grandes difficultés, ce travail (de
recouvrir une surface plane par un réseau de droites qui forment des
carrés égaux, comme dans les coordonnées cartésiennes)... (En faisant
cela) je n'ai plus la possibilité d'ajuster les quadrilatères de telle,
sorte que leurs diagonales soient égales. Si elles le sont d'elles-mêmes,
cela est une faveur spéciale que m'accorde la surface de marbre et
les petites règles, faveur qui ne peut me provoquer qu'une surprise
reconnaissante ». Relativity, London (Methuen), 1960, p. 85. Les
différentes tendances déterministes, dans les « sciences sociales », ont
depuis longtemps dépassé ces étonnements enfantins.
49
etc. ; la moitié pour ainsi dire de la gravité de la dépression
commencée en 1929 est due aux réactions « absurdes » des
groupes dirigeants). L'évolution de cette compréhension n'est
pas elle-même passible d'une interprétation «fonctionnelle ».
L'existence, et l'audience, de M. Rueff en 1965 défie toute
explication fonctionnelle et même rationnelle (32).
Considéré maintenant « en lui-même », le rationnel des
institutions non su et non voulu comme tel peut aider le
fonctionnel ; il peut aussi lui être adverse. S'il lui est violem-
ment et directement adverse l'institution s'effondrerait aussi-
tôt (le papier-monnaie de Law). Mais il peut l'être de façon
insinuante, lente, cumulative — et le conflit n'apparaît alors
qu'au bout d'un temps. Les crises de surproduction « norma-
les » du capitalisme classique appartiennent essentiellement à
ce cas (33).
Mais le cas le plus important est celui où la rationalité du
système institutionnel est pour ainsi dire « indifférente » quant
à sa fonctionalité, ce qui ne l'empêche pas d'avoir des consé-
quences réelles. Il y a, certes, des règles institutionnelles
positives qui ne contredisent pas les autres mais n'en découlent
(32) C'est un problème immense en soi, de savoir jusqu'à quel
point (et pourquoi) les hommes agissent chaque fois « rationnelle-
ment » eu égard à la situation réelle et institutionnelle. Cf. Max
Weber, Wirtschaft und Geselllschaft, Tübingen (Mohr) 1956, I, pp. 9-10.
Mais même la distinction qu'établit Weber, entre le déroulement
effectif d'une action et son déroulement idéal-typique dans l'hypo-
thèse d'un comportement parfaitement rationnel doit être précisée :
il y a la distance entre le déroulement effectif d'une action et la
« rationalité » positive (au sens où l'on parle de «droit positif ») de
la société considérée au moment considéré, c'est-à-dire le degré de
compréhension auquel cette société est parvenue concernant la logi-
que de son propre fonctionnement ; et il y a la distance entre cette
< rationalité » positive et une rationalité tout court concernant ce
même système institutionnel. La technique keynesienne d'utilisation
du budget pour la régulation de l'équilibre économique était tout
aussi valable en 1860 qu'en 1960. Mais il n'y a pas grand sens d'im-
puter aux dirigeants capitalistes d'avant 1930 un comportement
«irrationnel », lorsque, face à une dépression ils agissaient à contre
sens de ce que la situation aurait exigé ; ils agissaient, en règle
générale, conformément à ce qu'était la « rationalité positive » de
leur société. L'évolution de cette « rationalité positive » est un pro-
blème complexe que nous ne pouvons aborder ici ; rappelons seule-
ment qu'il est impossible de la réduire à un pur et simple « progrès
scientifique », pour autant que les intérêts et les situations de classe,
mais aussi des préjugés et des illusions « gratuites » qui relèvent
de l'imaginaire y jouent un rôle essentiel. La preuve, c'est qu'au-
jourd'hui encore, trente ans après la formulation et la diffusion
des idées keynesiennes, des fractions substantielles et parfois majori-
taires des groupes dominants défendent avec acharnement des con-
ceptions périmées. (comme le strict équilibre budgétaire ou le retour
à l'étalon-or) dont l'application plongerait tôt ou tard le système
dans la crise.
(33) Elles ne traduisent pas, comme le pensait Marx, des « contra-
dictions internes « insurmontables » (cf. dans le n° 31 de cette
revue, Le mouvement révolutionnaire sous le capitalisme moderne,
pp. 70 à 81, pour la critique de cette conception), mais le fait que,
pendant longtemps, la classe capitaliste était dépassée par la logique
de ses propres institutions économiques. V. la note précédente.
---50
pas non plus et sont posées sans qu'on puisse dire pourquoi
elles l'ont été de préférence à d'autres également compatibles
avec le système (34). Mais il y a surtout une foule de consé-
quences logiques des règles posées qui n'ont pas été explicitées
au départ et qui n'en jouent pas moins un rôle réel dans la
vie sociale. Elles contribuent donc à «former > celle-ci d'une
façon qui n'était pas exigée par la fonctionalité des relations
sociales, qui ne la contrecarre pas non plus, mais qui peut
tirer la société dans une des plusieurs directions que la fonc-
tionalité laissait indéterminées, ou créer des effets qui agis-
sent en retour sur celle-ci (la Bourse des valeurs représente,
par rapport au capitalisme industriel, essentiellement un tel
cas).
Cet aspect se relie à ce phénomène important, que nous
avons déjà remarqué à propos du rituel : rien ne permet
de déterminer a priori, le point où passera la frontière du
symbolique, le point jusqu'où le symbolique empiète sur le
fonctionnel. On ne peut fixer ni le degré général de symboli-
sation, variable selon les cultures (35), ni les facteurs qui font
que la symbolisation se porte avec une intensité particulière
sur tel aspect de la vie de la société considérée.
Nous avons essayé d'indiquer les raisons pour lesquelles
l'idée que le symbolisme institutionnel serait une expression
« neutre » « adéquate » de la fonctionalité, de la
« substance » des relations sociales sous-jacentes est inaccep-
table. Mais à vrai dire cette idée est privée de sens. Elle
postule effectivement une telle substance qui serait préconsti-
tuée par rapport aux institutions ; elle pose que la vie sociale
a « quelque chose à exprimer » qui est déjà pleinement réel
avant la langue dans laquelle il sera exprimé. Mais il est
impossible de saisir un « contenu » de la vie sociale qui serait
premier et « se donnerait » une expression dans les institutions
indépendamment de celles-ci ; ce « contenu » (autrement que
comme moment partiel et abstrait, séparé après coup), n'est
définissable
que dans une structure, et celle-ci comporte tou-
jours l'institution. Les « relations sociales réelles » dont il
s'agit sont toujours instituées, non pas qu'elles portent un
ou
(34) Un exemple évident est celui des peines fixées par les lois
pénales. Si l'on peut, jusqu'à un certain point, interpréter l'échelle
de gravité des délits et des crimes établie par chaque société, il est
évident que l'échelle des peines correspondantes comporte, qu'elle
soit précise ou imprécise, un élément d'arbitraire non rationalisable
du moins dès qu'on a quitté la loi du talion. Que la loi prévoie la
même peine pour, disons, tel vol qualifié et le proxénétisme, n'est
ni logique ni absurde ; c'est arbitraire. V. aussi plus loin la discus-
sion sur la Loi mosaïque.
(35) On n'a qu'à penser, par exemple, à l'opposition entre l'ex-
trême richesse du symbolisme concernant la « vie courante » dans
la plupart des cultures asiatiques traditionnelles et sa relative fruga-
lité dans les cultures européennes ; ou encore, à la variabilité de la
frontière qui sépare le droit et les mours dans les diverses sociétés
historiques.
51
ou une
vêtement juridique (elles peuvent très bien ne pas en porter
dans certains cas) ,mais qu'elles ont été posées comme façons
de faire universelles, symbolisées et sanctionnées. Cela vaut
bien entendu aussi, peut-être même surtout, pour les « infra-
structures », les rapports de production. La relation maître-
esclave, serf-seigneur, prolétaire-capitaliste, salariés-bureau-
cratie est déjà une institution et ne peut surgir comme relation
sociale sans s'institutionaliser aussitôt.
Dans le marxisme, il y a à cet égard une ambiguïté, tenant à ce
que le concept d'institution (même si le mot n'est pas utilisé) n'est
pas élucidé. Prises au sens étroit, les institutions appartiennent à la
« super-structure », et seraient déterminées par l « infra-structure ».
Cette vue est en elle-même intenable comme nous avons essayé de le
montrer (36). De plus, si on l'acceptait, on devrait voir les institutions
comme des « formes » servant et exprimant un « contenu »
substance de la vie sociale, structuré déjà avant ces institutions,
autrement cette détermination de celles-ci par 'celui-là n'aurait pas
de sens. Cette substance serait l' « infra-structure » qui, comme le mot
l'indique, est déjà structurée. Mais comment peut-elle l'être, si elle
n'est pas instituée ?. Si l'« économie », par exemple, détermine le
« droit » si les rapports de production déterminent les formes de
propriété, cela signifie que les rapports de production peuvent être
saisis comme articulés et le sont effectivement déjà «avant.» (logi-
quement et réellement) leur expression juridique. Mais des rapports
de production articulés à l'échelle sociale (non pas le rapport de
Robinson à Vendredi) signifient ipso facto un réseau à la fois réel et
symbolique qui se sanctionne lui-même donc une institution (36 a).
Les classes sont déjà dans les rapports de production, qu'elles soient
non reconnues comme telles par cette institution
second
degré » qu'est le droit. C'est ce qu'on a essayé de montrer autrefois
dans cette revue, à propos de la bureaucratie et de la propriété
« nationalisée » en U.R.S.S. (37). Le rapport bureaucratie
prolé-
tariat, en U.R.S.S., est institué en tant que rapport de classe, produc-
tif - économique - social, même s'il n'est pas institué comme tel et
expressément du point de vue juridique (de même que ne l'est pas,
du reste, le rapport bourgeoisie-prolétariat comme tel). Par consé-
quent, le problème du symbolisme institutionnel et de sa relative
autonomie par rapport aux fonctions de l'institution apparait déjà
au niveau des rapports de production,' encore plus de l'économie au
sens strict, et déjà à ce niveau une vue simplement fonctionaliste est
intenable. Il ne faut pas confondre cette analyse avec la critique de
certains néo-kantiens, comme R. Stammler, contre le marxisme, basée
sur l'idée de la priorité de la « forme » de la vie sociale (que serait le
droit) à l'égard de sa « matière » (l'économie). Cette critique participe
de la même ambiguïté que la vue marxiste qu'elle veut combattre.
L'économie elle-même ne peut exister que comme institution, cela
n'implique pas nécessairement une « forme juridique » indépendante.
Quant au rapport entre l'institution et la vie sociale qui s'y déroule,
ои
< au
(36) V. la première partie de cet article, dans le n° 36 de cette
revue, pp. 14. à 25.
(36 a) De même, on a parfois l'impression que certains psycho-
logues contemporains oublient que le problème de la bureaucratie
dépasse de loin la simple différenciation des rôles dans le groupe
élémentaire même si la bureaucratie y trouve un correspondant
indispensable.
(37) Cf. P. Chaulieu, Les rapports de production en Russie,
S. ou B., nº 2, p. 1 et suiv.
52
il ne peut pas être vu comme un rapport de forme à matière au sens
kantien, et en tout cas pas comme impliquant une « antériorité » de
l'une sur l'autre. Il s'agit de moments dans une structure
qui n'est
jamais rigide, et jamais identique d'une société à l'autre (38).
On ne peut pas dire non plus, évidemment, que le
symbolisme institutionnel « détermine » le contenu de la vie
sociale. Il y a ici un rapport spécifique, sui generis, que l'on
méconnaît et déforme à vouloir le saisir comme pure causation
ou pur enchaînement de sens, comme liberté absolue ou
détermination complète, comme rationalité transparente ou
séquence de faits bruts.
La société constitue son symbolisme, mais non dans une
liberté totale. Le symbolisme s'accroche au naturel, et il
s'accroche à l'historique (à ce qui était déjà là) ; il participe
enfin au rationnel. Tout cela fait que des enchaînements de
signifiants, des rapports entre signifiants et signifiés, des
connexions et des conséquences émergent, qui n'étaient ni
visés ni prévus. Ni librement choisi, ni imposé à la société
considérée, ni simple instrument neutre et médium transpa-
rent, ni opacité impénétrable et adversité irréductible, ni
maître de la société, ni esclave souple de la fonctionalité, ni
moyen de participation directe et complète à un ordre ration-
nel, le symbolisme détermine des aspects de la vie de la
société (et pas seulement ceux qu'il était supposé déterminer)
en même temps qu'il est plein d'interstices et de degrés de
liberté.
Mais ces caractéristiques du symbolisme, si elles indiquent
le problème que constitue chaque fois pour la société la nature
symbolique de ses institutions, n'en font pas un problème
insoluble, et ne suffisent pas pour rendre compte de l'autono-
misation des institutions relativement à la société. Pour autant
que
l'on rencontre dans l'histoire une autonomisation du sym-
bolisme, celle-ci n'est pas un fait dernier, et ne s'explique
pas par elle-même. Il y a un usage immédiat du symbolique,
où le sujet peut se laisser dominer par celui-ci, mais il y en
a aussi un usage lucide ou réfléchi. Même si ce dernier ne
peut jamais être garanti a priori (il n'est pas possible de
construire un langage, ni même un algorithme, à l'intérieur
duquel l'erreur soit « mécaniquement » impossible), il est pos-
sible, il se réalise, et montre ainsi la voie et la possibilité
d'un autre rapport où le symbolique n'est plus autonomisé
et peut être amené à l'adéquation au contenu. C'est une
chose de dire que l'on ne peut choisir un langage dans une
liberté absolue, et que chaque langage empiète sur ce qui
« est à dire ». C'est une autre chose, de croire que l'on est
fatalement dominé par le langage et qu'on ne peut jamais
(38) V. Rudolf Stammler, Wirtschaft und Recht nach der mate-
rialistichen Geschichtsauffassung, 50 éd., Berlin (de Gruyter), 1924,
en particulier pp. 108 à 151 et 177 à 211. V. aussi la sévère critique
de Max Weber, dans les Gesammelte Aufsätze zur Wissenchaftslehre.
53
dire que ce qu'il vous amène à dire. Nous ne pouvons jamais
sortir du langage, mais notre mobilité dans le langage n'a
pas de limites et nous permet de tout mettre en question, y
compris même le langage et notre rapport à lui. Il n'en va
pas autrement avec le symbolisme institutionnel – sauf
évidemment que le degré de complexité y est incomparable-
ment plus élevé. Rien de ce qui appartient en propre au
symbolique n'impose inéluctablement la domination d'un sym-
bolisme autonomisé des institutions sur la vie sociale, rien
n'exclut, dans le symbolique institutionnel lui-même, son
usage
lucide
par
la société étant ici encore entendu qu'il
n'est pas possible de concevoir des institutions qui interdisent
« par construction », « mécaniquement » l'asservissement de la
société à son symbolisme. Il y a, à cet égard, un mouvement
historique réel, dans notre cycle culturel gréco-occidental, de
conquête progressive du symbolisme, aussi bien dans les rap-
ports avec le langage que dans les rapports avec les insti-
tutions (39). Et même les gouvernements capitalistes ont fina-
lement appris à se servir à peu près correctement, à certains
égards, du « langage » et du symbolisme économiques, à dire
ce qu'ils veulent dire par le crédit, la fiscalité, etc. (le contenu
de ce qu'ils disent est évidemment autre chose). Cela n'im-
plique certes pas que n'importe quel contenu est exprimable
dans n'importe quel langage ; la pensée musicale de Tristan
ne pouvait pas être dite dans le langage du Clavecin bien
tem péré, la démonstration d'un théorème mathématique même
simple n'est pas possible dans la langue de tous les jours. Une
nouvelle société exigera de toute évidence un nouveau symbo-
lisme institutionnel, et le symbolisme institutionnel d'une
société autonome aura peu de rapports avec ce que nous
avons connu jusqu'ici.
La maîtrise du symbolisme des institutions ne poserait
donc pas des problèmes essentiellement différents de ceux de
la maîtrise du langage (abstraction faite pour l'instant de son
« alourdissement » matériel des classes, des armes, des
objets, etc.), s'il n'y avait pas autre chose. Un symbolisme est
maîtrisable, sauf pour autant qu'il renvoie, en dernier lieu,
à quelque chose qui n'est pas du symbolique. Ce qui dépasse
le simple « progrès dans la rationalité» ; ce qui permet au
symbolisme institutionel non pas de dévier passagèrement
quitte à être repris (comme peut le faire aussi le discours
lucide), mais de s'autonomiser ; ce qui, enfin, lui fournit son
supplément essentiel de détermination ou de spécification,
ne relève pas du symbolique.
(39) Cf. à nouveau ce que nous
romain.
avons dit plus haut du droit
54
LE SYMBOLIQUE ET L'IMAGINAIRE.
Les déterminations du symbolique que nous venons de
décrire n'en épuisent pas la substance. Il reste une compo-
sante essentielle, et, pour notre propos, décisive : c'est la
composante imaginaire de tout symbole et de tout symbolisme,
à quelque niveau qu'ils se situent. Rappelons le sens courant
du terme imaginaire, qui pour l'instant nous suffira : nous
parlons d'imaginaire lorsque nous voulons parler de quelque
chose d'« inventé » qu'il s'agisse d'une invention « abso-
lue » (« une histoire imaginée de toutes pièces »), ou d'un
glissement, d'un déplacement de sens, où des symboles déjà
disponibles sont investis d'autres significations que leurs
significations « normales » ou canoniques (« qu'est-ce que tu
vas imaginer là », dit la femme à l'homme qui récrimine sur
un sourire échangé par elle avec un tiers). Dans les deux
cas, il est entendu que l'imaginaire se sépare du réel, qu'il
prétende se mettre à sa place (un mensonge) ou qu'il ne le
prétende pas (un roman).
Les rapports profonds et obscurs entre le symbolique et
l'imaginaire apparaissent aussitôt si l'on réfléchit à ce fait :
l'imaginaire doit utiliser le symbolique, non seulement pour
s'« exprimer », ce qui va de soi, mais pour « exister », pour
passer du virtuel à quoi que ce soit de plus. Le délire le plus
élaboré comme le fantasme le plus secret et le plus vague
sont faits d'« images » mais ces « images » sont là comme
représentant autre chose, ont donc une fonction symbolique.
Mais aussi, inversement, le symbolisme présuppose la capa-
cité imaginaire. Car il presuppose la capacité de voir dans
une chose ce qu'elle n'est pas, de la voir autre qu'elle n'est.
Cependant, dans la mesure où l'imaginaire revient finale-
ment à la faculté originaire de poser ou de se donner, sous le
mode de la représentation, quelque chose qui n'est pas (qui
n'est pas donné dans la perception ou ne l'a jamais été), nous
parlerons d'un imaginaire dernier ou radical, comme racine
commune de l'imaginaire effectif et du symbolique (40). C'est
finalement la capacité élémentaire et irréductible d'évoquer
une image (41).
(40) On pourrait essayer de distinguer dans la terminologie ce
que nous appelons l'imaginaire dernier ou radical, la capacité de
faire surgir comme image quelque chose qui n'est pas et n'a pas
été, de ses produits, que l'on pourrait désigner comme l'imaginé.
Mais la forme grammaticale de ce terme peut prêter à confusion,
et nous préférons parler d'imaginaire effectif.
(41) « L'homme est cette nuit, ce néant vide qui contient tout dans
sa simplicité ; une richesse d'un nombre infini de représentations,
d'images, dont aucune ne surgit précisément à son esprit ou qui ne
sont pas toujours présentes. C'est la nuit, l'intériorité de la nature
qui existe ici : le Šoi pur. Dans des représentations fantastiques, il
fait nuit tout autour; ici surgit alors une tête ensanglantée, là
une autre figure blanche ; et elles disparaissent tout aussi brusque-
ment. C'est cette nuit qu'on aperçoit lorsqu'on regarde un homme
1
55
L'emprise décisive de l'imaginaire sur le symbolique
peut être comprise à partir de cette considération : le symbo-
lisme suppose la capacité de poser entre deux termes un lien
permanent de sorte que l'un « représente » l'autre. Mais ce
n'est que dans les étapes très avancées de la pensée ration-
nelle lucide que ces trois éléments (le signifiant, le signifié
et leur lien sui generis) sont maintenus comme simultané-
ment unis et distincts, dans une relation à la fois ferme et
souple. Autrement, la relation symbolique (dont l'usage
« propre » suppose la fonction imaginaire et sa maîtrise par
la fonction rationnelle) en revient, ou plutôt en reste dès le
départ là où elle a surgi : au lien rigide (la plupart du temps,
sous le mode de l'identification, de la participation ou de la
causation) entre le signifiant et le signifié, le symbole et
la chose, c'est-à-dire dans l'imaginaire effectif.
Si nous avons dit que le symbolique présuppose l'ima-
ginaire radical et s'y appuie, cela ne signifie pas que le
symbolique n'est, globalement, que de l'imaginaire effectif
dans son contenu. Le symbolique comporte, presque toujours,
une composante « rationnelle-réelle » : ce qui représente le
réel, ou ce qui est indispensable pour le penser, ou pour
l'agir. Mais cette composante se tisse inextricablement à la
composante imaginaire effective -- et cela pose, aussi bien à
la théorie de l'histoire qu'à la politique, un problème
essentiel.
Il est écrit dans les Nombres (15, 32 - 36) que les juifs ayant
découvert un homme qui travaillait le Sabbat, ce qui était interdit par
la Loi, l'amenèrent devant Moïse. La Loi ne fixait aucune peine pour
la transgression, mais le Seigneur se manifesta à Moïse, exigeant que
l'homme fût lapidé et il le fut.
Il est difficile de ne pas être frappé dans ce cas comme du
reste souvent lorsqu'on parcourt la Loi mosaïque par le carac-
tère démesuré de la peine, par l'absence de lien nécessaire, entre le
fait (la transgression) et la conséquence (le contenu de la peine). La
lapidation n'est pas le seul moyen d'amener les gens à respecter le
Sabbat, l'institution (la peine) dépasse nettement ce qu'exigerait
l'enchaînement rationnel des causes et des effets, des moyens et des
fins. Si la raison est, comme disait Hegel, l'opération conforme à un
but, le Seigneur s'est-il montré, dans cet exemple, raisonnable ? Rap-
pelons-nous que le Seigneur lui-même est imaginaire. Derrière la Loi,
qui est « réelle », une institution sociale effective, se tient le Seigneur
imaginaire qui s'en présente comme la source et la sanction ultime.
L'existence imaginaire du Seigneur est-elle raisonnable ? On dira
qu'à une étape de l'évolution des sociétés humaines, l'institution
ďun imaginaire investi de plus de réalité que le réel Dieu, plus
généralement un imaginaire religieux est « conforme aux buts »
de la société, découle des conditions réelles et remplit une fonction
essentielle. On tâchera de montrer, dans une perspective marxiste ou
dans les yeux : une nuit qui devient terrible ; c'est la nuit du monde
qui nous fait alors face. La puissance de tirer de cette nuit les
images, ou de les y laisser tomber, [c'est cela] le fait de se poser
soi-même, la conscience intérieure, l'action, la scission», Hegel,
Jenense Realphilosophie (1805-1806).
56
ces
sens
comme
freudienne (qui en l'occurrence non seulement ne s'excluent, mais se
complètent) que cette société produit nécessairement cet imaginaire,
cette « illusion » comme disait Freud en parlant de la religion, dont
elle a besoin pour son fonctionnement. Ces interprétations sont pré-
cieuses et vraies. Mais elles rencontrent leur limite dans
questions : Pourquoi est-ce dans l'imaginaire qu'une société doit
chercher le complément nécessaire à son ordre ? Pourquoi rencontre-
t-on chaque fois, au noyau de cet imaginaire et à travers toutes ses
expressions, quelque chose d'irréductible au fonctionnel, qui est
comme un investissement initial du monde et de soi-même par la
société avec un sens qui n'est pas « dicté » par les facteurs réels
puisque c'est lui plutôt qui confère à ces facteurs réels telle importance
et telle place dans l'univers que se constitue cette société
que l'on reconnaît à la fois dans le contenu et dans le style de sa
vie (et qui n'est pas tellement éloigné de ce que Hegel appelait
« l'esprit d'un peuple ») ? Pourquoi, de toutes les tribus pastorales
qui ont erré au deuxième millénaire avant notre ère dans le désert
entre, Thèbes et Babylone, une seule a choisi d'expédier au Ciel un
Père innomable, sévère et punissant, d'en faire l’unique créateur
et le fondement de la Loi et d'introduire ainsi le monothéisme dans
l'histoire ? Et pourquoi, de tous les peuples qui ont fondé des cités
dans le bassin méditerranéen, un seul a décidé qu'il y a
une loi
impersonnelle qui s'impose même aux Dieux, la posée
consubstantielle au discours cohérent et a voulu fonder sur ce Logos
les rapports entre les hommes, inventant ainsi et du même coup
philosophie et démocratie ? Comment se fait-il que, trois mille ans
après, nous subissons encore les conséquences de ce qu'ont pu rêver
les Juifs et les Grecs ? Pourquoi et comment cet imaginaire, une fois
posé, entraîne des conséquences propres, qui . vont au-delà de ses
« motifs » fonctionnels et parfois même les contrarient, qui survivent
longtemps après les circonstances qui l'ont fait naître qui finale-
ment montrent dans l'imaginaire un facteur autonomisé de la vie
sociale ?
Soit la religion mosaïque instituée. Comme toute religion, elle
est centrée sur un imaginaire. En tant que religion, elle doit instaurer
des rites ; en tant qu'institution, elle doit s'entourer de sanctions.
Mais ni comme religion, ni comme institution, elle ne peut exister,
si, autour de l'imaginaire central, ne commence pas la prolifération
d'un imaginaire second. Dieu a créé le monde en sept jours (six plus
un). Pourquoi sept ? On peut interpréter le nombre sept à la manière
freudienne ; on pourrait éventuellement aussi renvoyer à des faits
ou à des coutumes productives quelconques. Toujours est-il que cette
détermination terrestre (peut être « réelle », mais peut être déjà
imaginaire) exportée au iel, en est ré-importée sous forme de
sacralisation de la semaine. Le septième jour devient maintenant
jour d'adoration de Dieu et de repos obligatoire. Les conséquences
commencent à en découler, innombrables. La première a été la
lapidation de ce pauvre hère, qui ramassait des brindilles dans le
désert le jour du Seigneur. Parmi les plus récentes, mentionnons au
hasard le niveau du taux de la plus-value, la courbe de la fréquence
des coïts dans les sociétés chrétiennes qui présente des maxima
périodiques tous les sept jours, et l'ennui mortel des Dimanches
anglais (42).
Soit, dans un autre exemple, les cérémonies de « pas-
sage »,
de « confirmation », d'« initiation » qui marquent
(42) Il eût été évidemment beaucoup plus conforme à la « logi-
que » du capitalisme d'adopter un calendrier à « décades », avec 36
ou 37 jours de repos par an, que de maintenir les semaines et les
52 dimanches.
57
ces
l'entrée d'une classe d'âge d'adolescents dans la classe adulte ;
cérémonies qui jouent un rôle si important dans la vie de
toutes les sociétés archaïques, et dont des restes non négli-
geables subsistent dans les sociétés modernes. Dans le contexte
chaque fois donné, cérémonies font apparaître une
importante composante fonctionnelle - économique, et se
tissent de mille façons à la « logique » de la vie de la société
considérée (« logique » largement non-consciente, bien
entendu). Il est nécessaire que l'accession d'une série d'indi-
vidus à la plénitude de leurs droits soit marquée publiquement
et solennellement (à défaut d'état civil, dirait un fonctiona-
liste prosaïque), qu'une « certification » ait lieu, que pour le
psychisme de l'adolescent cette étape cruciale de sa maturation
soit marquée par une fête et une épreuve. Mais autour de ce
noyau on serait presque tenté de dire, comme pour les
huîtres perlières : autour de cette impureté
cristallise une
sédimentation innombrable de règles, d'actes, de rites, de
symboles, bref de composantes pleines d'éléments magiques
et plus généralement imaginaires, dont la justification rela-
tivement au noyau fonctionnel est de plus en plus médiate,
et finalement nulle. Les adolescents doivent jeûner tel nombre
de jours, et ne manger que tel type de nourriture, préparée
par telle catégorie de femmes, subir telle épreuve, dormir
dans telle case ou ne pas dormir tel nombre de nuits, porter
tels ornements et tels emblèmes, etc.
L'ethnologue, aidé par des considérations marxistes,
freudiennes ou autres, tentera chaque fois de fournir une
interprétation de la cérémonie dans tous ses éléments. Et il
fait bien s'il le fait bien. Il est aussitôt évident
que
l'on
ne peut interpréter la cérémonie par une réduction directe
à son aspect fonctionnel (pas plus que l'on n'a interprété une
névrose en disant qu'elle a à faire avec la vie sexuelle du
sujet) ; la fonction est à peu près partout la même, donc
incapable d'expliquer l'invraisemblable foisonnement de
détails et de complications presque toujours différents. L'in-
terprétation comportera une série de réductions indirectes à
d'autres composantes, où l'on trouvera à nouveau un élément
fonctionnel et autre chose (par exemple la composition du
repas des adolescents ou la catégorie de femmes qui le
prépareront seront reliées à la structure des clans ou
pattern alimentaire de la tribu, qui seront à leur tour
ramenés à des éléments « réels », mais aussi à des phénomènes
totémiques, à des tabous frappant tels aliments, etc.). Ces
réductions successives rencontrent tôt ou tard leur limite, et
cela sous deux formes : les éléments derniers sont des sym-
boles, de la constitution desquels l'imaginaire n'est pas
séparable ou isolable ; les synthèses successives de
éléments, les « totalités partielles » dont est faite la vie et la
structure d'une société, les « figures » où elle se laisse voir
au
ces
58
pour elle-même (les clans, les cérémonies, les moments de la
religion, les formes des rapports d'autorité, etc.) possèdent
elles-mêmes un sens indivisible comme s'il procédait d'une
opération originaire qui l'a posé d'emblée
et ce sens,
désormais actif comme tel, se situe à un autre niveau que
n'importe quelle détermination fonctionnelle.
Cette double action se laisse voir le plus facilement
dans les cultures les plus « intégrées », quel que soit le mode
de cette intégration. Elle se laisse voir dans le totémisme, où
un symbole « élémentaire » est en même temps principe
d'organisation du monde et fondement de l'existence de la
tribu. Elle se laisse voir dans la culture grecque, où la
religion (inséparable de la cité et de l'organisation sociale-
politique) recouvre de ses symboles chaque élément de la
nature et des activités humaines et confère du même coup un
sens global à l'univers et à la place des hommes dans
celui-ci (43). Elle se voit même dans le monde capitaliste
occidental, où, comme nous le verrons, le « désenchantement
du monde » et la destruction des formes antérieures de
l'imaginaire est allée paradoxalement de pair avec la consti--
tution d'un nouvel imaginaire, centré le « pseudo-
rationnel », et portant à la fois sur les « éléments derniers >>
du monde et sur son organisation totale.
Ce que nous disons concerne ce qu'on peut appeler l'imaginaire
central de chaque culture, qu'il se situe au niveau des symboles
élémentaires ou d'un sens global. Il y a évidemment en plus ce que
l'on peut appeler l'imaginaire périphérique, non moins important
dans ses effets réels, mais qui ne nous occupera pas ici. Il correspond
à une deuxième ou nième élaboration imaginaire des symboles, à des
couches successives de sédimentation. Une icône est un objet symbo-
lique d'un imaginaire mais il est investi d'une autre signification
imaginaire lorsque les fidèles en grattent la peinture et la boivent
comme médicament. Un drapeau est un symbole à fonction rationnelle,
signe de reconnaissance et de ralliement, qui devient rapidement ce
pour quoi on peut et on doit se tuer, ce qui fait descendre des frissons
le long de la colonne vertébrale des patriotes qui regardent passer
le défilé militaire.
sur
(43) Evoquons pour la facilité et la brièveté, l'exemple certaine-
ment le plus banal : la déesse « de la terre », la déesse-terre,
Demeter. L'étymologie la plus probable (d'autres ont été également
proposées ; cf. Liddel-Scott, Greek-English Lexicon, Oxford 1940)
est Gé-Meter, Gaia-Meter, terre-mère. Gaia est à la fois le nom de la
terre et de la première déesse, qui, avec Ouranos, est à l'origine de
la lignée des dieux. La terre est d'emblée vue comme déesse originaire,
rien n'indique qu'elle ait été jamais vue comme « objet ». Ce terme
qui dénote la terre, connote en même temps les « propriétés », plutôt
les façons d'être essentielles de la terre : féconde et nourricière.
C'est ce que connote aussi le signifiant mère. La liaison, ou plutôt
l'identification des deux signifiants : Terre-Mère, est évidente. Ce pre-
mier moment imaginaire est indissociable de l'autre : que la Terre-
Mère est une divinité, et anthropomorphe - pour cause, puisqu'elle est
Mère ! La composante imaginaire du symbole particulier est de même
substance si l'on peut dire, que l'imaginaire global de cette culture
ce que nous appelons la divinisation anthropomorphe des forces
de la nature.
59
ne
La vue moderne de l'institution, qui en
réduit la
signification au fonctionnel, n'est que partiellement correcte.
Pour autant qu'elle se présente comme la vérité sur le pro-
blème de l'institution, elle n'est que projection. Elle projette
sur l'ensemble de l'histoire une idée empruntée non pas
même à la réalité effective des institutions du monde
capitaliste occidental (qui n'ont été et sont toujours,
malgré l'énorme mouvement de « rationalisation », que par-
tiellement fonctionnelles), mais à ce que ce monde voudrait
que ses institutions soient. Des vues encore plus récentes, qui
ne veulent voir dans l'institution que le symbolique (et
identifient celui-ci au rationnel) représentent aussi une vérité
seulement partielle, et leur généralisation contient également
une projection.
Les vues anciennes sur l'origine « divine » des institutions
étaient, sous leurs enveloppes mythiques, beaucoup plus
vraies. Lorsque Sophocle (44) parlait de lois divines, plus
fortes et plus durables que celles faites de main d'homme
(et, comme par hasard, il s'agit dans le cas précis de l'in-
terdit de l'inceste qu'Edipe a violé il indiquait une
source de l'institution au-delà de la conscience lucide des
hommes comme législateurs. C'est cette même vérité qui
sous-tend le mythe de la Loi donnée à Moïse par Dieu, - par
un pater absconditus, par un invisible innommable. Par delà
l'activité consciente d'institutionalisation, les institutions ont
trouvé leur source dans l'imaginaire inconscient. Cet imagi-
naire doit s'entrecroiser avec le symbolique, autrement la
société n'aurait pas pu « se rassembler », et avec l'économique-
fonctionnel, autrement elle n'aurait pas pu survivre. Il peut
se mettre, il se met nécessairement à leur service aussi : il y
a, certes, une fonction de l'imaginaire de l'institution, bien que
là encore, on constate que l'effet de l'imaginaire dépasse sa
fonction ; il n'est pas « facteur dernier » (nous n'en cherchons
du reste pas)
mais sans lui, la détermination du symbolique
comme du fonctionnel, la spécificité et l'unité du premier,
l'orientation et la finalité du second restent incomplètes et
finalement incompréhensibles.
-
L'ALIENATION ET L'IMAGINAIRE.
L'institution est un réseau symbolique, socialement sanc-
tionné, où se combinent en proportions et en relation variables
une composante fonctionnelle et une composante imaginaire.
L'aliénation, c'est l'autonomisation et la dominance du moment
imaginaire dans l'institution, qui entraîne l'autonomisation et
(44) <...
Les lois les plus hautes, nées dans l'éther céleste, dont
l'Olympe seul est le père, qui n'ont pas été engendrées par la nature
mortelle des hommes et qu'aucun oubli jamais_n'endormira ;
en elles gît un grand dieu, qui ne vieillit pas ». Edipe Roi, 865-871.
car
60
ce
la dominance de l'institution relativement à la société. Cette
autonomisation de l'institution s'exprime et s'incarne réelle-
ment et matériellement, mais suppose toujours aussi que la
société vit ses, rapports avec ses institutions sur le mode de
l'imaginaire, autrement dit, ne reconnaît pas dans l'imaginaire
des institutions, son propre produit.
Cela Marx le savait. Marx savait que « l'Apollon des
Delphes était dans la vie des Grecs une puissance aussi réelle
que n'importe quelle autre ». Lorsqu'il parlait du fétichisme
de la marchandise, et montrait son importance pour le fonc-
tionnement effectif de l'économie capitaliste, il dépassait de
toute évidence la vue simplement économique et reconnaissait
le rôle de l'imaginaire (45). Lorsqu'il soulignait que le
souvenir des générations passées pèse lourd dans la conscience
des vivants, il indiquait encore mode particulier de
l'imaginaire qu'est le passé vécu comme présent, les fantômes
plus puissants que les hommes en chair et en os, le mort qui
saisit le vif comme il aimait dire. Et lorsque Lukács dit, dans
un autre contexte, que la conscience mystifiée des capita-
listes est la condition du fonctionnement adéquat de l'économie
capitaliste, autrement dit que les lois ne peuvent se réaliser
qu'en « utilisant » les illusions des individus, il montre encore
dans un imaginaire spécifique une des conditions de la
fonctionalité.
Mais ce rôle de l'imaginaire était vu par Marx comme un
rôle limité, précisément comme rôle fonctionnel, comme
chaînon « non économique » dans la chaîne « économique ».
Cela parce qu'il pensait pouvoir le ramener à une déficience
provisoire (un provisoire qui allait de la préhistoire au
communisme) de l'histoire comme économie, à la
maturité technique de l'humanité. Il était prêt à reconnaître
la puissance des créations imaginaires de l'homme — surna-
turelles ou sociales - mais cette puissance n'était pour lui que
le reflet de son impuissance réelle. Il serait schématique et
plat de dire que pour Marx l'aliénation n'était qu'un autre
nom de la pénurie, mais il est finalement vrai que dans sa
conception de l'histoire, telle qu'elle est formulée dans les
œuvres de maturité, la pénurie est la condition nécessaire
et suffisante de l'aliénation (46).
non-
(45) « ... Le rapport social déterminé existant entre les hommes
eux-mêmes prend ici à leurs yeux la forme fantasmagorique d'un
rapport entre objets. Il nous faut faire appel aux régions nébuleuses
du monde religieux pour trouver quelque chose d'analogue. Là, les
produits du cerveau humain paraissent animés d'une vie propre et
constituer des entités indépendantes, en rapports entre elles et avec
les hommes. Il en est de même, dans le monde des marchandises,
des produits du travail humain. C'est cela que j'appelle le fétichisme
qui s'attache aux produits du travail dès qu'ils figurent comme mar-
chandises.... » Et, plus loin : « La valeur . transforme chaque pro-
duit du travail en un hiéroglyphe social ». Le Capital (éd. Costes) I,
pp. 57 et 59.
(46) C'est là très certainement le point de vue des cuvres de
61
Nous ne pouvons pas accepter cette conception pour les
raisons que nous avons exposées ailleurs (47) : brièvement
parlant, parce qu'on ne peut pas définir un niveau de
développement technique ou
d'abondance économique à
partir duquel la division en classes ou l'aliénation perdent
leurs « raisons d’être » ; parce qu'une abondance technique-
ment accessible est déjà aujourd'hui socialement entravée ;
parce que les « besoins » à partir desquels seulement un état
de pénurie peut être défini, n'ont rien de fixe mais expriment
état social-historique. Mais surtout, parce qu'elle
méconnaît entièrement, le rôle de l'imaginaire, à savoir qu'il
est à la racine aussi bien de l'aliénation que de la création
dans l'histoire.
Car la création présuppose, tout autant que l'aliénation,
la capacité de se donner ce qui n'est pas (ce qui n'est pas
donné dans la perception, ou ce qui n'est pas donné dans les
enchaînements symboliques de la pensée rationnelle déjà
un
maturité : « Le reflet religieux du monde réel ne peut disparaître
que du jour où les conditions de la vie quotidienne pratique de
l'homme travailleur présentent des rapports nettement rationnels des
hommes entre eux et avec la nature. Le cycle de la vie sociale,
c'est-à-dire du processus matériel de la production ne se dépouille de
son voile mystique et nébuleux que du jour où son ensemble apparaît
comme le produit d'hommes librement associés et exerçant un con-
trôle conscient et méthodique. Mais il faut pour cela que la société
ait une base matérielle ou qu'il existe toute une série de conditions
matérielles de la vie qui, de leur côté, sont le produit naturel d'une
longue et pénible évolution ». Le Capital, ib., p. 67. Et aussi dans
l'inédit posthume « Introduction à une critique de l'économie poli-
tique » (rédigé en même temps que la Contribution à la critique de
l'économie politique, achevée en 1859) : « Toute mythologie dompte et
domine et façonne les forces de la nature dans l'imagination et par
l'imagination et disparaît donc lorsqu'on parvient à les dominer réelle-
ment » (Contribution à la critique, etc. trad. Laura Lafargue, Paris
1928, p. 351). S'il en était ainsi, la mythologie ne disparaîtrait
jamais, ni même au jour mythique où l'humanité pourrait jouer au
maître de ballet des quelques milliards de galaxies visibles dans
un rayon de treize milliards d'années-lumière. On ne comprendrait
pas non plus comment la mythologie concernant la nature a disparu
depuis longtemps du monde occidental ; si Jupiter a été ridiculisé
par le paratonnerre, et Hermès par le Crédit mobilier, pourquoi
n'avons-nous pas inventé un dieu-cancer, un dieu-athérome, ou un
dieu oméga-minus ? Ce que Marx en disait dans la 4º Thèse sur
Feuerbach était plus riche : «... Le fait que le fondement profane
(du monde religieux), se détache de lui-même et se fixe en empire
indépendant dans les nuages, ne peut s'expliquer que par cet autre
fait, que ce fondement profane manque de cohésion et est en contra-
diction avec lui-même. Il faut par conséquent que ce fondement soit
en lui-même compris dans sa contradiction aussi bien que révo-
lutionné dans la pratique. Par exemple, après que la famille ter-
restre a été découverte comme le mystère de la Sainte Famille, il
faut que la première soit elle-même anéantie en théorie et en prati-
que ». L'imaginaire serait donc la solution fantasmée des contradic-
tions réelles. Cela est vrai pour un certain type d'imaginaire, mais
un type dérivé seulement. Il est -insuffisant pour comprendre l'ima-
ginaire central d'une société, pour les raisons expliquées plus loin
dans le texte, qui reviennent à ceci : la constitution même de ces
contradictions réelles est inséparable de cet imaginaire central.
(47) V. Le mouvement révolutionnaire
le capitalisme
moderne, dans le n° 33 de cette revue, p. 75 et suiv.
sous
62
un
constituée). Et l'on ne peut pas distinguer l'imaginaire de la
création de l'imaginaire « pur et simple », en disant que le
premier « anticipe » sur une réalité non encore donnée, mais
« se vérifie » par la suite. Car il faudrait d'abord expliquer
en quoi cette « anticipation » pourrait avoir lieu sans
imaginaire et qu'est-ce qui empêcherait celui-ci de jamais se
fourvoyer. Ensuite, l'essentiel de la création n'est pas « décou-
verte », mais constitution du nouveau : l'art ne découvre pas,
il constitue et le rapport de ce qu'il constitue avec le « réel »,
rapport assurément très complexe, n'est en tout cas pas un
rapport de vérification. Et sur le plan social, qui est ici notre
intérêt central, l'émergeance de nouvelles institutions et de
nouvelles façons de vivre, n'est pas non plus une « décou-
verte », c'est une constitution active. Les Athéniens n'ont pas
trouvé la démocratie parmi d'autres fleurs sauvages qui
poussaient sur la Pnyx, ni les ouvriers parisiens n'ont déterré
la Commune en dépavant les boulevards. Ils n'ont pas non
plus, les uns et les autres, « découvert » ces institutions dans
le ciel des idées, après inspection de toutes les formes de
gouvernement qui s'y trouvent de toute éternité exposées et
bien rangées dans leurs vitrines. Ils ont inventé quelque chose,
qui s'est certes avéré viable dans les circonstances données,
mais qui aussi, dès qu'il a existé, les a essentiellement modi-
fiées – et qui, d'ailleurs, vingt-cinq siècles ou cent ans après,
continue d'être « présent dans l'histoire. Cette « vérifica-
tion » n'a rien à voir avec la vérification, par la circumnavi.
gation de Magellan, de l'idée que la terre est ronde (idée qui
elle aussi se donne au départ quelque chose qui n'est pas
dans la perception, mais qui se réfère à un réel déjà
constitué) (48).
| Lorsqu'on affirme, dans le cas
de l'institution, que
l'imaginaire n'y joue un rôle que parce qu'il y des
problèmes « réels » que les hommes n'arrivent pas à résoudre,
on oublie donc, d'un côté, que les hommes n'arrivent préci-
sément à résoudre ces problèmes réels, dans la mesure où ils
y arrivent, que parce qu'ils sont capables d'imaginaire ; et,
d'un autre côté, que ces problèmes réels ne peuvent être
problèmes, ne se constituent comme ces problèmes-ci, que telle
époque ou telle société se donne comme tâche de résoudre,
qu'en fonction d'un imaginaire central de l'époque ou de la
société considérée. Cela ne signifie pas que ces problèmes
a
ces
(48) Bien entendu, quelqu'un pourra toujours dire que
créations historiques ne sont que la découverte progressive des possi-
bles contenus dans un système absolu idéal et « pré-constitué ».
Mais comme ce système absolu de toutes les formes possibles ne peut
par définition jamais être exhibé, et qu'il n'est pas présent dans
l'histoire, l'objection est gratuite et revient finalement à une querelle
de mots. Après coup, on pourra toujours dire de n'importe quelle
réalisation qu'elle était aussi idéalement possible. C'est une tauto-
logie vide, qui n'apprend rien à personne.
63
comme
sont inventés de toutes pièces, surgissent à partir du néant
et dans le vide. Mais ce qui, pour chaque société, forme
problème en général (ou surgit comme tel à un niveau donné
de spécification et de concrétisation) est inséparable de sa
manière d'être en général, du sens précisément problématique
dont elle investit le monde et sa place dans celui-ci, sens qui
comme tel n'est ni vrai, ni faux, ni vérifiable ni falsifiable
par référence à des « vrais » problèmes et à leur « vraie »
solution, sauf dans une acception bien spécifique, sur laquelle
nous reviendrons.
S'agissant de l'histoire d'un individu, quel sens y-a-t-il à
dire que ses formations imaginaires ne prennent de l'impor-
tance, ne jouent un rôle que parce que des facteurs « réels >>
---- la répression des pulsions, un traumatisme — avaient déjà
créé un conflit ? L'imaginaire agit sur un terrain où il y a
répression des pulsions et à partir d'un ou plusieurs trau-
mas ; mais cette répression des pulsions est toujours là, et
qu'est-ce qui constitue un trauma ? En dehors de cas limites,
un événement n'est traumatique que parce qu'il est « vécu
comme tel »
par l'individu, et cette phrase veut dire en
l'occurrence : parce que l'individu lui impute une significa-
tion donnée, qui n'est pas sa signification « canonique », ou
en tout cas qui ne s'impose pas inéluctablement
telle (49).
De même, dans le cas d'une société, l'idée que ses
formations imaginaires « se fixent en empire indépendant
dans les nuages » parce que la société considérée n'arrive pas
à résoudre « dans la réalité » ses problèmes est vraie au niveau
second, mais non au niveau originaire. Car cela n'a de sens
que si l'on peut dire quel est le problème de la société,
qu'elle aurait été temporairement incapable de résoudre. Or
la réponse à cette question est impossible, non pas parce que
nos enquêtes ne sont pas assez avancées ou que notre savoir est
relatif ; elle est impossible parce que la question n'a pas de
sens. Il n'y a pas le problème de la société. Il n'y a pas
« quelque chose » que les hommes veulent profondément, et
que jusqu'ici ils n'ont pas pu avoir parce que la technique
était insuffisante ou même parce que la société restait
divisée en classes. Les hommes ont été, individuellement et
collectivement, ce vouloir, ce besoin, ce faire, qui s'est chaque
fois donné un autre objet et par là une autre « définition »
de soi-même.
Dire que l'imaginaire ne surgit – ou ne joue un rôle
que parce que l'homme est incapable de résoudre son
problème réel, suppose que l'on sait et que l'on peut dire
quel est ce problème réel, partout et toujours, et qu'il a été,
(49) L'événement traumatique est réel en tant qu'événement et
imaginaire en tant que traumatisme.
64
est et sera partout et toujours le même (car si ce problème
change on est obligé de se demander pourquoi, et on est
ramené à la question du départ). Cela suppose que l'on sait,
et que l'on peut dire ce qu'est l'humanité et ce qu'elle veut,
ce vers quoi elle tend, comme on le dit (ou on croit pouvoir
le dire) des objets.
A cette question, les marxistes donnent toujours une
double réponse, une réponse contradictoire dont aucune
« dialectique » ne peut masquer la confusion et, à la limite,
la mauvaise foi :
L'humanité est ce qui a faim.
L'humanité est ce qui veut la liberté
non pas la liberté
de la faim, la liberté tout court dont ils seront bien d'accord
pour dire qu'elle n'a ni ne peut avoir d'« objet » déterminé en
général.
L'humanité a faim, c'est certain. Mais elle a faim de quoi,
et comment ? Elle a encore faim, au sens littéral, pour la
moitié de ses membres, et cette faim il faut la satisfaire certes.
Mais est-ce qu'elle n'a faim que de nourriture ? En quoi alors
diffère-t-elle des éponges ou des coraux ? Pourquoi cette
faim, une fois satisfaite, laisse toujours apparaître d'autres
questions, d'autres demandes ? Pourquoi la vie des couches
qui, de tout temps, ont pu satisfaire leur faim, ou des sociétés
entières qui peuvent le faire aujourd'hui, n'est-elle pas
devenue libre – ou redevenue végétale ? Pourquoi le rassa-
siement, la sécurité et la copulation ad libitum dans les
sociétés scandinaves mais aussi, de plus en plus, dans toutes
les sociétés de capitalisme moderne (un milliard d'individus)
n'a-t-elle pas fait surgir des individus et des collectivités
autonomes ? Quel est le besoin que ces populations ne
peuvent pas satisfaire ? Que l'on dise que ce besoin est
maintenu constamment insatisfait par le progrès technique,
qui fait surgir de nouveaux objets, ou par l'existence
de couches privilégiées qui mettent devant les yeux des autres
d'autres modes de le satisfaire et l'on aura concédé ce que
nous voulons dire : que ce besoin ne porte pas en lui-même
la définition d'un objet qui pourrait le combler, comme le
besoin de respirer trouve son objet dans l'air atmosphérique,
qu'il naît historiquement, qu'aucun besoin défini n’est le
besoin de l'humanité. L'humanité a eu et a faim de nourri-
ture mais elle a eu aussi faim de vêtements et puis de vête-
ments autres que ceux de l'année passée, elle a eu faim de
voitures et de télévision, elle a eu faim de pouvoir et faim de
sainteté, elle a eu faim d'ascétisme et de débauche, elle a eu
faim de mystique et faim de savoir rationnel, elle a eu faim
d'amour et de fraternité mais aussi faim de ses propres cada-
vres, faim de fêtes et faim de tragédies, et maintenant il sem-
ble qu'elle commence à avoir faim de Lune et de planètes.
Il faut une bonne dose de crétinisme pour prétendre qu'elle
65
« bon
s'est inventé toutes ses faims parce qu'elle n'arrivait pas à
manger et à baiser suffisamment.
L'homme n'est pas ce besoin qui comporte son
objet >> complémentaire, une serrure qui a sa clé (à retrou-
ver ou à fabriquer). L'homme ne peut exister qu'en se défi-
nissant chaque fois comme un ensemble de besoins et d'ob-
jets correspondants, mais dépasse toujours ces définitions
et, s'il les dépasse (non seulement dans un virtuel permanent,
mais dans l'effectivité du mouvement historique), c'est parce
qu'elles sortent de lui-même, qu'il les invente (non pas dans
l'arbitraire certes, il y a toujours la nature, le minimum de
cohérence qu'exige la rationalité, et l'histoire précédente),
donc qu'il les fait en faisant et en se faisant, et qu'aucune défi-
nition rationnelle, naturelle ou historique ne permet de les
fixer une fois pour toutes. « L'homme est ce qui n'est pas ce
qu'il est, et qui est ce qu'il n'est pas », disait déjà Hegel.
(La fin au prochain numéro)
PAUL CARDAN.
66
1
DOCUMENTS
La rébellion des étudiants
LA BATAILLE DE L'UNIVERSITE DE BERKELEY
(Traduction et résumé d'une brochure de nos camarades anglais
du groupe « Solidarity »).
Une grande bataille est actuellement engagée par les étudiants
de l'Université de Californie, à Berkeley, aux Etats-Unis, Ils défendent
leur droit à exercer des activités politiques à l'intérieur de l'uni-
versité, sans être limités par les règles arbitraires et les restrictions
imposées par les autorités académiques.
L'origine du conflit a été une règle interdisant toute propagande
politique ou sociale, tout recrutement ou collecte d'argent pour des
objectifs politiques déplaisant à l'administration de l'Université.
Cette lutte nous paraît intéressante à la fois par son objet qui
est la défense des droits politiques et par l'expérience qui y a été
faite de nouvelles méthodes d'action directe. Elle souligne certains
dilemmes que doit affronter une société riche mais de plus en plus
bureaucratique. Elle illustre le genre de crises qu’une telle société
a tendance à susciter. Elle peut nous servir d'exemple par ses objec-
tifs et par ses méthodes.
L'affaire commence par la réaction inepte d'un bureaucrate uni-
"ersitaire qui déclenche l'action d'une minorité. Alimentée cons-
tamment par la maladresse administrative, la lutte intéresse une
masse croissante d'étudiants. Un programme apparaît ; un journal
bi-mensuel l'exprime (Free Speech Movement News Letters) ; y parti-
cipent des centaines et plus tard des milliers d’étudiants sans expé-
rience politique préalable (et bien plus sans expérience d'action poli-
tique directe). La lutte leur apprend quelques vérités fondamentales sur
la nature de l'Etat. Elle dévoile au grand jour les relations entre
les autorités universitaires, le monde des affaires, les politiciens
locaux et la police. Elle expose la nature de la gigantesque entreprise
de manipulation et de mystification appelée « éducation moderne >
et montre que ses vrais objectifs sont d'enseigner le conformisme,
la docilité et l'acceptation de l'autorité. Elle combine habilement
tactiques légales et illégales ; elle étend continuellement sa base.
Pour finir, des centaines de policiers en uniforme interviennent ;
plus de huit cents étudiants sont arrêtés.
Des piquets de grève sont établis. Le syndicat des transporteurs
refuse de franchir les piquets de grève pour fournir les installations
universitaires.
Nous sommes loin d'une discussion académique sur la liberté
d'expression.
Ce qui se passe à Berkeley nous intéresse parce qu'il y apparait
que de larges couches de population, qui n'ont pas été élevées dans
les traditions de la solidarité ouvrière et de l'action collective, peu-
vent dans les conditions d'une société bureaucratique agir ensemble
effectivement et acquérir rapidement une compréhension de la struc-
ture du pouvoir dans cette société et des moyens de l'attaquer.
De plus les étudiants français sont aussi aux prises avec des
restrictions arbitraires et des règles ridicules. Les étudiants n'ont
pas (ou n'ont qu'un simulacre) de pouvoir sur ce qui les touche immé.
- 67
diatement : la nature et le contenu de l'enseignement universitaire,
la gestion des institutions pour étudiants (amphis, laboratoires, les
restaurants et cités universitaires), les relations entre sexes dans
cités universitaires, ; n'importe quel étudiant pourra trouver une
dizaine d'autres exemples en quelques instants.
Les méthodes employées sont dans la ligne de celles que nos
camarades anglais avaient développées dans le cadre de leurs actions
antinucléaires et dans leurs luttes ouvrières. La lutte de Berkeley
prouve une fois de plus si besoin était le caractère fertile, fécond,
efficace et toujours renouvelé de ces tactiques qui font appel à l'ima-
gination de tous ceux qui sont engagés dans une lutte contre une
administration empétrée dans ses propres règles, sa propre lourdeur
et ses propres contradictions.
Signalons enfin que nos camarades Marvin et Barbara Garson,
que les lecteurs de cette revue connaissent bien ont joué une part
dans cette lutte et qu'ils ont été arrêtés au cours de la manifestation
du 2 décembre.
Nos lecteurs qui voudraient plus de détails ou se procurer le
journal Free Speech Movement News Letters peuvent écrire à Free
Speech Movement, Box 809, Berkeley, California, U. S. A.
1.
LA SITUATION GENERALE
en
se
Dans beaucoup d'universités
américaines, les groupes d'étu-
diants ont accès aux bureaux, à
l'équipement, au matériel d'im-
pression des organisations étu-
diantines pour leurs activités
propres. A Berkeley, ces facilités
sont réservées aux groupes « à
objet non controversé >> (sportif,
culturel au sens étroit, ...) Les
groupes à objectifs politiques et
sociaux voient relégués à
l'extérieur du territoire universi-
taire (le campus) pour
leurs
activités publiques. Traditionnel-
lement les activités de propa-
gande (distributions de tracts,
ventes de revues, signatures de
pétitions, souscriptions, ...)
faisaient à des tables situées à
certaines entrées du campus,
après autorisation préalable de
la police universitaire.
En septembre 64, un doyen de
l'université annonça
soudaine-
ment qu'un de ces endroits
Bancroft était propriété de
l'Université et que les tables de
distribution n'y seraient plus
admises « parce qu'elles gênent
la circulation ».
Il faut rappeler que déjà de-
puis plusieurs années les étu-
diants de Berkeley manifestaient
activité politique dévelop-
pée contre le Mac-Carthysme,
pour soutenir la lutte des noirs
et que des incidents très vio-
lents s'étaient produits lorsqu'un
membre de la « Commission des
Activités antiaméricaines » de la
Chambre des représentants était
venu faire une enquête à Berke-
ley. Il faut rappeler aussi qu'on
était en pleine période électo-
rale et que la Goldwatérisme
était particulièrement virulent
Californie (où un sénateur
ultra a été élu et où un amen-
dement à la constitution interdi-
sant toute loi contre la discri.
mination raciale a été voté par
referendum).
Un journal local (Oakland
Tribune) s'était distingué par
ses campagnes racistes et néo-
maccarthystes. Des organisations
étudiantes avaient organisé des
piquets de protestatio de unt
les bureaux du journal. La direc-
tion de celui-ci avait contacté le
chancelier de l'université, Strong.
C'était sans doute là l'origine
de l'interdiction mentionnée plus
haut.
Les 19 groupes affectés par la
décision protestèrent auprès du
doyen. Celui-ci · accepta que des
documents « informatifs » soient
distribués aux tables en litige,
mais décida que les documents
« persuasifs » seraient interdits.
Cette décision était inacceptable
pour les groupes ; de plus elle
révélait le vrai motif de l'affaire,
qui n'avait rien à voir avec les
se
une
68
difficultés de circulation. C'était
l'activité politique elle-même
qui était visée.
2.
LA PREMIERE BATAILLE
noms
ble ;
au
Son
se
au
Les jours suivants, certains
groupes
d'étudiants continue-
ront à occuper leurs tables com-
me d'habitude, sans s'occuper de
la nouvelle règle. Le troisième
jour, le mercredi 30 septembre,
à midi, le doyen Williams prit
les
de 5 étudiants qui
refusaient d'abandonner leur ta-
il les convoqua à son
bureau, pour trois heures de
l'après-midi, en vue de sanctions
disciplinaires. Entre midi et trois
heures, plus de 350 étudiants
avaient signé une pétition disant
qu'ils partageaient la responsa-
bilité de leurs cinq camarades
et demandant que les sanctions
disciplinaires leur soient éten-
dues à eux aussi.
A 3 heures, les cinq étudiants
présentèrent bureau du
doyen, avec 395 autres. Le
doyen refusa de les recevoir. Ils
attendirent ; et pendant qu'ils
attendaient, d'autres étudiants
se joignaient à eux. Ils étaient
500 à l'heure de la fermeture
des bureaux. Dans la soirée, le
bruit courut que les cinq étu-
diants du début et trois leaders
de la manifestation de l'après-
midi étaient suspendus pour une
période indéfinie.
Alors vint la première vraie
bataille. A midi le lendemain
le 11er octobre les étu-
diants firent une manifestation
pour protester à la fois contre
les suspensions et contre l'inter-
diction d'utiliser les tables. Cel-
les-ci furent occupées. La police
universitaire arrêta un étudiant,
Jack Weinberg, qui était à la
table du CORE (organisation
pour l'égalité raciale); il
bougea pas et fut traîné à la
voiture de police. Mais lorsque
colle-ci voulut démarrer, quel-
qu'un s'assit devant elle ; l'ins-
tant d'après la voiture était
complètement entourée d'étu-
diants assis. Des orateurs parlè-
rent à la foule du toit de la
voiture, qui était devenue à la
fois la cellule de Jack Weinberg
et le centre de la manifestation.
Cela dura du jeudi midi au ven-
dredi soir. La voiture de police
fut constamment entourée d'étu-
diants dont le nombre varia
entre cinq cents la nuit et trois
mille le jour.
Pendant toute cette semaine, le
Président de l'Université, Clark
Kerr, refusa de recevoir aucun
délégué étudiant. Pendant la
manifestation, un étudiant dit :
« Clark Kerr a écrit que l'univer-
sité est une usine à fabriquer
des spécialistes. Il nous consi-
dère comme des numéros. Eh
bien, si c'est cela le langage
qu'il comprend, nous allons lui
montrer notre nombre ».
Le vendredi soir, Kerr céda.
II céda nombre et à la
persistence, mais aussi à
désir de voir l'ordre rétabli pour
la journée officielle de visite des
parents. A ce moment la zone
de la manifestation était pour-
tant entourée par cinq cents
policiers.
Pendant que les délégués dis-
cutaient avec Kerr, les manifes-
tants se préparaient à des arres-
tations massives. Ils recevaient
des conseils d'un avocat et aussi
d'utiles suggestions de vétérans
de la lutte pour les droits civi-
ques qui avaient déjà l'expé-
rience des arrestations et de la
prison. On décida
que seuls
ceux qui étaient bien décidés à
laisser arrêter resteraient
assis autour de la voiture. Il y
eut 500, tandis que 2.000
autres assistaient. C'est à
moment que les négociateurs re-
vinrent avec un accord signé, qui
faisait quelques concessions,
mais ne garantissait pas la liber-
té de parole et de réunion sur
tout le campus. Les étudiants,
se dispersèrent vec des senti-
ments contradictoires : soulage-
ment après la tension, et désap-
pointement. Ils comprenaient
aussi
que ceci n'était que la
première bataille.
Des pressions extérieures
s'exerçaient aussi sur Kerr : un
membre du conseil municipal de
Berkeley critiquait l'attitude
se
en
ce
ne
69
ne
appaisante de Kerr ; il aurait
voulu que les manifestants soient
chassés à coups de lances d'in-
cendie, et si cela suffisait
pas, faire appel à l'armée. Le
président le chancelier étaient
très sensibles à ce genre de pres-
sion. Ils avaient déjà fait venir
la police d'Oakland, réputée
pour amour des méthodes
violentes. C'est seulement le
sens
des responsabilités des
étudiants, et en particulier des
négociateurs qui a empêché le
déchaînement de violences.
son
diatement faute de quoi, les
négociateurs seraient responsa-
bles de la suite. Devant une
telle attitude, les négociateurs
auraient été parfaitement justi-
fiés d'interrompre la discussion ;
heureusement, ils restèrent cal-
mes et négocièrent l'accord point
par point, refusant de souscrire
à toute clause qui n'aurait pas
l'approbation de leurs camara-
des assis autour de la voiture
de police,
présentant
pas
d'exigences inacceptables pour
Kerr, refusant de rompre les
négociations. On peut se deman-
der qui avait un comportement
d'adulte et qui avait un
portement infantile ce jour-là :
les étudiants ou ceux qui sont
chargés de leur éducation ?
ne
com-
Pendant les négociations, Kerr
agitait toujours le spectre d'une
émeute, disant qu'il ne pourrait
pas retenir la police, qu'ils de-
vaient signer un accord immé-
3.
L'ACCORD
L'accord passé entre Kerr et les représentants des étudiants por-
tait sur les points suivants :
1. Cessation de la manifestation en cours.
2. Un comité composé d'étudiants, de professeurs et de membres
de l'administration de l'université discutera du problème des activités
politiques à l'université et de leur contrôle et fera des recomman-
dations à l'administration.
3. L'étudiant arrêté sera libéré et l'université ne le poursuivra
pas.
4. La durée de la suspension des étudiants suspendus (les 5+3 du
mercredi) sera soumise au « Comité de conduite des étudiants du
sénat académique ».
5. Les activités des organisations d'étudiants continueront dans
le respect des règles de l'université.
Au cours des péripéties de cette période beaucoup d'étudiants
prirent conscience que la liberté de parole, la liberté de presse, la
liberté d'association, tous droits reconnus par la constitution des
Etats-Unis et s'imposant comme tels à l'Université de Californie (qui
est une université d'Etat) étaient en fait soumises pour eux à toute
une série de restrictions : autorisation préalable des réunions, paye-
ment des policiers chargés de les surveiller, etc...
A l'occasion de ces incidents, une organisation, le « Free Speech
Movement », se dégagea comme le porte-parole de la liberté d'ex-
pression et d'action politiques. Elle avança le programme suivant :
1. Droit pour les étudiants de parler librement en public, et
de donner la parole à toute personne qu'ils invitent dans les bâtiments
universitaires, sous la seule réserve que cela ne gêne ni la circu-
lation ni les cours normaux.
(Dans beaucoup d'universités, des incidents étaient nés lorsque
des groupes d'étudiants avaient invité des orateurs « Communistes »,
au sens mac-carthyste du mot).
2. La propagande politique sera permise dans tous les territoires
universitaires, sous les seules réserves mentionnées en 1.
3. Les limitations administratives réunions (préavis de
72 heures, payement de la « protection policière », présence de « mode-
rateurs » de l'Université, ...) seront revues.
aux
70
On assiste donc à un réel élargissement des objectifs. En même
temps des manifestations de solidarité et des revendications analo-
gues s'expriment dans de nombreuses autres universités américaines.
4.
L'IMPASSE
Suit une période de discussions et de manæuvres de la part de
l'administration au sujet de l'interprétation de l'accord : actions
unilatérales pour influencer les comités prévus dans l'accord en y
introduisant des professeurs et des étudiants soumis aux vues de
l'administration ; exigences de la part des étudiants que les représen-
tants des étudiants et des professeurs soient désignés par leur corps
et non par l'administration ; manquvres dilatoires au sujet du
maintien des sanctions prises contre les premiers étudiants.
Finalement un accord est conclu sur la composition du comité.
Il prévoit que ses décisions devront être prises à l'unanimité et que
le Président « considérerait très sérieusement » toutes ses propositions.
C'est le moment que choisit Kerr pour dénoncer à la presse la
présence de « 40 % de non-étudiants, dont la moitié de commu-
nistes » dans le Free Speech Movement.
Le même soir le conseil d'administration de l'Université annonça
qu'il avait établi son propre comité pour s'occuper des problèmes
litigieux.
Kerr avait aussi pris contact avec la chambre des députés de
Californie, pour qu'une loi déclare illégale toute activité politique
dans l'enceinte de l'université.
Le journal du F. S. M. répondit aux allégations de Kerr : « Nous
ne sommes pas les professionnels de l'agitation qu'on nous accuse
d'être ; mais nous
en train d'apprendre rapidement à le
devenir ; et nous n'oublierons pas ces leçons-là ».
Les soi-disant progressistes habituels prodiguaient aussi leurs
conseils : « ne vous aliénez pas la sympathie des gens extérieurs à
l'université. »
Mais les étudiants avaient compris qu'il n'y avait rien à gagner
et beaucoup de temps à perdre à ces discussions de procédure et d
ces prétendues négociations, que les jours devenaient des semaines
et les désaccords des impasses et qu'il était nécessaire de retourner
au pouvoir du nombre et de l'action directe.
sommes
5.
LA REPRISE DE L'ACTION.
derrière les tables. La conversa-
tion fut la suivante :
Est-ce vous qui utilisez cet-
te table ?
Oui.
Rassemblez-vous de l'ar-
gent ?
Le 9 novembre, un lundi, une
dizaine de tables de propagande
furent érigées non pas à l'en-
droit habituel, mais en face du
principal bâtiment administratif
de l'université, donc en violation
ouverte de la règle, toujours en
vigueur, qui limitait ces activi-
tés aux zones situées près des
entrées du campus.
Environ 500 étudiants étaient
présents. Divers orateurs s'a-
drossdrent à cux pendant deux
heures, y compris des profes-
Neurs sympathisants du mouve-
ment.
Un peu après une demi-dou-
zaine de doyens arrivèrent et
s'adressèrent aux étudiants assis
J'accepte celui qu'on me
donne.
Avez-vous une autorisa-
tion ?
Non.
Savez-vous que vous
vio-
lez le règlement de l'Université ?
Je sais que le règlement de
l'Université est anticonstitution-
nel.
Allez-vous cesser cette acti-
vité ?
Non.
-:71
me
son
au
rut
de
noms.
« Le
/
se
sen-
Veuillez donner votre
identité.
L'étudiant donnait alors
nom, ou montrait sa carte d'étu-
diant. Aussitôt, il se levait, ; un
autre étudiant prenait sa place,
et la même scène se reprodui-
sait. 75 noms furent ainsi enre-
gistrés ; les doyens refusèrent
d'en
prendre davantage bien
qu'il y eut de longues queues
d'étudiants attendant derrière
chaque table. Une fois de plus,
la solidarité payait.
Le lendemain, le mardi, il y
avait encore plus de tables, et
pour s'y installer environ 200
étudiants. Aucun doyen n'appa-
pour prendre
Aussi envoya-t-on à l'adminis-
tration une liste de ceux qui
étaient présents, plus environ
500 noms qui n'avaient pas été
pris la veille. Toute la semaine,
des tables furent érigées en face
du bâtiment administratif, et il
fut décidé qu'elles y resteraient
jusqu'à ce que leur présence soit
reconnue légale dans les endroits
habituels.
Ces tables eurent l'honneur de
toutes sortes de visites. En plus
de centaines de journalistes et
de photographes, il y eut le mai-
re de Berkeley, des fonctionnai-
res du procureur de la Républi-
que, des agents de comités de
vigilance d'extrême droite et,
évidemment, des agents
F. B. I., plus occupés à cela
qu'à rechercher les meurtriers du
Mississipi. Les autorités univer-
sitaires aussi bien qu'extérieu-
res commençaient à prendre l'af-
faire très au sérieux.
Le journal du F. S. M. publiait
les nouvelles dès qu'elles étaient
disponibles et
même temps
éclairait les aspects plus fonda-
mentaux de la lutte, soulignant
que le combat pour la liberté
d'expression amenait en fait à
mettre en cause la structure du
pouvoir, que si on met celle-ci
en cause dans l'université, on est
amené à la mettre en cause à
l'extérieur aussi ; que la lutte
en vue de cette démocratie véri-
table ne peut se faire que par
des actions de masse basées sur
la solidarité de tous ceux qui y
sont impliqués et non par des
atermoiements et des apaise-
ments tactiques.
Le F. S. M. publia lui-même
de nouvelles règles organisant la
liberté de parole et l'action
politique. Elles furent appliquées
pendant trois semaines. Pendant
trois semaines cet aspect de la
vie universitaire fut géré par
les étudiants. Une autre espèce
de fonctionnement de l'Univer-
sité commençait à se manifes-
ter.
Finalement le < Bureau
des
Régents de l'Université » se réu-
nit pour mettre un terme
conflit,
Bureau des. Ré-
gents » disent les statuts de
l'Université « représente la com-
munauté Californienne ». En fait
il est composé de présidents de
grandes compagnies. On y voit
figurer aussi une certaine Mada-
me Randolph Hearst, « ména-
gère ». Les étudiants ne
taient pas tellement bien repré-
sentés par cette institution. Aus-
si organisèrent-ils une mani-
festation, qui réunit 5.000 étu-
diants, autour du bâtiment où
étaient réunis les Régents. Ceux-
ci se refusèrent à recevoir toute
délégation des étudiants.
Après la réunion, l'adminis-
tration publia les nouvelles rè-
gles. C'était pratiquement celles
d'avant le conflit avec en plus
des sanctions pour toute activité
politique pouvant « conduire » à
des activités, illégales en dehors
de l'université, le caractère de
celles-ci étant décidé par l'ad-
ministration. Les étudiants firent
remarquer que si « activités
illégales » il y avait, ils préfé-
raient encore être jugés par les
tribunaux, où ils auraient
moins le droit de se défendre.
Toutefois, comme le droit
d'établir des tables de propa-
gande leur était rendu, il était
difficile d'amener les étudiants
à contester les droits arbitraires
que s'arrogeait l'administration.
D'autant plus que le F. S. M.
était maintenant gonflé en effec-
tifs par des centaines de nou-
du
en
au
72
vcaux
membres, moins formés
politiquement, se laissant pren-
dre par les sirènes tactiques de
l'administration et exerçant une
action modératrice. Un des lea-
ders de la tendance dure expri-
son regret de « coïtus
interruptus social ».
sur
ma
ce
OCCUPATION
6.
LA GRANDE
DES LOCAUX
ce
aux
C'est à moment où tout
semblait s'éteindre que l'Admi-
nistration remit le feu aux pou-
dres en annonçant des mesures
disciplinaires contre deux des
principaux leaders. On avait
laissé tomber toutes les autres
accusations, mais on poursuivait
ces deux-là pour l'immobilisa-
tion de la voiture de police ;
l'un d'eux était en plus accusé
de menaces et de violences con-
tre un policier au cours des inci-
dents de cette journée.
L'administration croyait-elle
que les choses étaient suffisam-
ment tassées pour qu'elle puisse
prendre une revanche ? Ou bien
s'agissait-il d'une provocation
pour créer un nouveau conflit
dont elle espérait sortir victo-
rieuse cette fois ? Toujours est-il
que les étudiants de Berkeley
réagirent vivement et montre-
rent qu'ils avaient compris, et
bien compris, la leçon de la soli-
darité.
Les sanctions avaient
été
annoncées un vendredi, le 27 no-
vembre. Le week-end on discuta
et on s'organisa. Le lundi et le
mardi, des manifestations exi-
gèrent l'abandon par l'Univer-
sité des poursuites pour des faits
relevant des tribunaux ordinai-
res. Puis, le 2 décembre à midi
commença la plus grande mani-
festation : l'occupation en masse
de Sprout-Hall, le bâtiment ad-
ministratif de l'Université. 1.500
étudiants, orchestre en tête et
chantant, entrèrent dans le bâti-
ment ct l'occupèrent du haut
on bas. Le travail cessa et les
employés rentrèrent chez eux. Il
ne s'agissait cependant pas de
créer de l'obstruction. Le bâti-
ment fut déclaré le siège de
I' « Université libre de Califor-
nie ». Un étage fut réservé com-
me salles d'études. Les étudiants
en doctorat donnèrent des cours,
de mathématiques, d'histoire, de
biologie ... mais aussi
les
droits civiques, la politique,
la situation des noirs,
On orga-
nisa un ciné-club. Ailleurs on
jouait aux cartes, on chantait,
on pinçait la guitare. Les étu-
diants occupaient le
cour de
l'Université.
A 7 heures, heure de ferme-
ture officielle du bâtiment, les
étudiants furent invités à quit-
ter les lieux. Ils restérent. A
minuit, ils s'installèrent pour la
nuit, n'attendant pas d'offensive
avant le matin. Mais à deux heu-
res et demie, le bruit courut
d'une intervention prochaine. Ils
se préparèrent à l'arrestation (les
filles enlevaient leurs boucles
d'oreilles, les garçons débouton-
naient leur chemise, etc...). Il n'y
avait pourtant que quelques po-
liciers paisibles aux alentours.
A trois heures et quart le Chan-
celier Strong vint faire une pro-
clamation ordonnant
étu-
diants de se disperser. A trois
heures et demie les arrestations
commencèrent.
Elles durèrent treize heures.
800 personnes furent arrêtées.
Presque tous opposèrent la
résistance passive,
laissant
traîner dans les couloirs et les
escaliers, non pas par conviction
de non-violence, mais parce que
cela leur paraissait la meilleu-
tactique pour troubler et
ralentir les arrestations, et leur
donner ainsi le plus grand reten-
tissement. 700 policiers partici-
paient à l'opération. Les poli-
ciers après
heure, n'a-
vaient pu arrêter que 20 per-
sonnes, et la plupart des autres
s'étaient recouchés. Si bien qu'à
huit heures du matin quand
les employés et les autres étu-
diants arrivèrent ils n'avaient
fait qu'un quart de leur travail.
A l'extérieur il y avait aussi,
une foule de curieux et de jour-
nalistes que les étudiants haran-
guaient par les fenêtres. La poli-
devint brutale pour empê-
cher cela. C'est ainsi que des
se
re
une
се
73
scènes particulièrement brutales
ont été retransmises à la télé-
vision.
Avant la fin des arrestations,
grève générale paralysa
l'université, suivie à 65 %. Plu-
sieurs professeurs y participè-
rent aussi. Le syndicat des trans-
porteurs refusa d'alimenter l'uni-
versité. La guerre était mainte-
nant ouverte entre les étudiants
et l'administration.
une
7.
DUALITÉ DE POUVOIR ?
une
Après quelques jours de confusion, l'administration annonça
que le lundi de la semaine suivante, les cours seraient suspendus
et qu'il y aurait réunion générale au Grand Théâtre de
l'Université.
15.000 personnes y assistèrent. Le Président Clark Kerr fit une
proclamation qui était pratiquement une capitulation générale :
aucune poursuite pour les actes passés ; maintien provisoire des
anciennes règles sur la liberté de parole, jusqu'au moment où un
comité académique aurait déposé des propositions pour un nouveau
système.
Les dirigeants étudiants furent follement applaudis. Ils invité-
rent à une réunion de masse, qui se tiendrait immédiatement après
celle du Président Kerr. 8.000 étudiants y participèrent (pendant ce
temps, les étudiants « loyalistes » réunissaient 500 personnes). La
réunion du F. S. M. fut une assemblée révolutionnaire. Plusieurs
professeurs prirent la parole. Un doyen de Faculté déclara :
« Vous
avez le pouvoir. Je vous demande de l'exercer avec sagesse ». L'exi-
gence générale était que les décisions soient prises par les organis-
mes de professeurs et d'étudiants et non plus par l'administration.
Le travail reprit normalement le lendemain.
Nous n'avons pas de nouvelles sur ce qui s'est passé depuis
est évident que
situation demeure explosive. Mais
per-
sonne ne peut affirmer qu'elle explosera ou pas. La situation est
révolutionnaire ; elle échappe à la prédiction. L'administration reste
puissante. Elle est appuyée par l'appareil d'Etat de Californie. Mais
si de nouveaux événements se produisent, ils ont toute chance d'être
intéressants. De plus, il est probable que les événements de Berkeley
auront une profonde répercussion dans d'autres universités.
Le conflit est né apparemment d'un problème de liberté d'expres-
sion. Mais en fait il est beaucoup plus profond. L'administration de
l'université est composée d'éminents porte-paroles de la société
bureaucratique (voir infra : «La mentalité de Clark Kerr »). La
carte perforée IBM est devenue dans les manifestations un symbole
de ce que les étudiants refusent (ils en portaient à la boutonnière
avec des slogans inscrits dessus). Au cour du conflit il y a toute
la structure autoritaire de la société américaine. L'université et son
administration sont un reflet du pays qu'il faut conquérir et du
gouvernement qu'il faut balayer. La classe dirigeante l'a compris
ainsi, qui n'a cessé d'exiger la plus féroce répression.
L'Université dépend de cette classe dominante, financièrement
notamment ; mais les étudiants et les professeurs sont l'Université,
qui ne peut exister sans eux ou contre eux, s'ils opposent la force
de leur nombre.
74-
La mentalité de Clark Kerr
Nous traduisons ici une analyse parue dans le journal de nos
camarades anglais « Solidarity », de la brochure « The Mind of Clark
Kerr » par Hal Draper, socialiste indépendant aux Etats-Unis. Draper
analyse la vision du monde du Président de l'Université de Cali-
fornie, celui qui a fait venir plus d'un millier de policiers pour
écraser les manifestations étudiantes dont nos lecteurs viennent de
lire le récit.
Quelle sorte d'homme est Clark Kerr, Président de l'Université
de Californie ? Quelle sorte de « pédagogue » appellerait mille poli-
ciers prêts à utiliser bombes lacrymogènes et bâtons pour
l'aider à restaurer le respect d'un certain type de « loi » et un cer-
tain type « d'ordre » chez les étudiants ? Qu'est-ce qui se passe
vraiment dans la tête d'un Dirigeant d'une Université Américaine
moderne ?
La brochure de Draper (publiée par l'Independant Socialist
Club P. O. Box 910, Berkeley 1, California, U. S. A.) est dédiée aux
« étudiants qui ont fait le sit-down ». Elle contribue à faire compren-
dre les raisons de la Bataille de Berkeley des 1-2 octobre 1964. Cette
contribution est dans la meilleure tradition de la littérature révolu-
tionnaire : sobre, bien documentée, courageuse et capable d'inspirer
des actions ultérieures. Nous la citerons largement.
La brochure est en réalité une critique de deux livres écrits
par Clark Kerr (1). Ensemble, ces deux livres présentent une image
générale de la conception qu'a Kerr de la société américaine actuelle
et de la place qu'il donne au nouveau type d'université, la « multi-
versité », dans une telle société.
Ces livres proclament ouvertement des convictions, qui, dit Draper,
sont 'courantes dans maints milieux académiques et élitistes ', bien
que souvent 'formulées seulement en termes allusifs'. Des hauteurs
olympiennes du non-engagement, Kerr analyse et décrit la venue de
la société bureaucratique. Il n'exprime pas ouvertement son avis,
mais se présente comme ' l'interprète de la réalité inexorable'. Il
est, pour ainsi dire, le 'Bureaucrate de l'Histoire, nous informant
simplement des moyens d'agir en conformité avec ses règles '. Il
aimerait qu'on prenne sa vision de l'avenir comme ’l'impératif de
l'histoire :
Voici le 'rêve orgiastique d'un paradis bureaucratique’ selon Kerr :
1. Le Nouvel Ordre résultera (et résulte) de la convergence
actuelle des deux systèmes principaux : le capitalisme qui devient
de plus en plus autoritaire et bureaucratique, et qui est sur le chemin
du totalitarisme Soviétique, et le système communiste Russe, qui
s'est adouci ; les deux convergent quelque part à mi-chemin pour
devenir un « Industrialisme » non différencié. Ce qui les pousse, ce
sont les forces de l'industrialisation. C'est le chemin du progrès.
2. L'Etat de Leviathan a pris le pouvoir ; 'il est partout, « omni-
présent ». L'Etat ne disparaîtra jamais, comme l'avait prédit l'uto-
piste Marx :
3. «L'Elitisme » Bureaucratique bat son plein : 'Les éléments
progressistes et socialement décisifs sont uniquement les « cadres,
privés ou fonctionnaires », et leurs techniciens et spécialistes. « C'est
l'avant-garde ». Et Kerr les nomme : « En particulier, nous aimerions
(1) Industrialism and Industrial Man by G. Kerr, J.-T. Dunlop, F.
Harbison et C.-A. Myers (Harvard University Press, 1960) et The
Uses of the University, par C. Kerr, (Harvard, 1963).
Les doubles guillemets sont de Kerr, les simples guillemets de
Draper.
- 75
census
SOR
nous adresser aux intellectuels, aux cadres, aux dirigeants du gou-
vernement et aux dirigeants syndicalistes qui gèrent et qui géreront
leur pays... » Il ne prétend évidemment pas laisser un rôle au
peuple.
4. L'avenir. « Nous allons vers un système de parti unique, de
fait sinon ouvertement ». « L'âge des idéologies est fini ». « La société
bureaucratique a besoin d'une administration... la bureaucratie poli-
'tique bienveillante et l'oligarchie économique bienveillante sont
comme les masses tolérantes ». « La vie parlementaire peut paraître
de plus en plus décadente et les partis politiques simplement des
bureaucraties supplémentaires... non seulement les dictatures mais
aussi les démocraties sont guidées ». « Toutes les élites se ressem-
bleront de plus en plus. Des professionnels s'occuperont de l'économie :
l'entreprise financière est toujours autoritaire, au fond, de par son
besoin d'efficacité... Il faut concentrer l'autorité ». « On oubliera
les luttes de classes, qui seront remplacées par le concours bureau-
cratique... les bordereaux couleront, et non le sang ». Il n'y aura ni
individu indépendant, ni fourmi mais un être hybride. En tant que
travailleur « il sera sujet à une conformité très poussée » dans la pro-
duction, ce qu'il acceptera « comme un fait immuable. L'Etat, les
dirigeants, les syndicats sont tous des agents disciplinaires ».
Il y aura une certaine « liberté ». « La Société a atteint le con-
et il est peut-être moins nécessaire pour « Big Brother »
d'exercer une surveillance politique. On n'aura pas, non plus besoin
d'employer la génétique ni les moyens chimiques pour éviter la
révolte. Il n'y aura pas de révolte, de toute façon, sauf des petites
révoltes bureaucratiques qui pourront être mâtées chacune en
temps ».
5. Dans tout ceci, on ne perd pas son temps en 'louanges
rituelles de la démocratie'. Aucune prétention démocratique même pas
du bout des lèvres. Que restera-t-il de la liberté ? « Peut-être en
aura-t-on dans les loisirs individuels. Le conservatisme bureaucra-
tique dans la vie économique et politique pourrait être accompagné
d'une nouvelle bohème dans la vie privée. Le système économique
sera peut-être très ordonné et le système politique stérile du point
de vue idéologique, mais les aspects recréationnels et culturels pour-
raient être divers et changeants. Le nouvel esclavage à la technolo-
gie amènera peut-être une nouvelle recherche de la diversité et de
l'individualité ». Kerr se console, « Le nouvel esclavage et la nou-
velle liberté marchent la main dans la main ».
Et n'y aura-t-il pas de protestations contre tout cela ? Pas d'op-
position ? Kerr dit que non : de qui viendrait-elle ?
Les intellectuels ? Voici ce que Kerr en dit : « Les intellectuels
(y compris les étudiants d'université) sont un élément particulière-
ment peu solide, capable de réactions extrêmes dans des situations
objectives plus extrêmes que tout autre groupe social. Ils sont
naturellement irresponsables, en ce qu'ils n'ont aucun engagement
durable vis-à-vis d'une institution ou d'une philosophie, et ne peu-
vent pas répondre des conséquences de leurs actes. Il en résulte que
personne, y compris eux-mêmes, n'a confiance en eux ». Et de toute
façon, selon Kerr, les bureaucrates sauront s'en occuper. « Celui qui
sait le mieux attirer ou capter les intellectuels et se servir d'eux
joue un rôle important dans la société, car ils peuvent être un
instrument utile aussi bien qu'une source de dangers ». Comme le
dit Draper, 'Tout le monde doit être soit payé par le F. B. I. soit
soupçonné par lui'.
·
Les travailleurs ? Non, dit Kerr. L'organisation hiérarchique
aura détruit toute solidarité et toute volonté de lutte. «Un point
essentiel est la séparation inévitable et éternelle entre ceux qui
gèrent et ceux qui sont gérés ». L'U. R. S. S. s'est industrialisée et
76
7
se
la Chine s'industrialise sans conflits organisés. Un mouvement ouvrier
compté est devenu de plus en plus commun ».
Draper dit dans sa brochure qu'il ne peut pas traiter de 'la
puérilité scandaleuse de cette conception de l'histoire des contesta-
tions en U. R. S. S. et en Chine, où littéralement des millions d'hom-
ines ont dû être détruits dans l'opération consistant à « tenir en
main la contestation ». Il rappelle seulement à ses lecteurs que près
de 1.000 policiers furent appelési par Kerr lui-même sur le
campus de Californie pour « tenir en main la contestation » des
étudiants.
Avec une telle conception de la société, on devine facilement
le rôle que Kerr donne à l'université moderne (ou « multiversité »,
comme il l'appelle).
Kerr montre l'université comme une institution qui est et qui
sera de plus en plus identique à une entreprise industrielle'. Quand
Kerr parle du « produit invisible de l'université, les connaissances »
ce n'est pas une métaphore. Ecoutons-le : « La production, la distri-
bution et la consommation des connaissances sous tous les aspects
rend compte de 29 % du produit national... La production des
connaissances s'accroît à peu près deux fois plus vite que le reste
de l'économie... Le rôle joué par les chemins de fer dans la deuxième
moitié du XIXe siècle et par l'automobile dans la première moitié
du XX°, peut être tenu dans la seconde moitié de celui-ci par l'indus-
trie des connaissances ; à savoir constituer le foyer de la croissance
nationale ». « L'université et certaines portions de l'industrie devien-
nent de plus en plus semblables. Le professeur, du moins dans les
sciences naturelles et sociales, devient de plus en plus un entrepre-
neur. Les deux mondes convergent physiquement et psychologi-
quement ».
« L’université, dit Kerr correctement, situe dans le tissu
social général de son époque ». Il rejette avec un mépris justifia-
ble la vieille idée de la Tor d'Ivoire (non pas parce qu'elle ferait
des connaissances et de la culture des attributs de la classe domi-
nante, mais parce qu'elle ne rend pas, du point de vue technique).
L'intégration de l'université, pour Kerr, consiste à la mettre au
service des couches dominantes. «Les hommes politiques ont besoin
d'idées nouvelles pour résoudre des problèmes nouveaux. Les organes
d'exécution ont besoin de conseils d'experts sur la manière de traiter
les vieux problèmes. Le professeur peut fournir les deux ».
Kerr voit clairement le rôle de l'état dans cette transformation
gigantesque. L'université doit s'adapter à l'influence des subventions
massives qu'elle reçoit de l'état. La guerre froide, la course
armements et le Spoutnik ont influencé profondément la forme et le
contenu de l'éducation. « La multiversité a démontré comment elle
peut s'adapter à de nouvelles possibilités de créativité, combien elle
est sensible à l'argent... »
Mais même dans ce paradis bureaucratique, rien n'est gratuit.
Que donneront les universités en échange de cette aide énorme ?
« Les organismes gouvernementaux exerceront des contrôles de plus
en plus spécifiques, et l'université, habituée à son nouveau niveau
de vie, les acceptera. A leur tour, les universités devront devenir
plus sévères, centraliser l'autorité. Il est bien connu que dans cer-
taines situations on ne peut pas se maintenir sans aide, alors une
plus grande contrainte extérieure sera imposée dans la plupart des
situations ».
Clark Kerr n'a rien contre l'étiquette de bureaucrate :
contraire. «A la place de l'autocratie, qui n'était pas toujours telle-
ment agréable, il y a maintenant une bureaucratie qui est générale-
ment bienveillante, comme dans tant d'autres pays. Au lieu des
aux
au
77
Capitaines de l'Erudition il y a les Capitaines de la Bureaucratie, qui
sont parfois les esclaves sur leur propre navire ».
Kerr se réjouit que les Hommes de l'Avenir dans la nouvelle
Université-Usine ne soient ni les érudits (humanistes ou scientifi-
ques), ni les enseignants, mais les « praticiens », les administra-
teurs, qui comprennent maintenant de nombreux enseignants et des
dirigeants de la société en général.
Faut-il s'étonner que les étudiants de l'Université de Californie
se soient révoltés ?
- 78
LE MONDE EN QUESTION
LE KHROUTCHTCHEVISME SANS KHROUTCHTCHEV
la ligne que les Chinois ont déjà
dénoncée comme étant celle du
khouchtchevisme sans Khroucht-
chev. Cela d'abord et surtout sur
le plan intérieur.
Dès le lendemain du départ de
K., il fut proclamé que la « ligne
du XXIIe congrès » serait main-
tenue c'est-à-dire la libérali-
sation du régime sous tous ses
aspects. Les franchises des intel-
lectuels et des artistes seraient
respectées ; la consommation
populaire serait développée, et,
en ce qui concerne la gestion éco-
nomique, l'assouplissement des
structures allait se poursuivre. Ce
dernier point est, jusqu'à nouvel
ordre, l'essentiel.
au
avec
La braderie de Décembre.
en
Moins de trois mois après, le
limogeage de Khrouchtchev appa-
raît comme une opération extrê-
mement limitée à tous égards.
Il n'a été accompagné ni d'une
épuration de quelque envergure
ni d'un véritable tournant politi-
que, ni même d'une dénonciation
en règle du dirigeant déchu. Du
point de vue « technique », cette
opération chirurgicale de haute
précision est déjà significative
de la Russie post-stalinienne en
ce qu'elle est bien dans la ma-
nière d'une bureaucratie très fi-
nement structurée
moins
par comparaison
l'instru-
ment forgé par Staline et
composée de managers obsédés,
dans le domaine de l'exercice du
pouvoir comme dans les autres,
par le souci d'opérer aux moin-
dres couts. Mais surtout, en agis-
sant ainsi, les dirigeants sovié-
tiques ont montré combien ils
étaient conscients d'une part de
la vulnérabilité ou, du moins, de
la sensibilité extrême de la SO-
ciété soviétique moderne, qui ne
permet plus sous peine de mala-
die peut-être mortelle, que l'on
taille à vif dans sa chair comme
faisait Staline ; d'autre part du
caractère étroitement contrai-
gnant des problèmes surgis de
l'évolution sociale, économique et
politique de l'U.R.S.S., du bloc
communiste et même du monde
entier. Nulle part autant qu'en
U.R.S.S., on n'a l'impression de
voir les dirigeants d'un pays mo-
derne pris à la gorge par des
problèmes
leur laissent pas le choix des
solutions.
On peut faire cette constata-
tion à propos des diverses ini-
tiatives prises depuis la fin
octobre par les nouveaux diri-
geants de l’U.R.S.S. et qui tracent
En effet, le problème de l'ap-
provisionnement des villes
denrées alimentaires et celui de
la distribution des biens de
consommation ont pris dans la
dernière période, semble-t-il, des
dimensions dramatiques. Curieu-
sement, le
gouvernement doit
faire face en même temps à une
situation de rareté qui sévit
avec une particulière acuité dans
le domaine alimentaire mais qui
affecte aussi certains produits
industriels, et à un engorgement
du marché des biens de consom-
mation, se traduisant par l'accu-
mulation de monstrueux stocks
d'invendus dans les magasins
de l'Etat. Une braderie gigan-
tesque a été organisée en décem-
bre. Mais ce ne pouvait être qu'un
expédient à court terme. Car ce
dont il s'agit n'est pas une sur-
production momentanée mais une
inadaptation chronique et
quelque sorte « structurelle » des
produits aux besoins et aux désirs
des consommateurs. Ce problème
en
79
comme
un
est tout nouveau en U.R.S.S. et
s'il est considéré comme brûlant,
ce n'est pas seulement à cause
des dimensions qu'il a prises sur
le plan économique mais surtout
parce qu'en concernant de très
près les masses il revêt une signi-
fication politique évidente. Sous
Staline, la distribution était
assurée par la pénurie. Sitôt que
les objets cessent d'être vraiment
rares et qu'un certain choix est
proposé, on assiste à ce double
phénomène d'une pénurie des
biens correspondant aux goûts du
public, qui font l'objet de spé-
culations, de trafics, etc... et d'une
surabondance des biens dont les
consommateurs veulent
pas
et qui s'accumulent dans les
magasins, sans que pour autant
les usines qui les fabriquent ces-
sent ou modifient leur production
puisque celle-ci a été fixée une
fois pour toutes par le plan.
D'où la décision des successeurs
de K. d'élargir le champ des
expériences de gestion « décen-
tralisée » et basée sur le profit
comme « indice » de rationalité
économique et absolument pas
moteur » de l'activité
productive, proclament les «théo-
riciens » de la Pravda et d'ail-
leurs, surtout, ne pas confon-
dre ! Il est impossible de
savoir jusqu'où les dirigeants
soviétiques iront dans cette voie,
mais on peut affirmer dès à pré-
sent que si ce système de gestion
est maintenu au delà du stade
expérimental dans secteur
notable de l'économie, il ne pour-
ra que modifier profondément, de
proche en proche, tout le sys-
tème économique de l'U.R.S.S. en
sapant l'autorité du plan et des
planificateurs. Déjà le dernier
numéro des « Problèmes écono-
miques », revue publiée par l'Aca-
démie des Sciences de l'U.R.S.S.
demande l'extension de cette
libéralisation à l'industrie lour-
de et révèle que les invendus
dans le domaine des biens de
production atteignent 70 mil-
liards de nouv. frs. On commence
donc à voir comment l'entrée de
la société soviétique dans l'« ère
de la consommation » constitue
une dynamique irrésistible qui
conduit les dirigeants bien plu-
tôt qu'elle n'est conduite par eux.
ne
La Pravda du 15 décembre 1964 justifie ainsi
la décision du gouvernement soviétique de confier
aux kholkhoziens eux-mêmes la gestion de leur
production :
« Qui, mieux que le laboureur, sait quelle cul-
ture il doit prévoir, combien d'hectares il doit
ensemencer et de quelle manière ? Qui, mieux que
l'éleveur, sait quel élevage il doit favoriser, com-
ment le nourrir et le soigner ?... On pourrait penser
que c'est une vérité première et pourtant il se
trouve encore certains responsables pour essayer
de donner des conseils aux paysans et aux éleveurs,
pour tenter de leur imposer leurs propres concep-
tions qui sont parfois irréfléchies ».
Et qui mieux que l'ouvrier ? ...
2
Le paysan et les « détails »
de la culture
Sur le plan agricole, les pro-
blèmes sont différents, puisqu'il
s'agit essentiellement de porter la
production à un niveau qui lui
permette de satisfaire les besoins
croissants de la société sovié-
tique. C'est donc la modernisa-
tion des techniques agricoles qui,
une fois de plus est à l'ordre du
jour. Mais c'est, une fois de plus
aussi, un problème de gestion. Car
-
80
se
се
eux-
l'accroissement de la production
ct même la modernisation des
techniques ne peuvent faire
malgré les paysans, dont une cer-
taine autonomie de fait n'a pu
être entamée par 35 ans de col-
lectivisme. Aussi, les successeurs
de Khrouchtchevont-ils assorti
les investissements massifs desti-
nés à l'amélioration technique de
l'agriculture, de mesures visant à
obtenir la participation active
des agriculteurs à la production.
Ils ont levé certaines limitations
qui entravaient la culture et l'éle-
vage sur les lopins individuels
des kholkhoziens et la commer-
cialisation des produits de
travail privé. Ils ont d'autre part
confié « aux paysans
mêmes » la gestion des entrepri-
ses agricoles, à l'intérieur des
normes quantitatives et qualita-
tives fixées par le plan, de
manière à limiter les conséquen-
ces désastreuses de l'arbitraire
bureaucratique dans le domaine
des « détails » (comme dit la
« Pravda ») de la culture et de
l'élevage.
Mais ainsi que le souligne la
« Pravda » du 5 janvier, cette
« initiative créatrice »
sans reste étroitement assujettie
aux directives du plan établi par
l'état. Bien plus, la « Pravda »
met en garde les paysans contre
la tentation, de sortir des préro-
gatives qui leur sont accordées
en matière de gestion et cite un
certain nombre d'exemples à ne
pas suivre concernant des entre-
prises dans lesquelles, à titre
expérimental, une certaine parti-
cipation de la base à la planifi-
cátion avait été établie mais où
les initiatives intempestives des
paysans avaient compromis gra-
vement la réalisation du plan
d'état.
Comment concilier le système
de la planification bureaucrati-
que
situation
où
l'autonomie des « sujets écono-
miques », qu'il s'agisse des pro-
ducteurs ou des consommateurs,
devient non seulement une réalité
qu'on ne peut plus supprimer
mais même une des conditions
nécessaires pour que la produc-
tion puisse être menée à bien
tel est le problème fondamen-
tal qui se pose aux dirigeants
soviétiques et qui apparaît avec
une évidence croissante dans les
réformes
qu'ils entreprennent
sans fin dans l'industrie comme
dans l'agriculture.
Le P.C. entre ciel et terre.
Autre série de mesures des
nouveaux dirigeants soviétiques,
celles qui ont aboli la division
que Khrouchtchev avait introduite
au sein du Parti entre une bran-
che agricole et une branche in-
dustrielle et ont rétabli le parti
dans la position qu'il occupait
avant 1960, c'est-à-dire celle d'un
organe de pouvoir non seulement
unitaire mais distinct des organes
de gestion proprement dite. A
première vue et c'est d'ailleurs
la raison invoquée officiellement
pour justifier cette réforme il
s'agit d'un renforcement du Par-
ti. Non seulement celui-ci, scindé
en deux, était moins apte à jouer
son rôle de creuset où doivent se
fondre les divers éléments les
plus dynamiques de la société
soviétique et de système nerveux
central de celle-ci, mais surtout il
était plongé et même empêtré
dans les tâches de gestion directe
de l'économie : ou bien il faisait
double emploi avec l'appareil ad-
ministratif et
gestionnaire et
apparaissait comme un gêneur et
un parasite ou bien au contraire
les dirigeants de l'agriculture et de
l'industrie l'utilisaient pour lui
faire endosser des responsabilités
gênantes qu'il avait dû er
avec eux.
Mais lorsque Khrouchtchev avait
introduit sa réforme du parti, il
avait lui aussi pour objectif de
renforcer son rôle. C'est pour
mettre les bureaucrates du P.C.
plus directement en contact avec
les réalités économiques qu'il les
avait spécialisés, de façon à ce
que, à la fois, leur travail d'éla-
boration politique repose sur un
fondement réaliste et leur in-
fluence l'appareil gestion-
naire soit plus directe donc plus
forte. Ainsi, les réformes en sens
contraire de 1960 et 64 apparais-
sent-elles comme les phases d'une
des pay-
avec
une
sur
81
.
:
bureaucratie soviétique depuis la
fin du stalinisme à élaborer et
à appliquer une ligne politique
quelconque, tandis que son idéo-
logie n'a plus même pour la
forme
aucune existence. Ce
n'est plus la bureaucratie qui fait
l'Histoire ; la société russe mar-
che toute seule, mue par
des
forces dont, au reste, les plus
puissantes n'apparaissent guère
dans l'actualité et le rôle des
dirigeants » se réduit à consa-
crer des états de fait, à freiner
quand ils le peuvent et à bricoler
frénétiquement pour éviter l'ac-
cident mécanique qui ferait
éclater la machine.
la
Rompre avec la Chine aux
moindres frais
une
oscillation qui est inscrite dans
la nature même du Parti. Comme
le faisait ressortir Claude Lefort
dans le numéro 19 de cette revue
(Le totalitarisme sans Staline
l’U.R.S.S. dans une nouvelle
phase N° 19, p. 1), le P.C. a à
la fois tout le pouvoir et aucun
pouvoir particulier ; il élabore la
politique du pays, mais il est
coupé des réalités économiques,
sociales, culturelles, qui forment
le contenu même de la politique ;
il doit faire exécuter cette poli-
tique, mais ce sont d'autres orga-
nes qui rencontrent les résistan-
ces de tous ordres que la réalité
oppose à l'application de
trancher tous les problèmes, mais
ce qu'il sait, ce qui peut étayer
son arbitrage, d'autres
qui lui
sont subordonnés: — le lui ont
appris. Cette contradiction multi-
forme se traduit par une oscil-
lation perpétuelle entre
phase où le Parti se cantonne
dans son rôle d'élaboration géné-
rale, d'impulsion et de contrôle
mais alors voit fleurir
l'arbitraire et le « bureaucra-
tisme »
et une phase où il se
plonge dans les problèmes réels
de la gestion mais alors il fait
double emploi avec les spécialis-
tes et ne joue plus le rôle que
d'un gêneur ou d'une dupe.
Cependant, pour qu'à quatre
d'intervalle à peine, les
dirigeants soviétiques aient
éprouvé le besoin de bouleverser
de fond en comble et de rebou-
leverser l'organisation interne
de ce qui est censé constituer
l'instrument essentiel de leur
pouvoir dans tous les domaines,
il faut que cet instrument
soit révélé bien peu adéquat.
Voilà encore
une contradiction
qui était larvée et comme gelée
pendant la période stalinienne et
qui se développe et apparaît au
grand jour depuis la déstalinisa-
tion et l'accélération des transfor-
mations qui affectent la société
russe. En fait, ce qui apparaît
derrière
remaniements de
structures que l'on assemble et
désassemble comme des cartes à
jouer, c'est l'impuissance de la
on
ans
La même impuissance à mal-
triser les problèmes éclate dans
les rapports de l’U.R.S.S. avec les
autres pays et partis commu-
nistes. Même à l'intérieur du
camp soviétophile, Brejnev et
Kossyguine se sont trouvés en
posture d'accusés pour la manière
dont ils ont pris le pouvoir. Le
P.C.I. et moins nettement
le P.C.F. en ont profité pour don-
ner des leçons de démocratie au
grand frère et surtout pour ac-
croître leur indépendance à son
égard.
Du côté des relations sino-
soviétiques, la dynamique qui
semble conduire inéluctablement
à la rupture se poursuit. La seule
différence
la période
khrouchtchévienne, c'est que K.
marchait à cette rupture tambour
battant, alors que ses successeurs
s'y laissent mener la tête basse
et traînant le pied. L'échec appa-
remment total des pourparlers
qui ont eu lieu à Moscou entre
Chou En Lai et les dirigeants du
Kremlin à l'occasion de l'anniver-
saire de la révolution d'Octobre
a dissipé la très légère incerti-
tude que l'on pouvait avoir sur
l'évolution du conflit sino-sovié-
tique après le limogeage de K.
Depuis, la polémique même
partiellement repris. Il est cer-
tain que B. et K. ne pouvaient
pas, parlant
Chinois
renier la * ligne du XXem
ауес
se
a
ces
en
aux
82
congrès » qui, sur le plan inté-
rieur leur tient lieu de légiti-
mité.
« dé-
a
un
Dans ces conditions, B. et K.
qui semblent bien inaugurer en
toutes choses ce qu'on peut appe-
ier l'« ère des comptables » peu-
vent seulement espérer limiter
les frais de la rupture avec la
Chine. Circonscrire d'abord la
cassure effective, en évitant par
exemple qu'elle entraîne
véritable conflit entre les Etats,
dangereux pour la sécurité de
l'un comme de l'autre. Limiter
d'autre part les répercussions de
la rupture sur le camp socialiste.
C'est certainement dans cet esprit
que la conférence
des partis
communistes convoquée par Mos-
cou pour le 15 décembre a été
reportée au mois de mars. En
tout cas, ni la Chine ni l'U.R.S.S.
peuvent envisager pour
moment-là une réconciliation. Les
Chinois se montrent résolus à ne
pas changer d'un pouce leur posi-
tion et attendent que l'U.R.S.S.
s'aligne sur eux
en tout
cas, affectent d'attendre. Mais, les
Soviétiques, de leur côté, ne peu-
vent réellement modifier ni leur
politique intérieure ni leur poli-
tique extérieure.
En effet, dans domaine
dans les autres, le
khrouchtchévisme se poursuit : le
rapport de forces à l'échelle mon-
diale et les impératifs de l'évo-
lution interne de l'U.R.S.S. impo-
sent aux dirigeants de Moscou de
continuer à rechercher la
tente » avec l'ouest. On dit
qu'ils avaient reproché à Khroucht-
chev l'extrême mollesse de sa
réaction au moment des bombar-
dements du Nord-Vietnam par les
Américains l'été dernier. Mais B.
et K. ne se sont pas montrés plus
énergiques lors de l'opération
belgo-américaine de Stanleyville.
Pourtant celle-ci avait été annon-
cée. Mais l’U.R.S.S. n'a rien fait
pour l'empêcher bien qu'il ait
été évident que cette opération
«humanitaire» qui a causé la mort
des « otages > (otages parce que
les occidentaux ont menacé d'in-
tervenir) n'ait eu d'autre but que
de renverser au moins tempo-
rairement la situation mili-
taire au Congo faveur de
Tshombé. Il est vrai que
le
Vietnam nord touche plus direc-
tement l’U.R.S.S. que le Congo,
mais aussi le risque était beau-
coup moins grand d'intervenir
au Congo. Ce qui semble clair,
c'est que depuis la crise cubaine,
l’U.R.S.S. laisse mener
aux occi-
dentaux des opérations de police
« propres »,
limitées dans le
temps et dans l'espace et affecte
de n'être pas concernée. Aussi
les autres, ne se gênent-ils pas.
en
ne
ce
ou
ce
comme
P. CANJUERS
GRAND FILM SUR LA PECHE SOUS-MARINE
suivi d'un débat sur le travail, les loisirs et les
sports. - Entrée gratuite.
(affiche signée, dans un coin, en bas, en petits caractères :
Parti Communiste Français, section de Boulogne, etc...)
DU BON USAGE DES SARTRES
« Il y avait à Paris, une Union
des Etudiants Communistes ».
Elle éditait un journal qui s'ap-
pelait Clarté. Au début de l'his-
toire, c'était une Union bien sage
qui obéissait en toute chose au
Parti et qui suivait sa ligne.
Aussi était-elle bien traitée par
le Parti qui lui donnait tout ce
dont elle avait besoin, en parti-
culier l'argent nécessaire à la
publication de « Clarté ». Mais
voici que l'U.E.C. se mit à affi-
cher des velléités d'indépendance.
Tantôt elle penchait vers la ligne
d'un parti oncle, tantôt elle allait
83
.
même jusqu'à écouter les mur-
mures trompeurs de gens tout à
fait étrangers à la famille. Le
Parti en était tout à fait désolé.
Il essaya tout pour la ramener
dans le droit chemin. Mais dou-
ceurs ou menaces, calineries ou
violences, rien n'y fit. Non seule-
ment, l’U.E.C. se refusa à pro-
mettre de n'écouter que la voix
sage du Parti mais elle afficha
même des attitudes insolentes et
cria si fort que les voisins surent
tout de la dispute. Le Parti se
fâcha et lui coupa les vivres.
Comment faire désormais pour
publier « Clarté » ?
A ce point notre histoire pour-
rait tourner tout à fait au conte
de fées et continuer ainsi
« l'U.C.E. se rendit compte que
pour remplir son rôle elle devait
se comporter en adulte. Elle an-
nonça publiquement son autono-
mie, dénonça les pressions dont
elle avait été l'objet de la part
du Parti. Elle édita « Clarté »
(un « Clarté » bien diminué pour
ce qui est du volume et de la
qualité du papier) avec l'aide
financière et l'appui pratique de
ses militants et de ses lecteurs.
Ce fut désormais journal
sans compromission, qui essayait
de donner à la politique tout le
sens qu'elle peut avoir à notre
époque, qui n'avait
peur
ni
d'aborder des questions neuves
et controversées ni de reconnaî-
tre les limites de ce qu'il avait à
dire, qui n'essayait pas d'attirer
les gens par un aspect dépolitisé
dans le fallacieux espoir de les
repolitiser subrepticement. Evi-
demment, cette ligne de conduite
coûta à l'U.E.C. bien des déboires
et bien des attaques ; il y eut
beaucoup de difficultés financiè-
res et la parution fut irrégu-
lière... ».
Mais trève de plaisanterie.
L'affaire se passait en 1964. Il
n'était pas question de rompre
publiquement avec le Parti et il
fallait trouver de l'argent pour
continuer à paraître. Pour cela,
on aurait pu vendre de la pâte
dentifrice du coca-cola
profit de « Clarté ». Mais les spé-
cialistes en études de marché de
l’U.E.C. indiquèrent une bien
meilleure voie : dans notre éco-
nomie où le « tertiaire » est en
plein développement, il est beau-
coup plus rentable de vendre de
la culture. Et comme celle-ci ne
demande qu'à se vendre, tout
s'arrangea à merveille. C'est ainsi
qu'en décembre, l'U.E.C. organisa
à grands renforts de publicité,
un débat public à la Mutualité,
avec Sartre et Beauvoir comme
têtes d'affiche. Cela garantissait
le succès de foule. Aussi s'agis-
sait-il de choisir les autres parti-
cipants au débat, non pas dans
le souci d'organiser un vrai dé-
bat mais de façon à mettre en
valeur les grandes vedettes, qui
avaient d'ailleurs leurs caprices
et leurs exigences (voir les dis-
cussions autour de l'éventuelle
participation d'Axelos).
Malgré l'âge moyen du public,
que tous les journaux ont monté
en épingle, le cirque de la Mutua-
lité atteste une fois de plus la
sénilité des groupes de gauche
et d'extrême-gauche, même parmi
les étudiants. De quoi s'agit-il en
effet pour ces organisations et
au premier chef pour l'U.E.C. ?
De trouver un substitut à la
guerre d'Algérie. Pendant la
guerre d'Algérie, l’U.E.C. et même
l’U.N.E.F. pouvaient rassembler
les étudiants pour
leur parler
politique au sens indubitable du
terme et pas seulement pour leur
en parler, mais pour organiser
eux des actions auxquelles
il ne suffisait pas d'assister mais
auxquelles il fallait participer.
L'agitation autour du problème
algérien ayant pris fin, on
rait pu penser que ces groupes
sauraient au moins ouvrir le
débat sur les nouveaux problèmes
qui sont précisément les problè-
mes politiques du monde. mo-
derne à condition qu'on ac-
cepte de les considérer comme
tels, ce qui demande une liberté
d'esprit dont un étudiant commu-
niste, si frondeur soit-il à l'égard
du parti-père, semble décidément,
par construction, incapable.
Alors que faire pour trouver
quand même du monde, pour
relancer « Clarté » ? On utilise
les bonnes vieilles méthodes du
un
avec
au-
ou
au
84
nouveau.
papa (et des oncles, les curés)
on organise une réunion-spectacle
autour d'un sujet quelconque et
on introduit la politique par la
bande. Mais la politique intro-
duite par la bande n'a pas pour
autant un sens
C'est
toujours la bonne vieille notion
de politique mais présentée sous
un emballage équivoque. Et pour
cette besogne louche, qui pour-
rait-on trouver de plus indiqué
que
le héros de l'équivoque,
la conscience à double entrée qui
redécouvre l'humanisme et le
sens de l'Histoire lorsque les
Français répriment la révolution
algérienne mais qui ne voit plus
rien lorsque les tanks.
écrasent l'un des mouvements
révolutionnaires les plus éclai-
rants de l'Histoire, l'échine à
double détente qui se cabre fiè-
rement devant l'oppression capi-
taliste mais qui se ploie jusqu'à
terre devant la dictature du par-
ti, enfin, puisqu'il s'agissait de
cela, le littérateur putassier qui,
pour vendre des charmes avant-
gardistes, cligne de l'oeil et roule
des fesses, à longueur de milliers
de pages suivant les recettes les
plus éventées du plus vieux
métier du monde - en un mot
l'homme qui a su mériter le prix
Nobel.
Paul TIKAL
russes
DEUX BALS, DEUX MANIERES
Deux façons bien différentes de s'amuser, d'organiser un bal,
un spectacle et le décor de ce spectacle. C'est ce que l'on pouvait
constater un samedi soir en passant du bal des Arts Décoratifs, 31, rue
d'Ulm, au bal du Syndicat du Livre (C.G.T.), 94, boulevard Auguste-
Blanqui.
Rue d'Ulm, le Pop'Art envahit toute l'Ecole, salles de cours,
éscaliers, couloirs, etc. Un peu partout, on remarque des inscriptions
telles que « LE COUPABLE C'EST L'ETAT ». Au Syndicat du Livre,
décor traditionnel d'une salle des fêtes : les murs s'ornent d'immen-
ses panneaux proclamant des slogans cégétistes pour l'annulation
de toutes les forces de frappe, pour la semaine de quarante heures,
etc.
Les étudiants, débraillés, déguisés, créent une ambiance sur-
chauffée et se livrent à des jeux enfantins. Boulevard Auguste-Blan-
qui, public de jeunes et de moins jeunes ouvriers d'imprimerie. Cer-
tains, pour cette soirée annuelle, ont fait un effort vestimentaire,
tandis que d'autres viennent dans une tenue « prolétaire ». Pour
tous ces jeunes, ce bal est une sortie du samedi soir, où l'on se
retrouve entre « gars du métier », en espérant qu'on pourra découvrir
« l'âme soeur » de la semaine.
Le contraste est tout aussi remo
marquable du côté des orchestres.
Au bal du Livre, les musiciens, entrés depuis longtemps dans la
catégorie des « croulants », font évoluer les danseurs sur des rythmes
modernes, tels que le twist, le madison. Au contraire, les étudiants
des Arts décos gigotent caricaturalement sur des rythmes de java
et de valses de la Belle Epoque exécutés par les fanfares folkloriques
dont les musiciens ont encore l'âge des « yéyé ». La symétrie dans
l'opposition est vraiment totale : de l'orchestre des Arts Décos ou de
l'orchestre du Livre, on peut se demander quel est le plus folklorique.
Rue d'Ulm, les étudiants ont à leur disposition deux bars : l'un,
isolé du vacarme, offre du champagne ; l'autre ne proposant à
l'assoiffé que du gros rouge et un blanc plutôt douteux. Rien d'ori-
ginal au Syndicat du Livre, où une affiche avertit les affamés qu'ils
peuvent commander des « casse-croûte ». Par contre et ce n'est
pas le moins surprenant, dans cette salle placée sous le signe des
slogans C.G.T., la bouteille de champagne est obligatoire pour ceux
qui s'installent à une table.
85-
Deux façons de s'amuser, reflétant deux manières de vivre, deux
milieux sociaux bien différents et qui s'ignorent. Ceux qui rêvent
d'une rencontre et d'une association des travailleurs et des étudiants
n'auront pas la tâche facile.
Michel LAIROT
DES MEDECINS ET DES GREVES
Un des événements qui avaient frappé l'opinion publique au
début de l'année 1964 était la grève des médecins belges. Scandaleuse
démission pour les uns, admirable réflexe de défense pour les autres,
elle a ranimé les discussions sur l'organisation de la médecine, elle
a fait l'objet d'innombrables controverses dans les revues spécialisées
ou non et même a fait les gros titres des journaux pendant pas mal
de temps. Depuis, les grèves de médecins entrent dans les moeurs.
Rien qu'en feuilletant les journaux de décembre, on relève des
petits échos concernant une grève des anesthésistes à Paris, une grève
de solidarité des médecins de Meurthe-et-Moselle pour un de leurs
confrères inculpé de non-assistance à une personne en danger, une
grève toute paisible, cette fois des médecins belges des hôpitaux
à propos d'un article obscur de la loi Leburton... Voilà : les grèves
de médecins font partie du paysage. Elles attirent moins l'attention
qu'une grève des services publics parce qu'on a moins besoin du
médecin que du mécanicien de locomotive et elles n'étonnent pas
plus parce qu'au fond on commence à ne plus bien voir la différence
entre un médecin et un employé du métro. Ces grèves, qui à chaque
fois détruisent un peu plus ce fameux rapport «libéral » d'homme
à homme que les médecins prétendent vouloir maintenir avec leurs
clients, attestent qu'ils entrent dans l'ordre bureaucratique et fonc-
tionnarisé contre lequel précisément ils protestent... en faisant la
grève.
« APPRENEZ LE GESTE QUI SAUVE »...
OU L'HUMANISME OCCIDENTAL EN QUATRE LEÇONS
New York, mars 64 : Catherine Genovese est assassinée à
coups de couteau dans la rue. Des centaines de gens assistent de leur
fenêtre à la scène, qui dure un très long moment. Aucun n'intervient
ni n'appelle la police, même par téléphone.
Frouard (Meurthe-et-Moselle), 19 novembre 64 : Deux jeunes
gens se battent pour une fille, au bal du samedi soir. L'un d'eux
est poignardé par l'autre. Il a une artère sectionnée et perd son sang
abondamment. Six garçons le regardent mourir dans la rue, sans
faire un geste. Un autre jeune homme court chez le Dr Colin qui
habite à proximité. Il l'éveille et lui demande de venir secourir le
blessé. Le médecin refuse. Il prétendra par la suite que le jeune
garçon lui avait dit qu'une ambulance avait été appelée.
Trappes, 15 décembre 1964 : Une voiture renverse un piéton
qui traversait la route sur un passage clouté. Une deuxième, puis,
une troisième et probablement au moins encore une quatrième voi-
ture écrasent l'homme étendu sur la chaussée. Aucune ne s'arrête.
Ensuite environ 400 voitures font un écart pour éviter le corps mais
ne s'arrêtent pas non plus.
Quelque part en brousse, au Congo (d'après le « Messaggero »
du 18/12/64 et le « Guardian » du 19/12/64) : Une équipe de cinéastes
italiens accompagne un groupe de mercenaires afin de recueillir des
86
scènes intéressantes pouvant servir ultérieurement à la fabrication
d'un grand film d'aventures (il ne s'agit pas de bandes d'actualités).
Alors qu'ils cheminent dans la brousse, trois petits Africains viennent
à eux et leur adressent la parole dans leur langage. Geste machinal
d'un des mercenaires qui braque sur les trois enfants sa mitraillette.
« Un instant, s'écrient les cinéastes, nos caméras ne sont pas au
point ». Le mercenaire abaisse son arme. « Ça y est, nos caméras sont
au point », disent les cinéastes. Le mercenaire abat les trois enfants.
Les cinéastes tournent.
LA GREVE DE LA GENERAL MOTORS
ANNONCE-T-ELLE
DE NOUVELLES LUTTES SOCIALES ?
« sit-
(D'après l'hebdomadaire améri-
cain « Nation » du 16 nov. 1964).
La récente grève de la Général
Motors qui a duré six semaines
peut être considérée comme la
plus longue et la plus importante
grève sauvage depuis les
downs » des années trente.
Après l'accord obtenu chez
Chrysler puis chez Ford, tout le
monde s'attendait à une négo-
ciation facile. Le 26 septembre,
Business Week pouvait ainsi ré-
sumer la situation : « il ne reste
plus que des questions non éco-
nomiques à régler. Un accord
formel n'aura
doute pas
lieu avant la date limite, une
grève reste possible mais elle est
improbable>.
La direction elle-même fut
surprise. Quelques heures avant
la date limite, les dirigeants syn-
dicaux étaient prêts à accepter
ses offres : « Nous avons obtenu
davantage pour les conditions de
travail que dans les trois ou
quatre dernières négociations ».
Mais cette amélioration en elle-
même s'avéra une
de
conflits, en montrant aux diri-
geants locaux combien cette
question vitale des conditions, de
travail avait été négligée dans le
passé, tandis que le syndicat ne
s'occupait que d'obtenir des bé-
néfices marginaux.
Pour la base, questions
apparaissaient bien plus déci-
sives que les bénéfices économi-
ques
séduisants obtenus chez
Chrysler et acceptés par Ford
et Général Motors. Dans quatre
domaines d'importance majeure
pour les hommes et les femmes
travaillant à la chaîne, les pré-
cédents contrats obtenus à la
General Motors bien qu'aussi
avantageux du point de vue éco-
nomique étaient bien infé-
rieurs à ceux obtenus chez Ford
et chez Chrysler. Ces quatre
domaines étaient : les normes
de production, l'allocation de
temps aux délégués syndicaux
pour s'occuper des revendications,
les mesures disciplinaires et les
heures supplémentaires obligatoi-
res. Reuther, le chef du syndicat
de l'automobile, ne put convain-
cre les représentants de la base
d'accepter l'offre finale de la
G.M. L'accord fut refusé par
10 voix contre 1 : la grève s'en-
suivit.
sans
ne
au
Source
La situation étonnante dans
laquelle le meilleur contrat ob-
tenu depuis une décennie et demie
s'avéra le moins satisfaisant
pour les syndicats locaux
constituait que l'un des para-
doxes qui survinrent cours
des négociations de l'automne
dernier. La General Motors et
l’U.A.W. (syndicat des travailleurs
de l'automobile) désiraient tel.'
lement éviter les effets indirects
de la grève que les deux camps
se mirent tout de suite d'accord
pour que le plus grand nombre
d'ateliers continuent à travailler,
de manière que Ford et Chrys-
ler, qui utilisent certaines pièces
fabriquées par G.M., ne soient pas
affectés par
le conflit. Les
conséquences de cette décision
ces
87
la
une
furent de donner un avantage à
Ford et à Chrysler dans la
compétition. Chrysler accrut ses
ventes de 23 % et Ford de 12 %.
Mais ce n'était pas inquiétant
pour G.M., bien que ses clients
aient réclamé à cor et à cri des
voitures. Pendant dernière
décennie, le problème le plus cru-
cial de la G.M. est de ne pas
avoir une part trop importante
du marché de l'automobile (elle
atteint jusqu'à 56 % des ventes
totales) pour échapper aux lois
antitrust.
C'est pour cela que pendant
les deux premières semaines, la
grève provoqua peu d'inquiétudes
à la G.M. Pour leur part, les
ouvriers avaient tellement fait
d'heures supplémentaires pen-
dant les deux dernières années
qu'une courte grève était
détente bienvenue. De plus, les
arrêts de travail brefs servent
de soupape de sûreté
pour
l'agressivité des ouvriers. Les
dirigeants de la G.M. le savent
bien comme ils savent que la
production perdue peut être faci-
lement rattrapée par les heures
supplémentaires. Cependant
bout de quelque temps on com-
mençait à craindre les répercus-
sions sur l'économie qui auraient
pu influencer défavorablement
l'élection du Président Johnson.
Celui-ci commençait à exercer
une pression sur la G.M. Une
réunion du conseil syndical fut
convoquée, et les questions natio-
nales réglées, laissant aux bran-
ches locales le droit de continuer
de débrayer jusqu'à la résolution
des conflits locaux. Ainsi la
grève se termina officiellement
le 25 octobre alors que 28 des
123 branches locales produisant
77 % des voitures G.M. conti-
nuaient leur
grève
jusqu'au
6 novembre.
Ce résumé des événements est
intéressant à deux égards. Tout
d'abord, il montre que ce n'est
pas Reuther qui a encouragé la
grève, mais que lui et ses amis
ont appelé à la grève officielle
pour éviter une répétition des
grèves sauvages de 1958 et de
1961. Cette fois-ci, le syndicat
U.A.W. était décidé à garder les
rênes en main. Reuther croyait
qu'il avait gagné des avantages
< irrésistibles ». Ce n'était pas de
sa faute si les travailleurs avaient
d'autres revendications plus im-
portantes que lui ou les patrons
de la G.M. ne le croyaient.
Et surtout cette grève illustre
le fait que nous entrons dans
une nouvelle phase du mouve-
ment ouvrier. Elle a été décrite
récemment par Stan Brams, édi-
teur de « Labor Trends » :
« Aujourd'hui une Troisième Force
se développe dans le monde du travail
(les deux autres étant le capitalisme
et la tion syndicale).
La pression de cette troisième force,
des idées et des projets de la base
est dirigée à la fois contre le syndicat
et contre les compagnies. Elle est
devenue de plus en plus forte ces
dernières années, et c'est elle qui est
la cause de ce qui parait comme une
contradiction entre les revendications
des travailleurs et la stratégie syndi-
cale. Et cette pression ira
augmentant ».
Tout dans la situation actuelle
confirme cette appréciation.
au
en
SUR POPULATION ABSOLUE ET RELATIVE
La surpopulation est un phénomène universel mais il revêt des
formes très différentes selon le stade de développement où les
divers pays se trouvent. De plus chacun s'attaque au problème aves
les moyens que lui suggère son génie propre. Aux Indes, par exemple
si profondément marquées par la religion que celle-ci interdit de
tuer les vaches comme chacun sait le problème du surpeu-
plement des bovidés va sans doute être bientôt résolu grâce à un
double S en matière plastique introduit dans l'utérus des femelles.
L'équipement d'une vache avec cet engin est très facile et ne
88
contredit en rien aux principes fondamentaux de la culture hin-
doue.
Aux Etats-Unis, le pays le plus riche du monde, les problèmes
sont quelque peu différents. Le reproductian des citoyens est
accueillie avec faveur mais là aussi, les valeurs morales gardent
tous leurs droits. La reproduction est encouragée mais à condition
qu'elle s'accomplisse dans la légitimité et surtout dans la prospérité,
deux valeurs clés de la civilisation américaine. Une mère célibataire
de 25 ans en a fait dernièrement l'expérience à Newark (New Jersey) :
elle a été condamnée à rester en prison pour une durée indéfinie
parce qu'elle a trop d'enfants. Elle avait pourtant obtenu un sursis
en 1962. Le juge s'était contenté de lui enjoindre de trouver un
emploi pour nourrir ses quatre enfants et le cinquième qu'elle
attendait. Le même juge l'a condamnée cette année en déclarant :
« Je vous avais enjoint de ne plus avoir d'enfants illégitimes et
vous avez violé mon injonction ».
REFLEXIONS SUR LA PREMIERE INTERNATIONALE
ou
une
en
Au milieu du mois de novem-
bre dernier, s'est tenu à Paris,
pendant trois jours, un colloque
international sur la Première
Internationale, à l'occasion du
centenaire de sa fondation. Ce
n'était pas là une manifestation
commémorative sur le ton ly-
rique, comme il s'en est tenu, ici
là, mais
assemblée
d'historiens soucieux d'appliquer
les méthodes de la recherche
scientifique et de répondre no-
tamment aux questions suivan-
tes : où et quand l'Internationale
s'est-elle implantée, dans quelles
conditions et avec quel succès.
Il ne s'agit pas, ici, de résu-
les réponses qui furent
apportées mais de souligner cer-
tains faits, peu mal
connus,qui invalident les croyan-
ces pieusement répandues et
entretenues par
le marxisme
militant, faits qui, en même
temps, contribueront à faire ap-
paraître la vanité d'une organi-
sation (même si elle se veut un
instrument révolutionnaire), lors-
qu'elle reproduit dans sa struc-
ture et ses méthodes la division
entre dirigeants et exécutants.
Si on ne s'entend guère sur
l'importance historique de la
Première Internationale, c'est
qu'il s'avère impossible de chif-
frer même approximativement
le nombre de ses adhérents.
M. J. Maitron a avancé le chiffre
de quelques milliers ; J. Rou-
gerie (1) celui de quelques dizai-
nes de milliers et Bruhat quel-
ques centaines de milliers. On
explique ces différences en remar-
quant que le premier parle des
militants connus de la police,
le second des adhérents réguliers
et le troisième de ceux qui ont
subi l'influence des militants. Ce
qui, en revanche, paraît hors de
doute (sauf en Belgique) c'est
que le recrutement de l'Interna-
tionale se faisait, non dans, la
grande industrie (mines, métal-
lurgie) mais dans les industries
déclin, traditionnelles, et
même dans les entreprises arti-
sanales. Et cela pour une raison
assez simple : les ouvriers com-
prenaient l'Internationale para-
doxalement
comme
union du prolétariat international
mais comme un moyen de sau-
vegarder leurs intérêts particu-
liers. En effet cette organisation
présentait, pour eux, deux avan-
tages principaux :
1) un aspect purement finan-
cier
forme d'entr'aide
de grève. Le rapport du
Conseil général (Congrès de Bâle
de l’A.I.T., sept. 1869) précise, à
propos des grèves lyonnaises :
« Ce n'était
pas
l'Internationale
mer
ou
non
une
sous
en
cas
(1) Voir son rapport sur le
colloque international de 1964,
dans le no 49 du Mouvement So-
cial.
89
que la
en
en
nous
nos
en
nous
qui jeta les ouvriers dans la est soupçonné d'être un espion
grève mais, la grève qui les jeta au service de l'ennemi. D'autre
dans l'Internationale ». (Cahiers“ part, dans la « Seconde adresse
de l'I.S.E.A., n° 152, S. 8, p. 128). du Conseil général sur la guerre
2) un certain contrôle de l'émi- franco-allemande », on peut lire
gration de la main-d'cuvre
« classe ouvrière alle-
étrangère qui, si elle n'était pas mande a résolument donné son
contrôlée, ferait baisser les appui à la guerre » (Ed. SOC.
salaires. «L'A.I.T. avait été fon- p. 287). Certes, on ajoute que
dée à la suite de rencontres cette guerre de l'Allemagne était
entre syndicalistes anglais et « libératrice » et voulait sauver
ouvriers français... Les syndica- l'Europe du « cauchemar oppres-
listes anglais travaillaient à sant du second Empire ». Mais
l'amélioration des conditions de pourquoi tant s'indigner d'argu-
vie des ouvriers, sans remettre mentations de ce type, après le
cause le régime capitaliste ; début de la guerre de 1914 et
novembre 1863, ils s'adres- célébrer l'internationalisme ?
saient aux ouvriers français dans Nous sommes conditionnés par
les termes suivants :
les slogans de la zame Internatio-
« La fraternité des peuples est nale qui prétendait après la fail-
d'une haute importance dans
lite de la 2 Internationale
l'intérêt du travail car lorsque retrouver la pureté mythique de
la
essayons d'améliorer
« première », l'âge d'or de
conditions sociales, soit
en di-
l'internationalisme. En fait, les
minuant les heures de travail,
trois se valent et, ce qui
soit en rehaussant son prix, on
concerne la troisième, ce n'est pas
menace toujours de faire la théorie du « socialisme dans
venir des Français, des Alle- un seul pays », le pacte germa-
mands, des Belges qui travaillent no-soviétique ou l'actuelle que-
à meilleur compte. Si cela s'est
relle sino-soviétique qui peuvent
fait parfois, ce n'est pas que nos
« prouver le contraire ».
frères du continent veulent nous Pour revenir à la Première
nuire, mais faute de rapports Internationale, il faut ajouter
systématiques entre les classes
que, en Angleterre par exemple,
industrielles de tous les pays ». les historiens ne perçoivent quel-
(J. Verdes, Les délégués français ques manifestations passagères
aux conférences et congrès de d'internationalisme qu'à l'occa-
l’A.I.T. Cahiers de l'I.S.E.A., déjà sion d'événements localisés et de
cités, p. 86). Il faut noter à titre problèmes concrets, comme l'unité
de confirmation, que, sauf, en italienne, l'unité de la Pologne.
Allemagne, le slogan « Prolétai- Et on trouve là davantage une
res de tous les pays unissez- sentimentalité attendrie envers
vous >> n'est jamais utilisé et
ceux qui luttent pour leur liberté
qu'on lui préfère celui de
- que la conscience d'appartenir à
l'adresse inaugurale : « L'éman-
une classe identique par delà les
cipation des travailleurs
frontières. Certes, la théorie de
l'œuvre des travailleurs
l'universalité du proletariat
mêmes ».
été, depuis longtemps déjà, for-
Ce choix a également une autre mulée par Marx mais elle n'est
signification il exprime la vécue qu'au niveau de l'Appareil
méfiance, parfois formulée en
(Conseil général) composé prin-
termes violents, dont nos histo- cipalement d'émigrés ; on n'en
riens ont relevé des traces dans trouve aucune trace sérieuse dans
de nombreux textes, envers les les publications des ouvriers.
émigrés autres dirigeants D'une façon plus générale, ces
* apatrides » du Conseil général.
historiens affirment
que
l'in-
Enfin, les textes publiés par les fluence de Marx fut nulle
ouvriers montrent souvent
Angleterre, extrêmement contes-
étrange chauvinisme ; pendant la tée, pour ne pas dire plus, en
Commune de Paris, tout ouvrier Allemagne ; qu'en Espagne, si
sera
eux-
a
:
en
un
90
une
on
au
que cette
ne
une influence pouvait être déce-
lée, ce serait celle de Bakounine
et que seul, en Suisse, un petit
groupe se disait marxiste, mais
peut-être abusivement ; in-
fluence également nulle en France
où les ouvriers se montrent par-
ticulièrement méfiants envers les
« émigrés ». Ce qu'on observe en
France, selon J. Rougerie, c'est
une pratique de la classe ouvrière
(pratique de la grève, activité
syndicale) qui a pour premier
souci d'éliminer toute théorie
a priori, et, notamment la plus
connue alors, celle de Proudhon.
On remarque aussi
pratique dépasse, à chaque ins-
tant, le niveau de la lutte éco-
nomique quotidienne pour attein-
dre le niveau politique, pour
imposer, par exemple, des candi-
datures ouvrières, ce qui contre-
dit la théorie attribuée (2) à
Lénine selon laquelle les ouvriers
laissés à eux-mêmes ne pou-
vaient s'élever au-dessus du
trade-unionisme. Enfin, la Com-
mune de Paris
ne
peut être
considérée comme
un succès ni
même comme
un produit de la
Première Internationale qui, selon
Engels, n'a
pas
« remué
doigt pour la faire » (Lettre à
Sorge, 12 sept. 1874). Ce serait
plutôt, toujours selon J. Rouge-
rie, une déviation, un retour au
jacobinisme des sans-culottes, un
accident qui brise le lent et
sérieux travail de l'organisation.
Pour s'en convaincre, il n'est que
de lire, encore une fois, la
seconde adresse : « Toute tenta-
tive de renverser le nouveau gou-
vernement,
l'ennemi
frappe presque aux portes de
en
Paris, serait folie désespé-
rée... Que calmement et résolu-
ment, ils profitent de la liberté
républicaine pour procéder mé-
thodiquement à
leur propre
organisation de classe » (Loc. cit.,
p. 289). Que Marx, devant le fait
accompli, ait célébré, comme
sait, l'insurrection, montre bien
qu'au lieu de chercher tant à
savoir quelle a
été l'influence
de Marx sur les adhérents de
l’A.I.T. on ferait tout aussi bien
de chercher l'influence inverse et
de passer de l'hypothèse du so-
cialisme venu «d'en haut »
socialisme produit par le prolé-
tariat lui-même. La théorie
« marxienne » de l'auto-émanci-
pation du prolétariat peut
être interprétée seulement comme
une contestation des excès de la
bureaucratie « dirigeante » et du
parasitisme des
« permanents »,
elle met question le rôle
même de Marx. Ce dernier qui
n'est pas et ne s'est jamais pré-
senté comme le fondateur de
l’Internationale a, en effet, dit :
l'Internationale « est un lien, ce
n'est pas un pouvoir » (réponse
correspondant du journal
américain The World) et écrit,
dans le rapport qu'il rédigea au
nom du Conseil général pour le
congrès de Bruxelles (1868)
L'Internationale n'est fille ni
d'une secte, ni d'une théorie. Elle
est le produit spontané du mou-
vement prolétaire »... (Textes ci-
tés par M. Rubel, Cahiers de
l'I.S.E.A., n° 152, S. 8, p. 4 et 5).
Que plus tard, les fonctionnaires
appointés de la Troisième Inter-
nationale, pensent, parlent et
agissent autrement, c'est
doute leur droit; mais on devrait,
tout de même, commencer à sa-
voir que leur pieuse, incessante
et vague référence à la théorie et
à la pratique de Marx et de
l'A.I.T. a été et reste incorrecte.
au
un
:
quand
sans
(2) En effet, cette théorie sem-
ble avoir d'abord été formulée
par Kautsky dans sa critique d'un
ncuveau programme du Parti
social-démocrate autrichien (Neue
Zeit, 1901-2, XX), citée par Lénine
dans Que Faire.
Yvon BOURDET.
91
DU BON USAGE DE L'ETHNOLOGIE,
DES SOUS-DEVELOPPES ET DES COURSES A PIED
Une idée d'un ethnologue brésilien, Willi Aureli, va sans nul
doute contribuer puissamment à la solution des problèmes écono-
miques et humains que posent au Brésil l'immensité de son terri-
toire et les inégalités de développements entre les régions. Sur son
conseil un journal sportif de Sao Paulo a organisé cette année la
participation de trois indiens de la jungle à la course de la Saint-
Sylvestre, course de fond qui se déroule dans la nuit du 31 décembre
au 1er janvier à travers les rues de la ville. Ces indiens qui appar-
tiennent à la tribu Krao sont habitués à parcourir à la course des
dizaines de kilomètres sans jamais s'essouffler. Mais leur entrai-
nement « naturel » s'est révélé insuffisant. Il a fallu les soumettre
à peine, arrivés à Sao Paulo à un entraînement psychologique intense
pour qu'ils soient capables de prendre part à une compétition,
d'abord et aussi pour qu'ils fassent usage de leur talent non plus
dans la jungle mais au milieu des gratte-ciel et des voitures de la
capitale économique du Brésil.
De toutes façons, ces sauvages ont été bons à quelque chose,
pour une fois. L'opération publicitaire à laquelle ils ont participé était
assurée du succès : à l'arrivée des trois indiens, des touristes
américains ont déjà manqué leur avion pour pouvoir les photogra-
phier. Mais ce n'est pas tout. Comme on faisait miroiter à leurs
yeux les trophées de la course, les indiens ont montré peu d'enthou-
siasme. « Nous préférerions, ont-ils déclaré, rapporter de Sao Paulo
des plants d'arbres fruitiers et des chèvres, pour enrichir un peu
notre alimentation qui se compose uniquement de poissons de la
rivière Tocantin ». Nous proposons ces indiens pour un prix de la
F. A. O.
92
sto
Cercle de conférences
de SOCIALISME OU BARBARIE
Vendredi 26 mars 1965 :
Le mouvement révolutionnaire
face aux pays sous-développés
Mutualité (Métro Maubert-Mutualité), à 20 h. 45
La salle sera indiquée au tableau d'affichage.
Tous les lecteurs et amis de Socialisme ou Barbarie sont
cordialement invités à participer. Si les participants en
expriment le désir, des réunions ultérieures pourront être
organisées pour approfondir les sujets discutés.
93