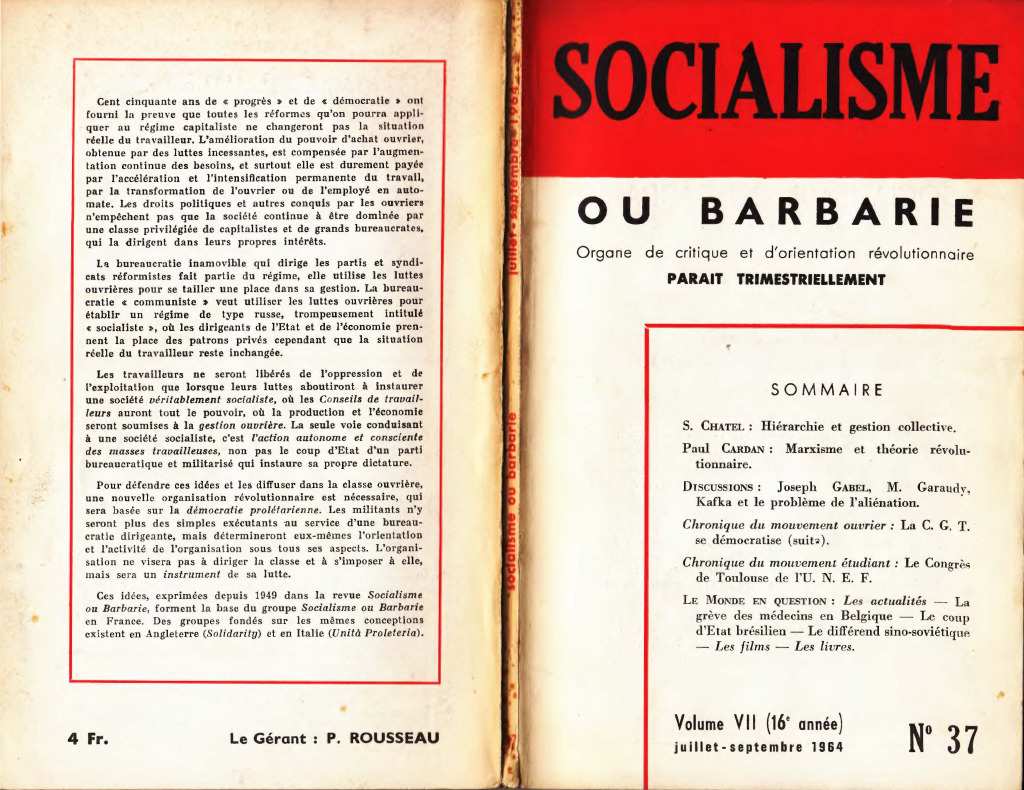CHATEL, S.: Hiérarchie et gestion collective 37:1-17
CARDAN, Paul: Marxisme et théorie révolutionnaire (II) 37:18-53 = FR1964E*
DISCUSSIONS:
GABEL, Joseph: M. Garaudy, Kafka et le problème de l'aliénation (à propos de l'essai: D'un réalisme sans rivages) 37:54-64
CHRONIQUE DU MOUVEMENT OUVRIER:
BARATIER, H.: La C.G.T. se démocratise... (suite) 37:65-68
CHRONIQUE DU MOUVEMENT ÉTUDIANT:
GUIMET, Jacques: Le 53e Congrès de l'U.N.E.F. 37:69-71
G. L.: Une autre point de vue sur l'U.N.E.F. 37:72
LE MONDE EN QUESTION:
GARROS, A.: Les Actualités 37:73-74
Les jeunes et l'anniversaire de la victoire alliée (une enquête de France-Soir) 37:75
Hauts-lieux du néo-capitalisme (France-Soir et Le Monde) 37:75
TIKAL, Paul: La grève des médecins en Belgique 37:75-78
Libération des contraceptifs (nouvelle venant de Tunisie) 37:79
SAREL, Benno: Le coup d'État brésilien 37:79-81
Un échantillon de la nouvelle humanité forgée en U.R.S.S. (extrait de la Komsomolskaia Pravda avec commentaire) 37:81
Camarade Mao, tu ferais bien de porter un casque... (citation de Khrouchtchev) 37:82
Les nouvelles formes "socialistes" de consommation (avec citations de Moscou-soir) 37:82
"Le XVIIe Congrès du P.C.F. est celui du rajeunissement" 37:82
Un chef perdu pour tout le monde (Le Monde) 37:82
CANJUERS, P.: Le différend sino-soviétique 37:82-85
LES FILMS:
SAREL, Benno: Le journal d'une femme de chambre (Bunuel) 37:86
MAI, Louise: Le silence (Bergman) 37:87-88
LES LIVRES:
BOURDET, Yvon: Annie Kriegel, "L'oeil de Moscou" à Paris ou les archives de Jules-Humbert Droz, ancien secrétaire de l'Internationale communiste37:89-92
Réunion publique à Clichy 37:93
ANNONCE: Andy Anderson: Hungary 56 37:94
À nos abonnés et à nos lecteurs! 37:94
Librairies qui vendent Socialisme ou Barbarie 37:94
BULLETIN D'ABONNEMENT 37:95
[DÉCLARATION DES PRINCIPES]
Socialisme ou Barbarie - NO. 37 (JUILLET-SEPTEMBRE 1964)
Table des matières
SOCIALISME OU BARBARIE
Paraît tous les trois mois
16, rue Henri-Bocquillon PARIS-15e
Règlements au C.C.P. Paris 11 987-19
Comité de Rédaction :
P. CARDAN
A. GARROS
D. MOTHE
Gérant : P. ROUSSEAU
4 F.
Le numéro
Abonnement un an (4 numéros)
Abonnement de soutien
Abonnement étranger
10 F.
20 F.
15 F.
Volumes déjà parus (I, nº 1-6, 608 pages ; II, n° 7-12,
464 pages ; III, nºs 13-18, 472 pages : 3 F. le volume ;
IV, nºs 19-24, 1112 pages ; V. nºs 25-30, 760 pages : 6 F.
le volume ; VI, nºs 31-36, 662 p., 9 F.). La collection complète
des nºs 1 à 36, 4 078 pages : 36 F. Numéros séparés : de 1 à
18, 0,75 F. le numéro : de 19 à 30, 1,50 F. le numéro, de 31 à
36, 2 F. le numéro.
L'insurrection hongroise (Déc. 56), brochure
Comment lutter ? (Déc. 57), brochure
Les grèves belges (Avril 1961), brochure
1,00 F.
0,50 F.
1,00 F.
SOCIALISME OU BARBARIE
Hiérarchie et gestion collective
1. La fonction disciplinaire.
2. La hiérarchisation des compétences.
3. L'organisation du travail.
4. Problèmes et perspectives d'une gestion collec-
tive.
;
Toute collectivité qui se constitue pour atteindre des
objectifs précis, et qui reconnaît la validité de certains cri-
tères d'efficacité et de rentabilité, comporte une structure
hiérarchique, vit et se développe en confiant à certains
hommes le soin d'élaborer les décisions fondamentales et
d'en contrôler l'exécution. Ceci est un fait : quel qu'ait été
le passé et quel que puisse être l'avenir, le présent est celui-là.
En ce qui concerne les organismes à fonction économi-
que, ceux qui produisent et commercialisent des biens ou des
services, l'existence de structures hiérarchiques est une évi-
dence. Mais les mêmes structures et le même type de fonc-
tionnement se rencontrent aussi bien en dehors de la vie
économique : la recherche scientifique n'est pas moins hiérar-
chisée, aujourd'hui, que ne l'est la production industrielle
ni dans la formation, ni dans la recreation, ni dans les soins
donnés aux corps ou aux âmes dans aucun de ces domaines
on ne rencontre des rapports qui romperaient avec le modèle
hiérarchique et permettraient aux hommes d'organiser autre-
ment leurs activités : le professeur a un supérieur, l'écri-
vain qui travaille à la télévision a un chef, l'interne est placé
sous le commandement d'un docteur situé au-dessus de lui
dans l'échelle hiérarchique ; quant au prêtre il appartient
à la plus vieille, à la plus solide, hiérarchie de l'histoire.
Le modèle hiérarchique semble posséder un tel pouvoir
d'attraction, que même les organisations qui se constituent
en dehors du travail y succombent. Les clubs de vacances, les
associations culturelles et sportives, les organismes d'assis-
met de bienfaisance, à peine se sont-ils formés qu'aussitôt
apparaissent des secrétaires et des présidents, des responsables
et des délégués à ceci et à celà - bref des hommes qui, grâce
i la fois aux statuts et à l'apathie des autres membres, acquiè-
.
1
rent de gré ou de force le monopole des décisions fonda-
mentales. Mais l'exemple le plus frappant de cette extension
à l'ensemble des activités sociales d'un type' de rapports
réservé, au départ, à un domaine particulier, est celui que
fournissent les organisations politiques et syndicales issues du
mouvement ouvrier. Car ici il s'agit de plus que d'une simple
extension : il s'est passé que le modèle hiérarchique a recon-
quis un domaine qui lui avait été arraché et que les rapports
caractéristiques de la société capitaliste, ceux en lesquels se
résumait son essence même, se sont imposés aux hommes qui
luttaient contre cette société et se sont introduits à l'intérieur
de leurs syndicats et de leurs partis. Si bien qu'en fin de
compte les organisations ouvrières sont devenues semblables
quant à leur structure aux organisations contre lesquelles
elles luttent ou disent lutter.
Il serait parfaitement inutile de continuer cette énumé-
ration des organismes à structure hiérarchique, car il devient
évident, dès que l'on regarde autour de soi, que la hiérarchie
apparaît aujourd'hui partout où se développe une activité à
la fois orientée, contrôlée du point de vue de son coût et de ses
résultats et s'efforçant de durer et de croître. Où, en effet,
voit-on apparaître des rapports qui ne doivent rien au modèle
hiérarchique ? D'une part, bien entendu, dans la vie privée :
mais ce qui caractérise la vie privée c'est que les rapports qui
s'y nouent, le rapport de l'homme et de la femme, du parent
et de l'enfant, – sont simples et gratuits, en ce sens qu'ils se
constituent sans but, mais, pour ainsi dire, pré-existent à tout
but et à toute fin. Le second domaine où apparaissent des
rapports non-hiérarchiques est celui des groupes informels
qui se constituent en marge de l'organisation officielle des
collectivités : là les hommes paraissent libres de nouer les
rapports qui leur plaisent ou leur conviennent et n'en sont
pas les esclaves, puisqu'ils peuvent les dénouer à tout moment ;
ils n'ont pas d'autre rang ni d'autre statut que celui la
collectivité leur attribue ; ils n'ont de pouvoir que par délé-
gation spontanée et révocable.
Mais évoquer les groupes informels c'est du même coup
souligner à quel point les notions de hiérarchie et d'effica-
cité sont liées dans la société contemporaine. Car de deux
chose l’une : ou les groupes informels se constituent sans
but, sans finalité, sur la simple base, par exemple, de l'affi-
nité ou de l'amitié mais dans ce cas ils se forment en
marge des activités productives, qui sont par essence orientées
vers la réalisation d'un objectif définissable, et appartiennent
eux aussi au domaine de la gratuité ; ou ils ont un but et sont
réellement la réponse d'un certain nombre d'hommes qui
veulent faire quelque chose de précis et qui, refusant le
modèle hiérarchique, adoptent le mode d'organisation carac-
téristique des groupes informels. Ce dernier cas est le seul
que
2
qui puisse nous intéresser en ce moment, le seul qui, sur son
propre terrain - le terrain des activités productives, orien-
tées, non-gratuites porte la contradiction à la hiérarchie
entendue en tant que mode d'organisation des rapports
humains, et propose une solution différente. Mais ce qui frappe
dans cette réponse (j'admets ici qu'on ait bien voulu I'entendre
et en comprendre toute l'importance, comme cette revue l'a
toujours fait) c'est son incapacité à se généraliser et à se
porter, ne serait-ce que momentanément, au niveau des pro-
blèmes que les organismes à structure hiérarchique ont à
résoudre quotidiennement. En effet le type de groupe infor-
mel le plus important, à la fois par le rôle qu'il joue dans
la société moderne et par la preuve qu'il apporte d'une volonté
d'autonomie. — est inconstestablement celui qui se constitue
parmi les ouvriers au sein de la production, comme moyen
et effet de la lutte contre les cadences et les autres formes
de contrôle du travail : or si ces groupes informels ont effec-
tivement à leur actif d'innombrables grèves (les wild-cat
strikes des ouvriers américains et anglais ; l'existence de grèves
sauvages dans les pays de l'Est est également un fait établi),
il est néanmoins vrai que ces mouvements, aussi importants
qu'il aient pu être, n'ont jamais réussi à se structurer et n'ont
laissé derrière eux ni organisations permanentes ni objectifs
dụrables. D'autre part il est évident que les problèmes d'orga-
nisation rencontrés par des hommes qui, dans un atelier, se
défendent contre les conditions de travail imposés, n'ont rien
de commun avec ceux que ces mêmes hommes rencontre.
raient s'ils avaient à gérer l'usine dont cet atelier fait partie,
ou l'économie à laquelle cette usine appartient.
Il ne s'agit pas de nier la valeur des grèves sauvages et
du type d'organisation qu'on y découvre. Le recours par les
ouvriers des pays les plus avancés à des formes de lutte et
d'organisation qui ne doivent rien au modèle hiérarchique
et qui témoignent au contraire de la volonté de ces hommes
de prendre en main leurs propres affaires au lieu de laisser
ce soin aux diverses hiérarchies qui prétendent le faire,
l'Etat, l'Entreprise, le Syndicat, le Parti -- l'importance de
ce phénomène ne peut être surestimée. Mais on ne peut en
ignorer les limites, car elles sont tout aussi importantes : les
luttes informelles se constituent à l'intérieur de structures
formelles, elles ne peuvent aboutir à leur suppression et l'his-
toire de ces quinze dernières années montre qu'elles ne le
tentent pas.
Là où il y a un but, là où les hommes cessent de s'accor-
der un comportement gratuit, là où leurs actions se dévelop-
pent à travers le temps et l'espace et font appel à un savoir
organisé - là apparaît une hiérarchie, et la seule manifesta-
tion importante d'autonomie que l'on puisse rencontrer
aujourd'hui, celle des luttes informelles dans l'industrie, ne
3
tout
fait que confirmer l'universalité de la solution hiérarchique
dans la société moderne. Tout se passe comme si les problèmes
rencontrés par les collectivités, la mise en oeuvre du savoir,
l'exploitation des ressources, l'organisation des rapports entre
les milliers, les dizaines de milliers et parfois les centaines
de milliers de personnes qui composent les collectivités d'au-
jourd'hui, la définition des liaisons avec l'extérieur
se passe comme si ces problèmes étaient si complexes, si
décourageants et si angoissants dans leur foisonnement in-
fini, que les hommes avaient renoncé à les résoudre autre-
ment qu'en s'en déchargeant sur une minorité de spécialistes :
les dirigeants, les cadres, les chefs, ceux qui ont à la fois les
connaissances et les
moyens, ceux dont le savoir permet
d'embrasser l'ensemble des problèmes et qui ont le pouvoir
de mettre en cuvre les solutions les meilleures.
De toute évidence la hiérarchie n'est pas la réponse libre
et spontanée de l'humanité à ses propres problèmes. Mais ce
qui est remarquable, c'est qu'il n'est pas possible de voir
dans la hiérarchie un mode de rapports qui s'imposerait mal-
gré eux aux travailleurs. Il n'y a pas d'un côté une structure
hiérarchique et de l'autre une majorité de travailleurs en
lutte contre cette structure. Car au fur et à mesure que les
autres modèles reculent devant le modèle hiérarchique, jus-
qu'au point où il semble qu'aucune activité ne puisse être
productive à moins d'être gouvernée par une hiérarchie –
au fur et à mesure que se produit cette extension dans l'espace,
le modèle agit sur l'esprit, rend l'intérieur cohérent par rap-
port à l'extérieur, adapte le psychisme des hommes aux condi-
tions de vie dans les systèmes hiérarchisés.
L'expérience quotidienne de chacun confirme cette modi-
fication du psychisme sous l'effet d'un modèle hiérarchique
envahissant, omniprésent, totalitaire. Il est frappant, tout
d'abord, de constater que les gens admettent de plus en plus
largement l'existence d'une hiérarchie. Ils n'en sont pas néces-
sairement satisfaits, et ils ne sont pas, non plus, nécessaire-
ment persuadés de l'efficacité de la hiérarchie sous le com-
mandement de laquelle il travaillent : mais ils ne voient
d'autre solution aux problèmes qui se posent dans le tra-
vail que celui qui consiste à confier la responsabilité et le
pouvoir à une catégorie d'hommes plus compétents et mieux
payés. Parmi les employés cette opinion est si répandue qu'on
est justifié d'affirmer qu'elle est la seule existant à ce propos :
pour ma part, il ne m'est jamais arrivé d'en entendre d'autre.
Mais il est important de noter qu'une opinion analogue émane
de plus en plus fréquemment des ouvriers eux-mêmes, chez
lesquels elle tend à remplacer l'attitude égalitaire et anti-
hiérarchique d'autrefois.
Ce phénomène, qui représente pour les ouvriers un chan-
gement profond et pour les employés de bureau la consoli-
4
au lieu
dation d'une attitude qui existait déjà, n'est pas superficiel et
ne peut-être mis, simplement, au compte de la contamination
par l'idéologie dominante : car il est lié aux modifications
non seulement des conditions de travail, mais du travail lui-
même. D'une part, en effet, la promotion a cessé d'être cette
mystification par laquelle, au prix de l'élévation de quelques
unn, on tentait autrefois de maintenir la majorité dans une
vie d'espoir perpétuel, de crainte et de soumission :
de diminuer, comme on aurait pu s'y attendre, la catégorie
de ceux qui exercent un commandement devient chaque jour
plus importante. Au fur et à mesure que les collectivités
deviennent plus complexes, le nombre d'hommes chargés de
dominer cette complexité croît ; mais plus il y a d'hommes
occupés à diriger, plus intensément se pose le problème de
la direction des dirigeants, de la hiérarchisation de la hiérar-
chie, du commandement des chefs : ainsi la hiérarchie se
développe et prolifère non seulement à sa base, au contact
avec la production, mais également à l'intérieur d'elle-même
et vers son sommet, car en même temps qu'elle étend son
contrôle elle doit consolider, pas à pas, sa propre unité. C'est
donc tout d'abord parce que la hiérarchie se développe et
s'unifie sans
cesse que la promotion devient une réalité,
offrant la possibilité soit d'accéder à la hiérarchie soit de
s'y élever, et devenant ainsi de plus en plus souvent l'hori-
zon et l'espoir des gens qui travaillent.
Mais il existe encore une autre raison à cette obsession de
promotion qui joue un rôle si important dans la psychologie
de l'homme moderne : c'est que de plus en plus souvent la
promotion s'accompagne d'une augmentation dans l'intérêt
du travail et dans sa valeur intrinsèque. Dans le passé la pro-
motion signifiait essentiellement l'accession à un poste dis-
ciplinaire, et il était normal, pour la grande majorité des
exécutants, de l'assimiler à un acte de trahison. Mais il est
clair qu'aujourd'hui la hiérarchie a moins de liens avec la
discipline qu'avec le savoir : y pénétrer, ou s'élever en son
sein, c'est se développer en tant qu'être humain, c'est penser
d'avantage, être plus responsable, plus autonome. Puisque
cela est le cas, il est inévitable que se répande une attitude
d'acceptation, ou tout au moins de passivité et de conformisme,
envers la hiérarchie en tant que mode d'organisation des
hommes.
Mais, cette adhésion a une signification ambiguë, comme
toute opinion exprimée par une catégorie sociale : dire que
l'on est favorable à quelque chose ne signifie pas que l'on
mourrait pour ce quelque chose, afficher une opinion ne veut
pas dire que l'esprit en soit infecté : pour en juger il faut
d'autres éléments. Or pour juger de la profondeur avec laquelle
la notion de hiérarchie agit sur l'esprit des hommes qui tra-
vaillent aujourd'hui, l'on dispose d'un symptôme infiniment
5
plus important et plus grave : l'irresponsabilité. Car l'irres-
ponsabilité n'est pas une simple opinion, et elle est plus
qu'une attitude : elle se confond avec la structure même de la
personnalité, elle introduit, à l'intérieur de l'homme, jusque
dans son domaine le plus privé, la privation de responsabi-
lité qui est le fondement même de la hiérarchie.
Un homme qui aurait contemplé le monde au début du
siècle, ou même entre les deux guerres mondiales, aurait vu
un univers dominé par les luttes et les souffrances, mais où
la responsabilité, en tant qu'attitude vis-à-vis de soi-même et
des collectivités auxquelles l'on appartenait, était un trait
dominant aussi bien des individus que des mouvements
sociaux. Mais aujourd'hui, s'il songe à la société dans laquelle
il vit, aux collectivités qu'il connaît, à lui-même, à son propre
comportement, à la manière dont il affronte ses problèmes
personnels nul être ne peut s'empêcher de remarquer en
lui et autour de lui, dans sa famille et dans son bureau ou
atelier, une énorme et stupéfiante irresponsabilité. Ce n'est
pas seulement la société dans laquelle ont vit qui paraît trop
vaste, trop complexe ; ce n'est pas seulement l'usine ou l'admi.
nistration dans laquelle on travaille qui semble lointaine, dif-
férente de soi, abstraite ;' ce n'est pas seulement le travail
qui fatigue et ennuie, tourne en dérision les efforts, décourage
l'initiative. Car maintenant c'est l'existence elle-même qui
semble basculer du côté des choses que l'on ne veut plus ou
que l'on ne peut plus contrôler : les hommes subissent leur
vie privée comme ils subissent leur travail, les problèmes de
leur famille deviennent aussi complexes que ceux de leur
usine, tout leur échappe --- même leurs enfants. Qui aurait
l'audace de demander à un homme de rendre compte de sa
vie ? Il vous reprocherait, si vous vous y risquiez, de tenter
de l'en rendre responsable.
Or, l'irresponsabilité est à la fois la condition et l'effet
de la hiérarchie en tant que système. La condition, puisque
l'essence même du système consiste à priver les hommes de
la responsabilité de leurs actes. Il s'agit, il est vrai, d'une
privation graduelle : elle est absolue, à la base, au niveau du
pur exécutant, puis s'atténue au fur et à mesure que l'on
considère des niveaux hiérarchiques plus élevés, jusqu'au
moment (plus théorique que réel) ou l'on atteint la responsa-
bilité totale. Quel que soit, cependant, le niveau (à l'exception
des derniers degrés, ceux des dirigeants à proprement parler)
un degré d'irresponsabilité persiste, et doit persister, puisque
chacun doit se reconnaître comme incapable, en droit ou
en fait, de résoudre une partie de ses propres problèmes
la solution de ces problèmes relevant du niveau hiérarchique
supérieur. Inversement l'irresponsabilité est un effet du sys-
tème, qui va au-delà de ce qui serait nécessaire à son bon
fonctionnement, s'étend de ce dont on n'est pas responsable à
6
-
ce qui engage la responsabilité de chacun : l'irresponsabilité
est un poison, on ne peut y goûter sans être atteint tout entier.
Dans la perspective d'une extension infinie de la hiérar-
chie et d'une aggravation de son effet sur le psychisme des
hommes — que devient le socialisme, c'est-à-dire la revendi-
cation d'une humanité concrètement responsable d'elle-même ?
Il est évident que les deux perspectives s'excluent. Le socia-
lisme ne peut surgir que de la destruction par les exécutants
eux-mêmes de la distinction entre ceux qui décident et ceux
qui exécutent ; il ne peut se maintenir et durer que si partout,
à tout instant, cette destruction se répète. Entre la gestion par
la collectivité et la gestion par la hiérarchie il n'y a pas de
coexistence possible.
Tant que l'on en reste à ces premières constatations, tant
que l'on considère de l'extérieur la hiérarchie, à la fois en
tant que mode d'organisation et en tant que catégorie sociale,
le dilemme est insurmontable. Car ou la perspective d'une
société socialiste est réelle mais c'est alors la société pré-
sente qui est un fantôme, et ses réalités les plus criantes,
ses structures les plus pesantes et les plus désespérantes
deviennent une illusion. Ou, au contraire, c'est la société
d'aujourd'hui, celle dans laquelle nous vivons, qui est réelle :
mais la perspective du socialisme devient alors un rêve.
Il faut aller plus loin, et regarder le fonctionnement
du système de gestion hiérarchique, les problèmes que ce
système est conçu pour résoudre, la manière dont il le fait et
le prix qu'il y met, les comportements qu'il fait apparaître,
les résistances et les concours qu'il suscite. Car en gérant les
affaires de la collectivité, la hiérarchie rencontre tous les pro-
blèmes de cette collectivité : dans une certaine mesure, elle
en est la conscience. Comment obtenir et maintenir l'adhé-
sion des hommes ? Comment assurer leur application, com-
ment susciter leur initiative et leur participation aux affaires
collectives ? Comment organiser, comment utiliser toutes les
compétences de manière productive, comment, jusqu'à quel
point, exercer un contrôle sur le travail de chacun ? Quel est
le but de la collectivité, que fait-elle, doit-elle continuer, quel
est son avenir ? Que signifie le travail, qu'est-ce que chaque
homme peut en attendre, quelle vie lui propose-t-on ? La
hiérarchie n'a pas d'autre fonction que de trouver des réponses
à ces problèmes. Mais, si c'est bien le cas, il apparaît que
la
gestion hiérarchique et la gestion collective sont deux réponses
à un seul et même problème, celui que posent les collectivités
modernes par leur gigantisme, par leur technicité, pár la
complexité presque terrifiante de leurs liaisons internes, par
l'adhésion qu'elles requièrent de leurs membres. Car qu'est-ce
que le socialisme sinon le fait pour les collectivités de devenir
pleinement responsables, de résoudre elles-mêmes leurs pro-
7
pres problèmes et de permettre ainsi à toute l'humanité et à
chaque homme de redevenir maître de sa vie ? Et quels sont
ces problèmes sinon ceux que la hiérarchie affronte et résoud
à sa manière aujourd'hui ?
Parce qu'il est impossible d'élaborer une conception de
gestion collective sans suivre pas à pas la hiérarchie dans sa
propre gestion, je tenterai tout d'abord, ici, de dégager les
fonctions de la hiérarchie, ce qu'elle fait et comment elle le
fait. Mon expérience en ce domaine est limitée à certains
aspects de l'industrie de construction mécanique, et les géné-
ralisations que je ferai émaneront toutes de cette expérience :
abordées soit avec un souci d'universalité soit avec le désir
d'y retrouver la trace d'expériences différentes, certaines affir-
mations paraîtront fausses, et le seront. Néanmoins l'unité de
la société contemporaine est telle qu'il ne doit pas être impos-
sible d'atteindre à certaines vérités à partir d'une expérience
limitée.
1. LA FONCTION DISCIPLINAIRE
Lorsque, le lundi matin, l'on revoit au bout de la rue la
silhouette des bâtiments dans lesquels l'on vit sa vie de tra-
vailleur, c'est toujours avec le même découragement, le même
ennui anticipé : même les hommes qui aiment leur travail et
qui, à travers ce qu'ils font pour gagner leur vie parviennent
à réaliser des aspirations surgies des recoins les plus secrets de
leur être, même ceux-là ont un mouvement de recul devant
ces lieux sans âme, ces gardiens statufiés, ces couloirs lugu-
bres, ces photographies artistiques accrochées aux murs, qui
paraissent témoigner à la fois de l'anonymat des salles et de
la médiocrité de ceux qui y vivent, ces sourires stupides et
ces gestes prétentieux dans lesquels l'on plonge sitôt franchie
la porte d'entrée, et qui, presqu'en même temps, réapparais-
sent sur votre propre visage et sur vos propres membres.
Les lundis matins sont ceux où chacun redécouvre cette
vérité banale : le travail est une obligation pénible. Mais ce
n'est pas seulement contre cette obligation que l'on éprouve
en soi un mouvement de révolte : le travail vous écoeure, mais
aussi les gens avec lesquels vous devez travailler, l'endroit, la
manière et les conditions. En franchissant le portail vous
vous jetez dans un monde que vous n'avez pas fait, parmi
des hommes auxquels vous lient les liens les plus étroits et
pour lesquels pourtant vous n'éprouvez aucun sentiment pro-
fond, ni affection, ni admiration, ni haine. Mais en allant au
travail, ce n'est pas seulement votre monde privé que vous
perdez : vous perdez vous-même. Celui qui, chez lui,
est un grand homme, devient maintenant le dernier des subor-
donnés ; la femme qui nourrit de son affection l'enfant ou le
mari ou la mère qui partage sa vie, laisse au vestiaire, avec
8
son tricot, non pouvoir d'aimer et de rendre heureux ; des
hommes qui, pendant le week-end, pratiquent des sports dan-
gereux, nécessitant des décisions rapides et leur exécution
instantanée, redeviennent, une fois assis derrière leur bureau,
des êtres d'une exaspérante lenteur.
Travailler, c'est se transformer, devenir un personnage,
conuer d'être le soi-même de l'intimité ; c'est tomber d'un
monde privé dont on est (ou plutôt : dont on croit être) le
inuître, dans un univers qui vous domine et vous reforme à
Ha façon et selon sa convenance ; c'est n'être plus qu'une
fonction imposée, une somme d'actes entièrement connus, une
case sur un organigramme ; c'est n'être plus que ce que l'on fait.
Et si, au retour des week-ends ou, pire encore, des vacances,
cela devient si évident et même si douloureux pour certains
(à tel point que cette souffrance intérieure en arrive à s'exté-
rioriser par des symptômes reconnaissables : blancheur du
visage, enrouement de la voix, somnolence, etc.), c'est parce
que ces moments-là, mieux que d'autres, font ressortir le
contraste entre ce que l'on est et ce que l'on doit être, entre
la vie privée et la vie publique, entre un monde où la manière
de faire a autant d'importance que le faire, où le sentiment
pèse aussi lourd que l'acte et le rêve que la réalité, et un
autre monde, celui du travail, qui ne connaît que les choses
et les actes capables de produire ces choses.
A ces moments-là on éprouve une révolte impuissante et
infantile contre le sort qui vous arrache à vous-même et vous
jette dans un monde étranger, et cette révolte persiste
longtemps après que ce soit estompé le choc du retour, ou
ce choc, bien plus grave, que subissent ceux qui travaillent
pour la première fois et qui découvrent à quel point il est
désespérant de ne jamais accomplir un seul acte réellement
important et de devoir retrécir l'immense domaine de son
âme aux minuscules frontières d'une fonction et d'un poste.
Je crois même que la persistance, sous une forme intériorisée,
de cette révolte de chacun contre son propre travail, est l'une
des caractéristiques essentielles du travailleur moderne
particulièrement de l'employé de bureau. Il suffit d'analyser
son propre comportement au travail pour constater en soi
la présence de cette révolte souterraine. Comme le docteur
Folamour, dans le film de Stanley Kubrick, possède un bras
qui contrecarre systématiquement ses efforts et, à l'occasion,
tente d'étrangler le savant auquel il appartient, tout employé
porte en lui-même un saboteur acharné à détruire ce qu'il
construit, à ralentir ce qu'il veut presser, à perdre ce qu'il
voudrait retrouver. Selon les circonstances et les hommes, le
saboteur agit à découvert ou dans la clandestinité la plus
totale : tantôt il laisse s'entasser les papiers au fur et à mesure
qu'ils arrivent, tantôt les classe si ingénieusement qu'ils sont
à jamais introuvables ; tantôt il oublie les tâches urgentes qui
t
9
l'indisposent et tantôt il les accumule en si grand nombre
qu'on passerait ses journées à seulement les compter. Le sabo-
teur agit au bon moment, le plus tard possible : il intervient
toujours après l'effort, après qu'on ait payé le prix. Par
exemple : le brouillon d'une note est achevé, mais quelque
chose retient l'auteur de le faire taper : trois mois plus
tard un autre brouillon, presque similaire, sera rédigé par le
même homme — qui rédigera ainsi, au fil des mois, cinq
brouillons pour cette même note, presqu'indifférenciables les
uns des autres et dont n'importe lequel aurait pu être frappé
et mis en circulation. Trois hommes, formant un comité
chargé de la solution d'un problème spécifique, discutent
longuement de la répartition de leurs tâches : le lendemain
matin les décisions de la veille ont été oubliées. Un dessina-
teur, voulant provoquer la fabrication d'un nombre donné de
pièces, médite longuement et finit par exprimer sous la forme
d'une fraction la quantité à fabriquer, ajoutant ainsi au temps
qu'il a lui-même perdu celui de tous ceux qui, recevant sa
spécification, s'efforcent de recomposer le processus mental
qui a abouti à cette fraction. Un homme convoque si souvent
ses collaborateurs à des réunions où l'on devra faire le point
de la situation et prendre des décisions, qu'il n'y a plus ni
situation ni décisions mais seulement une réunion ininter-
rompue, coupée de courtes pauses. Un organisateur insiste
sur la nécessité, avant de commencer une étude, de définir
les besoins : mais la définition des besoins, la procédure et la
forme de cette définition, tous ces préalables ne semblent
foisonner et s'étirer à travers le temps que pour ensevelir
l'étude elle-même.
Le travail est une combinaison d'actes positifs cohé-
rents par rapport au résultat recherché — et d'actes négatifs
qui n'ont d'autre fonction que de nuire aux premiers, les ren-
dre improductifs et inutiles. Les exemples de cet anéantisse-
ment permanent et inconscient de ses propres peuvres sont
innombrables : chaque homme qui travaille pourrait en citer
assez pour remplir, à lui seul, un livre entier. Je sais bien que
l'explication de ce phénomène ne peut être simple pas
plus qu'il ne peut être simple d'expliquer pourquoi un être
humain se détruit, jusqu'au suicide ou jusqu'à la folie. Mais
pour le moment il suffit de remarquer que cette autodestruc-
tion existe et qu'elle témoigne de l'ambiguïté de la signification
du travail. Les gens qui travaillent trouvent une valeur dans
ce qu'ils font et pourtant ils se sentent dominés et opprimés
par leur travail. Dans les bureaux, ceci est plus évident que
partout ailleurs. L'employé est entièrement livré à son travail :
il n'existe pour lui ni solidarité, ni lutte, et, au bureau,
l'amitié ou la camaraderie ne poussent que sur le sol du
bavardage ; si les journées de l'employé doivent avoir un sens,
ce sens ne peut venir que du travail. Ainsi chacun croit ou
10
se force à croire que sa fonction est utile, que les gestes qu'il
accomplit sont nécessaires, qu'il est lui-même indispensable.
La passion de trouver une valeur dans son travail est telle
que l'employé la trouve autant dans la forme que dans le
fond, autant dans la manière de faire les choses que dans la
fonction elle-même. Et comme cette fonction est généralement
enfouie sous la croûte des routines et des manières de faire
qui se sont prises elles-mêmes comme but, ce sont en fin de
compte ces routines et ces manières de faire qu'on adore,
c'est en elles qu'on voit le sens et la valeur du travail. Mais
d'un autre côté les employés se sentent perdus dans un
univers trop grand, trop complexe, un univers où les questions
renvoient aux questions et qu'il semble impossible d'embrasser
d'un seul regard : l'homme qui travaille de ses mains trouve
le sens de ce qu'il fait au bout de ses gestes mais le travail
de l'employé n'a de sens que relié à tout le reste, et la rivière
de papier qui passe à travers son bureau ne trouve son bul
que bien plus loin, au-delà de son regard. Chacun, ainsi, se
sent sous la dépendance de l'ensemble : ce qu'il croyait lui
appartenir, les gestes et les routines de son travail, sa fonction
et sa justification - tout cela lui échappe et au lieu de surgir
de lui, s'impose à lui et le domine.
Le travail est à la fois ce qui permet aux hommes de
vivre et ce qui les crucifie : c'est parce qu'il a, dans la société
contemporaine, cette signification contradictoire qu'il s'accom-
pagne nécessairement de contrainte. D'abord, il est vrai, parce
que personne ne travaille pour son plaisir
sens étroit
du terme. Mais surtout et bien plus profondément parce qu'il
existe ce conflit au sein du travail, qui ne peut être contenu
à l'intérieur de certaines limites qu'au moyen de la contrainte.
Il n'y a pas de travail possible si les tendances à l'auto-
destruction, à l'annulation des efforts, à l'oubli, au gaspil-
lage de temps et d'énergie, ne sont pas tenues en échec, ou
tout au moins empêchées de produire leur plein effet.
La hiérarchie joue un rôle capital dans l'exercice de cette
contrainte ; elle a une fonction disciplinaire ; elle doit main-
tenir la collectivité au travail et réprimer les actes qui mettent
en question la finalité et la structure de la collectivité. Mais
pour comprendre de quelle manière se pose le problème de
la contrainte dans le travail moderne, il est indispensable de
regarder de plus près la fonction disciplinaire de la hiérar-
chie, et, pour commencer, voir en quoi elle diffère de la
fonction traditionnelle de surveillance et de répression.
Il est clair, en effet, que la discipline qui règne sur les
administrations et même sur certains ateliers d'aujourd'hui
ressemble peu à celle que l'on trouvait dans l'usine d'autrefois.
L'objectif, tout d'abord, diffère. Dans le passé - et encore
aujourd'hui dans certains lieux -- il s'agissait de contraindre
les êtres à se comporter en automates. La misère se chargeait
au
11
de conduire les hommes jusqu'à la porte des usines : les
gardiens, les surveillants et les contremaîtres prenaient alors
le relai et veillaient à ce qu'aucun homme, sitôt franchie la
porte, ne puisse être autre chose que ce qu'il fallait qu'il soit
l'appendice ou le rouage d'une machine. Se comporter en
homme, se redresser, regarder autour de soi, s'intéresser aux
choses, parler avec ses voisins, respirer librement — voilà ce
qu'il fallait réprimer. La discipline était la conformité de
chaque homme à la machine qu'il servait, et être un homme
était commettre un acte d'indiscipline, et même de révolte.
que faire
Mais aujourd'hui, anéantir l'humanité des hommes ne peut
être le but d'aucune structure : impossible à imposer aux
travailleurs manuels, un tel anéantissement deviendrait une
absurdité si l'on tentait d'y soumettre les travailleurs intel-
lectuels, les techniciens, les dessinateurs, les calculateurs, les
ingénieurs. Il n'était pas absurde de viser à la suppression,
dans le travailleur manuel, de tout ce qui le rendait différent
de la machine qu'il servait, car la production n'avait
de l'humanité des exécutants, de leur pensée et de leur initia-
tive. Mais lorsqu'il s'agit non plus des exécutants mais de ceux
qui spécifient le travail à exécuter, il ne peut être question
d'une pareille suppression. L'exécutant n'apporte rien de nou-
veau : il permet à un objet d'exister, mais cet objet est déjà
entièrement défini : sa fonction, sa morphologie, sa matière,
les opérations nécessaires à son obtention, tout cela pré-existe
au geste de l'exécutant et le détermine. Mais il suffit de penser
à l'un de ceux qui préparent ce geste, par exemple l'agent de
méthodes chargé de définir les opérations de fabrication, pour
comprendre que la préparation ne peut se ramener simple-
ment à un travail d'exécution accompli dans d'autres condi-
tions. Aucun préparateur ne prépare le travail du prépara-
teur : est-ce à dire que chaque préparateur fait à sa guise,
que chaque dessinateur dessine ce qu'il lui plaît et que parmi
tous les calculs qui lui sont demandés le calculateur ne s'oc-
cupe que de ceux qui lui paraissent dignes de son attention ?
Non, évidemment. Chacun de ces hommes reçoit des spécifi-
cations qui définissent l'objet de son travail : le dessinateur
travaillera à partir de certaines contraintes fonctionnelles
qu'il n'est pas libre de modifier ; l'agent de méthodes établit
la gamme de fabrication d'une pièce dont la morphologie est
déjà définie par un plan. D'autre part, ce que chacune de ces
fonctions produit le calcul, le plan, la gamme – est
partiellement déterminé par des normes ou des routines qui,
parmi une diversité de solutions possibles, excluent a priori
certaines. Mais il reste que le calcul, le plan et la gamme sont
des créations originales, que ce sont des produits de la pensée
qui ne préexistent pas à l'acte de leur production (autre chose
est de savoir si tous ces produits sont originaux et nécessaires).
12
comme
Dans ces conditions il serait absurde de régimenter les
bureaux comme on régimentait autrefois les ateliers et
on continue de le faire. Car il ne s'agit pas de
réprimer l'initiative, mais de l'encourager ; il ne s'agit
pas de priver les hommes de tout esprit de responsabilité,
mais de lutter contre l'affaiblissement de cet esprit. Autre-
fois il était essentiel, pour le bon fonctionnement de la
production, que chacun comprenne que le travail était une
activité bestiale, sans signification, sans joie. Aujourd'hui il
est essentiel au contraire, pour que les bureaux fonctionnent
de manière satisfaisante, pour que l'immense quantité de
spécifications que tout travail matériel exige aujourd'hui,
puisse être accumulée, que les hommes trouvent un sens et une
valeur à cette activité de spécification et qu'ils y attèlent toutes
leurs ressources intellectuelles.
Si cela est le cas, il est facile de comprendre qu'aucune
catégorie de gardiens ou de surveillants ne puisse satisfaire à
de pareilles exigences. On n'imagine pas un surveillant faisant
les cent pas entre les planches à dessin, attentif à ce qu'aucun
dessinateur ne lève le crayon du papier, ni un contremaître
chargé d'empêcher les calculateurs de regarder par la fenêtre
ou de s'absenter trop longtemps aux cabinets ! S'il s'agit moins
de réprimer que de stimuler, seule la hiérarchie est compé-
tente, car elle seule connaît les tâches à exécuter, elle seule
est capable de juger de leur exécution, ainsi que de la capa-
cité et de la valeur des exécutants.
C'est donc à la hiérarchie elle-même que revient aujour-
d'hui la fonction disciplinaire - c'est-à-dire à une catégorie
d'hommes hautement spécialisés et jouant, dans l'exécution
du travail, un rôle positif, défini par leurs compétences et ne
se limitant nullement à la surveillance. Ce changement a cer-
taines conséquences qu'il faut souligner. Tout d'abord le
lien entre les subordonnés et ceux qui les surveillent leurs
chefs — est désormais marqué par ce double caractère du
chef, à la fois surveillant et homme compétent. Dans la mesure
où ils jouent un rôle réel dans la production du service dont
ils ont la charge, les cadres ne peuvent avoir, simultanément,
une attitude répressive envers les gens avec lesquels ils
travaillent. Il est certain qu'il existe encore des cas de cadres
se comportant avec leurs subordonnés comme le contremaître
avec ses ouvriers : au retour d'un déjeûner arrosé, générale-
ment en fin de semaine, ces hommes s'installent au milieu de
leurs possessions, le visage rouge et la parole épaisse et se
dépensent en invectives. Mais il s'agit de personnes générale-
ment âgées, reliques d'un passé en voie de disparition. De plus
leur marge d'invective se réduit de plus en plus : l'homme
qu'ils injuriaient hier, chaque vendredi à quinze heures
trente, accomplit aujourd'hui un stage de formation ; demain
il sera difficilement remplaçable, il faudra l'amadouer, non
13
l'injurier, lui fournir des motifs de s'appliquer, l'augmenter
et lui donner une promotion. Il leur faut également comp-
ter avec le changement d'esprit des subordonnés : dans un cas
auquel je pense un bureau d'une quinzaine de personnes est
arrivé, grâce à une coalition formée de certains éléments deve-
nus précieux et du reste du personnel, à empêcher les explo-
sions de colère auxquelles il était soumis de la part de ses deux
chefs directs. Mais si l'attitude des hommes chargés de la sur-
veillance change, cela est vrai également des subordonnés qui
subissent cette surveillance : on en vient facilement à haïr
un homme qui n'a d'autre fonction que de vous surveiller ;
cela est plus rare si l'homme qui vous surveille est en même
temps celui dont vous reconnaissez et utilisez les compéten-
ces ; et cela est presqu'impossible si la surveillance qu'il exerce
consiste essentiellement en une comparaison des résultats aux
objectifs, si elle ne fait qu'expliciter la surveillance à laquelle
toute collectivité se soumet. D'autres problèmes surgissent
alors, et d'autres comportements : car la surveillance qu'exerce
la hiérarchie n'est pas l'auto-surveillance de la collectivité.
puisqu'elle la remplace et la rend impossible ; elle s'impose
aux subordonnés ; elle les maintient dans l'irresponsabilité et
les frustre du pouvoir de se contrôler et de se corriger eux-
mêmes.
Ces nouveaux rapports entre ceux qui contrôlent et ceux
qui exécutent, entre hiérarchie et subordonnés, laissent moins
de possibilités à la lutte et à la contestation qui, dans l'an-
cienne structure,
étaient des caractères dominants. Les
employés d'un bureau ne luttent contre leur chef d'aucune
manière qui puisse être comparée avec le combat incessant
que mènent les ouvriers contre le contremaître, dans la majo-
rité des sections d'atelier. Le conflit entretenu par l'existence
même de la hiérarchie et par son contrôle extérieur ne provo-
que qu'exceptionnellement des situations de crise et de révolte
ouverte : il s'exprime à travers une tension dans les rapports,
un manque de confiance et d'estime, une absence de commu-
nication, il est un sentiment à peine objectivé plutôt que la
caractéristique d'un comportement. Mais, simultanément, ce
conflit si difficile à saisir parfois qu'on ne parvient pas à le
voir là-même ou il a atteint une grande intensité, ce conflit
presque tout entier intériorisé contient en lui un problème
fondamental, celui du contrôle des collectivités et de l'inté-
gration de leurs membres. Peut-on contrôler les
dehors, les intégrer de force ? Peut-on agir sur eux comme sur
une simple matière ? Existe-t-il une technique des relations
humaines ? Comment stimuler un homme, l'attacher à son
travail, lui faire découvrir la valeur et la signification de ce
qu'il fait ? Ce sont ces problèmes que soulèvent les rapports
quotidiens entre dirigeants et subordonnés, non seulement
pour l'observateur qui, comme nous en ce moment, cherche
gens du
14
la signification de ces rapports, mais également pour ceux qui
les vivent.
La hiérarchie ne peut se contenter à cet égard des notions
qui contiennent le présupposé de son existence – à savoir
qu'il n'existe d'autre contrôle possible pour une collectivité
que celle exercée par une hiérarchie, et que l'auto-contrôle
est une absurdité. Car d'une part la hiérarchie est elle-même
hiérarchisée, soumise donc elle aussi aux mêmes rapports
supérieur-subordonné. Et d'autre part elle vit de trop près la
vie des subordonnés pour ne pas constater l'importance des
phénomènes d'auto-contrôle du groupe ou de l'équipe. Elle se
rend ainsi compte que, plutôt que de consister en un contrôle
paternaliste exercé de l'extérieur et refusé pour la même
raison, sa fonction doit évoluer autrement, et lui permettre
d'influencer les groupes, au lieu de viser à les dominer ; elle
laissera donc aux subordonnés la possibilité de se déterminer
et de se contrôler eux-mêmes, se contentant pour sa part de
fixer les objectifs et d'assurer le cadre général de l'action. Il
s'agit, il est vrai, toujours de contrôler, d'obtenir des hommes
un résultat fixé par avance et en dehors d'eux : mais il est
essentielle de constater de quelle manière cet objectif rencontre
la réalité, se heurte au phénomène fondamental de l'autono-
mie des hommes et élabore les concepts qui lui permettront
de poursuivre sa route.
La hiérarchie ne peut être saisie en flagrant délit de
contrainte. Cela s'explique par les remarques précédentes,
par son expérience de l'inutilité de la contrainte appliquée
aujourd'hui. Mais si la contrainte ne se montre jamais, si les
employés ne sont jamais « forcés à... », mais seulement « pous-
sés à » c'est qu'elle s'exerce d'une autre manière et par l'inter-
médiaire d'autres hommes. La contrainte, c'est le subordonné
lui-même qui l'exerce : il est à la fois surveillé et surveillant,
accusateur et accusé. La hiérarchie, quant à elle, ne fait que
créer et mettre en place le système que le subordonné lui-
même, comme la souris sur sa roue, fera alors fonctionner,
entretenant lui-même la surveillance de la prison dans laquelle
il est enfermé.
De quoi est fait ce système ? Tout d'abord de deux inci-
tations : la promotion et le salaire. Il est évident qu'aucun
subordonné désireux soit d'accomplir une carrière correcte,
soit simplement de continuer de gagner chaque année un peu
plus que l'année dernière (ne serait-ce que pour compenser
la hausse du coût de la vie) n'a intérêt à commettre des actes
d'indiscipline et à faire étalage de sa paresse ou de son manque
d'intérêt au travail.
Mais ces incitations ne résument pas le système. Car ce
qu'il y a de remarquable dans ce système à ce point de vue
c'est le nombre impressionnant de récompenses comparées aux
15
V
sanctions. Ainsi il est exclu, aujourd'hui, dans une organisa-
tion bureaucratique de quelqu'importance, qu'un homme soit
licencié. Le pire qui puisse arriver, au cas où un homme se
montre réellement inassimilable dans un certain poste, c'est
que les services du personnel déploient une activité fébrile
pour trouver le poste qui lui conviendra « vraiment », chacun,
depuis le chef de service de l'intéressé jusqu'au psychologue
d'entreprise se frappant la poitrine et se reprochant amère-
ment d'avoir fait, d'un employé pas plus mauvais qu'un autre,
un problème pour l'entreprise. Et d'autre part, quel est
l'homme qui, au cours de son existence d'employé, ne pro-
gresse pas, n'acquiert pas quelques privilèges, ne voit aug.
menter son salaire ? Il existe plus d'exceptions à cette règle
que le système ne veut bien l'admettre : mais l'essentiel est
que
la majorité n'y prête que peu d'attention et se comporte
de plus en plus comme si ces exceptions n'existaient pas.
Aucun système de contrainte ne peut fonctionner s'il
distribue à tous les mêmes récompenses : c'est pourtant ce
qui se produit ici. Personne n'est oublié, tout le monde
progresse comme une foule gravissant un escalier sans fin.
Tous montent, et ainsi rien ne change. Quelques-uns montent
un peu plus vite que les autres et vont légèrement plus loin' :
mais comme ceux qui restent collés au sol, il s'agit là d'excep-
tions qui frappent peu l'esprit. Et malgré cela les hommes
continuent de travailler, ils respectent l’horaire, tremblant
comme des enfants s'ils ont quelques minutes de retard ; ils
s'absentent rarement, ne cherchent même pas à exploiter les
possibilités offertes par les conventions collectives en matière
de maladie ; ils ne se battent pas, ne s'injurient pas, ne font
la cour aux collègues de l'autre sexe que dans une clandesti-
nité absolue ; ils travaillent, ils viennent au bureau pour
travailler, ils n'y cessent jamais, en apparence, de travailler.
L'employé est comme le croyant qui n'a pas besoin de
voir l'enfer pour trembler : la sanction devient inutile, à
partir du moment où chacun se sanctionne et se punit lui-
même. Personne n'arrive systématiquement en retard. Per-
sonne ne s'affiche avec une femme qui n'est pas la sienne.
Personne ne simule une maladie pour pouvoir partir en vacan-
ces. Personne dans le pire cauchemar ne rêverait qu'il puisse
être assez grossier pour ne pas serrer un minimum 'de cent
mains par jour, ou assez impoli pour devancer un collègue
dans le franchissement d'une porte. Ce raffinement ridicule
des moeurs dont les bureaux offrent l'image, ce faux attache-
ment à certaines règles, ces paroles pieuses tout cela est
une manifestation du conformisme qui pénètre jusqu'à la
moelle les organisations modernes. Et s'il peut exister un
système capable de contraindre les gens sans jamais les punir,
c'est d'abord parce qu'il exploite ce conformisme, l'entretient
et le développe.
16
au
1
Mais il existe aussi une seconde raison à l'efficacité para-
doxale de ce système de contrainte dans la joie qui agit sur
l'employé d'aujourd'hui, quelque soit son rang dans la hiérar-
chie de l'établissement : l'intérêt travail. Soit qu'on
éprouve vraiment un tel intérêt, soit qu'on s'abuse soi-même
en prétendant l'éprouver, il est de toutes façons impossible
de vivre en acceptant la passivité et l'ennui, l'absence de
signification dans ce que l'on fait. Or, manquer à la disci-
pline, c'est manquer d'une manière ou d'une autre à son
travail, et manquer à son travail c'est reconnaître que cela
même dont on chante publiquement les louanges, ce qui vous
tient rivé à votre place 8 ou 9 heures par jour, absorbe votre
meilleure énergie, gaspille vos années — cela ne vous inté-
resse pas, ne vient pas de vous, mais s'impose à vous et vous
domine ; c'est se retrouver enfant sur les bancs de l'école,
nourrisson se débattant sur sa chaise. A 30, 40 ou 50 ans, un
homme ressent le besoin de vivre en paix avec lui-même : il
ne peut admettre que la plus grande partie de sa vie ait été
vouée, ou doive l'être, à l'absurdité et à l'inutilité. Il ne peut
vivre jour après jour et penser : je ne suis rien, je ne fais
rien, toutes mes actions sont dictées par la contrainte. A moins
de pourrir intérieurement il doit accrocher ses espoirs, et ses
longues rêveries, et le flux de son âme, à quelque réalisation
objective, il doit pouvoir sortir de lui-même, se projeter en
quelque chose et, s'assurer ainsi de ses forces et de sa valeur.
La discipline est devenue un automatisme, chaque homme
est son propre gendarme, chaque homme contrôle son appli-
cation au travail, sa conformité aux normes : le système est
parfait, il n'y a plus de conflits, les voix s'estompent et les
bureaux ressemblent à des cathédrales, tant les gestes sont
suaves, et les sentiments pieux. Mais chassée des gestes, chassée
de la pensée consciente, l'indiscipline réapparaît ailleurs. Sous
la discipline apparente, sous l'adhésion des individus aux fins
et aux méthodes, sous leur conscience, vit et prospère un
refus fondamental de tout cela, un refus si profond qu'il
semble concerner non ces tâches, mais toute tâche, non cette
discipline mais toute espèce de discipline et de règle, non cette
réalité, mais toute réalité. Il n'y a plus de révolte, plus de
cynisme, plus de mauvais esprit, leurs miasmes ont fui
devant les néons, les linoléums et la géométricité des tables
métalliques. Mais aujourd'hui il y a la paresse, l'ennui, la
lenteur d'esprit, les hésitations de la volonté, l'irresponsabi-
lité et la routine.
S. CHATEL.
(Suite et fin au prochain numéro).
17
Marxisme
et théorie révolutionnaire
II.
LA THEORIE MARXISTE DE L'HISTOIRE (suite)
On a vu (1) pourquoi ce qu'on a appelé la conception
matérialiste de l'histoire nous apparaît aujourd'hui intenable.
Brièvement parlant, parce que cette conception :
fait du développement de la technique le moteur de
l'histoire « en dernière analyse », et lui attribue une évolution
autonome et une signification close et bien définie,
essaie de soumettre l'ensemble de l'histoire à des caté-
gories qui n'ont un sens que pour la société capitaliste déve-
loppée et dont l'application à des formes précédentes de la
vie sociale pose plus de problèmes qu'elles n'en résoud,
est finalement basée sur le postulat caché d'une nature
humaine essentiellement inaltérable, dont la motivation prédo-
minante serait la motivation économique,
Ces considérations concernent le contenu de la concep-
tion matérialiste de l'histoire, qui est déterminisme
économique (dénomination souvent utilisée d'ailleurs par les
partisans de la conception). Mais la théorie est tout autant
inacceptable en tant qu'elle est déterminisme tout court,
c'est-à-dire en tant qu'elle prétend que l'on peut réduire l'his-
toire aux effets d'un système de forces elles-mêmes soumises
à des lois saisissables et définissables une fois pour toutes, à
partir desquelles ces effets peuvent être intégralement et
exhaustivement produits (et donc aussi déduits). Commė,
derrière cette conception, il y a inévitablement une thèse sur
ce que c'est que l'histoire, donc une thèse philosophique, nous
y reviendrons dans la troisième partie de ce texte.
un
DETERMINISME ECONOMIQUE ET LUTTE DE CLASSE.
Au déterminisme économique semble s'opposer un autre
aspect du marxisme : « l'histoire de l'humanité est l'histoire
de la lutte des classes ». Mais semble seulement. Car, dans la
mesure où l'on maintient les affirmations essentielles de la
(1) Dans la première partie de ce texte, publiée dans le n° 36 de
Socialisme ou Barbarie, p. 1 à 27.
18
ves >>
conception matérialiste de l'histoire, la lutte des classes n'est
pas en réalité un facteur à part. Elle n'est qu'un chaînon des
liaisons causales établies chaque fois sans ambiguïté par l'état
de l'infrastructure technico-économique. Ce que les classes
font, ce qu'elles ont à faire, leur est chaque fois nécessaire-
ment tracé par leur situation dans les rapports de production,
sur laquelle elles ne peuvent rien, car elle les précède causa-
lement aussi bien que logiquement. En fait, les classes ne sont
que l'instrument dans lequel s'incarne l'action des forces pro-
ductives. Si elles sont acteurs, elles le sont exactement au sens
où les acteurs au théâtre récitent un texte donné d'avance et
accomplissent des gestes prédéterminés, et où, qu'ils jouent
bien ou mal, ils ne peuvent empêcher que la tragédie s'ache-
mine vers
sa fin inexorable. Il faut une classe
pour
faire
fonctionner un système socio-économique d'après ses lois, et il
en faut une pour le renverser lorsque il sera devenu
« incompatible avec le développement des forces producti-
et que ses intérêts conduiront tout aussi inéluctable-
ment à instituer un nouveau système qu'elle fera fonctionner
à son tour. Elles sont les agents du processus historique, mais
les agents inconscients (l'expression revient maintes fois sous
la plume de Marx et d’Engels), elles sont agies plutôt qu'elles
n'agissent, dit Lukács. Ou plutôt, elles agissent en fonction de
leur conscience de classe et l'on sait que « ce n'est pas
la
conscience des hommes qui détermine leur être, mais leur être
social qui détermine leur conscience ». Ce n'est pas seulement
que la classe au pouvoir sera conservatrice, et la classe mon-
tante sera révolutionnaire. Ce conservatisme, cette révolution
seront prédéterminés dans leur contenu, dans tous leurs
détails « importants » (2) par la situation des classes corres-
pondantes dans la production.
Ce n'est pas par hasard que l'idée d'une politique plus ou
moins « intelligente » du capitalisme paraît toujours à un
marxiste comme une stupidité cachant une mystification.
Pour qu'on accepte même de parler d'une politique intel-
ligente ou non, il faut admettre que cette intelligence ou
(2) Rigoureusement parlant, il faut dire : dans tous leurs détails,
point. Un déterminisme n'a de sens que comme déterminisme inté-
gral, même le timbre de la voix du démagogue fasciste ou du tribun
ouvrier doivent découler des lois du système. Dans la mesure où cela
est impossible, le déterminisme se réfugie d'habitude derrière la
distinction entre « l'important » et le « secondaire ». Clemenceau a
ajouté, un certain style personnel à la politique de l'impérialisme
français, mais style ou pas style, cette politique aurait été de toute
façon « la même » dans ses aspects importants, dans son
On divise ainsi la réalité en une couche principale où passe
l'essentiel, où les connexions causales peuvent et doivent être établies
en avant et en arrière de l'événement considéré, et une couche secon-
daire, où ces connexions n'existent pas ou n'importent pas. Le déter-
minisme ne peut ainsi se réaliser qu'en divisant à nouveau le monde,
ce n'est qu'en idée qu'il vise un monde unitaire, dans son appli-
cation il est en fait obligé de postuler une partie « non-déterminée »
de la réalité.
essence.
se
19
son
absence peuvent faire une différence quant à l'évo-
lution réelle. Mais comment le pourraient-elles, puisque
cette évolution est déterminée par des facteurs d'un autre
ordre « objectifs » ? On ne dira même pas que cette politi-
que ne tombe pas du ciel, agit dans une situation donnée, ne
peut pas dépasser certaines limites tracées par le contexte
historique, ne peut trouver de résonnance dans la réalité
que si d'autres conditions sont présentes toutes choses
évidentes. Le marxiste parlera comme si cette intelligence ne
pouvait rien changer (hormis le style des discours, grandiose
chez Mirabeau, lamentable chez Laniel) et s'attachera tout
au plus à montrer que le « génie » de Napoléon comme la
« stupidité » de Kerensky étaient nécessairement « appelés »
et engendrés par la situation historique.
Ce n'est pas par hasard non plus que l'on résistera avec
acharnement à l'ideé que le capitalisme moderne a essayé de
s'adapter à l'évolution historique et à la lutte sociale, et s'est
modifié en conséquence. Ce serait admettre que l'histoire du
dernier siècle n'a pas été exclusivement déterminée par des
lois économiques, et que l'action de groupes et de classes socia-
les a pu modifier les conditions dans lesquelles ces lois agissent
et par là leur fonctionnement même.
C'est du reste sur cet exemple que l'on peut voir le plus
clairement que déterminisme économique, d'un côté, lutte
des classes de l'autre, proposent deux modes d'explication,
irréductibles l'un à l'autre, et que dans le marxisme il n'y a
pas véritablement « synthèse », mais écrasement du second au
profit du premier. Est-ce que dans l'évolution du capitalisme
l'essentiel c'est l'évolution technique et les effets du fonction-
nement des lois économiques qui régissent le système ? Ou
bien est-ce la lutte des classes et des groupes sociaux ? A
lire Le Capital, on voit que c'est la première réponse qui
est la bonne. Une fois ses conditions sociologiques établies, ce
qu'on peut appeler les « axiomes du système >> posés dans la
réalité historique (degré et type donné de développement
technique, existence de capital accumulé et de prolétaires
en nombre suffisant, etc.) et recevant une impulsion continue
d'un progrès technique autonome, le capitalisme évolue uni-
quement selon les effets des lois économiques qu'il comporte,
et que Marx a dégagées. La lutte des classes n'y intervient
nulle part (2 a). Qu'un marxisme plus nuancé et plus subtil,
(2 a) Elle n'intervient qu'aux limites - historiques et logiques
du système : le capitalisme ne naît pas organiquement par le simple
fonctionnement des lois économiques de la simple production mar-
chande, il faut l'accumulation primitive qui constitue une rupture
violente de l'ancien système ; il ne laissera pas non plus la place
au socialisme sans la révolution prolétarienne. Mais cela ne change
rien à ce que nous disons ici, car il vaut encore, pour ces interven-
tions actives de classes dans l'histoire, qu'elles sont prédéterminées,
elles n'introduisent rien qui soit en droit imprévisible.
20
ces
s'appuyant au besoin sur d'autres textes de Marx, refuse cette
vue unilatérale et affirme que la lutte des classes joue un rôle
important dans l'histoire du système, qu'elle peut altérer le
fonctionnement de l'économie, mais que simplement il ne faut
pas oublier que cette lutte se situe chaque fois dans un cadre
donné qui en trace les limites et en définit le sens
concessions ne servent à rien, la chèvre et le chou n'en seront
pas pour autant conciliés. Car ce dont il s'agit c'est que les
« lois >> économiques formulées par Marx n'ont à proprement
parler pas de sens en dehors de la lutte des classes, elles n'ont
aucun contenu précis : la « loi de la valeur », lorsqu'il faut
l'appliquer à la marchandise fondamentale, la force de travail,
ne signifie rien, elle est une formule vide dont le contenu ne
peut être fourni que par la lutte entre ouvriers et patrons,
qui détermine pour l'essentiel le niveau absolu et l'évolution
dans le temps du salaire. Et comme toutes les autres « lois »
présupposent une répartition donnée du produit social, l'en-
semble du système reste suspendu en l'air, complètement indé-
terminé (2 b). Et ce n'est pas là seulement une « lacune »
théorique — « lacune » à vrai dire tellement centrale qu'elle
ruine immédiatement la théorie. C'est aussi un monde de
différence dans la pratique. Entre le capitalisme du Capital,
où les « lois économiques » conduisent à une stagnation du
salaire ouvrier, à un chômage croissant, à des crises de plus
en plus violentes et finalement à une quasi-impossibilité du
système à fonctionner ; et le capitalisme réel, où les salaires
croissent à la longue parallèlement à la production et où
l'expansion du système continue sans rencontrer aucune anti-
nomie économique insurmontable, il n'y a pas seulement
l'écart qui sépare l'imaginaire et le réel. Ce sont deux univers,
dont chacun comporte un autre destin, une autre philosophie,
une autre politique, une autre conception de la révolution.
Finalement, l'idée
que
l'action autonome des masses
puisse constituer l'élément central de la révolution socialiste,
admise ou non, restera toujours moins que secondaire pour
un marxiste conséquent — car sans intérêt véritable et même,
sans statut théorique et philosophique. Le marxiste sait où
doit aller l'histoire ; si l'action autonome des masses va dans
cette direction, elle ne lui apprend rien, si elle va ailleurs,
c'est une mauvaise autonomie ou plutôt, ce n'est plus une
autonomie du tout, puisque si les masses ne se dirigent pas
vers les buts corrects, c'est qu'elles restent encore sous l'in-
fluence du capitalisme. Lorsque la vérité est acquise, tout le
reste est erreur, mais l'erreur ne veut rien dire dans un univers
déterministe : l'erreur, c'est le produit de l'action de l'ennemi
de classe et du système d'exploitation.
(2 b) Voir dans le n° 31 de cette revue, « Le mouvement réyo-
lutionnaire sous le capitalisme moderne », pp. 69 à 81.
21
ce que
Pourtant, l'action d'une classe particulière, et la prise de
conscience par cette classe de ses intérêts et de sa situation,
paraît avoir un statut à part dans le marxisme : l'action et la
prise de conscience du proletariat. Mais cela n'est vrai que
dans un sens à la fois spécial et limité. Ce n'est pas vrai quant à
le prolétariat a à faire (2c) : il a à faire la révolution
socialiste, et l'on sait ce que la révolution socialiste a à faire
(sommairement parlant, à développer les forces productives
jusqu'à ce que l'abondance rende possible la société commu-
niste et une humanité libre). C'est vrai seulement pour ce qui
est de savoir s'il le fera ou non. Car, en même temps que l'idée
que le socialisme est ineluctable, existe chez Marx et les
grands marxistes (Lénine ou Trotsky par exemple) l'idée d'une
incapacité éventuelle de la société à dépasser sa crise, d'une
« destruction commune des deux classes en lutte », bref l'alter-
native historique socialisme ou barbarie. Mais cette idée repré-
sente la limite du système et d'une certaine façon la limite de
toute réflexion cohérente : il n'est pas absolument exclu que
l'histoire « échoue », donc se révèle absurde, mais dans ce cas
non seulement cette théorie, mais toute théorie s'effondre.
Par conséquent, le fait que le prolétariat fera ou ne fera pas
la révolution, même s'il est incertain, conditionne tout, et une
discussion quelconque n'est possible que sur l'hypothèse qu'il
la fera. Cette hypothèse admise, le sens dans lequel il la fera
est déterminé. La liberté concédée ainsi au prolétariat n'est
pas différente de la liberté à la folie que nous pouvons nous
reconnaître : liberté qui ne vaut, qui n'existe même, qu'à
condition de ne pas en user, car son usage l'abolirait en même
temps que toute cohérence du monde (3).
Mais si l'on élimine l'idée que les classes et leur action
sont des simples relais ; si l'on admet que la « prise de
conscience » et l'activité des classes et des groupes sociaux
(comme des individus) font surgir des éléments nouveaux,
non-prédéterminés et non-prédéterminables (ce qui ne veut
certes pas dire que l'une et l'autre soient indépendantes des
situations où elles se déroulent), alors on est obligé de sortir
du schéma marxiste classique et à envisager l'histoire d'une
(2 c) « Il ne s'agit pas de ce que tel ou tel prolétaire ou même
le prolétariat entier se représente à un moment comme le but. Il
s'agit de ce qu'est le prolétariat et de ce que, conformément à son
être, il sera historiquement contraint de faire » dit Marx dans un
passage connu de La Sainte Famille.
(3) Cela vaut aussi et surtout, malgré les apparences, pour
Lukács. Lorsqu'il écrit, par exemple, « ...pour le prolétariat vaut
...que la transformation et la libération ne peuvent être que sa propre
action ...L'évolution économique objective ne peut que mettre entre
les mains du prolétariat la possibilité et la nécessité de transformer
la société. Mais cette transformation ne peut être que l'action libre
du prolétariat lui-même. « (Histoire et conscience de classe, p. 256
de la trad. française), il ne faut pas oublier que toute la dialectique
de l'histoire qu'il expose ne tient qu'à condition que le prolétariat
accomplira cette action libre.
22
pas de
manière essentiellement différente. Nous y reviendrons dans
la partie V de ce texte.
La conclusion qui importe, n'est pas que la conception
matérialiste de l'histoire est « fausse » dans son contenu. C'est
que le type de théorie que cette conception vise n'a
sens, qu'une telle théorie est impossible à établir et que du
reste on n'en a pas besoin. Dire que nous possédons enfin le
secret de l'histoire passée et présente (et même, jusqu'à un
certain point, à venir) n'est pas moins absurde que dire que
nous possédons enfin le secret de la nature. Il l'est même plus,
à cause précisément de ce qui fait de l'histoire une histoire,
et de la connaissance historique une connaissance historique.
>
SUJET ET OBJET DE LA CONNAISSANCE HISTORIQUE.
Lorsqu'on parle de l'histoire, qui parle ? C'est quelqu'un
d'une époque, d'une société, d'une classe donnée - bref, c'est
un être historique lui-même. Or cela même, qui fonde la possi-
bilité d'une connaissance historique (car seul un être histori-
que peut avoir une expérience de l'histoire et en parler),
interdit que cette connaissance puisse jamais acquérir le statąt
d'un savoir achevé et transparent - puisqu'elle est elle-même,
dans son essence, un phénomène historique qui demande à
être saisi et interprété comme tel.
Il ne faut pas confondre cette idée avec les affirmations
du scepticisme ou du relativisme naïf : ce que chacun dit n'est
jamais qu'une opinion, en parlant on se trahit soi-même plutôt
qu'on ne traduit quelque chose de réel. Il y a bel et bien autre
chose que la simple opinion (sans quoi ni discours, ni action,
ni société ne seraient jamais possibles), on peut contrôler ou
éliminer les préjugés, les préférences, les haines, appliquer
les règles de l' « objectivité scientifique ». Il n'y a pas que
des opinions qui se valent, et Marx par exemple est un grand
économiste, même lorsqu'il se trompe, tandis que François
Perroux n'est qu'un bavard, même lorsqu'il ne se trompe pas.
Mais toutes les épurations faites, toutes les règles appliquées
et tous les faits respectés, il reste que celui qui parle n'est
« conscience transcendantale », il est un être histo-
rique, et cela n'est pas un accident malheureux, c'est une
condition logique (une « condition transcendantale ») de la
connaissance historique. De même que seuls des êtres naturels
(aussi naturels) peuvent se poser le problème d'une science
de la nature, car seuls des êtres de chair peuvent avoir une
expérience de la nature (4), seuls des êtres historiques peuvent
pas une
(4) En termes de philosophie kantienne : la corporalité du sujet
est une condition transcendantale de la possibilité d'une science de
la nature, et, par voie de conséquence, tout ce que cette corporalité
implique.
23
-
se poser le problème de la connaissance de l'histoire, car eux
seuls peuvent avoir l'histoire comme objet d'expérience. Et,
de même qu'avoir une expérience de la nature n'est pas sortir
de l'Univers et le contempler, de même, avoir une expérience
de l'histoire ce n'est pas la considérer de l'extérieur comme
un objet achevé et posé en face car une telle histoire n'a
jamais été et ne sera jamais donnée à personne comme objet
d'enquête.
Avoir une expérience de l'histoire en tant qu'être histo-
rique c'est être dans et de l'histoire, comme aussi être dans et
de la société. Et, en laissant de côté d'autres aspects de cette
implication, cela signifie :
penser nécessairement l'histoire en fonction des caté-
gories de son époque et de sa société — catégories qui sont
elles-mêmes un produit de l'évolution historique (5).
penser l'histoire en fonction d'une intention pratique
ou d'un projet projet qui fait lui-même partie de l'histoire.
Cela Marx non seulement le savait, il a été le premier à
le dire clairement. Lorsqu'il raillait ceux qui croyaient
« pouvoir sauter par-dessus leur époque » il dénonçait l'idée
qu'il puisse jamais y avoir un sujet théorique pur produisant
une connaissance pure de l'histoire, que l'on puisse jamais
déduire a priori les catégories valant pour tout matériel histo-
rique (autrement que comme abstractions plates et vides) (6).
Lorsqu'en même temps il dénonçait les penseurs bourgeois de
son époque, qui à la fois appliquaient naïvement aux périodes
précédentes des catégories qui n'ont un sens que relativement
au capitalisme et refusaient de relativiser historiquement ces
dernières (« pour eux, il y a eu de l'histoire, mais il n'y en a
plus » disait-il dans une phrase qu'on croirait forgée à l'in-
tention des « marxistes ») et affirmait que sa propre théorie
correspondait au point de vue d'une classe, le prolétariat révo-
lutionnaire, il posait pour la première fois le problème de ce
qu'on a appelé depuis le socio-centrisme (le fait que chaque
société se pose comme le centre du monde et regarde toutes
les autres de son propre point de vue) et tentait d'y répondre.
Nous avons essayé de montrer (7) que Marx n'a
pas
fina-
lement surmonté ce socio-centrisme et que l'on trouve chez
lui ce paradoxe d’un penseur qui a pleinement conscience de
la relativité historique des catégories capitalistes et qui en
même temps les projette (ou les rétro-jette) sur l'ensemble de
l'histoire humaine. Qu'il soit bien compris qu'il ne s'agit pas
(5) V. la première partie de ce texte, nº 36 de cette revue, pp. 6-7
et 20-21.
(6) V. par exemple sa critique des abstractions des économistes
bourgeois, dans l'Introduction à une critique de l'économie politique
(publiée avec la Contribution à la critique de l'économie politique,
trad. Laura Lafargue, en particulier p. 308 et suiv.).
(7) Dans la première partie de ce texte, l. c., p. 21 à 25.
24
là d'une critique de Marx, mais d'une critique de la connais-
sance de l'histoire. Le paradoxe en question est constitutif de
toute tentative de penser l'histoire (8). Il est nécessaire, il est
inévitable que, perchés un siècle plus haut, nous puissions
relativiser plus fortement certaines catégories, dégager plus
clairement ce qui, dans une grande théorie, l'attache solide-
ment à son époque particulière et l'y enracine. Mais c'est parce
que elle est enracinée dans son époque, que la théorie est
grande. Prendre conscience du problème du socio-centrisme,
essayer d'en réduire tous les éléments saisissables est la pre-
mière démarche inévitable de toute pensée sérieuse. Croire
que l'enracinement n'est que du négatif, et qu'on devrait et
pourrait s'en débarrasser en fonction d'une épuration indéfinie
de la raison, c'est l'illusion d'un rationalisme naïf. Ce n'est
pas
seulement que cet enracinement est la condition de notre
savoir, que nous ne pouvons réfléchir sur l'histoire que parce
que, êtres historiques nous-mêmes, nous sommes pris dans une
société en mouvement, nous avons une expérience de la structu-
ration et de la lutte sociale. Il est condition positive, c'est notre
particularité qui nous ouvre l'accès à l'universel. C'est parce
que nous sommes attachés à une vision, à une structure caté-
goriale, à un projet donnés que nous pouvons dire quelque
chose de signifiant sur le passé. Ce n'est que lorsque le présent
est fortement présent, qu'il fait voir dans le passé autre chose
et plus que le passé ne voyait en lui-même. D'une certaine
façon, c'est parce que Marx projette quelque chose sur le
passé, qu'il y découvre quelque chose. C'est une chose de criti.
quer, comme nous l'avons fait, ces projections en tant qu'elles
se donnent comme vérités intégrales, exhaustives et systéma-
tiques. C'en est une autre, que d'oublier que, pour « arbi-
traire » qu'elle soit, la tentative de saisir les sociétés précéden-
tes sous les catégories capitalistes a été chez Marx d'une
fécondité immense même si elle a violé la « vérité propre »
à chacune de ces sociétés. Car en définitive, précisément, il
n'y a pas de telle « vérité propre » — ni celle que dégage le
matérialisme historique, certes, mais pas davantage celle que
révélerait une tentative, combien utopique et combien socio-
centrique finalement, de « penser chaque société pour elle-
même et de son propre point de vue ». Ce qu'on peut appeler
la vérité de chaque société, c'est sa vérité dans l'histoire, pour
elle-même aussi mais pour toutes les autres également, car
le paradoxe de l'histoire consiste en ceci que chaque civili-
sation et chaque époque, du fait qu'elle est particulière et
dominée par ses propres obsessions, arrive à évoquer et à
dévoiler dans celles qui la précèdent ou l'entourent des signi-
(8). De penser sérieusement et profondément. Chez les auteurs
naïfs il n'y a pas de paradoxe, rien que la platitude simple de
projections ou d'un relativisme également non-critiques.
25
fications nouvelles. Jamais celles-ci ne peuvent épuiser ou
fixer leur objet, ne serait-ce que parce qu'elles deviennent tôt
ou tard elles-mêmes objet d'interprétation (nous essayons
aujourd'hui de comprendre comment et pourquoi la Renais-
sance, le XVIIe et le XVIIIe siècles ont vu de façon tellement
différente chacun l'antiquité classique) ; jamais non plus
elles ne se réduisent aux obsessions de l'époque qui les a
dégagées, car alors l'histoire ne serait que juxtaposition de
délires et nous ne pourrions même pas lire un livre du passé.
Ce paradoxe constitutif de toute pensée de l'histoire, le
marxisme essaie, on le sait, de le dépasser.
Ce dépassement résulte d'un double mouvement. Il y a
une dialectique de l'histoire, qui fait que les points de vue
successifs des diverses époques, classes, sociétés, entretiennent
entre eux un rapport défini (même s'il est très complexe). Ils
obéissent à un ordre, ils forment système qui se déploie dans
le temps, de sorte que ce qui vient après dépasse (supprime
en conservant) ce qui était avant. Le présent comprend le passé
(comme moment « surmonté ») et de ce fait il peut le com-
prendre mieux que ce passé ne se comprenait lui-même. Cette
dialectique est, dans son essence, la dialectique hegelienne ;
que ce qui était chez Hegel le mouvement du logos devienne
chez Marx le développement des forces productives et la suc-
cession de classes sociales qui en marque les étapes n'a pas, à
cet égard, de l'importance. Chez l'un et chez l'autre, Kant
« dépasse » Platon et la société bourgeoise est « supérieure »
à la société antique. Mais cela prend de l'importance à un
autre égard et c'est là le deuxième terme du mouvement.
Parce que précisément cette dialectique est la dialectique de
l'apparition successive des diverses classes dans l'histoire, elle
n'est plus nécessairement infinie en droit (9) ; or, l'analyse
historique montre qu'elle peut et doit s'achever avec l'appa-
rition de la « dernière classe », le prolétariat. Le marxisme est
donc une théorie privilégiée parce qu'elle représente « le point
de vue du prolétariat » et que le prolétariat est la dernière
classe — non pas dernière en date simplement, car alors nous
resterions toujours attachés, à l'intérieur de la dialectique
historique, à un point de vue particulier destiné à être rela-
tivisé par la suite ; mais dernière absolument, en tant qu'il
doit réaliser la suppression des classes et le passage à la « vraie
histoire de l'humanité ». Le prolétariat est classe universelle,
c'est parce qu'il n'a pas d'intérêts particuliers à faire valoir
qu'il peut aussi bien réaliser la société sans classes qu'avoir
sur l'histoire passée un point de vue « yrai » (10).
(9) La nécessité d'une telle infinité, et la nécessité de son
contraire, est une des impossibilités de l'hégélianisme, et, en fait,
de toute dialectique prise comme système. On y reviendra plus loin.
(10) C'est Lukács, dans Histoire et conscience de classe, qui a
développé avec le plus de profondeur et de rigueur ce point de vue.
26
Nous ne pouvons pas, aujourd'hui, maintenir cette façon
de voir, pour de nombreuses raisons. Nous ne pouvons pas
nous donner d'avance une dialectique achevée ou sur le point
de s'achever de l'histoire, fut-elle qualifiée de « pré-histoire ».
Nous ne pouvons pas nous donner la solution avant le pro-
blème. Nous ne pouvons pas nous donner d'emblée une dialec-
tique quelle qu'elle soit, car une dialectique postule la ratio-
nalité du monde et de l'histoire, et cette rationalité est pro-
blème, tant théorique que pratique. Nous ne pouvons pas
penser l'histoire comme une unité, nous cachant les énormes
problèmes que cette expression cache dès qu'on lui donne un
sens autre que formel, ni comme unification dialectique pro-
gressive, car Platon ne se laisse pas résorber par Kant ni le
gothique par le rococo, et dire que la supériorité de la culture
espagnole sur celle des Aztèques a été prouvée par l'extermi. .
nation de ces derniers laisse un résidu d'insatisfaction aussi
bien chez l’Aztèque survivant que chez nous qui ne compre-
nons pas en quoi et pourquoi l'Amérique précolombienne cou-
vait elle-même sa suppression dialectique par sa rencontre
avec des cavaliers porteurs d'armes à feu. Nous ne pouvons
pas fonder la réponse finale aux problèmes ultimes de la
pensée et de la pratique sur l'exactitude de l'analyse par Marx
de la dynamique du capitalisme, maintenant que nous savons
que cette exactitude est illusoire, mais même si nous ne le
savions pas. Nous ne pouvons pas poser
d'emblée une théorie,
fut-ce la nôtre, comme « représentant le point de vue du prolé-
tariat >> car, l'histoire d'un siècle l'a montré, ce point de vue
du prolétariat, loin d'offrir la solution de tous les problèmes,
est lui-même un problème dont seul le prolétariat (disons,
pour éviter les arguties, l'humanité qui travaille) pourra
inventer ou ne pas inventer la solution. Nous ne pouvons en
tout cas poser le marxisme comme représentant ce point de
vue car il contient, profondément inbriqués à son essence,
des éléments capitalistes et que, non sans rapport avec cela,
il est aujourd'hui l'idéologie en acte de la bureaucratie par-
tout et celle du proletariat nulle part. Nous ne pouvons pas
penser que, le prolétariat fût-il la dernière classe et le
marxisme son représentant authentique, sa vision de l'histoire
est la vision qui clot définitivement toute discussion. La rela-
tivité du savoir historique n'est pas seulement fonction de sa
production par une classe, elle est aussi fonction de sa produc-
tion dans une culture, à une époque, et ceci ne se laisse pas
résorber par cela. La disparition des classes dans la société
future n'éliminera pas automatiquement toute différence quant
aux vues sur le passé qui pourront y exister, ne conférera
pas à celle-ci une coïncidence immédiate à leur objet, ne les
soustraira pas à une évolution historique. En 1919 Lukács,
alors Ministre de la Culture du gouvernement révolutionnaire
hongrois, disait dans un discours officiel, à mots couverts :
27
maintenant que le prolétariat est au pouvoir, nous n'avons
plus besoin de maintenir une vision unilatérale du passé (11).
En 1964, lorsque le prolétariat n'est au pouvoir nulle part,
nous avons encore moins la possibilité de le faire.
Bref, nous ne pouvons plus maintenir la philosophie
marxiste de l'histoire.
III.
LA PHILOSOPHIE MARXISTE DE L'HISTOIRE
La théorie marxiste de l'histoire se présente en premier
lieu comme une théorie scientifique, donc comme une géné-
ralisation démontrable ou contestable au niveau de l'enquête
empirique. Cela, elle l'est indiscutablement et comme telle, il
était inévitable qu'elle connaisse le sort de toute théorie scien-
tifique importante. Après avoir produit un bouleversement
énorme et irréversible dans notre manière de voir le monde his-
torique, elle est dépassée par la recherche qu'elle a elle-même
déclenchée, et doit prendre sa place dans l'histoire des théo-
ries, sans que cela mette en question l'acquis qu'elle lègue. On
peut dire, comme Che Guevara, qu'il n'est pas plus nécessaire
de dire aujourd'hui qu'on est marxiste, qu'il n'est besoin de
dire qu'on est pasteurien ou newtonien à condition de com-
prendre vraiment ce que cela veut dire : tout le monde est
« newtonien » au sens qu'il n'est pas question de revenir à la
manière de poser les problèmes ou aux catégories antérieures
à Newton ; mais personne n'est plus réellement « newtonien »,
car personne ne peut plus être partisan d'une théorie qui est
purement et simplement fausse (12).
Mais à la base de cette théorie de l'histoire, il y a une
philosophie de l'histoire, profondément et contradictoirement
tissée avec elle, et elle-même contradictoire comme on le verra.
Cette philosophie n'est ni ornement ni complément, elle est
nécessairement fondement. Elle est le fondement aussi bien
de la théorie de l'histoire passée, que de la conception poli-
tique, de la perspective et du programme révolutionnaires.
L'essentiel, c'est qu'elle est une philosophie rationaliste, et,
comme toutes les philosophies rationalistes, se donne d'avance
la solution de tous les problèmes qu'elle pose.
(11) V. « Le changement de fonction du matérialisme histo-
rique », dans Histoire et conscience de classe, en particulier pp. 258-9,
274-5, 282, 284-5.
(12) Bel et bien fausse, et non pas « approximation améliorée
par les théories ultérieures ». L'idée des « approximations succes-
sives », d'une accumulation additive des vérités scientifiques, est
un non-sens progressiste du xixe siècle, qui domine encore largement
la conscience des scientifiques.
28
en
ce
sens
LE RATIONALISME OBJECTIVISTE.
La philosophie de l'histoire marxiste est d'abord et surtout
un rationalisme objectiviste. On le voit déjà dans la théorie
marxiste de l'histoire appliquée à l'histoire passée. L'objet de.
la théorie de l'histoire, c'est un objet naturel et le modèle
qui lui est appliqué est un modèle analogue à celui des scien-
ces de la nature. Des forces agissant sur des points d'appli-
cation définis produisent des résultats prédéterminés selon
un grand schéma causal qui doit expliquer aussi bien la sta-
tique que la dynamique de l'histoire, la constitution et le
fonctionnement de chaque société autant que le déséquilibre
et le bouleversement qui doivent la conduire à une forme
nouvelle. L'histoire passée est donc rationnelle,
que tout s'y est déroulé selon des causes parfaitement adéqua-
tes et pénétrables par notre raison en son état de 1859. Le
réel est parfaitement explicable ; en principe, il est d'ores et
déjà expliqué. (on peut écrire des monographies sur les causes
économiques de la naissance de l'Islam au vile siècle, elles
vérifieront la théorie matérialiste de l'histoire et ne nous
apprendront rien sur elle). Le passé de l'humanité est confor-
me à la raison, en ce sens que tout y a une raison assignable
et que ces raisons forment système cohérent et exhaustif.
Mais l'histoire à venir est tout aussi rationnelle, car elle
réalisera la raison, et cette fois-ci dans un deuxième sens : le
sens non plus seulement du fait, mais de la valeur. L'histoire
à venir sera ce qu'elle doit être, elle verra naître une société
rationnelle qui incarnera les aspirations de l'humanité, où
l'homme sera enfin humain (ce qui veut dire que son exis-
tence coïncidera avec son essence et son être effectif réalisera
son concept).
Enfin, l'histoire est rationnelle dans un troisième sens :
de la liaison du passé et de l'avenir, du fait qui deviendra
nécessairement valeur, de cet ensemble de lois quasi-naturelles
aveugles qui aveuglement ceuvrent à la production de l'état le
moins aveugle de tous : celui de l'humanité libre. Il y a donc
une raison immanente aux choses, qui fera surgir une société
miraculeusement conforme à notre raison.
L'hégélianisme, on le voit, n'est pas en réalité dépassé.
Tout ce qui est, et tout ce qui sera, réel, est et sera rationnel.
Qu’Hegel arrête cette réalité et cette rationalité au moment
où apparaît sa propre philosophie, tandis que Marx les pro-
longe indéfiniment, jusques et y compris l'humanité commu-
niste, n'infirme pas ce que nous disons, plutôt le renforce.
L'empire de la raison qui, dans le premier cas, embrassait
(par un postulat spéculatif nécessaire) ce qui est déjà donné,
s'étend maintenant aussi sur tout ce qui pourra jamais être
donné dans l'histoire. Que ce que l'on peut dire dès mainte-
nant sur ce qui sera devienne de plus en plus vague au fur
29
et à mesure que l'on s'éloigne du présent, cela relève des limi-
tations contingentes de notre connaissance et surtout de ce
qu'il s'agit de faire ce qui est à faire aujourd'hui et non pas
de « fournir des recettes pour les cuisines socialistes de l'ave-
nir ». Mais cet avenir est d'ores et déjà fixé dans son principe :
il sera liberté, comme le passé et le présent a été et est
nécessité.
Il y a donc une « ruse de la raison », comme disait le vieil
Hegel, il y a une raison au travail dans l'histoire, garantissant
que l'histoire passée est compréhensible, que l'histoire à venir
est souhaitable et que la nécessité apparemment aveugle des
faits est secrètement agencée pour accoucher du bien.
Le simple énoncé de cette idée suffit pour faire percevoir
la foule extraordinaire de problèmes qu'elle masque. Nous ne
pouvons en aborder, et brièvement, que quelques-uns.
LE DETERMINISME.
Dire que l'histoire passée est compréhensible, au sens de
la conception marxiste de l'histoire, veut dire qu'il existe un
déterminisme causal sans faille « importante » (13), et que
ce déterminisme est, au second degré si l'on peut dire, porteur
de significations qui s'enchaînent dans des totalités elles-
même signifiantes. Or ni l'une ni l'autre de ces idées ne peut
être acceptée sans plus.
Il est certain que nous ne pouvons pas penser l'histoire
sans la catégorie de la causalité, et même que, contrairement
à ce qu'ont affirmé des philosophes idéalistes, l'histoire est par
excellence le domaine où la causalité a pour nous un sens, puis-
qu'elle y prend au départ la forme de la motivation et que
donc nous pouvons comprendre un enchaînement « causal »,
ce que nous ne pouvons jamais dans le cas des phénomènes
naturels. Que le passage du courant électrique rende la lampe
incandescente, ou que la loi de la gravitation fasse que la lune
se trouve à tel moment tel endroit du ciel, sont et resteront
toujours pour nous des connexions extérieures, nécessaires,
prévisibles mais incompréhensibles. Mais que A marche sur
les pieds de B, que B l'injurie, et que A réponde par un
soufflet, nous comprenons la nécessité de l'enchaînement lors
même que nous pouvons le considérer comme contingent
(reprocher aux participants de s'être laissés « emporter » tan-
dis qu'ils « auraient pu » se contrôler tout en sachant, par
notre expérience, qu'à certains moments on ne peut pas ne
pas se laisser emporter). Plus généralement, que ce soit sous
la forme de la motivation, sous celle du moyen technique
indispensable, du résultat qui se réalise parce qu'on en a posé
intentionnellement les conditions, ou de l'effet inévitable
(13) V. plus haut, note 2.
30
même si non voulu de tel acte, nous pensons et nous faisons
constamment notre vie et celle des autres sous le mode de la
causalité.
Il y a du causal, dans la vie sociale et historique, parce
qu'il y a du « rationnel subjectif » : la disposition des troupes
carthaginoises à Cannes (et leur victoire) résulte d'un plan
rationnel d’Annibal. Il y en a aussi, parce qu'il y a du « ration-
nel objectif », parce que des relations causales naturelles et des
nécessités purement logiques sont constamment présentes dans
les relations historiques : sous certaines conditions techniques
et économiques, production d'acier et extraction de charbon se
trouvent entre elles dans une relation constante et quantifia-
ble (plus généralement, fonctionnelle). Et il y a aussi du
< causal brut », que nous constatons sans pouvoir le réduire à
des relations rationnelles subjectives ou objectives, des corré-
lations établies dont nous ignorons le fondement, des régula-
rités de comportement, individuelles ou sociales, qui restent
de purs faits.
L'existence de ces relations causales de divers ordres per-
met, au-delà de la simple compréhension des comportements
individuels ou de leur régularité, d'enserrer ceux-ci dans des
« lois », et de donner à ces lois des expressions abstraites d'où
le contenu « réel » des comportements individuels vécus a été
éliminé. Ces lois peuvent fonder des prévisions satisfaisantes
(qui se vérifient avec un degré de probabilité donné). Il y a
ainsi, par exemple, dans le fonctionnement économique du
capitalisme une foule extraordinaire de régularités observa-
bles et mesurables, que l'on peut appeler, en première approxi-
mation, des « lois », et qui font que sous un grand nombre
de ses aspects ce fonctionnement paraît compréhensible et est,
jusqu'à un certain point, prévisible. Même au-delà de l'éco-
nomie, il y a une série de « dynamiques objectives » partiel-
les. Cependant, nous ne parvenons pas à intégrer ces dyna-
miques partielles à un déterminisme total du système, et cela
sens totalement différent de celui qu'exprime la
crise du déterminisme dans la physique moderne : ce n'est
pas que le déterminisme s'effondre ou devienne problématique
aux limites du système, ou que des failles apparaissent à l'in-
térieur de celui-ci. C'est plutôt l'inverse : comme si quelques
aspects, quelques coupes seulement du social se soumettaient
au déterminisme, mais baignaient elles-mêmes dans un ensem-
ble de relations non-déterministes.
Il faut bien comprendre à quoi tient cette impossibilité.
Les dynamiques partielles que nous établissons sont bien
entendu incomplètes ; elles . renvoient constamment les unes
aux autres, toute modification de l'une modifie toutes les
autres. Mais si cela peut créer des difficultés immenses dans
la pratique, il n'en crée aucune de principe. Dans l'univers
dans un
31
physique aussi, toute relation ne vaut que « toutes choses
égales d'ailleurs ».
L'impossibilité en question ne tient pas à la complexité
de la matière sociale, elle tient à sa nature même. Elle tient
à ce que le social (ou l'historique) contient le non-causal
comme un moment essentiel.
Ce non-causal apparaît à deux niveaux. Le premier, qui
nous importe le moins ici, est celui des écarts que présentent
les comportements réels des individus relativement à leurs
comportements « typiques ». Cela introduit un élément d'im-
prévisible, mais qui ne pourrait pas comme tel empêcher un
traitement déterministe, tout au moins au niveau global. Si
ces écarts sont systématiques, ils peuvent être soumis à une
investigation causale ; s'ils sont aléatoires, ils sont passibles
d'un traitement statistique. L'imprévisibilité des mouvements
des molécules individuelles n'a pas empêché la théorie ciné-
tigue des gaz d'être une des branches les plus rigoureuses de
la physique, c'est même cette imprévisibilité individuelle qui
fonde la puissance extraordinaire de la théorie.
Mais le non-causal apparaît à un autre niveau, et c'est
celui-ci qui importe. Il apparaît comme comportement non
pas simplement « imprévisible », mais créateur des individus,
des groupes, des classes ou des sociétés entières) ; non pas
comme simple écart relativement à un type existant, mais
comme position d'un nouveau type de comportement, comme
institution d'une nouvelle règle sociale, comme invention d'un
nouvel objet ou d'une nouvelle forme bref, comme surgis-
sement ou production qui ne se laisse pas déduire à partir
de la situation précédente, conclusion qui dépasse les prémis-
ses ou position de nouvelles prémisses. On a déjà remarqué
que l'être vivant dépasse le simple mécanisme parce qu'il peut
donner des réponses nouvelles à des situations nouvelles. Mais
l'être historique dépasse l’être simplement vivant parce qu'il
peut donner des réponses nouvelles aux « mêmes » situations
ou créer de nouvelles situations.
L'histoire ne peut pas être pensée selon le schéma déter-
ministe (ni d'ailleurs selon un schéma « dialectique » simple),
parce qu'elle est le domaine de la création. Nous reprendrons
ce point dans la partie V de ce texte.
L'ENCHAINEMENT DES SIGNIFICATIONS
ET LA « RUSE DE LA RAISON ».
Au-delà du problème du déterminisme dans l'histoire, il y
a un problème des significations « historiques ». En premier
lieu, l'histoire apparaît comme le lieu des actions conscientes
d'êtres conscients. Mais cette évidence se renverse aussitôt que
l'on y regarde de plus près. L'on constate alors, avec Engels,
que « l'histoire est le domaine des intentions inconscientes et
32
des fins non voulues ». Les résultats réels de l'action historique
des hommes ne sont pour ainsi dire jamais ceux que les
acteurs avaient visés. Cela n'est peut-être pas difficile à com-
prendre. Mais ce qui pose un problème central, c'est que ces
résultats, que personne n'avait voulus comme tels, se présen-
tent comme « cohérents » d'une certaine façon, possèdent une
« signification » et semblent obéir à une logique qui n'est ni
une logique « subjective » (portée par une conscience, posée
par quelqu'un), ni une logique « objective », comme celle
que nous croyons déceler dans la nature,
et que nous
pouvons appeler une logique historique.
Des centaines de capitalistes, visités ou non par l'esprit
de Calvin et l'idée de l'ascèse intra-mondaine, se mettent à
accumuler. Des milliers d'artisans ruinés et de paysans affa-
més se trouvent disponibles pour entrer dans les usines.
Quelqu'un invente une machine à vapeur, un autre, un nou-
veau métier à tisser. Des philosophes et des physiciens essaient
de
penser l'univers comme une grande machine et d'en trouver
les lois. Des rois continuent de se subordonner et d'émasculer
la noblesse et créent des institutions nationales. Chacun des
individus et des groupes en question poursuit des fins qui lui
sont propres, personne ne vise la totalité sociale comme telle.
Pourtant le résultat est d'un tout autre ordre : c'est le capita-
lisme. Il est absolument indifférent, dans ce contexte, que ce
résultat ait été parfaitement déterminé par l'ensemble des
causes et des conditions. Admettons que l'on puisse montrer
pour tous ces faits, jusques et y compris pour la couleur des
chausses de Colbert, toutes les connexions causales multidi-
mensionnelles qui les relient les uns aux autres et tous aux
« conditions initiales du système ». Ce qui importe ici,
c'est que ce résultat a une cohérence que personne ni rien ne
voulait ni ne garantissait au départ ou par la suite ; et qu'il
possède une signification (plutôt, paraît incarner un système
virtuellement inépuisable de significations), qui fait qu'il y a
bel et bien une sorte d'entité historique qui est le capitalisme.
Cette signification apparaît de multiples façons. Elle est
ce qui, à travers toutes les connexions causales et au-delà
d'elles, confère une sorte d'unité à toutes les manifestations
de la société capitaliste et fait que nous reconnaissons immé-
diatement dans tel phénomène un phénomène de cette culture,
qui nous fait classer immédiatement dans cette époque des
objets, des livres, des instruments, des phrases dont nous ne
connaîtrions rien par ailleurs, et qui en exclut tout aussi immé-
diatement une infinité d'autres. Elle apparaît comme l'exis-
tence simultanée d'un ensemble infini de possibles et d'un
ensemble infini d'impossibles donnés pour ainsi dire d'emblée.
Elle apparaît encore en ceci, que tout ce qui se passe à l'inté-
rieur du système non seulement est produit de façon conforme
à quelque chose comme « l'esprit du système », mais concourt
33
à l'affermir (même lorsqu'il s'oppose à lui et tend à la limite
à le renverser comme ordre réel).
Tout se passe comme si cette signification globale du
système était donnée en quelque sorte d'avance, qu'elle « pré-
déterminait » et sur-déterminait les enchaînements de causa-
tion, qu'elle se les asservissait et leur faisait produire des
résultats conformes à une « intention » qui n'est bien entendu
qu'une expression métaphorique, puisqu'elle n'est l'intention
de personne. Marx dit quelque part, « s'il n'y avait pas le
hasard, l'histoire serait de la magie >> - phrase profondément
vraie. Mais l'étonnant est que le hasard dans l'histoire prend
lui-même la plupart du temps la forme du hasard signifiant,
du hasard « objectif », du « comme par hasard » comme le dit
si bien l'ironie populaire. Qu'est-ce qui peut donner au nom-
bre incalculable de gestes, d'actes, de pensées, de conduites
individuelles et collectives qui composent une société cette
unité d'un monde, où un certain ordre (ordre de sens, pas
nécessairement de causes et d'effets), peut toujours être trouvé
tissé dans le chaos ? Qu'est-ce ce qui donne, aux grands événe-
ments historiques, cette apparence qui est plus qu'apparence
d'une tragédie admirablement calculée et mise en scène, où
tantôt les erreurs évidentes des acteurs sont absolument inca-
pables d'empêcher le résultat de se produire, où l'on a l'im-
pression que la « logique interne » du processus est capable
d'inventer et de produire au moment voulu tous les coups
de pouce et les crans d'arrêt, toutes les compensations et tous
les truquages nécessaires pour que le processus aboutisse,
et tantôt l'acteur jusqu'alors infaillible fait la seule erreur de
sa vie, qui était indispensable à son tour pour la production
du résultat « visé » ?
Cette signification, déjà autre que la signification effecti-
vement vécue pour les actes déterminés d'individus précis, et
en tout cas pour ce qui est des ensembles historiques, pose,
comme telle, un problème proprement inépuisable. Car il y a
irréductibilité du signifiant au causal, le signifiant bâtissant
un ordre d'enchaînements autre, et pourtant inextricablement
tissé avec les enchaînements de causation.
Que l'on considère par exemple la question de la
cohérence d'une société donnée une société archaïque ou
une société capitaliste. Qu'est-ce qui fait que cette société
« tienne ensemble », que les règles (juridiques ou morales)
qui ordonnent le comportement des adultes soient cohérentes
avec les motivations de ceux-ci, qu'elles soient non seulement
compatibles mais profondément et mystérieusement apparen-
tées au mode de travail et de production, que tout cela à son
tour corresponde à la structure familiale, au mode d'allaite-
ment, de sevrage, d'éducation des enfants, qu'il y ait une struc-
ture finalement définie de la personnalité humaine dans cette
34
culture, que cette culture comporte ses névroses et pas d'au-
tres, et que tout cela se coordonne avec une vision du monde,
une religion, telle façon de manger et de danser? A étudier
une société archaïque (14) on a par moments l'impression
vertigineuse qu'une équipe de psychanalystes, économistes,
sociologues, etc.,. de capacité et de savoir surhumains, a
travaillé d'avance sur le problème de sa cohérence et a légiféré
en posant des règles calculées pour l'assurer. Même si nos
ethnologues, en analysant le fonctionnement de ces sociétés
et en l'exposant, y introduisent plus de cohérence qu'il n'y en
a réellement, cette impression n'est pas et ne peut pas être
totalement illusoire : après tout, ces sociétés fonctionnent, et
elles sont stables, elles sont même « auto-stabilisatrices » et
capables de résorber des chocs importants (sauf évidemment
celui du contact avec la « civilisation »).
Certes, dans le mystère de cette cohérence on peut opérer
une énorme réduction causale et c'est en cela que consiste
l'étude « exacte » d'une société. Si les adultes se comportent
de telle façon, c'est qu'ils ont été élevés d'une certaine
manière ; si la religion de ce peuple a tel contenu, cela cor-
respond à la « personnalité de base » de cette culture ; si les
rapports du pouvoir sont organisés ainsi, cela est conditionné
par ces facteurs économiques, ou inversement, etc. Mais cette
réduction causale n'épuise pas le problème, elle en fait sim-
plement apparaître à la fin la carcasse. Les enchaînements
qu'elle dégage, par exemple, sont des enchaînements d'actes
individuels qui se situent dans le cadre donné d'avance à la
fois d'une vie sociale qui est déjà cohérente à chaque instant
comme totalité concrète (15) (sans quoi il n'y aurait pas de
comportements individuels) et d'un ensemble de règles expli-
cites, mais aussi implicites, d'une organisation, d'une structure,
qui est à la fois un aspect de cette totalité et autre chose
qu'elle. Ces règles sont elles-mêmes. le produit, à certains
égards, de cette vie sociale et dans nombre de cas (presque
jamais pour les sociétés archaïques, souvent pour les sociétés
historiques) on peut parvenir à insérer leur production dans
la causation sociale (par exemple, l'abolition du servage ou
la libre concurrence introduits par la bourgeoisie servent ses
buts et sont explicitement voulues pour cela). Mais, lors même
que l'on arrive à les « produire » ainsi, il reste que leurs
auteurs n'étaient pas et ne pouvaient pas être conscients de la
totalité de leurs effets et de leurs implications - et que pour-
tant ces effets et ces implications s’ « harmonisent » inexpli-
cablement avec ce qui existait déjà ou avec ce que d'autres
au même moment produisent dans d'autres secteurs du front
(14) V. par exemple les études de Margaret Mead dans Male and
Female ou dans Sex and Temperament in Three Primitive Societies.
(15) Donc le simple renvoi à la série infinie des causations ne
'résoud pas le problème.
35
social (16). Et il reste que, dans la plupart des cas, des
« auteurs » conscients tout simplement n'existaient pas (pour
l'essentiel, l'évolution des formes de vie familiale, fondamen-
tale pour la compréhension de toutes les cultures, n'a pas
dépendu d'actes législatifs explicites, et encore moins de tels
actes résultaient d'une conscience des mécanismes psychana-
lytiques obscurs qui sont à l'ouvre dans une famille). Il reste
aussi le fait que ces règles sont posées au départ de chaque
société (17), et qu'elles sont cohérentes entre elles quelle que
soit la distance des domaines qu'elles concernent.
(Lorsque nous parlons de cohérence dans ce contexte,
nous prenons le mot au sens le plus large possible : pour une
société donnée, même le déchirement et la crise peuvent d'une
certaine façon traduire la cohérence car elles s'insèrent dans
son fonctionnement, elles n'entraînent jamais un effondrement,
une pulvérisation pure et simple, ce sont « ses » crises et
« son » incohérence. La grande dépression de 1929, comme
les deux guerres modiales, sont bel et bien des manifestations
« cohérentes » du capitalisme, non pas qu'elles s'imbriquent
simplement dans ses enchaînements de causation, mais qu'elles
en font avancer le fonctionnement en tant que fonctionne-
ment du capitalisme ; dans ce qui est de mille façons leur
on peut encore voir de mille façons le sens du
capitalisme).
Il y a une deuxième réduction que nous pouvons opérer :
si toutes les sociétés que nous observons, dans le présent ou
le passé, sont cohérentes, il n'y a pas lieu de s'en étonner,
puisque par définition seules des sociétés cohérentes sont
observables ; des sociétés non-cohérentes se seraient effondrées
aussitôt et nous ne pourrions pas en parler. Cette idée, pour
importante qu'elle soit, ne clôt pas non plus la discussion ;
elle ne pourrait faire « comprendre » la cohérence des socié-
tés observées qu'en renvoyant à un processus de « tâtonnements
et d'erreurs » où auraient seules subsisté, par une sorte
de sélection naturelle, les sociétés « viables ». Mais déjà en bio-
logie, où l'évolution dispose des milliards d'années et d'un pro-
cessus infiniment riche de variations aléatoires, la sélection
naturelle à travers les tâtonnements et les erreurs ne paraît pas
suffisante pour répondre au problème de l'orthogenèse ; il sem-
ble bien que des formes « viables » soient produites loin au-
dessus de la probabilité statistique de leur apparition, les varia-
tions aléatoires (par mutation) du patrimoine génétique d'une
non-sens
(16) Bien entendu, ce n'est pas là une vérité absolue : il y a aussi
des « mauvaises lois », incohérentes ou détruisant elles-mêmes les
fins qu'elles veulent servir. Ce phénomène semble d'ailleurs, curieu-
sement, limité aux sociétés modernes. Mais cette constatation n'al-
tère pas ce que nous disons, pour l'essentiel : elle reste une variante
extrême de la production de règles sociales cohérentes.
(17) Nous ne disons pas de la société », nous ne discutons pas le
problème métaphysique des origines.
- 36 -
espèce restent confinées dans des limites très étroites. En his-
toire, le renvoi à une variation aléatoire et à un processus de
sélection paraît gratuit, et du reste, le problème se pose à un
niveau antérieur (en biologie aussi !): la disparition des peu-
ples et des nations décrits par Hérodote peut bien être le
résultat de leur rencontre avec d'autres peuples qui les ont
écrasés ou absorbés, il n'empêche que les premiers avaient
déjà une vie organisée et cohérente, qui se serait poursuivie
sans cette rencontre. Du reste, nous avons vu de nos yeux,
propres ou métaphoriques, naître des sociétés et nous savons
que cela ne se passe pas ainsi. On ne voit pas, dans l'Europe
du XIIIe au xixe siècle, un énorme nombre de types de société
différents apparaître, dont tous sauf un disparaissent parce
qu'incapables de survivre ; on voit un phénomène, la naissance
(accidentelle par rapport au système qui l'a précédée) de la
bourgeoisie, qui, à travers ses mille ramifications et ses mani-
festations les plus contradictoires, des banquiers lombards à
Calvin et de Giordano Bruno à l'utilisation de la boussole, fait
apparaître dès le départ un sens cohérent qui ira s'affirmant
et se développant.
Ces considérations permettent de saisir un deuxième aspect
du problème. Ce n'est pas seulement dans l'ordre d'une société
que se manifeste la superposition d'un système de significations
à un réseau de causes ; c'est également dans la succession des
sociétés historiques, ou, plus simplement, dans chaque pro-
cessus historique. Que l'on considère par exemple, le proces-
sus d'apparition de la bourgeoisie, que nous avons déjà évoqué
plus haut ; ou encore mieux celui, que nous croyons si bien
connaître, qui a conduit à la révolution russe de 1917 d'abord,
au pouvoir de la bureaucratie ensuite.
Il n'est pas possible ici, et il n'est du reste guère néces-
saire, de rappeler les causes profondes qui travaillaient la
société russe, la dirigeaient vers une deuxième crise sociale
violente après celle de 1905 et fixaient les principaux acteurs
du drame en la personne des classes essentielles de la société.
Il ne nous paraît pas difficile de comprendre que la société
russe était grosse d'une révolution, ni que dans cette révolu-
tion le prolétariat allait jouer un rôle déterminant - en tout
cas, nous n'y insisterons pas. Mais cette nécessité compréhen-
sible reste « sociologique » et abstraite ; il faut qu'elle se média-
tise dans des processus précis, qu'elle s'incarne dans des actes
(ou des omissions), datés et signés de personnes et de groupes
définis qui aboutissent dans le sens voulu ; il faut encore
qu'elle trouve réunies au départ une foule de conditions, dont
on ne peut pas toujours dire que leur présence était garantie
par les facteurs mêmes qui créaient la « nécessité générale »
de la révolution. Un aspect de la question, petit si l'on veut,
mais qui permet de voir facilement et clairement ce que nous
- 37
aucun
or
voulons dire, est celui du rôle des individus. Trotsky, dans
son Histoire de la révolution russe, ne le néglige nullement.
Il est parfois saisi lui-même d'étonnement, qu'il fait partager
au lecteur, devant l'adéquation parfaite du caractère des per-
sonnes et des rôles historiques qu'elles sont appelées à jouer ; il
l'est aussi devant le fait que lorsque la situation « exige » un
personnage d'un type déterminé, ce personnage surgit (on se
rappelle les parallèles qu'il trace entre Nicolas II et Louis XVI,
entre la Tsarine et Marie-Antoinette). Quelle est donc la clé
de ce mystère ? La réponse que donne Trotsky semble encore
d'ordre sociologique : tout, dans la vie et dans l'existence
historique d'une classe privilégiée en décadence, la conduit à
produire des individus sans idées et sans caractère, et si un
individu différent y apparaissait exceptionnellement, il ne
pourrait rien faire avec ces matériaux et contre la « néces-
sité historique » ; tout, dans la vie et l'existence de la classe
révolutionnaire, tend à produire des individus au caractère
trempé et aux vues fortes. La réponse contient sans
doute une grande part de vérité, elle n'est pourtant pas suf-
fisante, ou plutôt elle en dit trop et pas assez. Elle en dit
trop, parce qu'elle devrait valoir dans tous les cas,
elle ne vaut que là précisément où la révolution a été victo-
rieuse. Pourquoi le prolétariat hongrois n'a produit comme
chef trempé que Bela Kun pour qui Trotsky n'a pas assez
d'ironie méprisante, pourquoi le prolétariat allemand n'a pas
su reconnaître ou remplacer Rosa Luxembourg et Karl
Liebknecht, où était le Lénine français en 1936 ? Dire que
dans ce cas la situation n'était pas mûre pour que les chefs
appropriés apparaissent c'est précisément quitter l'interpré-
tation sociologique, qui peut légitimement prétendre à une
certaine compréhensibilité, et revenir au mystère d'une situa-
tion qui exige ou interdit. D'ailleurs la situation qui devait
interdire n'interdit pas toujours : depuis un demi-siècle, les
classes dominantes ont su se donner parfois des chefs qui,
quel que fut leur rôle historique, n'ont été ni des Prince Lvov,
ni des Kerensky. Mais l'explication n'en dit pas assez non
plus, car elle ne peut pas montrer pourquoi le hasard est
exclu de cette affaire là même où il paraît à l'oeuvre de la
façon la plus aveuglante, pourquoi il est toujours « dans le
bon sens » et pourquoi les hasards infinis qui iraient en sens
contraire n'apparaissent pas. Pour que la Révolution abou-
tisse, il faut la veulerie du Tsar et le caractère de la Tsarine,
il faut Raspoutine et les absurdités de la Cour, il faut Kerensky
et Kornilov ; il faut que Lénine et Trotsky reviennent à
Pétrograd, et pour cela il faut une erreur de raisonnement
du Grand Etat major allemand et une autre du gouvernement
britannique - pour ne pas parler de toutes les diphtéries
et de toutes les pneumonies qui ont consciencieusement évité
ces deux personnes depuis leur naissance. Trotsky pose carré-
38
-
ment la question : sans Lénine, est-ce que la révolution aurait
pu aboutir, et, après dicussion, tend à répondre par la néga-
tive. Nous sommes enclins à penser qu'il a raison, et que d'ail-
leurs on pourrait en dire autant pour lui-même (17 a). Mais
en quel sens peut-on dire que la nécessité interne de la révo-
lution garantissait l'apparition d'individus tels que Lénine et
Trotsky, leur survie jusqu'à 1917 et leur présence, plus qu'im-
probable, à Pétrograd au moment voulu ? Force est de cons-
tater que la signification de la révolution s'affirme et aboutit
à travers des enchaînements de causes sans rapport avec elle
et qui pourtant lui sont inexplicablement reliés.
La naissance de la bureaucratie en Russie après la révolu-
tion permet encore de voir le problème à un autre niveau.
Dans ce cas aussi, l'analyse fait voir à l'oeuvre des facteurs
profonds et compréhensibles, sur lesquels nous ne pouvons
pas revenir ici (17 b). La naissance de la bureaucratie en
Russie n'est pas un hasard, certes, et la preuve en est que
la
bureaucratisation est depuis apparue de plus en plus comme
la tendance dominante du monde moderne. Mais pour com-
prendre la bureaucratisation des pays capitalistes, nous fai-
sons appel à des tendances immanentes à l'organisation de
la production, de l'économie et de l'Etat capitalistes. Pour
comprendre la bureaucratisation de la Russie à l'origine, nous
faisons appel à des processus totalement différents, comme
le rapport entre la classe révolutionnaire et son parti, la
« maturité » de la première et l'idéologie du second. Or, du
point de vue sociologique, il n'y a pas de doute que la forme
canonique de la bureaucratie est ceīle qui émerge à une étape
poussée de développement du capitalisme. Pourtant, la bureau-
cratie qui apparaît historiquement la première est celle qui
surgit en Russie dès le lendemain de la révolution, sur les
ruines sociales et matérielles du capitalisme ; et c'est même
elle qui, par mille influences directes et indirectes, a forte-
ment induit et accéléré le mouvement de bureaucratisation
du capitalisme. Tout s'est passé comme si le monde moderne
couvait la bureaucratie - et que pour la produire il a fait feu
de tout bois, y compris du bois qui y paraissait le moins
approprié, c'est-à-dire du marxisme, du mouvement ouvrier
et de la révolution prolétarienne.
Comme dans le problème de la cohérence de la société, ici
encore il y a une réduction causale que l'on peut et que l'on
une
(17 a) On peut évidemment en discuter à perte de vue. On peut
surtout dire que la révolution n'aurait pas pris la forme d'une saisie
du pouvoir par le parti bolchévik, qu'elle aurait consisté en
réédition de la Commune. Le contenu de telles considérations peut
paraître oiseux. Le fait que l'on ne peut pas les éviter montre que
l'histoire ne peut pas être pensée, même rétrospectivement, en dehors
des catégories du possible et de l'accident qui est plus qu'accident.
(17 b) V. par exemple, dans le n°36 de cette revue, L'Opposition
ouvrière d'Alexandra Kollontaſ, et l'introduction et les notes qui
accompagnent ce texte.
39
en cela
nous
avons
oublié que
doit opérer
et c'est
que consiste une étude à la fois
exacte et raisonnée de l'histoire. Mais cette réduction causale,
on vient de le voir, ne supprime pas le problème. Il y a ensuite
une illusion qu'il faut éliminer : l'illusion de rationalisation
rétrospective. Ce matériel historique, où nous ne pouvons pas
nous empêcher de voir des articulations de sens, des entités
bien définies, à figure pourrait-on dire personnelle
la
guerre du Péloponnèse, la révolte de Spartacus, la Réforme,
la Révolution française c'est lui-même qui a forgé notre
idée de ce qu'est le sens et une figure historique. Ces événe-
ments, ce sont eux qui nous ont appris ce qu'est un événe-
ment, et la rationalité que nous y trouvons après coup ne
nous surprend que parce que
nous l'en l'avions tout d'abord extraite. Lorsqu’Hegel dit à
peù près qu'Alexandre devait nécessairement mourir à trente-
trois ans parce qu'il est de l'essence d'un héros de mourir
jeune et qu'on n'imagine pas un Alexandre vieux, et lorsqu'il
érige ainsi une fièvre accidentelle en manifestation de la
Raison cachée dans l'histoire, on peut observer que précisé-
ment notre image de ce qu'est un héros a été forgée à partir
du cas réel d'Alexandre et d'autres analogues et qu'il n'y a
donc rien de surprenant à ce que l'on retrouve dans l'événe-
ment une forme qui s'est constituée pour nous en fonction de
l'événement. Il y a une démystification du même type à opérer
dans une foule de cas. Mais elle n'épuise pas le problème.
D'abord, parce qu'on rencontre ici aussi quelque chose d'ana-
logue avec ce qui se passe dans la connaissance de la
nature (18) : lorsqu'on a effectué la réduction de tout ce qui
peut apparaître comme rationnel dans le monde physique à
l'activité rationalisante du sujet connaissant, il reste encore
le fait que ce monde a-rationnel doit être tel que cette acti-
vité puisse avoir prise sur lui, ce qui exclut qu'il puisse être
chaotique. Ensuite, parce que le sens historique (c'est-à-dire,
un sens qui dépasse le sens effectivement vécu et porté par
les individus) semble bel et bien pré-constitué dans le maté-
riel que nous offre l'histoire. Pour rester dans l'exemple cité
plus haut, le mythe d'Achille qui lui aussi meurt jeune (et
de nombreux autres héros, qui ont le même sort) n'a pas été
forgé en fonction de l'exemple d'Alexandre (ce serait plutôt
le contraire) (19). Le sens articulé : « Le héros meurt jeune >>
semble avoir fasciné l'humanité depuis toujours, en dépit
à cause de l'absurdité qu'il dénote, et la réalité semble lui
avoir fourni assez de support pour qu'il devienne « évident ».
De même, le mythe de la naissance du héros (20), qui présente
à travers des cultures et des époques très diverses des traits
ou
(18) Ce que Kant déjà appelait « le hasard transcerdantal ».
(19) On sait qu'Alexandre avait «pris, pour modèle » Achille.
(20) V. Le mythe de la naissance du héros, d’O. Rank, et le Moise
de Freud.
40
1
analogues (qui à la fois déforment et reproduisent des faits
réels), et finalement tous les mythes, témoignent de ce que
faits et significations sont mêlés dans la réalité historique
longtemps avant que la conscience rationalisante de l'histo-
rien ou du philosophe n'intervienne. Enfin, parce que l'his-
toire paraît constamment dominée par des tendances, parce
qu'on y rencontre quelque chose comme la « logique interne »
des processus qui confère une place centrale à une signifi-
cation ou complexe de significations (nous nous sommes réfé-
rés plus haut à la naissance et au développement de la bour-
geoisie et de la bureaucratie), relie entre elles des séries de
causation qui n'ont aucune connexion interne et se donne
toutes les conditions « accidentelles » nécessaires. Le premier
étonnement que l'on éprouve, en regardant l'histoire, c'est de
constater qu'en effet, le nez de Cléopâtre eut-il été plus court,
la face du monde aurait été changée. Le deuxième, encore
plus fort, c'est de voir que ces nez ont eu la plupart du temps
les dimensions requises.
Il y a donc un problème essentiel : il y a des significations
qui dépassent les significations immédiates et réellement .
vécues et elles sont portées par des processus de causation qui,
en eux-mêmes n'ont pas signification – ou pas cette signi-
fication-là. Pressenti depuis des temps immémoriaux par
l'humanité, posé explicitement quoique métaphoriquement
dans le mythe et la tragédie (dans laquelle la nécessité prend
la figure de l'accident), il a été clairement envisagé par Hegel.
Mais la réponse que celui-ci fournit, la « ruse de la raison »
qui s'arrange pour faire servir à sa réalisation dans l'histoire
des événements apparemment sans signification n'est évidem-
ment qu'une phrase qui ne résoud rien et qui finalement par-
ticipe de la vieille obscurité des voies de la Providence.
Or le problème devient encore plus aigü dans le marxisme.
Car le marxisme à la fois maintient l'idée de significations
assignables des événements et des phases historiques, affirme
plus qu'aucune autre conception la force de la logique interne
des processus historiques, totalise ces significations en
signification d'ores et déjà donnée de l'ensemble de l'histoire
(la production du communisme) et affirme pouvoir réduire
intégralement le niveau des significations au niveau des causa-
tions. Les deux termes de l'antinomie sont ainsi poussés à la
limite de leur intensité, mais leur synthèse reste purement
verbale. Lorsque Lukács dit, pour montrer que Marx a, à cet
égard aussi, résolu le problème que Hegel n'avait pu que
poser : « La ruse de la raison ne pouvait que rester une
géniale expression métaphorique aussi longtemps que
l'on
n'avait pas montré les facteurs réels (économiques, P. C.) qui
sont à l'ouvre », il ne dit en fait rien. Ce n'est pas seulement
« facteurs réels » sont insuffisants sur le plan de la
une
que ces
41
causation même pour « expliquer » intégralement la produc-
tion des résultats. La question est : comment des facteurs éco-
nomiques peuvent avoir une rationalité qui les dépasse de
loin, comment leur fonctionnement à travers l'ensemble de
l'histoire peut-il incarner une unité de signification qui est
elle-même porteur d'une autre unité de signification à un
autre niveau ? C'est déjà un premier coup de force, de trans-
former l'évolution technico-économique en une « dialectique
des forces productives » ; c'en est un deuxième, de superposer
à cette dialectique une autre qui produit la liberté à partir
de la nécessité ; c'en est un troisième, de prétendre que celle-
ci se réduit intégralement à celle-là. Même si le communisme
se réduisait simplement à une question de développement
suffisant des forces productives, et même si ce développement
résultait inexorablement du fonctionnement de lois objectives
établies avec une certitude totale, le mystère resterait entier :
comment le fonctionnement de lois aveugles peut-il produire
un résultat qui a pour l'humanité à la fois une signification
et une valeur positive ?
De façon encore plus précise et plus frappante, on retrouve
ce mystère dans l'idée marxiste d'une dynamique objective
des contradictions du capitalisme. Plus précise, parce que
l'idée est soutenue par une analyse spécifique de l'économie
capitaliste. Plus frappante, parce qu'on totalise ici une série
de significations négatives. Le mystère semble en apparence
résolu, puisqu'on montre dans le fonctionnement du système
économique les enchaînements de causes et d'effets qui le
conduisent à sa crise et préparent le passage à un autre ordre
social. En réalité, le mystère reste entier. En acceptant l'ana-
lyse marxiste de l'économie capitaliste, nous nous trouverions
devant une dynamique des contradictions unique, cohérente,
et orientée, devant cette chimère que serait une belle ratio-
nalité de l'irrationnel, cette énigme philosophique d'un monde
du non-sens qui produirait du sens à tous les niveaux et réali-
serait finalement notre désir. En fait, l'analyse est fausse et
la projection que contient sa conclusion est évidente. Mais
peu importe ; l'énigme existe effectivement, et le marxisme
ne la résoud pas, au contraire. En affirmant que tout doit être
saisi en termes de causation et qu'en même temps tout doit
être pensé en termes de signification, qu'il n'y a qu'un seul
et immense enchaînement causal, qui est simultanément un
seul et immense enchaînement de sens, il exacerbe les deux
pôles qui la constituent au point de rendre impossible de la
penser rationnellement.
Le marxisme ne dépasse donc pas la philosophie de l'his-
toire, il n'est qu'une autre philosophie de l'histoire. La ratio-
nalité qu'il semble dégager des faits, il la leur impose. La
« nécessité historique » dont il parle (au sens que cette expres-
42
sion a eu couramment, précisément d'un enchaînement de faits
qui conduit l'histoire vers le progrès) ne diffère en rien, philo-
sophiquement parlant, de la Raison hégélienne. Dans les deux
cas, il s'agit d'une aliénation proprement théologique de
l'homme. Une Providence communiste, qui aurait agencé l'his-
toire en vue de produire notre liberté, n'est pas moins une
Providence. Dans les deux cas, on élimine ce qui est le pro-
blème central de toute réflexion : la rationalité du monde
(naturel ou historique), en se donnant d'avance un monde
rationnel par construction. Rien n'est évidemment résolu de
cette façon, car un monde totalement rationnel serait de ce
fait même infiniment plus mystérieux que le monde dans
lequel nous nous débattons. Une histoire rationnelle de bout
en bout et de part en part serait beaucoup plus massivement
incompréhensible que l'histoire que nous connaissons ; sa
rationalité totale serait fondée sur une irrationalité totale,
car elle serait de l'ordre du pur fait et d'un fait tellement
brutal, solide et englobant que nous en étoufferions. Enfin,
dans ces conditions, disparaît le problème premier de la pra-
tique : que les hommes ont à donner à leur vie individuelle
et collective une signification qui n'est pas pré-assignée, et
qu'ils ont à le faire aux prises avec des conditions réelles qui
ni n’excluent ni ne garantissent l'accomplissement de leur
projet.
LA DIALECTIQUE ET LE « MATERIALISME »
Lorsque le rationalisme de Marx se donne une expres-
sion philosophique explicite, il se présente comme dialecti-
que ; et non pas comme une dialectique en général, mais
comme la dialectique hégélienne, à laquelle on aurait enlevé
<< la forme idéaliste mystifiée ».
C'est ainsi que des générations de marxistes ont répété
mécaniquement la phrase de Marx : « chez Hegel, la dialec-
tique était sur la tête ; je l'ai remise sur ses pieds », sans se
demander si une telle opération était vraiment possible et
surtout, si elle était capable de transformer la nature de son
ohjet. Suffit-il de retourner une chose pour en modifier la
substance, le « contenu » de l'hégélianisme était-il donc si
peu relié à sa « méthode » dialectique qu'on pouvait lui en
substituer un autre radicalement opposé - et cela s'agissant
d'une philosophie qui proclamait que son contenu était « pro-
duit » par sa méthode ou plutôt que méthode et contenu
n'étaient que deux moments de la production du système ?
Il n'en est évidemment rien, et si Marx a conservé la dia-
lectique hégélienne, il en a conservé aussi le vrai contenu
philosophique qui est le rationalisme. Ce qu'il en a modifié,
ce n'est que le costume, qui, « spiritualiste » chez Hegel, est
43
« matérialiste » chez lui. Mais, dans cet usage, ce ne sont là
que des mots.
Une dialectique fermée, comme la dialectique hégélienne,
est nécessairement rationaliste. Elle présuppose et « démon-
tre » à la fois que la totalité de l'expérience est exhausti-
vement réductible à des déterminations rationnelles. (Qu'au
surplus, ces déterminations se trouvent chaque fois miracu-
leusement coïncider à la « raison » de tel penseur ou de telle
société, qu'il y ait donc au noyau de tout rationalisme un
anthropocentrisme ou socio-centrisme, qu'autrement dit tout
rationalisme érige en Raison telle raison particulière, cela est
pleinement évident et pourrait clore la discussion). Elle est
Î'aboutissement nécessaire de toute philosophie spéculative et
systématique, qui veut répondre au problème : comment
pouvons-nous avoir une connaissance vraie ? et se donne la
vérité comme système achevé de relations sans ambiguité et
sans résidu. Peu importe à cet égard si son rationalisme prend
une tournure « objectiviste » (comme chez Marx et EngeĪs), le
monde étant rationnel en soi, système de lois sans limite régis-
sant un substratum absolument neutre et notre pénétration
de ces lois découlant du caractère (incompréhensible, faut-il
le dire) de reflet de notre connaissance ; ou s'il prend une
tournure « subjectiviste » (comme dans les philosophies de
l'idéalisme allemand, y compris finalement même chez Hegel),
le monde dont il peut être question (en fait donc l'univers
du discours) étant le produit de l'activité du sujet, ce qui en
garantit du coup la rationalité (20 a).
Réciproquement, toute dialectique rationaliste est néces-
sairement une dialectique fermée. Sans cette fermeture, l'en-
semble du système reste suspendu en l'air. La « vérité » de
chaque détermination n'est rien d'autre que le renvoi à la
totalité des déterminations, sans lequel chacun des moments
du système reste à la fois arbitraire et indéfini. Il faut donc
se donner la totalité sans résidu, rien ne doit rester en dehors,
autrement le système n'est pas incomplet, il n'est rien du tout.
Toute dialectique systématique doit aboutir à une
« fin de
l'histoire », que ce soit sous la forme du savoir absolu de Hegel
ou de ſ’ « homme total » de Marx.
L'essence de la dialectique hégélienne ne se trouve pas
dans l'affirmation que le logos « précède » la nature, encore
moins dans le vocabulaire qui en forme le « vêtement théo-
logique ». Elle gît dans la méthode elle-même, dans le postu-
lat fondamental selon lequel « tout ce qui est réel, est ration-
nel », dans la prétention inévitable de pouvoir produire la
totalité des déterminations possibles de son objet. Cette
(20 a) Des éléments de dialectique « subjectiviste » de ce type se
rencontrent dans les œuvres de jeunesse de Marx, et ils forment la
substance de la pensée de Lukács. On y reviendra plus loin.
44
une
essence ne peut pas être détruite par la remise de la dialec-
tique « sur ses pieds », puisque visiblement il s'agira toujours
du même animal. Un dépassement révolutionnaire de la
dialectique hégélienne exige non pas qu'on la remette sur les
pieds, mais que, pour commencer, on lui coupe la tête.
La nature et le sens de la dialectique hégélienne ne peut
pas, en effet, changer du fait qu'on appellera désormais
« matière » ce que l'on appelait auparavant « logos » ou
« esprit » si du moins par « esprit » on n'entend pas un
Monsieur à barbe blanche demeurant au ciel et si l'on sait
que la nature « matérielle » n'est
pas
masse d'objets
colorés et solides au toucher. Il est complètement indifférent
à cet égard de dire que la nature est un moment du logos,
ou que le logos surgit à une étape donnée de l'évolution de la
matière, puisque dans les deux cas les deux entités sont posées
d'emblée comme de même essence, à savoir d'essence ration-
nelle. D'ailleurs aucune de ces deux affirmations n'a un sens,
puisque personne ne peut dire ce qu'est l'esprit ou la matière
en dehors de définitions purement vides car purement nomi-
nales : la matière (ou l'esprit) est tout ce qui est, etc. La
matière et l'esprit dans ces philosophies ne sont finalement
que de l'Etre pur, c'est-à-dire, comme disait justement Hegel,
du Néant pur. Se dire « matérialiste » ne diffère en rien de
se dire « spiritualiste » si par matière on entend une entité
par ailleurs indéfinissable mais exhausitivement soumise à des
lois consubstantielles et co-extensives à notre raison, et donc
dès maintenant pénétrables par nous en droit (et même en
fait, puisque les « lois de ces lois », les « principes suprêmes
de la nature et de la connaissance » sont d'ores et déjà
ce sont les « principes » ou les « lois de la dialec-
tique », découverts depuis cent cinquante ans et maintenant
même numérotés grâce au camarade Mao Tsé-Toung). Lors-
qu'un astronome spiritualiste, comme Sir James Jeans, dit
que Dieu est un mathématicien, et lorsque des matérialistes
dialectiques affirment farouchement que la matière, la vie et
l'histoire sont intégralement soumises à un déterminisme dont
on trouvera un jour l'expression mathématique, il est triste
de penser que sous certaines conditions historiques les parti-
sans de chacune de ces écoles auraient pu fusiller ceux de
l'autre (et l'ont effectivement fait). Car ils disent tous exacte-
ment la même chose, lui donnant simplement un nom différent.
Une dialectique « non spiritualiste » doit être tout aussi
une dialectique « non matérialiste » au sens qu'elle refuse de
poser un Etre absolu, que ce soit comme esprit, comme
matière ou comme la totalité déjà donnée en droit de toutes
les déterminations possibles. Elle doit éliminer la clôture et
l'achèvement, repousser le système complété du monde. Elle
doit écarter l'illusion rationaliste, accepter sérieusement l'idée
qu'il y a de l'infini et de l'indéfini, admettre, sans pour autant
connus :
45
renoncer au travail, que toute détermination rationnelle laisse
un résidu non déterminé et non rationnel, que le résidu est
tout autant essentiel que ce qui a été analysé, que nécessité
et contingence sont continuellement imbriquées l'une à l'autre,
que la « nature », hors de nous et en nous, est toujours autre
chose et plus que ce que la conscience en construit, - et
que tout cela ne vaut pas seulement pour l' « objet », mais
aussi pour le sujet, et non seulement pour le sujet « empirique »
mais aussi pour le sujet « transcendantal » puisque toute légis-
lation transcendantale de la conscience présuppose le fait brut
qu'une conscience existe dans un monde (ordre et désordre,
saisissable et inépuisable), fait que la conscience ne peut pas
produire elle-même, ni réellement ni symboliquement. Ce n'est
qu'à cette condition qu'une dialectique peut vraiment envisager
l'histoire vivante, que la dialectique rationaliste est obligée
de tuer pour pouvoir la coucher sur les paillasses de ses
laboratoires.
Mais une telle transformation de la dialectique n'est pos.
sible, à son tour, que si l'on dépasse. l'idée traditionnelle et
séculaire de la théorie comme système fermé et comme
contemplation. Et c'était là effectivement une des intuitions
essentielles du jeune Marx.
IV.
LES DEUX ELEMENTS DU MARXISME
ET LEUR DESTIN HISTORIQUE
Il y a dans le marxisme deux éléments dont le sens et le
sort historique ont été radicalement opposés.
L'élément révolutionnaire éclate dans les cuvres de jeu-
nesse de Marx, apparaît encore de temps en temps dans ses
Quvres de maturité, réapparaît parfois dans celles des plus
grands marxistes - Rosa Luxembourg, Lénine, Trotsky –
résurgit une dernière fois chez G. Lukács. Son apparition
représente une torsion essentielle dans l'histoire de l'huma-
nité. C'est lui qui veut détrôner la philosophie speculative en
proclamant qu'il ne s'agit plus d'interpréter, mais de trans-
former le monde, et qu'il faut dépasser la philosophie en
la réalisant. C'est lui qui refuse de se donner d'avance la
solution du problème de l'histoire et une dialectique achevée,
et affirme que le communisme n'est pas un état idéal vers
lequel s'achemine la société, mais le mouvement réel qui sup-
prime l'état de choses existant ; qui met l'accent sur le fait
que les hommes font leur propre histoire dans des conditions
chaque fois données, et qui déclarera que l'émancipation des
travailleurs sera l'oeuvre des travailleurs eux-mêmes. C'est lui
qui sera capable de reconnaître dans la Commune de Paris
ou dans les Soviets russes non seulement des événements insur-
46
rectionnels, mais la création par les masses en action de nou-
velles formes de vie sociale. Peu importe pour l'instant si
cette reconnaissance est restée partielle et théorique ; si les
idées évoquées plus haut ne sont que des points de départ,
soulèvent de nouveaux problèmes ou én enjambent d'autres.
Il y a ici, il faut être aveugle pour ne pas le voir, l'annonce
d'un monde nouveau, le projet d'une transformation radicale
de la société, la recherche de ses conditions dans l'histoire
effective et de son sens dans la situation et l'activité des
hommes qui pourraient l'opérer. Nous ne sommes pas au
monde pour le regarder ou pour le subir ; notre destin n'est
pas la servitude ; il y a une action qui peut prendre appui
sur ce qui est pour faire exister ce que nous voulons être ;
comprendre que nous sommes des apprentis sorciers est déjà
un pas hors de la condition de l'apprenti sorcier, et compren-
dre pourquoi nous le sommes en est un deuxième ; au-delà
d'une activité inconsciente de ses vraies fins et de ses résultats ·
reéls, au-delà d'une technique qui d'après des calculs exacts
modifie un objet sans que rien de nouveau en résulte, il peut
et il doit y avoir une praxis historique qui transforme le
monde en se transformant elle-même, qui se laisse éduquer
en éduquant, qui prépare le nouveau en se refusant à le prédé-
terminer car elle sait que les hommes font leur propre histoire.
Mais ces intuitions resteront des intuitions, elles ne
seront jamais vraiment développées (21). L'annonce du monde
nouveau sera rapidement étouffée par le foisonnement d'un
deuxième élément qui sera développé sous forme de système,
qui deviendra rapidement prédominant, qui relèguera le pre-
mier dans l'oubli ou ne l'utilisera rarement
que comme
alibi idéologique et philosophique. Ce deuxième élément est
celui qui réaffirme et prolonge la culture et la société capita-
listes dans ses tendances les plus profondes, même s'il le fait
à travers la négation d'une série d'aspects apparemment (et
réellement) importants du capitalisme. C'est celui qui réalise
le passage à la limite du capitalisme, qui tisse ensemble la
logique sociale du capitalisme et le positivisme des sciences
du xixe siècle. C'est lui qui fait comparer à Marx l'évolution
sociale à un procés naturel (22), qui met l'accent sur le
(21) Sauf, jusqu'à un certain point, par G. Lukács (dans Histoire
et Conscience de classe). Il est du reste frappant que Lukács, lors-
qu'il rédigeait les essais contenus dans ce livre, ignorait quelques-
uns des manuscrits de jeunesse les plus importants de Marx (notam-
ment le manuscrit de 1844 intitulé Economie Politique et Philoso-
phie et l'idéologie allemande), qui n'ont été publiés qu'en 1925 et 1931.
(22) Dans la deuxième préface au Capital, Marx cite, en la quali-
fiant d' «excellente », la description de sa « véritable méthode s par
Le courrier européen de Saint-Pétersbourg, qui affirmait notamment :
« Marx considère l'évolution sociale comme un procés naturel régi
par des lois qui ne dépendent pas de la volonté, de la conscience
ni de l'intention des hommes, mais les déterminent au contraire ».
(Le Capital, éd. Costes, vol. I, p. XCII).
47
déterminisme économique, qui salue dans la théorie de Darwin
une découverte parallèle à celle de Marx (23). Comme tou-
jours, ce positivisme scientiste se renverse immédiatement en
rationalisme et en idéalisme dès qu'il pose les questions der-
nières et qu'il y répond. L'histoire est système rationnel soumis
à des lois données, dont on peut dès maintenant définir les
principales. La connaissance forme système, déjà possédé dans
son principe ; il y a certes progrès « asymptotique » (24), mais
celui-ci est vérification et raffinement d'un noyau solide de
vérités acquises, les « lois de la dialectique ». Corrélativement,
le théorique garde sa place éminente, son caractère premier
quels que soient les invocations de l' « arbre vert de la
vie », les renvois à la pratique comme vérification ultime (25).
Tout se tient dans cette conception : analyse du capita-
lisme, philosophie générale, théorie de l'histoire, statut du
prolétariat, programme politique. Et les conséquences les plus
extrêmes en découlent en bonne logique, et en bonne his-
toire aussi comme l'expérience l'a montré depuis un demi-
siècle. Le développement des forces productives commande le
reste dans la vie sociale. Dès lors, même s'il n'est pas fin ulti-
me en soi, il est fin ultime en pratique puisque le reste en est
déterminé et en découle « par surcroît », puisque « le royaume
de la liberté ne peut s'édifier que sur le royaume de la néces-
(23) Comparaison faite plusieurs fois par Engels. Cela ne veut
pas dire évidemment que l'on puisse sous-estimer l'importance de
Darwin dans l'histoire de la science, ni même dans celle des idées
en général.
(24) C'est l'idée qu'exprime Engels à plusieurs reprises, notam-
ment dans l'Anti-dühring. Idée qui recouvre un crypto-kantisme
bizarre et honteux, et qui est en contradiction ouverte avec toute
« dialectique ».
(25) Lukács a montré très justement que la pratique telle que
l'entend Engels, c'est-à-dire « l'attitude propre à l'industrie et à
l'expérimentation » est « le comportement le plus proprement contem-
platif » (Histoire et conscience de classe, p. 168). Mais, jetant lui aussi
le voile des fils de Noë sur la nudité du père, il laisse entendre
implicitement qu'il s'agit là d'une erreur personnelle d'Engels, qui
sur ce point aurait été infidèle au véritable esprit de Marx. Or ce
que pensait Marx et même le jeune Marx n'était nullement diffé-
rent : « La question de savoir si la vérité objective revient à la pen-
sée humaine n'est pas une question théorique, mais une question
pratique. Dans la pratique, l'homme doit démontrer la vérité. c'est-
à-dire la réalité et la puissance, l'en-deçà de sa pensée. La querelle
sur la réalité ou la non-réalité de la pensée isolée de la pratique
est une question purement scolastique ». (IIe Thèse sur Feuerbach).
Visiblement dans ce texte il ne s'agit pas exclusivement ou même
essentiellement de la praxis historique au sens de Lukács, mais de
la « pratique » en général, y compris de l'expérimentation et de
l'industrie, comme d'ailleurs le montrent d'autres passages des textes
de jeunesse. Or, non seulement cette pratique reste, comme le rap-
pelle Lukács, à l'intérieur de la catégorie de la contemplation ; elle
ne peut jamais être une vérification de la pensée en général, une
« démonstration de la réalité de la pensée ». Elle nous fait
jamais rencontrer qu'un autre phénomène, il n'est pas question qu'elle
permette de dépasser la problématique, kantienne.
ne
48
sité » (26), qu'il présuppose l'abondance et la réduction de la
journée de travail et celles-ci un degré donné de développe-
ment des forces productives. Ce développement, c'est le
progrès. Certes, l'idéologie vulgaire du progrès est dénoncée
et tournée en dérision, on montre que le progrès capitaliste
se base sur la misère des masses. Mais cette misère elle-même
fait partie d'un processus ascendant. L'exploitation du prolé-
tariat est justifiée « historiquement », aussi longtemps que
la bourgeoisie en utilise les fruits pour accumuler et continue
ainsi son expansion économique. La bourgeoisie, classe exploi-
teuse dès le début, est classe progressive aussi longtemps qu'elle
développe les forces productives (27). Dans la grande tradition
réaliste hégélienne, non seulement cette exploitation mais tous
les crimes de la bourgeoisie, décrits et dénoncés à un certain
niveau, sont récupérés par la rationalité de l'histoire à un
autre et finalement, puisqu'il n'y a pas d'autre critère, justi-
fiés. « L'histoire universelle n'est pas le lieu de la félicité »,
disait Hegel.
On s'est souvent demandé comment des marxistes avaient-
ils pu être staliniens. Mais si les patrons sont progressifs, à
condition qu'ils bâtissent des usines, comment des commissaires
qui en bâtissent autant et plus ne le seraient-ils pas (27 a) ?
Quant à ce développement des forces productives, il est univo-
que et univoquement déterminé par l'état de la technique. Il
n'y a qu'une technique à une étape donnée, il n'y a donc aussi
qu'un seul ensemble rationnel de méthodes de production. Il
n'est pas question, cela n'a pas de sens, d'essayer de développer
une société par des voies autres que l' « industrialisation »
terme en apparence neutre, mais qui finalement accouchera de
tout son contenu capitaliste. La rationalisation de la production,
c'est la rationalisation créée déjà par le capitalisme, la souve-
raineté de l' « économique » dans tous les sens du terme, la
(26) Le Capital, éd. Costes, vol. XIV, pp. 114-115.
(27) Corrélativement, elle ne cesse de l'être que lorsqu'elle freine
leur développement. Cette idée revient sans cesse sous la plume des
grands classiques du marxisme (à commencer par Marx lui-même),
sans parler des épigones. Que devient cette idée aujourd'hui, lorsque
l'on constate que depuis vingt-cinq ans le capitalisme a développé
les forces productives plus que ne l'avaient fait les quarante siècles
précédents ? Comment un marxiste peut-il parler aujourd'hui de
perspective révolutionnaire en restant marxiste, et donc en affir-
mant en même temps qu' « une société ne disparaît jamais avant
que soient développées toutes les forces productives qu'elle est assez
large pour contenir » (Marx, Fréface à la Contribution à la critique
de l'économie politique, l. c, p. 6) ? Cela ni Nikita Khrouchtchev,
ni les « gauchistes » de tout poil n'ont jamais pris la peine de
l'expliquer.
(27 a) Nous ne voulons évidemment pas dire que la bourgeoisie
n'a pas été « progressive », ni que le développement des forces pro-
ductives est réactionnaire ou intérêt. Nous disons qu'entre
tes deux choses il n'y a pas de rapport simple, et qu'on ne peut sans
plus faire correspondre la « progressivité » d'un régime à sa capacité
de faire avancer les forces productives, comme le fait le marxisme.
sans
49
quantification, le plan qui traite les hommes et leurs activités
comme des variables mesurables. Réactionnaire sous le capi-
talisme dès lors que celui-ci ne développe plus les forces pro-
ductives et ne s'en sert que pour une exploitation de plus en
plus « parasitaire », tout cela devient progressif sous la dicta-
ture du prolétariat ». Cette transformation « dialectique » du
sens du taylorisme, par exemple, sera explicitée par Trotsky
dès 1919 (28). Que cette situation laisse subsister quelques
problèmes philosophiques, puisqu'on ne voit pas dans ces condi-
tions comment des « infrastructures » identiques peuvent sou-
tenir des édifices sociaux opposés ; qu'elle laisse aussi subsis-
ter quelques problèmes réels, pour autant que les ouvriers
insuffisamment mûrs ne comprennent pas la différence qui
sépare le taylorisme des patrons et celui de l'Etat socialiste,
peu importe. On enjambera les premiers à l'aide de la « dialec-
tique », on fera taire les seconds à coups de fusil. L'histoire
universelle n'est pas le lieu de la subtilité.
Enfin, s'il y a une théorie vraie de l'histoire, s'il y a une
rationalité à l'oeuvre dans les choses, il est clair que la direc-
tion du développement doit être confiée aux spécialistes de
cette théorie, aux techniciens de cette rationalité. Le pouvoir
absolu du Parti – et, dans le Parti, des « coryphées de la
science marxiste-leniniste » selon l'admirable expression forgée
par Staline à son propre usage - a un statut philosophique ;
il est fondé en raison dans la « conception matérialiste de
l'histoire » beaucoup plus véritablement que dans les idées de
Kautsky, reprises par Lénine, sur < l'introduction de la
conscience socialiste dans le prolétariat par les intellectuels
petits-bourgeois ». Si cette conception est vraie, ce pouvoir
doit être absolu, toute démocratie n'est que concession à la
faillibilité humaine des dirigeants ou procédé pédagogique
dont eux seuls peuvent administrer les doses correctes. L'alter-
native est en effet absolue. Ou bien cette conception est vraie,
donc définit ce qui est à faire, et ce que les travailleurs font
ne vaut que pour autant qu'ils s'y conforment ; ce n'est pas
la théorie qui pourrait s'en trouver confirmée ou infirmée, car
le critère est en elle, ce sont les travailleurs qui montrent
s'ils se sont ou non élevés à « la conscience de leurs intérêts
historiques » en agissant conformément aux mots d'ordre qui
concrétisent la théorie dans les circonstances (29), ou bien,
l'activité des masses est un facteur historique autonome et
créateur, auquel cas toute conception théorique ne peut être
(28) Terrorisme et communisme, éd. 10-18, p. 225. ·
(29) Certes, les mots d'ordre peuvent être erronés, car les dirigeants
se sont trompés dans l'appréciation de la situation, et notamment
dans l'appréciation du degré de conscience et de combativité des tra-
vailleurs. Mais cela ne modifie pas la logique du problème : les
travailleurs apparaissent toujours comme une variable à estimation
incertaine dans l'équation que les dirigeants ont à résoudre.
50
qu'un chaînon dans le long processus de réalisation du projet
révolutionnaire ; elle peut, elle doit même, s'en trouver boule-
versée. Alors la théorie ne se donne plus d'avance l'histoire
el ne se pose plus comme étalon du réel, mais accepte d'entrer
vraiment dans l'histoire et d'être bousculée et jugée par
elle (30). Alors aussi tout privilège historique, tout « droit
d'aînesse » est dénié à l'organisation basée sur la théorie.
Ce statut majoré du Parti, conséquence inéluctable de la
conception classique, trouve sa contrepartie dans ce qui est,
malgré les apparences, le statut minoré du prolétariat. Si
celui-ci a un rôle historique privilégié, c'est parce que, classe
exploitée, il ne peut à la fin que lutter contre le capitalisme
dans un sens prédéterminé par la théorie. C'est aussi parce:
que, placé au coeur de la production capitaliste, il forme dans
la société la force la plus grande et que, « dressé, éduqué,
discipliné » par cette production, il est porteur de cette disci-
pline rationnelle par excellence. Il compte non pas en tant
que créateur de formes historiques nouvelles, mais en tant
que matérialisation humaine du positif capitaliste, débarrassé
de son négatif : il est « force productive » par excellence, sans
rien avoir en lui qui puisse entraver le développement des
forces productives.
Ainsi l'histoire se trouvait encore une fois avoir produit
autre chose que ce qu'elle semblait préparer : sous le couvert
d'une théorie révolutionnaire, s'était constituée et développée
l'idéologie d'une force et d'une forme sociale qui était encore
à naître l'idéologie de la bureaucratie.
Il n'est pas possible de tenter ici une explication de la
naissance et de la victoire de ce deuxième élément dans le
marxisme ; cela exigerait de reprendre l'histoire du mouve-
ment ouvrier et de la société capitaliste depuis un siècle. On
peut simplement résumer brièvement ce qui nous paraît en
avoir été les facteurs décisifs. Le développement du marxisme
comme théorie s'est fait dans l'atmosphère intellectuelle et
philosophique de la deuxième moitié du XIXe siècle ; celle-ci
a été dominée, comme aucune autre époque de l'histoire, par
le scientisme et le positivisme, triomphalement portés par
l'accumulation de découvertes scientifiques, leur vérification
expérimentale, et surtout, pour la première fois à cette échelle,
« l'application raisonnée de la science à l'industrie ». L'appa-
rente toute-puissance de la technique était quotidiennement
« démontrée », la face de pays entiers se transformant rapi-
(30) Combien cette conception est étrangère aux marxistes le
montre le fait que, pour les plus «purs » parmi eux, l'histoire réelle
es! vue implicitement comme si elle avait « déraillé » depuis 1939
ou même depuis 1923, puisqu'elle ne s'est pas déroulée sur les rails
posés par la théorie. Que la théorie pourrait tout aussi bien avoir
déraillé depuis bien plus longtemps, cela ne leur traverse jamais
l'esprit.
51
en
dement par l'extension de la révolution industrielle ; ce qui,
dans le progrès technique, nous apparaît aujourd'hui non seu-
lement comme ambivalent, mais même comme indéterminé
quant à sa signification sociale, n'émergeait pas encore. L'éco-
nomie se donnait comme l'essence des relations sociales et le
problème économique comme le problème central de la société.
Le milieu offrait aussi bien les matériaux que la forme pour
une théorie « scientifique » de la société et de l'histoire ; il
l'exigeait même, et en prédéterminait largement les catégo-
ries dominantes. Mais le lecteur qui a compris ce que nous
avons voulu dire dans les pages qui précèdent, comprendra
aussi que nous ne pouvons pas penser que ces facteurs four-
nissent « l'explication » du destin du marxisme. Le destin
de l'élément révolutionnaire dans le marxisme ne fait qu'ex-
primer, au niveau des idéologies, le destin du mouvement
révolutionnaire dans la société capitaliste jusqu'à maintenant.
Dire que le marxisme, depuis un siècle, s'est graduellement
transformé une idéologie qui a sa place dans la
société existante, c'est simplement dire que le capitalisme
a pu se maintenir et même s'affermir comme système social,
qu'on ne peut pas concevoir une société où s'affirme à la
longue le pouvoir des classes dominantes et où, simultanément,
vit et se développe une théorie révolutionnaire. Le devenir
du marxisme est indissociable du devenir de la société dans
laquelle il a vécu.
Ce devenir est irréversible, et il ne peut y oir de « restau-
ration » du marxisme dans sa pureté originelle, ni de retour
« bonne moitié ». On rencontre parfois encore des
« marxistes » subtils et tendres (qui en règle générale ne se
sont jamais occupés de politique, de près ou de loin) pour
qui, étonnamment, toute l'histoire subsequente est à compren-
dre à partir des textes de jeunesse de Marx et non pas ces
textes de jeunesse à interpréter à partir de l'histoire ulté-
rieure. Ainsi veulent-ils maintenir la prétention que le
marxisme a « dépassé » la philosophie, en l'unifiant aussi bien
à l'analyse concrète (économique) de la société qu'à la pra-
tique, et que pour autant il n'est plus et même n'a jamais
pu être une spéculation ou un système théorique. Ces préten-
tions (qui s'appuient sur une certaine lecture de quelques
passages de Marx et sur l'oubli d'autres infiniment plus nom-
breux), ne sont pas « fausses il y a dans ces idées des
germes dont nous avons dit plus haut qu'ils sont essentiels.
Mais ce qu'il faut voir, ce n'est pas seulement que ces germes
ont été recouverts pa un gel de cent ans. C'est que, dès qu'on
dépasse le stade des inspirations, des intuitions, des inten-
tions programmatiques dès que ces idées doivent s'incar-
ner, devenir la chair d'une pensée qui tente d'embrasser le
monde réel et animer une action, ce qui était la belle unité
nouvelle se dissout. Elle se dissout, car ce qui devait être une
vers
sa
52
description philosophique de la réalité du capitalisme,
l'intégration de la philosophie et de l'économie, se décompose
en deux phases, une résorption de la philosophie par une
économie qui n'est que de l'économie, et une réapparition
illégitime de la philosophie au bout de l'analyse économique.
Elle se dissout car ce qui devait être l'union de la théorie et
de la pratique se dissocie dans l'histoire réelle entre une
doctrine rigidifiée à l'état où l'a laissée la mort de son fonda-
teur, et une pratique à laquelle cette doctrine sert, au mieux,
de couverture idéologique. Elle se dissout car, en dehors de
quelques rares moments (comme 1917) dont l'interprétation
d'ailleurs reste à faire et n'est nullement simple, la praxis est
restée un mot et que le problème du rapport entre une acti-
vité qui se veut consciente et l'histoire effective, comme du
rapport entre les révolutionnaires et les masses, demeure
entier.
S'il peut y avoir une philosophie qui soit autre chose et
plus que la philosophie, cela reste à démontrer. S'il peut y
avoir une politique qui soit autre chose et plus que de la
politique, cela le reste également. S'il peut y avoir une union
de la réflexion et de l'action, et si cette réflexion et cette
action, au lieu de séparer ceux qui les pratiquent et les autres,
les emportent ensemble vers une nouvelle société, cette union
reste à faire. L'intention de cette unification était présente à
l'origine du marxisme. Elle est restée une simple intention
mais, dans une nouveau contexte, elle continue, un siècle
après, de définir notre tâche.
Paul CARDAN.
ce
(Les deux dernières parties de texte,
« Bilan
provisoire » et « Le statut d'une théorie révolutionnaire »,
seront publiées dans le prochain numéro de Socialisme ou
Barbarie).
53
1
DISCUSSIONS
M. Garaudy, Kafka
et le problème de l'aliénation
(A propos de l'essai : D'un réalisme sans rivages*)
ne
sommes
NOTE DE LA REDACTION. Il est sans doute superflu de présenter aux
lecteurs de SOCIALISME OU BARBARIE, le D' Joseph Gabel, un des rares penseurs
qui ont tenté, pendant les vingt dernières années, de maintenir vivants les
éléments les plus féconds de la théorie marxiste et de les appliquer à des
problèmes neufs. Nous comptons, du reste, publier dans un de nos prochains
numéros, une analyse critique de son important ouvrage LA FAUSSE CONSCIENCE
(Editions de Minuit, 1963).
Nous sommes donc heureux de publier son essai qu'on va lire. Qu'il
nous soit simplement permis d'ajouter que nous
pas forcément
d'accord avec l'ensemble des points de vue qu'il exprime. Nous pensons
notamment qu'il surestime la portée des tendances qui produisent actuellement,
dans le monde communiste, ce qu'il appelle la « désaliénation », ou, plus
exactement, la nature et la signification du reflet qu'en offre l'appareil officiel
des partis communistes lorsque, par exemple, il pense que de ce fait, « une
saisie dialectique du réel redevient possible » (de la part des communistes). Que
le monde stalinien comme le monde capitaliste soit obligé de bouger,
c'est sûr ; que la réification intégrale des dirigeants et du système ne peut
représenter qu'un moment limite, nous l'avons depuis longtemps dit ici même.
Il n'en résulte pas que cela constitue une « désaliénation » sans plus ; et sur-
tout, de la part de l'appareil dirigeant, l' « adaptation » à la nouvelle situation
obéit toujours au même impératif, du maintien de sa domination. Ce maintien
n'est plus possible par la simple contrainte totalitaire, celle-ci doit être remplacée
par une manipulation plus subtile. Mais il serait, à notre avis, erroné et grave
de laisser penser que cela pourrait conduire à une « renaissance idéologique »
du communisme. Une telle renaissance ne serait possible qu'à condition que
l'appareil en question soit brisé et éliminé. C'est d'ailleurs ce qui permet de
comprendre indépendamment de toute considération de personnes la
pauvreté et la platitude extrême des essais de Garaudy. Est-ce un hasard, si
après la « langue de bois » stalinienne, les ex-staliniens mal déstalinisés ne
puissent se servir que d'une langue de coton ?
« De quel humour est capable l'histoire : l'antistali-
nisme volé aux anti-staliniens, par les staliniens. Ils
ne savaient rien à l'époque, ils étaient trop candides,
trop confiants, trop fervents. Il fallait être hypocrite,
fasciste, pour croire à de telles horreurs. Il faut
manquer de pudeur pour se féliciter d'avoir été
anti-stalinien du temps de Staline » (Edgar Morin
« Etudes » (Bruxelles), nº 3, 1963, p. 12).
Plon, 1963.
54
se
F'endant des décennies, le problème de l'aliénation a fait pour
les marxistes dogmatiques, figure de sujet tabou. Il n'y a pas très
longtemps encore bien après la mort de Staline, en tout cas
H. Lefebvre s'est vu rappeler à l'ordre dans une revue philosophique
russe pour avoir accordé une attention exagérée à cette question
impure.
En effet je reprends ici la formule même dont sert
H. Lefebvre « le drame de l'aliénation est «dialectique » (1). Nulle
critique valable, nulle prise de conscience réelle de fait de l'aliénation
ne saurait avoir lieu hors d'un contexte dialectique ; pour tout un
courant de la psychanalyse contemporaine, l'acte thérapeutique
(désaliénant) du psychanalyste consiste essentiellement en l'acte de
dialectisation de la conscience morbide prisonnière d'une existence
purement spatiale (2). Le concept d'aliénation est littéralement vide
de sens en dehors des cadres d'une pensée dialectique. Or, toute l'his-
toire idéologique du stalinisme n'est guère qu'un long et patient effort
pour éliminer tout élément dialectique du marxisme quitte à justifier
généralement à l'aide d'accusations d'irrationalisme ou d'idéalisme
cette dé-dialectisation. C'est M. R. Garaudy lui-même qui s'est
chargé de nous fournir la somme ou si l'on veut : l'indigeste
de ce courant idéologique : La Théorie matérialiste de la connais-
sance (3) « ouvrage peu documenté et peu critique qui expose un
matérialisme marxiste dénué de tout élément dialectique vérita-
ble... » (4). Jusqu'en 1953 il était difficile d'être dialecticien sans
passer pour idéaliste, être sensible au problème de l'aliénation à
la manière des surréalistes par exemple sans faire figure d'apolo-
giste honteux de la décadence bourgeoise. Dans l'univers cristallin
du manichéisme stalinien un univers de détenteurs de vérités
révélées et de déviationnistes au service de la police une véritable
critique de l'aliénation , même portant exclusivement sur la
conscience politique de l'adversaire ! ne saurait avoir de droit de
cité. Une idéologie profondément aliénée elle-même, n'est jamais en
mesure de contenir une théorie sociologique et critique de l'alié-
nation ; dénoncer la mauvaise foi de l'adversaire et exalter impli-
citement la vérité définitive du point de vue propre constitue la
technique de confort intellectuel, correspondant à besoins.
Le manichéisme est certes une manifestation de l'aliénation poli-
tique mais il ne saurait y avoir une théorie manichéenne de l'alié-
nation. Dans les cadres du stalinisme l'aliénation tend ainsi à devenir
un mythe (5).
ses
(1) « Critique de la vie quotidienne », Paris 1947, p. 111.
(2) Cf. les travaux de Gisèle Pankow qui se rattachent à la tradi-
tion psychanalytique, mais aussi à la pensée d’E. Minkowski. Cf.
aussi certains aspects de la pensée de Jacques Lacan. Plutôt que de
résumer ici ces théories nous nous permettrons de renvoyer à notre
ouvrage La Fausse Conscience. (Editions de Minuit, 1962), p. 11;
note 5 pour Lacan, pp. 176-77 pour Pankow. Nous y avons tenté
d'élaborer une théorie dialectique de l'aliénation clinique (Interpré-
tation de la schizophrénie comme forme individuelle de la conscience
réifiée).
(3) Paris, P. U. F. 1954. Mais cet ouvrage n'est que l'une des deux
« sommes » de la dite tendance, l'autre étant hélas ! La Destruc-
tion de la Raison, de G. Lukács !
(4) Calvez : La pensée de Karl Marx, Paris (Seuil), 1956, p. 648.
(5) De même le stricte physiologisme de la psychiatrie russe sous
Staline, visait en somme à écarter toute position indiscrète du pro-
blème de l'aliénation à l'échelle individuelle et notamment toute
analyse structurelle de la pensée délirante. Cf. la collection de la
revue La Raison passim.
55
Ce merveilleux confort intellectuel de l'univers manichéen appar-
tient désormais et de façon irréversible espérons-le au passé.
Les temps et les idées ont changé radicalement ; pour le sociologue
de la connaissance le fait qu'une certaine renaissance de la dialec-
tique ait marché de pair avec un regain d'actualité du problème de
l'aliénation, n'est aucunement un fait du hasard. C'est en effet la
réhabilitation discrète de certaines grandes doctrines dialectiques
qui a inauguré ce processus dès 1954 : la relativité a cessé de faire
figure de « machisme » idéaliste, la psychanalyse d'être considérée
comme une doctrine policière destinée à justifier le racisme améri-
cain ! (6). Demain nous assisterons à la réhabilitation de la Gestalt,
de Binswanger, de Moreno ; d'ici là, M. Garaudy aura eu le temps
d'oublier les pages de sa thèse (7) où il a exécuté la Gestalt comme
doctrine idéaliste. La remise en honneur de la théorie de l'aliénation
devait s'en suivre logiquement et il est permis une fois n'est pas
coutume ! de faire écho à L. Aragon qui célèbre dans la parution
de l'essai de R. Garaudy un événement d'importance. Ce n'est pas un
grand ouvrage, il s'en faut, sa publication chez un éditeur bour-
geois !
marque cependant une étape : celle de la prise de
conscience par le marxisme communiste de l'importance du problème
de l'alienation. Certes, H. Lefebvre s'est souvent intéressé à l'alié-
nation mais nous lui devons bien ce compliment qu'en tant que
penseur, il n'a jamais parlé qu'en son propre nom. La voix de
M. Garaudy est en revanche His masters voice. Avec lui c'est le parti
communiste qui commence à s'intéresser à cette question cruciale ;
c'est là un fait nouveau dont il est impossible de méconnaître
l'importance.
*
Isaac Deutscher a sans doute été un précurseur dans cette ques-
tion : au moment de la publication en 1954 de son livre : La Russie
après Staline, on tendait encore assez généralement à considérer la
détente comme un fait relevant de la seule politique étrangère sovié-
tique, sans cause véritablement sociologique (la mort de Staline ne
serait être qualifiée de cause sociologique !) sans incidence structu-
relle sur la conscience politique ou l'idéologie. Selon Deutscher le
progrès de l'industrialisation aurait fait reculer la magie primitive
de la conscience politique soviétique ; la mort de Staline aurait été
en somme une cause occasionnelle, rendant possible la percée d'un
processus sous-jacent. Il eut donc le mérite de percevoir le phéno-
mène de la détente dans une optique historiciste (8) ; quant à l'aspect
causal de son explication, il est permis de formuler des réserves.
Cette explication octroie en effet une vertu désaliénante autonome
au processus d'industrialisation, ce qui reste à prouver. La décen-
tration de puissance dans le camp socialiste a sans doute joué le rôle
du véritable primum movens : l'avènement du « socialisme polycen-
trique » a brisé le schéma manichéen et réifié de la vision du monde
du stalinisme, schéma qui avait marqué de son empreinte natu-
rellement dans le sens d'une dédialectisation extrême toute la
base logique de cette idéologie (9). Le jour où la perception dualiste
(6) Ces tristes âneries ont été bel et bien imprimées notam-
ment dans la revue La Raison, entre 1951 et 1954.
(7) La Théorie matérialiste de la Connaissance, pp. 163-168.
(8) « Historiciste » dans le sens de Mannheim (cf. son
essai
Historismus paru en 1924 dans l'Archiv f. Sozialwissenschaft) c'est-
à-dire fonctionalisé selon une totalité historique concrète.
(9) J'ai signalé cette incidence gnoséo-sociologique de la polycentr -
sation du camp socialiste dans un article paru en 1958 (« Commu-
56
non
de l'univers cède à la pression des réalités, une saisie dialectique
redevient possible. La véritable signification historique de Khroucht-
chev n'est pas d'avoir atténué une terreur policière dont il avait été
lui-même un artisan, mais d'avoir « pris conscience >>
sans
quelque lucidité, de la nouvelle réalité polycentrique alors que' Staline
a entraîné son monde dans une réaction de défense de structure
proprement délirante (10). Il ne s'agit donc ni de dégel, ni de revi-
sionnisme (11), mais de quelque chose de tout autrement précis :
d'un processus de désaliénation politique. La parution de l'essai de
R. Garaudy marque le moment, important pour l'histoire idéologique,
où ce processus est assez avancé pour rendre sociologiquement
possible la position théorique du problème de l'aliénation en général.
Il existe en effet une profonde parenté entre la signification de
l'euvre de Kafka et celle de Georges Lukács. L'univers de Kafka
est très exactement celui décrit dans Histoire et Conscience
de Classe mais vu dans l'optique et analysé par les moyens propres
du romancier. Les années se situant autour de 1920 ont été comme
l'a observé un jour Georges Lapassade (12) particulièrement
fertiles en cuvres « désaliénantes » : Lukács, Kafka, Moreno et son
« psychodrame », mouvement surréaliste ; j'y ajouterai l'essai
oublié de Paul Szende : Verhüllung und Enthüllung (paru en
1922). Même certains aspects de l'euvre de V. Pareto « désalié-
nateur » de droite appartiennent à ce contexte. Kafka est porté par
cette vague en étant sans doute son représentant par excellence ; la
philosophie implicite de son cuvre transcende de loin une critique,
pourtant exempte d'indulgence, de la réalité sociale de son temps,
nisme et Dialectique ». Les Lettres Nouvelles, 1958). Plutôt que
la structure sociale et économique de la Russie, c'est sa position
dans l'intérieur du camp socialiste qui a changé ; la nouvelle impor-
tance de la Chine et à un moindre degré, le succès des entreprises
titiste et gomulkiste, ont partiellement compromis la situation « privi-
légiée » de la Russie, sapant ainsi l'une des bases du sociocentrisme »
(Art. cit. p. 565, avril 1958). Anotre sens c'est là le véritable
« secret sociologique » du processus de désaliénation qui a lieu dans
le camp socialiste.
L'action désaliénante du progrès technique, invoquée implicite-
ment par Deutscher, a pu jouer un rôle réel, mais à notre sens
secondaire. Cette théorie pose au demeurant un curieux problème,
car le progrès technique n'est pas un privilège du camp socialiste.
Elle fournit donc la clé du phénomène néo-capitaliste compris comme
une forme moins réifiée du système capitaliste. Cf. à ce propos
l'article de P. Cardan, dans « Socialisme et Barbarie », nºs 31 à 33.
(10) Que l'on songe à l' « identification » Tito-Franco courante à
l'époque, ou encore aux manifestations délirantes de l'antisionisme
en U. R. S. S. comme le trop fameux procès des « assassins en blouse
blanche ». C'était de la schizophrénie pure.
(11) On parle un peu à tort et à travers de revisionnisme
à ce sujet. Le terme « désaliénation » désigne un processus histori-
que précis : retour à la dialectique et prise de conscience consécu-
tive de l'actualité du « problème dialectique de l'aliénation. Son
usage implique donc une critique persistante du stalinisme. Le terme
« revisionnisme » implique en revanche la supposition gratuite que
Marx a été un stalinien avant la lettre et le stalinisme n'est en somme
que l'épanouissement pratique » des doctrines de Marx. Son emploi
constitue donc une justification marxiste du stalinisme tout
prétendant dépasser les deux. Il consacre donc une mystification. Le
seul emploi légitime du terme « revisionnisme » est celui qui désigne
le mouvement d'Edouard Bernstein en Allemagne vers 1900.
(12) Dans une conférence chez les Jeunes Socialistes vers 1961.
en
57
pour déboucher sur une dénonciation générale de toutes les formes
d'aliénation ou de réification sans exception aucune. Cette cuvre
constitue donc M. Carrouges l'a bien vu dès 1948 (13) une
critique anticipée de l'aliénation politique dite « de gauche » : du
stalinisme. Il est permis d'en dire autant d'Histoire et Conscience
de Classe. Le mécanisme de sociologie de connaissance qui
a conduit autrefois le marxisme officiel à rejeter l'œuvre de Kafka
et celui qui a présidé à la disgrâce de Lukács est le même : un
contexte politique profondément aliéné ne saurait admettre la
position même purement théorique voire exclusivement littéraire
du problème de l'aliénation (14). L'accusation d'idéalisme formulé
à l'encontre de Lukács, celle d'être le reflet de la décadence bourgeoise,
à l'adresse de Kafka, ne sont guère que des théories de couverture
(Verhüllungstheorien) destinées à masquer la raison gnoséo-sociolo-
gique fondamentale mais inavouable de ce rejet, Ces mécanismes de
barrage ne semblent plus jouer en 1963 ; nous sommes là indiscutable-
ment en présence d'un fait capital et c'est en même temps la raison qui
nous fait considérer la date de parution de l'essai médiocre de
R. Garaudy comme une date importante. Nous assistons à une sorte
de consolidation » de la déstalinisation ;
conscience à travers de Kafka, de l'actualité du problème de l'alié-
nation, le marxisme officiel risque de rendre irréversible son rejet
du stalinisme (15).
de
< cure
en
prenant
On souhaiterait qu'un ouvrage porteur d'une signification objec-
tive de cette envergure en soit digne de par son originalité ou le
niveau philosophique de sa réflexion. Or, Garaudy continue d'utiliser
ces concepts passe-partout qui proviennent directement de l'arsenal
idéologique du stalinisme et, pour autant qu'il les dépasse il n'ap-
porte rien d'original, rien qu'on ne puisse déjà trouver chez les
auteurs qui se sont déjà occupé depuis des années de la question, et
dont M. Garaudy fait mine d'ignorer les travaux.
On aurait, par exemple, vu avec satisfaction, ne serait-ce qu'en
gage d'une déstalinisation littéraire, figurer en bas de page une
référence à l'excellent ouvrage du regretté André Németh : Kafka ou
le mystère juif (16) qui pose précisément le problème des racines
juives de la pensée de Kafka et aussi celui de ses rapports avec
l'existentialisme : deux thèmes importants de la recherche de
M. Garaudy. Le deuxième est d'ailleurs résolu d'autorité à l'aide
d'une sentence définitive ; « L'amour et le mariage peuvent être
le lien avec l'existence authentique. C'est ce qui exclut l'interpré-
tation existentialiste de Kafka : la liberté est dans le lien et non
dans sa rupture » (17). De quel « existentialisme » s'agit-il ? de
(13) Carrouges, Op cit, p. 75 sq.
(14) Les psychanalystes considèrent qu'il est impossible de prati-
quer valablement l'analyse thérapeutique ou didactique sans être
soi-même analysé.
(15) On songe avec horreur à l'éventualité suivante : Les stali-
niens reprennent le pouvoir à Moscou. M. Khrouchtchev est arrêté,
jugé et exécuté comme ennemi du peuple et agent de l'impérialisme
américain. (Les preuves en seraient moins difficiles à trouver qu'à
l'époque pour Zinoviev ou Boukharine). On recommence à dénoncer
la psychanalyse comme doctrine policière et Kafka comme produit
de décomposition de la pourriture bourgeoise (Je ne parle même pas
de Saint-John Perse !). Que ferait alors M. Garaudy ? Que feront ses
lecteurs ? En idéologie tout comme dans le domaine du progrès
technique, certains progrès sont virtuellement irréversibles.
(16) Paris, 1947, Jean Vigneau, éditeur.
(17) Garaudy, p. 176.
58
en
celui de Heidegger, de celui de Sartre, de l'existentialisme chrétien
de Gabriel Marcel le premier à notre connaissance à souligner
l'importance d'une dialectique « avoir-être » et dont Garaudy semble
avoir fait son plus grand profit (18) ou encore de celui des héros
des « faits-divers » de Saint-Germain-des-Prés des années 50 ? On
est tenté par la dernière hypothèse. En tout cas la « démonstration »
de M. Garaudy ne démontre rien sauf la persistance chez lui d'un
solide noyau stalinien à l'arrière-plan d'un effort pénible de penser
« marxiste ouvert ». La définition de l'existentialisme qui sous-
tend son raisonnement relève typiquement de cette conceptualisation
émotionnelle, égocentrique (voir les concepts de fascisme»,
« machisme », idéalisme) qui formaient l'ossature logique des écrits
idéologiques d'avant 1953.
Personnellement nous admettons avec André Németh, l'existence
d'une parenté entre la philosophie implicite de l'æuvre de Kafka et
l'existentialisme, pour peu que l'on considère les catégories corol-
laires de réification et d'aliénation comme le dénominateur commun
à la fois des divers « existentialismes >> et des aspects variés de
l'iceuvre kafkéenne. Selon J.-Y. Calvez, la philosophie existentielle
était essentiellement « une tentative de sauver le sujet de son asser-
vissement à un monde objectif » ; il dénonce bien après Lukács
et le chapitre célèbre sur la réification dans Histoire et Conscience
de Classe le « trop d'objectivation » dans notre civilisation (19).
En soulignant la parenté lukácsienne de certaines catégories de la
pensée de M. Heidegger, L. Goldmann a entrevu dès 1945 l'essentiel
de cette question (20), mais il l'a entrevu dans l'optique d'un plagiat
possible ce qu'explique en partie le climat intellectuel et moral
de l'immédiate après-guerre et le souvenir encore vivace du rôle
politique moyennement glorieux de l'auteur de Sein und Zeit
alors qu'il s'agit là en réalité d'une manifestation de la conver-
gence objective des deux principales doctrines de désaliénation de
notre temps, convergence qui se cristallisera en France
sous la
Quatrième République, dans la pensée de Sartre notamment (21).
M. Garaudy est tiraillé ici entre les exigences contradictoires de son
orthodoxie. Il a admis une certaine analogie de structure de l'univers
marxiste et celui de Kafka ; dès lors reconnaître la parenté de ce
dernier avec les philosophies de l'existence risquerait d'orienter son
réalisme politique vers des rivages dangereux. D'où cette réfutation
sommaire qui ne réfute rien.
*
(18) Mais sans l'ombre d'une référence l'ouvrage de G. Marcel :
Etre et Avoir, qu'un professeur de philosophie n'est pas censé ignorer
et dont l'influence paraît patente p. e. pp. 187 et 225.
(19) J.-Y. Calvez : La pensée de Karl Marx, Paris (Seuil), 1956,
p. 50 et passim ; développements d'une rare lucidité.
(20) Voir l'appendice de l'édition allemande de son ouvrage :
Mensch, Gesellschaft u. Welt in der Philosophie Emmanuel Kants
(Zurich, 1945, Thèse de Doctorat en Philosophie).
(21) Cf. aussi l'ouvrage de M. G. Marcel : Les hommes contre
l'humain, Faris (La Colombe), 1951 ; une critique de la réification
dansecheptiembre de l'esistentialismes chrétiennes seraittintéressant
sibilité de la vie intellectuelle française pour le problème de
l'aliénation sous la Quatrième République, et son indifférence pres-
que totale pour le même problème sous la Cinquième. Est-ce un effet
de la montée de la technocratie dénoncée récemment par G. Gurvitch ?
En U. R. S. S. et de façon générale dans le camp du marxisme
officiel nous assistons à un processus inverse. L'étude comparée
des deux processus offrirait un sujet intéressant pour une étude
de sociologie de la connaissance.
59
une
On comprend dès lors qu'il ne veuille pas se souvenir de l'article,
intéressant cependant, de G. Bataille : Franz Kafka devant la critique
communiste (22) ; ce serait de l'héroïsme intellectuel. L'essai admi-
rable de Volkmann-Schluck: Conscience et être dans le « Procès >>
de Kafka (23)
dont
seule ligne contient à notre
sens, plus de marxisme bien compris que l'æuvre entière de
M. Garaudy a pu lui échapper à cause de sa langue ; celui de
L.-H. Sebillotte (24) a été écrit pour un public restreint de spécialistes.
L'ouvrage déjà cité d'André Németh n'a pas bénéficié de l'audience
qu'il aurait mérité. Mais le livre de M. Carrouges, essayiste des plus
notoires, qui sans employer la terminologie proprement marxiste,
n'en a pas moins posé clairement dès 1948 l'essentiel du problème (25) ?
Et l'article de M. Blanchot ? (« Critique » 1952). Et l'ouvrage de
Rochefort ? Et les études de Marthe Robert ? Seule la (médiocre)
biographie de Max Brod a trouvé grâce. On ne fait pas d'étalage
d'érudition, nous répliquera-t-on. Mais Garaudy fait de l'étalage ; il
cite, sans raison majeure, Tacite et nul lecteur de son essai n’a le
droit d'ignorer qu'il a lu The Pilgrims Progress de John Bunyan
dont les analogies avec Le Château sont d'un ordre purement for-
mel (26). Les antécédents de sa réflexion sont seuls visés par sa
modestie sélective. Modestement il accepte d'apparaître comme le
Christophe Colomb d'un domaine je n'exagère pas : qu'on lise
la préface. de L. Aragon dont il n'est même pas l'Américo Vespucci.
*
Nous en arrivons au point délicat de notre étude : le manque
d'autocritique choquant de notre auteur à l'égard de ses propres
antécédents idéologiques, manque d'autocritique qui complète son
(22) « Critique », Oct, 1950.
(23) Bewusstsein und Dasein in Kafkas « Prozess », Neue
Rundschau 1950.
(24) Paru dans l'Evolution Psychiatrique, Janvier-Mars 1956.
(25) M. Carrouges : Kafka, Faris 1948, Ed. la Bergerie 1948. Cf.
notamment pp. 75-78 : « Pourquoi cette hostilité contre Kafka ?...
c'est que la critique de Kafka ne porte pas exclusivement contre le
monde capitaliste, elle porte tout aussi bien contre le monde socia-
liste : car la critique de la bureaucratie est aussi valable dans les
deux régimes, le mythe du Procès est aussi une critique de la justice
du socialisme d'Etat » (p. 77). C'est bien le problème de rapports
entre l'oeuvre de Kafka et le problème de l'aliénation qui est posé
ici, autrement dit l'idée centrale de l'essai de M. Garaudy. Mais
il est posé dans l'optique d'une théorie totale de l'aliénation. (Le
« concept total et général de l'idéologie » selon l'expression de Karl
Mannheim) qui ne connaît pas de tabous, fussent-ils des tabous
progressistes.
De mon côté, j'ai écrit en 1953 : « Il [Kafka] gêne déjà passa-
blement les théoriciens de la lucidité à sens unique ; ceux pour qui
la désaliénation est surtout une transaliénation... Il n'y a pas que
l'aliénation de droite qui menace l'homme moderne et l'quvre de
Kafka comme le souligne à juste titre M. Carrouges dénonce
toutes les aliénations » (Kafka, romancier de l'aliénation, « Critique >>
(Paris), n° 78, 1953, p. 959). On voit là tout le mécanisme de socio-
logie de la connaissance qui a conduit au rejet communiste de Kafka
dans l'immédiat après-guerre. On voit aussi que la lucidité garau-
dienne, à sens unique en 1953, est quelque peu post-festum en 1963.
(26) Op cit, p. 227. En revanche Swift dont les analogies avec
Kafka sont réelles est oublié, de même que A. Camus dont les
rapports avec l'univers kafkéen posent un problème compliqué et
qui est tout juste jugé digne d'une petite mention anonyme, p. 154.
í
60
ignorance plus ou moins consciente (27) des antécédents littéraires
de son sujet. Il y a là une véritable scotomisation du passé ;
la réflexion part du « point zéro » et se déroule dans un éternel
présent. Németh a signalé le même phénomène dans l'æuvre même
de Kafka ! (Németh, Op. cit, p. 85-86), Garaudy a beau s'instituer
interprète de Kafka, son propre univers n'en conserve pas moins
une structure kafkéenne.
Voici un phénomène dont il faut bien se garder de sous-estimer
l'importance. Nous avons salué la parution de l'essai de M. Garaudy
comme l'un des premiers symptômes apparents d'un processus latent
de désaliénation idéologique. Le phénomène signalé est important,
car il marque les limites de cette désaliénation. L'inconscience avec
laquelle Pierre Daix préface La journée d'Ivan Denissovitch est en
réalité une forme de fausse conscience ; il en est de même lorsque
M. Garaudy dénonce « les interprétations pseudo-marxistes », voyant
en Kafka tantôt un petit bourgeois décadent au pessimisme corrosif,
tantôt l'homme de la révolte sinon du socialisme » (28). Quels sont
donc ces fameux « pseudo-marxistes » (le mot n'est pas trop fort),
ceux de la première catégorie en particulier ? Tout comme Kafka,
M. Garaudy cultive lui aussi de temps à autre «la technique de
l'anonyme et de l'impersonnel » (29) ; on ne le comprend que trop
en dressant le portrait-robot de ce fameux pseudo-marxiste,
nous risquons de voir apparaître le portrait (robot) de M. Garaudy !
Cette facilité d'oublier les antécédents (voire de les transformer
rétroactivement en fonction des exigences de l'actualité) de « repartir
du point zéro » correspond à une forme dégradée et anti-dialectique
de l'expérience temporelle (30), que l'on retrouve avec une certaine
constance à la base de la plupart des manifestations de l'aliénation
politique ou religieuse (31). Dans cet ordre d'idées, je ne vois pas
de différence vraiment essentielle entre le procureur [et l'accusé]
du procès d'épuration qui «scotomise » un moment favorable du
passé. (Rajk et la guerre civile espagnole !) pour l'assimiler aux
exigences du présent, l'historiographe soviétique qui juge les événe-
ments politiques de l'époque tsariste en fonction des critères d'un
avenir socialiste, imprévisible à l'époque (32) et la scotomisation
systématique de son propre passé de marxiste dogmatique chez
Garaudy. Ce marxisme est donc un stalinisme édulcoré, dilué mais
pas encore consciemment dépassé. Nous avons quitté d'un pied, l'ère
stalinienne pour entrer dans l'ère stalinistique pour employer
l'expression d’Edgar Morin (33).
car
(27) C'est à cette forme d'ignorance en partie volontaire, en partie
structurelle, déterminée en tout cas par l' « être social » (Sein) et
dans une certaine mesure, par l'intérêt du groupe, qu'il convient de
réserver le terme de scotomisation. Ce néologisme n'a pas la faveur
de tout le monde ; dans des études portant sur l'aspect psychologi-
que des processus d'aliénation, il est cependant d'utilité certaine.
(28) Garaudy.: Op. cit., p. 153-54.
(29) Garaudy : Op. cit., p. 190.
(30) « Le temps est inséré dans toute dialectique... la dialectique
suppose le temps et le temps se fait sentir par une sorte de dialec-
tique » (Jean Wahl cité par K. Axelos : Héraclite et la Philosophie,
Faris, Ed. de Minuit, 1962, pp. 54-55.
(31) Je renvoie ici à la magistrale analyse du temps religieux
dans les ouvrages de Mircea Eliade.
(32) Cf. notamment les critiques soviétiques de la révolte de
l'iman Chamyl sous Nicolas 1'er, qui avait été qualifiée de « réaction-
naire » comme si Chamyl et ses mourides pouvaient et devaient
prévoir la transformation révolutionnaire future de l'autocratie.
(33) Je regrette de ne pas pouvoir ici faute de place tout
le premier alinéa de son extraordinaire article : « De l'ère stalinienne
à l'ère stalinistique », Etudes » (Bruxelles), nº 3, 1963, p. 1.
61
en
Cette transformation structurelle de la conscience explique
et excuse au moins partiellement la totale désinvolture avec
laquelle sont traités les précurseurs idéologiques de l'orientation
philosophique actuelle de M. Garaudy. Pour M. Garaudy, toucher à
des sujets tabou avant l'autorisation suprême, est tout bonnement
un acte illégal, comme l'est devant la loi, un acte médical valable
en soi et en plus, couronné de succès, mais perpétré par une personne
démunie de diplôme. Tout ce que peut espérer le « coupable »
pareil cas c'est le non-lieu, c'est-à-dire en somme le droit de se faire
oublier. Je comprends la psychologie de M. Garaudy mieux qu'il ne
la comprend lui-même ; dans son optique, avoir parlé de Kafka
lorsqu'il fallait parler de Favlov n'est pas le mérite d'un précurseur
mais la faute d'un indiscipliné; en jetant le voile de l'oubli sur ces
errements, il a l'impression, sans doute sincère, de se conduire avec
une certaine magnanimité. Mari légitime de la théorie marxisme
< ouverte >> son union ayant été bénie par la seule autorité compé-
tente en la matière il pourrait poursuivre de sa haine les amants
pré-matrimoniaux de femme. Grand seigneur, il contente
élégamment de les ignorer.
sa
se
son
nous
avons
sans
une
Il ne s'agit pas bien entendu, d'une querelle de priorité intellec-
tuelle mais d'un problème général : celui même qu'a posé Edgar
Morin dans
article dont
tiré notre épigraphe.
« Le visage intellectuel du parti communiste a changé » constate
M. Garaudy (34), mais M. Lefebvre signale de son côté, non
quelque amertume, que « ceux qui ont... eu raison se voient écartés
du débat, On veut changer, on dit qu'on change, mais ceux qui ont
voulu ce changement sont éliminés au cours du changement » (35).
Voici la question. Les marxistes dits « libres » (« libres » surtout par
rapport à une discipline intellectuelle étouffante) ont fait depuis belle
lurette, la découverte de tout un ur vers intellectuel fait de dialec-
tique inconsciente et d'expérience spontanée de l'aliénation. Du
moment que la « dialectique » n'est plus considérée comme
technique ésotérico-magique réservée à des initiés, mais comme une
dimension authentique de la réalité, il ne faut pas s'étonner de
trouver de la dialectique non seulement chez les théoriciens plus ou
moins officiellement marxistes, mais même chez des penseurs comme
Meyerson, Lalande ou Brunschwicg.
Cette orientation « marxiste ouverte » n'a strictement rien de
commun avec le « révisionnisme » ; nul révolutionnaire n'était plus
épris de culture classique, plus enclin à assimiler les valeurs de toute
provenance que Marx. Il s'agit bien au contraire de fidélité à l'une
des plus fructueuses traditions intellectuelles du marxisme : celle
de la « remise sur pieds » des doctrines dites idéalistes (Umstülpung).
Le marxisme de l'époque. stalinienne acceptait non sans quelque
réticence occulte l’Umstülpung de Hegel par Marx comme un fait
accompli, mais loin de continuer de façon créatrice cette tradition,
il a dressé un véritable cordon sanitaire contre l'intrusion des dialec-
tiques d'origine impure : que l'on songe aux critiques adressées par
M. Garaudy à une doctrine aussi évidemment dialectique que la
Gestalt. Censuré à gauche, critiqué à droite, le dialecticien n'avait
pas la vie facile sous le stalinisme : il risquait d'être brimé, à la
fois par des penseurs objectivement très proches d’un marxisme bien
compris mais qui ne veulent pas admettre cette parenté comme par
voir compte rendu,
(34) «La semaine de la pensée marxiste »,
Le Monde, 23 janvier 1964, p. 6.
(35) Le Monde, 29 janvier 1964, p. 8.
62
comme
exemple R. Aron, et par des « théoriciens » prodigieusement éloignés
de la dialectique mais qui repoussent toute «prise de conscience >>
de cet éloignement
entre autres M. Garaudy, première
manière. Il fallait davantage de non-conformisme intellectuel ou de
mépris du succès facile pour être marxiste «ouvert » entre 1947-
1955 que pour être stalinien, car l'univers prélogique et réifié de ce
dernier bénéficiait du soutien sans faille de la plus redoutable des
coteries intellectuelles et cette coterie puissant facteur de forma-
tion de l'opinion publique commandait du respect jusqu'à ses
adversaires, en leur imposant, par voie de conditionnement, ses
propres tabous intellectuels. Il était plus facile pour un psychiatre
marxiste de s'endormir sur le « mol oreiller » du délire pavlovien,
que d'évoquer l'évidente valeur dialectique des ouvres d'un Moreno,
d’un Binswanger voire d'un Bergson au mépris du ricanement (36)
d'augures infaillibles nourris d'un marxisme non pas assimilé mais
révélé.
Aujourd'hui à la faveur des changements historiques objectifs,
le marxisme officiel retrouve le thème de l'aliénation ; du même coup,
on assiste à un retour relatif et partiel à la dialectique. La redé-
couverte de tout un univers de penseurs « objectivement » proches
du marxisme est le sous-produit de cette nouvelle orientation.
M. Garaudy « découvre » aujourd'hui Kafka authentique penseur de
l'aliénation. Demain on nous « découvrira ». L. Binswanger, psychopa-
thologiste de la « praxis » (37), après-demain on fera fête à la dialec-
tique implicite de l'euvre de J.-L. Moreno tant critiqué à l'époque
stalinienne et dont l'importance pour une anthropologie dialectique
vient encore récemment d'être mise en évidence par G. Lapassade (38).
Bientôt on se resouviendra de la dialectique d'o. Hamelin (39). Le
jour est peut-être proche où justice dialectique sera rendue à
Bergson ! (40).
Nous
donc en présence d'un véritable changement.
structurel au sein de l'idéologie communiste, pour peu que se confirme
l'orientation idéologique actuelle. Phénomène réconfortant en fin de
compte, même pour ceux qui sont loin d'approuver les buts politi-
1.
sommes
en
(36) Ceux qui risqueraient d'être choqués par le terme « rica-
nement », je conseille de lire dans une bibliothèque publique les
dernières pages du n° 4 de la revue La Raison, organe des psychia-
tres pavloviens. (Le nº qui ne porte pas de date a paru vers 1952).
(37) Cf. mon article < Analyse existentielle et marxisme
psychiatrie », L'Année sociologique, nº 60, pp. 229-246.
(38) G. Lapassade : l'Entrée dans la Vie, Paris, Ed. de Minuit.
(39) Le seul ouvrage marxiste à notre connaissance, qui s'est
intéressé à la dialectique hamelinienne est : La Sainte famille existen-
tialiste, Paris, Editions sociales, 1947, mais c'est pour l'accabler
sous la traditionnelle accusation d' « idéalisme ».
(40) Dans la préface de son tout dernier ouvrage (Karl Marx,
Paris (Seghers), 1964, Garaudy part en guerre contre «les révision-
nismes qui ont successivement essayé depuis plus de trois quarts
de siècle, de se parer des prestiges du marxisme, mais en le gref-
fant sur des philosophies inoffensives. L'on a ainsi prétendu « repen-
ser » Marx à partir du néo-kantisme, du bergsonisme, du néo-hégé-
lianisme, de la phénoménologie, de l'existentialisme) voire de la
théologie... » (Op. cit., p. 9 passage souligné par nous). L'allusion au
marxisme « repensé » à partir du bergsonisme vise probablement ma
thèse ou celle de G. Lapassade : l'Entrée dans la Vie. Le caractère
traditionnellement anonyme de la critique sert évidemment à esqui-
ver tout débat. Or, nul ne songe à « repenser » Marx en fonction de
Bergson, mais au contraire à « repenser » Bergson en fonction de
Marx : autrement dit, il s'agit d'une forme d'Umstülpung. En récusant
a priori cette démarche, M. Garaudy montre une fois de plus à quel
point son dépassement du stalinisme demeure superficiel.
63
sens
en
ques du communisme. Car le mouvement une fois engagé, il devient
difficile d'en contrôler totalement le
et le contenu. Mais
M, Garaudy est-il the right man pour présider à une renaissance
idéologique ? On aimerait connaître les détails de l'illumination
mystique qui a converti l'auteur de la Théorie matérialiste de la
connaissance cette somme théologique de pensée non-dialec-
tique un théoricien dialectique du problème de l'aliénation.
Saint-Thomas ne se transforme. pas sans raison en Galilée, et l'idée
se présente, obsédante, que Garaudy a été délégué à la tête d'un
courant irrésistible de renaissance dialectique, venu de la base estu-
diantine probablement précisément pour le maintenir dans des
« limites raisonnables ». Mais ce qui compte objectivement c'est
l'existence de ce courant et non pas les avatars télécommandés de
la « réflexion » garaudienne. Une situation existe désormais riche de
promesses, à condition que le courant qui se dessine trouve un maître
à penser, dans le sens non péjoratif de ce terme, et non pas un
maître d'école. M. Garaudy n'est pas l'homme de ce rôle. Le tragique
de sa situation réside dans le fait qu'il ne saurait l'assumer autre-
ment qu'en niant mieux : scotomisant de façon presque
inconsciente un passé personnel chargé de dogmatisme ; il ne
saurait donc dépasser le stalinisme qu'en payant lourdement tribut
à la mentalité stal ienne,
en
Joseph GABEL.
-
64
CHRONIQUE DU MOUVEMENT OUVRIER
La C. G.T. se démocratise...
(suite)
La lettre de H. Baratier, qu'on va lire ci-
dessous, montre un autre. aspect de la « démo-
cratisation » de la C. G. T., que nous avons déjà
illustrée sur autre exemple dans notre
précédent numéro (S. ou B., n° 36, pp. 72-74).
un
Bagneux, le 3 mars 1964.
Henri BARATIER
24, avenue Louis-Pasteur
BAGNEUX (Seine)
au
Comité Exécutif du Syndicat C. G. T. Renault
82, rue Yves-Kermen
BOULOGNE
Camarades,
Ayant appris par les informations publiques que le prochain
congrès du syndicat Renault avait lieu les 13, 14 et 15 mars, je vous
informe que je demanderai au congrès de considérer qu'il estime
irrégulière et inapplicable la mesure d'exclusion qui m'a été signifiée
le 20 décembre 1963.
Conformément aux statuts, je demande au comité exécutif de
mettre cette question à l'ordre du jour du congrès et à être entendu
par lui.
Vous trouverez ci-joint le texte d'une lettre que je vous demande
de porter à la connaissance des syndiqués afin de leur permettre de
prendre position en vue des débats du congrès.
Salutations syndicalistes,
H. BARATIER.
Bagneux, le 3 mars 1964.
Henri BARATIER
Syndiqué C. G. T. Dép. 36
A. 0. C.
aut
Syndiqués C. G. T. DES USINÉS RENAULT
à BILLANCOURT.
Camarades,
Le congrès de notre syndicat doit se dérouler les 13, 14 et 15 mars.
Il se tiendra dans une période difficile pour l'ensemble de la classe
ouvrière française. Les sujets de préoccupation de ses débats seront
nombreux et importants.
65
La parodie d'exclusion qui a été organisée contre moi me semble
faire partie de ces questions importantes et soulève des problèmes
syndicaux qui dépassent de beaucoup une affaire personnelle. Je vous
demande donc de prendre connaissance des faits et conséquences qui
entourent cette affaire, d'en discuter dans les réunions de sections
préparatoires au congrès et de donner mandat aux délégués élus au
congrès pour déclarer irrégulière et inapplicable la mesure d'exclusion
qui m'a été signifiée le 20-12-63.
LES FAITS.
« com-
Le 6 juillet 1963 j'ai adressé au comité exécutif une lettre où il
est dit :
« Le 5 juin dernier, j'ai été convoqué pour le 7 à une Assemblée
« générale de la section syndịcale A. 0. C. 2 section dont j'ignorais
« jusqu'alors l'existence. A l'ordre du jour de cette réunion figurait
* entre autres « le comportement du camarade BARATIER ».
« Dès l'ouverture des débats sur cette question de mon
« portement », il est apparu que la véritable affaire décidée et préparée
« à l'avance, en dehors de la section syndicale, était « l'exclusion du
« camarade BARATIER » de la C. G. T.
« Il y avait 11 présents auxquels il fut en effet proposé de
« m'exclure. Sur les 11, 7 ont voté pour l'exclusion et 3 lettres
« d'adhérents ont été lues qui demandaient également l'exclusion,
« 3 présents se sont abstenus et j'ai personnellement refusé de parti-
* ciper à un vote aussi éloigné qu'il est possible de la démocratie
« syndicale et dans une assemblée ne groupant qu'une faible mino-
* rité des syndiqués. Un fait est grave, c'est que les 3 lettres appor-
« tées à la réunion montrent bien que l'affaire avait été préparée à
l'avance à l'insu de certains camarades de la section.
« Dans ces conditions, je conteste formellement validité d'un
< telle décision et en ferai appel si c'est nécessaire, à la commission
« des conflits et au congrès suivant les dispositions statutaires, ainsi
« qu'à toutes autres instances de la C. G. T.
« Je conteste également la valeur des motifs mis en avant dans
< ce « procés ».
« Il m'a été reproché de ne pas approuver les grèves tournantes.
« Oui, c'est exact, j'ai cette position. Mais, en plus du fait que je
« pense avoir profondément raison, je suis certain que ce n'est pas un
« motif d'exclusion. Il n'est pas concevable d'exclure les nombreux
« syndiqués qui pensent comme moi sur cette question et il n'est pas
« concevable de leur interdire de penser ainsi parce qu'ils sont dans
« la Cl. G. T.
« Deuxième grief qui a été porté à ma connaissance ce 7 juin
« au soir : « je parle quelquefois avec des ouvriers qui publient un
« bulletin politique dans l'usine ».
« Je ne collabore nullement à ce bulletin, mais par un hasard
« étonnant le secrétaire de la section qui propose mon exclusion y
« a collaboré. Je trouve personnellement que c'était son droit et que
« nul syndiqué ne peut être inquiété pour cela ou sinon il faudrait,
« par exemple, en venir à exclure de la C. G. T. les camarades socia-
« listes dont le journal de parti critique parfois durement nos diri-
« geants. Or, heureusement, personne songe à exclure les
« camarades socialistes. Ceci dit,
des ouvriers
« d'une quelconque tendance me paraît compatible avec l'apparte-
« nance à la C. G. T. ainsi d'ailleurs que la réprobation des actes de
☆ violence destinés à empêcher ces ouvriers de s'exprimer ou de faire
« connaître leurs positions. S'il y a besoin d'éclaircissements à ce
« sujet, je suis prêt à m'expliquer très largement. Cette question
ne
converser
avec
- 66
R
« étant certainement une des plus importantes pour l'organisation
« des actions futures victorieuses de la classe ouvrière tout entière.
« La tentative de m'exclure après 18 ans d'appartenance sans
« interruption à la C. G. T. chez Renault me parait, en outre, en
* complète contradiction avec les résolutions et les déclarations faites
* lors de notre dernier congrès confédéral.
« Les difficiles progrès effectués pour avancer dans la voie de
« l'unité ouvrière et syndicale risquent sans aucun doute d'être
« compromis si de telles méthodes ne sont pas immédiatement et
* clairement condamnées dans nos rangs et je pense que le comité
* exécutif de mon syndicat se prononcera dans ce sens en faisant
* annuler cette soi-disant décision d'exclusion.
« L'unité n'est pas seulement un souhait ou un thème de propa-
qande mais une nécessité. Il faut agir dans tous les domaines pour
« qu'elle se réalise et pour cela se convaincre profondément qu'elle
« doit être acceptable pour tous. Aussi bien pour ceux qui sont depuis
« 18 ans ou plus à la C. G. T. que pour ceux qui sont adhérents à
« l'autres organisations syndicales auxquelles la C. G. T. propose
« l'unification ».
Par suite, ma section syndicale s'étant refusée à toute commu-
nication, j'ai obtenu, en me rendant au siège du syndicat, le 11-12-63,
communication du procès-verbal de la section syndicale A. 0. C. 2
se terminant ainsi :
« Le comité exécutif de notre syndicat jugeant insuffisant le
< nombre de syndiqués s'étant prononcés pour l'exclusion, nous vous
« proposons de répondre par oui ou non en signant chacun de votre
* nom.
Inscrits : 63 Votants : 57 Pour l'exclusion : 44
Contre : 0 Abstentions : 13 ».
Il est à noter que ma propre voix ne figure pas dans ce procès-
verbal pour la raison essentiell que je n'ai pas ét consulté.
Une lettre datée du 20-12-63, signée POPEREN, secrétaire général,
me' parvient par la suite :
« Après avoir pris connaissance de la consultation des adhérents
* de la section syndicale et considérant que la C. G. T. est ouverte
« à tous les travailleurs sauf à ses ennemis caractérisés, ce qui est
« particulièrement ton cas, il a été décidé de t'exclure (à l'unani-
« mité sauf une voix) des rangs de la Confédération Générale du
* Travail ».
Où a-t-on vu, autre part que dans les procès truqués, que l'on
condamne quelqu'un sans l'entendre ? Le fait de venir voir les syndi-
qués un par un, de leur raconter aussi longtemps qu'il le faut des
calomnies sur un militant, et ensuite de faire signer en faveur de
l'exclusion, c'est tout à fait contraire à la lettre et à l'esprit des
statuts du syndicat.
Le fait que, dans ces conditions 13 syndiqués se soient abstenus,
laisse supposer qu'il est possible qu'ils puissent eux aussi être baptisés
d'ennemis caractérisés de la C. G. T. Pourquoi pas ? Si on les empêche,
eux aussi, de faire entendre les raisons de leur vote.
Tout ceci se passant à l'insu du principal intéressé (qui,
remarquons-le, bien que toujours membre de la section, n'a pas été
consulté) sans ordre du jour prévoyant l'exposé des versions diffé-
rentes des faits sans discussion, me fait dire que cette exclusion n'est
pas recevable et doit être rejetée par le congrès.
une
COMMENTAIRES.
J'ai dit que je ne considérais pas cette affaire comme
question personnelle mais comme un grave problème syndical. Je le
pense parce que d'abord il risque d'aboutir à tous les abus de pouvoir
67
ses
en
d'une fraction dans le syndicat qui exclurait ceux qui la gênent sans
même s'embarrasser des statuts. Ensuite, parce que de telles méthodes
sont radicalement opposées à une juste orientation d'unité syndicale
qui ne peut se faire que dans le respect des opinions de chacun et
des conditions de fonctionnement démocratique de l'organisation
syndicale.
Enfin, aspect de beaucoup plus grave à mes yeux : cette affaire
me' visant après 18 ans de présence à la C. G. T. Renault, vient à un
moment où la majorité des travailleurs et la majorité des syndiqués
dans l'usine critiquent sévèrement dans les ateliers l'orientation
désastreuse des grèves tournantes qui n'a amené que des échecs et
des déboires.
La direction de notre syndicat croit pouvoir facilement éviter de
répondre de responsabilités m'excluant frauduleusement
aujourd'hui, et peut-être d'autres demain qui disent la même chose
que moi sur ces néfastes tactiques de lutte. Elle se trompe cependant
car il faudra bien tenir compte de l'opinion de la majorité des
travailleurs. Ce qui est certain c'est que le plus tôt sera le mieux et
qu'il n'y a plus de temps à perdre, sinon nous serons bientôt écrasés
secteur par secteur à la plus grande satisfaction des patrons et de
leur gouvernement,
Le temps n'est pas aux exclusions fractionnelles pour essayer de
cacher les responsabilités, mais à la préparation d'une puissante
lutte unie de la classe ouvrière.
Je ne voudrais pas dans cette lettre engager sur le fond une
discussion sur le bilan de trois ans de grèves tournantes, mais je
crois quand même qu'il est temps d'essayer de voir à ce congrès ce
que nous a apporté cette orientation. En deux mots, je crois pouvoir
dire que cette tactique, qui nous avait été présentée comme devant
élever la lutte, n'a en fait que permis à toute une série de mouvè-
ments de sombrer dans le découragement et, ce qui est plus grave, a
fait repartir: prochaine vague à un niveau plus bas que la
précédente.
Camarades, je vous demande sans passion ni souci d'intérêt
personnel, de réfléchir à ces questions. Vous serez amenés, j'en suis
sûr, à exiger le respect de la démocratie syndicale et la dénonciation
de cette tentative d'exclusion qui me vise et que, de toute façon, ces
questions qui concernent directement notre avenir, soient discutées
au grand jour et non étouffées comme c'est le cas actuellement dans
plusieurs endroits de l'usine.
Salut syndicaliste,
H. BARATIER.
----
68
CHRONIQUE DU MOUVEMENT ÉTUDIANT
Le 53e Congrès de l'U.N.E.F.
L’U. N. E. F. a tenu son Congrès annuel entre le 30 mars et le
6 avril dernier à Toulouse. Deux sortes de décisions sont habituel-
lement prises dans un Congrés : les unes concernent l'élaboration
d'une plateforme, les autres l'appareil et la passation des pouvoirs.
A l’U. N. E. F., en principe, l'appareil est renouvelé chaque année ;
en fait le renouvellement est partiel et, le plus souvent, on retrouve
dans le bureau élu des anciens membres qui restent à leur poste
plusieurs années de suite. Ainsi, le délégué culturel sortant a tenu
pendant trois ans la même fonction dans le bureaux successifs. Seul
le président est régulièrement renouvelé.
Cette année, le Congrès a été reconnu comme très important, et
pour certains, même, comme historique. En effet, la plateforme votée
par le Congrès à la quasi-unanimité est celle qui avait été rejetée à
Dijon l'année dernière. C'est la plateforme universitaire. Pour la
définir, nous n'avons qu'à reprendre les termes du discours, essen.
tiellement consacré au problème de l'Education Nationale, prononcé
par M. Defferre à Lyon le 22 mai 1964 : « Actuellement, l'étudiant
est un être passif, subordonné, dépendant de ses maîtres, seuls déten-
teurs du savoir. Il n'existe aucune participation active et créatrice
des étudiants à leur enseignement ». M. Defferre propose, comme la
F. G. E. L. (Fédération des Groupes d'Etudes de Lettres) et comme
l'U. N. E. F., l'allocation d'études, la cogestion des Quvres universi-
taires et l'association des étudiants à la définition de l'enseignement
supérieur. (C'est nous qui soulignons).
La nouvelle plateforme a donc été approuvée, après une année
de tâtonnements et de luttes internes, qui avaient déjà abouti; trois
mois après Dijon, où les « universitaires » s'étaient trouvés en mino-
rité, à l'entrée de quelques-uns de ceux-ci au Bureau National lors
de l'Assemblée générale de juillet 1963.
D'autre part, et pour la première fois depuis longtemps, l'appa-
reil a été peu près entièrement renouvelé ; c'est un bureau « pro-
vincial », où la F. G. E. L. n'est pas représentée, qui a été mis en
place. Ses membres sont plus jeunes, par l'âge et par l'expérience
syndicale, que ceux de l'ancien bureau.
Oomment cela s'est-il passé ? La tradition des Congrès de
I'U. N. E. F. et les statuts veulent que le nouveau bureau soit élu
par une minorité de congressistes, par un « conclave », au terme de
tractations de couloirs plus ou moins officieuses préparées de
longue date par les bureaux des A. G. E., par le bureau sortant, par
des anciens du mouvement, des « personnalités » qui apparaissent au
moment crucial et disparaissent jusqu'au Congrès suivant, enfin par
les différents groupes de pression qui ont une influence dans le mou-
vcment syndical, notamment les groupes parisiens.
On a vu vers les derniers jours du Congrès ces groupes s'agiter
autour du Bureau National. Le « conclave » réunissait environ une
cinquantaine de participants sur plus de trois cents délégués. Il était
composé de l'ensemble du Bureau National et de deux délégués (le
président et le vice-président) de chacune des Associations Générales
d'Etudiants de Paris et de province. Il siégea à huis-clos pendant
69
deux jours et deur nuits pour essayer de résoudre un PE
problème qui
n'était pas simple : répondre auä exigences de la F. G. E. L., qui se
présentait comme étant à l'origine de la nouvelle tendance univer-
sitaire, et la plus apte à en faire la théorie et à la mettre en prati-
que. La F. G. E. L. était handicapée au Congrès par son échec dit
de la « prise de la Sorbonne » le 21 février 1964 (1) ; mais elle gardait
tout son prestige du fait que plusieurs de ses membres avaient élaboré
et publié des théories assez cohérentes et allant plus loin que tout
ce qu'avaient pu faire les A. G. E. de province. Il ne paraissait donc
pas pensable que la F. G. E. L. put être écartée des instances natio-
nales qui devaient sortir du Congrès. Sa délégation s'était, d'ailleurs,
systématiquement répartie dans les différentes commissions pour y
faire prévaloir ses thèses avec une souci d'unification, de cohérence
et d'organisation des thèmes, face à la dispersion et à l'empirisme
des différents courants qui traversent l'U. N. E. F.
D'autre part, la tension traditionnelle entre Paris et la province
ne pouvait qu'aller en s'accentuant devant ce leadership intellectuel
de la F. G. E. L. qui est réel, même lorsque celle-ci se trouve dans
l'opposition, devant cette sorte d'autorité idéologique qu'elle exerce
sur le bureau et qu'elle désire exercer sur l'ensemble du mouvement,
devant le style de ses interventions et le langage ésotérique qu'elle
emploie volontiers. Ainsi, on a pu savoir que dans le conclave toulou-
sain, les affrontements entre la F. G. E. L. et les autres groupes
avaient été souvent violents, que les mises en question de la F. G. E. L.
consistaient parfois en des attaques personnelles, et que les provin-
ciaux voyaient de plus en plus mal la F. G. E. L. prendre trop d'in-
fluence dans le Bureau National ; ils n'envisageaient cependant pas
de la laisser à l'écart, comme cela s'est produit. Ils estimaient
qu'étant donné la nouvelle orientation de l’U. N. E. F., il fallait que
ta F. G. E. L. soit présente, ne serait-ce que pour l'apaiser un peu en
lui donnant sa part du pouvoir.
Malgré les tentatives de compromis, et au bout de deux jours et
deux nuits de conclave, une crise a éclaté. Elle a conduit à l'élection
d'un bureau auquel personne ne s'attendait. Mais avant d'en venir là,
il faut dire combien est contradictoire la tenue de ce conclave avec
les doctrines anti-bureaucratiques affichées par l'appareil. On
proclame que tous doivent participer aux décisions. On lance le slo-
gan : « faire de tout adhérent un militant et de tout militant un
responsable ». Mais un cinquième des membres du Congrès seule-
ment participe aux décisions les plus essentielles, au sein du conclave.
Pendant ce temps, que font les autres congressistes ? Ils atten-
dent, dans l'amphithéâtre, que la réunion restreinte à huis-clos se
termine, en se distrayant comme ils peuvent, en faisant le socio-
drame du Congrès, en votant des motions « folkloriques », pour
employer l'argot étudiant, en mimant des décisions auxquelles ils ne
peuvent participer. Les uns s'emparent du micro pour proposer à un
auditoire qui dort sur les bancs, ou qui joue aux cartes, le meilleur
des bureaux possibles. Les autres dessinent sur les fresques du grand
amphithéâtre des graffitis hautement symboliques, des caricatures des
dirigeants et du pouvoir, qu'ils n'osent pas, par ailleurs, contester.
Malgré les efforts d'un psycho-sociologue « bien connu dans le mou-
vement », qui s'empare de la caméra du $. I. C. U. (Service d'Infor-
mation Çinématographique de l’U. N. E. F.) pour filmer le conclave
par le trou de la serrure, et qui tente de « monter » la base contre
l'appareil en formant autour de lui des « groupes de bourdonnement »,
les délégués de province ne réagissent pas contre la condition qui
leur est faite ; ils attendent, passivement, que les décisions soient
prises pour eux et qu'ils n'aient plus qu'à les entérinér.
1
(1) V. S. ou B., nº 36, p. 75 et suiv.
70
Il semble donc que la débureaucratisation soit menée de main
de maître par la bureaucratie : on garde les vieilles habitudes, les
vieux statuts, les vieilles manoeuvres de couloirs au vu et au su de
tout le monde. Les plus plus farouches partisans de la participation
intégrale se refusent à l'idée de changer le fonctionnement d'un
Congrès qui s'endort, au sens propre du mot.
Au bout de deux jours et deux nuits, les tractations n'ont abouti
à rien de positif dans le conclave, dont les éclats sont transmis de
bouche à oreille par certains initiés qui « savent » et qui apportent
de temps à autre aux congressistes de base de la nourriture propre
à les faire patienter un peu. Quand on ne sait rien, Xavier Joseph
les amusé en imitant, au micro, le chuintement des locomotives. Fina-
lement, tous les délégués sont appelés dans le grand amphithéâtre
pour y être consultés et pris à témoin de la crise qui n'arrive pas à se
dénouer. Lors de cette séance à huis-clos, suivie attentivement par le
psychosociologue-etnographe, caché dans une caisse (sa « boite noire »)
d'où il sortira couvert de toiles d'araignées, trois discours aussi
paternalistes les uns que les autres sont prononcés par des respon-
sables. Le premier est celui du président sortant, Mousel, qui déclare
ne plus pouvoir se représenter, mais qui propose au mouvement un
des membres de son bureau comme président : il l'offre pour sauver
le mouvement étudiant ; car seuls ceux qui ont été formés par une
année de travail avec lui, sont capables d'assumer les lourdes respon-
sabilités de la direction. Le second discours est celui du président
(parfois appelé Président-Directeur-Général) de la Mutuelle Nationale
des Etudiants de France, A. Griset, ancien président de la F. G. E. L.
Il propose sa solution à lui : organiser autour de M. Michelland et
avec des membres de la F. G. E. L., un bureau de salut public qui
lui paraît être le seul capable de sauver la situation. La troisième
intervention paternaliste est faite par Peninou, président pur et dur
de la F. G. E. L., qui reconnait précisément la dureté de ses positions,
l'intransigeance des conditions qu'il met à la participation de la
F. G. E. Li au bureau, mais qui doute qu’un bureau purement pro-
vincial puisse assurer une politique cohérente, puisque la vérité poli-
tique est l'affaire de la F. G. E. L.
Ces trois discours n'ont pas l'effet escompté : la province semble
se réveiller et impose, finalement, sa solution. Elle choisit un prési-
dent provincial, Schreiner, de Strasbourg, qui n'est pas facilement
accepté par le bureau sortant. Autour du président se retrouvent
uniquement, comme on l'a dit, des jeunes militants et cadres des
A. G. E. de province. Le cirque est terminé.
Quel est le véritable enjeu de cette mascarade ? Pourquoi ces
violents conflits de personnes et de groupes ? Aujourd'hui, jů,
M. Bidegain, président des Jeunes Patrons, a dans son usine M. J.-P.
Milbergue comme chef du personnel ; M. Bloch-Lainé, de la Caisse
des Dépôts et Consignations, bénéficie des services de M. Gaudez,
ancien président de l’U. N. E. F.; M. Defferré enfin, ne cache rien
de ce qu'il doit à M. Michelland (présidente pressentie de l’U. N. E. F.,
à Toulouse), pour l'élaboration de sa « plateforme universitaire ».
Retrouverons-nous bientôt la nouvelle vague des théoriciens dans
l'horizon 80 du syndicalisme ? Et s'agit-il simplement pour eux de
faire leurs premières armes dans le mouvement étudiant, de faire
leurs preuves ?
Plus tard, ils « s'intégreront » sans trop de difficultés. Il faut bien
vivre...
Jacques GUIMET.
Un autre point de vue sur l'U.N.E.F.
Il est utile, il est nécessaire que tout ce qui est négatif dans
I'U. N. E. F., aujourd'hui, soit décrit, analysé, et dénoncé.' Et nous
ne retiendrons pas sur ce point l'argument du « front commun contre
l'adversaire ». Mais le travail à l’U. N. E. F. n'est pas que négatif :
sont négatifs l'extrême bureaucratisme qui persiste, le carriérisme
de certains, l'intégration par le syndicalisme à la société techno-
cratique...
Est positive, par contre, la plateforme de l’U. N. E. F. dans la
mesure où elle conteste, notamment, la relation de dépendance à
l'Université, les contenus enseignés, l'incohérence des structures,
l'aliénation de la condition étudiante. Sur ce point, d'ailleurs la
contestation a été entendue. On accuse le coup.
Limitons-nous à quelques revues qui toutes, en ce mois de mai,
consacrent des études à la question universitaire : un numéro dou-
ble de la revue Esprit, la continuation dans les Temps Modernes du
débat autour de l'article de Marc Kravets, l'article de R. Aron dans
Preuves, un article dans Critique sur « la pédagogie de la pédago-
gie », les articles de Girod de l'Ain dans Le Monde et j'en passe.
Dans Esprit et dans les Temps modernes on fait à plusieurs reprises
allusion, pour les rejeter, aux thèses de l’U. N. E. F. en ce qu'elles
ont (ou avaient ?) de plus virulent. P. Ricoeur conclut avec les profes-
seurs qui ont inondé la revue de leur prose en soulignant « l'utopie
de la cogestion de l'université ». Il soutient que les professeurs n'ont
aucun pouvoir à partager, puisqu'ils n'ont aucun pouvoir comme
l'affirmait R. Aron dans Le Figaro, pendant la semaine même du
Congrès de Toulouse.
En fait, l’U. N. E. F. ici, a touché juste. Elle a donné forme à
l'immense malaise des étudiants (qu'on retrouverait aussi bien en
Russie, et ailleurs), qui est celui d'une société fondée sur des modèles
d'autorité répressive. Ces analyses opposent également, en fait,
I'U. E. C. aux dirigeants du parti communiste, qui cherchent à se
débarrasser par tous les moyens de cette contestation.
La question de l’U. N. E. F. reste donc complexe, ambiguë, diffi-
cile à analyser parce que la situation change sans cesse. Notre rôle
est de chercher à y voir un peu clair en critiquant ici ce qui est
bureaucratisme et conformisme, calcul, hésitations d'un syndicat qui
craint de s'isoler s'il va trop loin, mais en tenant compte aussi
de ce qu'il fait de positif.
G. L.
72
LE MONDE EN QUESTION
Les Actualités
Ecrire sur l'actualité à l'époque que nous traversons : curieux
paradoxe. Il n'y a plus que de l'actualité, les journaux et la radio
en sont pleins. Et cette actualité semble tellement inactuelle, à force
de remplir tout elle est tellement vide, que le lendemain il n'en
subsiste rien.
Les journées du coup d'état brésilien, aussi grosses de consé-
quences soient-elles pour l'avenir des peuples d'Amérique du Sud
ne sont pas restées à l'actualité plus de quelques jours. Qui s'en
soucie encore ?
Des conflits absurdes et meurtriers ont lieu à Chypre et au
Viet Nam. Qui s'en préoccupe vraiment ?
Le conflit sino-soviétique. est sans aucun doute générateur de
violentes tensions pour le futur. Mais à part les spécialistes de la
politique, qui suit attentivement les longues querelles entre la Pravda
et le Journal du Peuple ?
Pour l'instant l'événement est rare, le flash sensationnel est absent
et la grande presse ne se vend qu'à coups de canulars politiques, de
mariages princiers et de visites gaulliennes à grand spectacle. vite
oubliées.
Cependant télé, radio, journaux, revues consomment à divers
titres de l'actualité comme une nourriture vitale. Elle se débite à
jet continu, et quand il ne se passe rien, il faut bien inventer quelque
chose.
La façon la plus moderne de traiter l'actualité, la plus adéquate
à notre monde frénétique est incontestablement la radio. L'infor-
mation y est astucieusement présentée. Elle a l'apparence franche et
directe. En réalité elle est éclectique, superficielle, mystificatrice.
Son emprise est totalitaire et même les esprits les plus critiques
s'y laissent prendre.
Totalitaire la radio l'est, car sous des apparences de controverses,
de multiplicité d'opinions, elle présente la face conformiste et mora-
lisatrice de cette société.
Un poste aussi ingénieux et adapté qu’Europe n° 1 invente un
simulacre de participation des auditeurs en invitant ceux-ci à poser
des questions aux commentateurs de l'émission politique de 12 h. 30
chaque jour. Bien que cela réponde à un besoin de participer évident
des auditeurs, ils n'y posent que des questions judicieusement triées.
Ce seul fait prouve bien qu'un double aspect apparaît et nous le
retrouvons dans d'autres sphères de l'information et de l'actualité :
la mystification et l'authenticité.
Car il est incontestable qu'une certaine vie transparait à travers
tout cela. L'authenticité de quelques émissions est frappante. Les
faits pris sur le vif éclipsent le commentaire mystificateur. La même
chose vaut pour la télévision. Son influence s'accentuant par l'im-
pression visuelle, elle est d'autant plus jalousement contrôlée par
le pouvoir. Mais là encore, à défaut de pouvoir totalement mettre en
scène la réalité, on ne peut complètement oblitérer le sens que l'image
de la vie fait aussitôt transparaître
73
-
Dans la presse écrite quotidienne, à travers sa modernisation
remarquable depuis la dernière guerre, on observe la même antinomie.
Titres schématiques, inspirés par les headlines américains, inver-
sion de l'information, donnant d'abord le résumé dramatique,
impressionnant ou scandaleux de la nouvelle. Ici aussi, la boulimie
extraordinaire de notre époque impose de saisir les faits en fonction
de leur impact émotionnel.
La dépolitisation de la société a été comprise par la grande
presse qui utilise de plus en plus les faits divers en première, les
relations de la vie princière ou les reportages des voyages d'homme
d'Etat. Mais elle ne peut ignorer ce qui intéresse profondément les
gens, la maladie, les problèmes de l'enfant, la sexualité. Une cer-
taine vulgarisation de la psychanalyse qui apparaît dans la presse
en est l'illustration, frappante. Le « succès » de l'affaire Naessens et
celui, non épuisé, du procès Novak montre qu'il s'agit de questions
brûlantes que se posent les lecteurs dans leur vie de tous les jours :
la maladie (surtout le cancer), et les problèmes affectifs concernant
la façon d'élever ses enfants.
En même temps, l'actualité non politique est une constante
recherche du scandaleux, du sensationnel. On sait par exemple l'im-
portance prise par la sexualité dans les thèmes de la presse de masse.
Ses problèmes sont, avec ceux, liés, du couple, de la famille, parmi
les plus préoccupants pour les générations actuelles qui cherchent
confusément des solutions plus authentiques, non aliénées. Ils appa-
raissent donc, car on ne peut plus les refouler comme autrefois mais
autant leur place est grande, autant leur contenu est grossièrement
déformé. Il est connu que Del Duca, propriétaire de Paris-Jour, exige
la publication quotidienne d'une photo de femme sexy en première
page et d'une autre, très déshabillée, dans la page centrale.
France-Soir qui est le modèle du journal moderne titre une fois
sur cinq en gros caractères qui n'ont rien à voir avec la politique. Le
plus révélateur des dernières semaines est le titre de première révé-
lant : « 5.000 F. par jour de revenu au GANG des maisons closes de
Marseille ».
Ici une autre antinomie apparaît. Un tel abus de la sensation
de la nouvelle à peine croyable (titre Paris-Presse récent : UN PORT
CUBAIN ATTAQUE) fait développer le scepticisme, l'esprit
critique.
On peut encore parler de l'abrutissement, du bourrage de crâne,
du conditionnement psychologique dû à l'information sous toutes
ses formes. Mais il faut ajouter pour donner un reflet correct de la
réalité que l'opinion est aussi incrédule, sur ses gardes. Il est rare
qu'un lecteur ou un auditeur ait une confiance absolue dans un
organe de presse, dans les propos d'un commentateur de radio. Ce
réflexe s'étend aux fidèles des journaux d'opinion et même aux
militants de partis et de syndicats, qui critiquent ouvertement leur
presse.
Les contradictions qui apparaissent dans la presse, la radio, la
télé entre le désir des dirigeants de donner une vue mystifiée des
problèmes de l'information politique en générale et ce qui arrive à
s'exprimer de vrai, de profond quant aux préoccupations des gens,
entre la manipulation du public, et le scepticisme qu'elle déclenche,
montrent le conflit qui se perpétue dans le fond des relations
sociales.
se
A. GARROS.
74
- vendin
LES JEUNES ET L’ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE ALLIEE.
(Une enquête de France-Soir).
Voici ce que des garçons et des filles rencontrés à la
Foire du Trône ont répondu :
Le 8 mai ? C'est la fête de la Libération, dit
Daniel Boudoux, apprenti plombier, 17 ans.
La Libération de quoi ?
La Libération de Paris en 14.
Pour Dominique Mauvy, 17 ans, cela ne fait aucun
doute.
ça ne peut être qu'une guerre. A chaque fois
qu'on nous parle d'une date il s'agit d'une guerre. C'est
à croire qu'on ne devrait se souvenir que de ça...
Mais quelle guerre ?
L'une ou l'autre. J'en sais rien.
France-Soir, 9-5-1964.
HAUTS-LIEUX DU NEO-CAPITALISME.
Inauguration mouvementée, du magasin « Au Prin-
temps » à la Nation, pour cause d'affluence.
La foule était si dense que la direction fit fermer
provisoirement les 25 portes vitrées. Mécontents de ne
pouvoir entrer, plusieurs centaines de banlieusards,
arrivés en cars, tentèrent de forcer les ouvertures. Deux
portes
cédèrent
le choc : sept femmes furent
légèrement blessées.
France-Soir, 7-5-1964.
Ce n'était pas une émeute à la barrière du Trône.
C'était une révolution... commerciale.
Le Monde, 6-5-1964.
sous
LA GRÈVE DES MÉDECINS EN BELGIQUE
« VOTRE MEDECIN VOUS PARLE...
La Loi Leburton prévoit :
Le carnet de prestations, les opérations, traitements
spéciaux, séjours en clinique, etc., seront inscrits au
carnet (en code soi-disant secret) pour faciliter le
contrôle et éviter les abus.
MAIS !!!
Une personne sur deux a dans sa vie un ennui de
santé qu'elle n'aime pas chanter sur tous les toits :
MADAME, souhaitez-vous qu'on inscrive sur votre
carnet qu'on vous a enlevé un sein ?
MADEMOISELLE, aimeriez-vous que votre fiancé
puisse un jour connaître vos ennuis intimes ?
MONSIEUR, comment expliquez-vous au patron
chez qui vous vous présentez, que vous êtes capable
d'exécuter votre travail bien que vous ayez souffert d'une
anémie grave,
d'une dépression nerveuse,
d'un
épuisement ?
CE CARNET DE PRESTATIONS VOUS SUIVRA
COMME UN CASIER JUDICIAIRE SUIT UN MALFAI-
TEUR.
ои
75
Il y aura deux sortes de malades :
Les PAUVRES, qui seront obligés de se faire
soigner à la CHAINE dans le régime conventionné ;
Les RICHES, qui pourront choisir le médecin libre
qui leur convient le mieux.
(Extrait d'un tract diffusé par les médecins pen-
dant la grève en Belgique).
Il n'est pas nécessaire d'entrer dans les détails techniques de
la loi, ni même de souligner les falsifications que ce tract apporte
dans la description de cette loi, pour ressentir la puante hypocrisie
de l'argumentation des médecins dans cette histoire. Ne mentionnons
qu'un trait : à les en croire, la sécurité sociale et le système du
conventionnement (analogue au système français) * introduirait »
une médecine de classe. Prennent-ils leurs lecteurs pour des idiots
ou tiennent-ils à se couvrir de ridicule en prétendant que la médecine
libérale du 19e et du début du 20e siècle aurait été une médecine
égalitaire, tant pour ceux qui payaient les honoraires au médecin
qui les visitaient que pour ceux qui se faisaient « soigner » gratui-
tement à l'hôpital ?
C'est pure hypocrisie que de faire appel à la « médecine de
qualité » du régime libéral du siècle dernier. Il est bien vrai que la
médecine de cette époque était à certains égards une médecine bien
meilleure que celle d'aujourd'hui. Mais elle était réservée aux seuls
bourgeois. Et de toute façon, cette médecine-là est morte, depuis
longtemps, tuée entr'autres par les médecins qui ont accueilli la
manne de la sécurité sociale si bénéfique pour leurs revenus. Tant
pis si cela impliquait une médecine bureaucratisée.
Encore ce tract s'adresse-t-il à leurs clients, ce qui nous vaut un
certain effort vers une argumentation en termes réalistes et nous
épargne les invocations à Hippocrate et à Gallien (pourquoi pas à
Molière ?) courantes dans les grands communiqués officiels. Sans
doute ont-ils essenti qu'il serait vraiment trop imprudent d'expli-
quer à leurs clients que l'objet de leur lutte est de défendre le secret
professionnel (si couramment et légalement violé par ailleurs) ou la
fixation libre des honoraires au cours du « colloque singulier entre
médecin et malade ».
Il ne faudrait cependant pas en conclure que toute l'histoire
n'est « qu'une affaire de fric», comme le disait un dirigeant syndi-
caliste. Cet aspect est certes essentiel, comme le montre le fait que
les négociations, les concessions sur les « principes libéraux » furent
très aisées ; les obstacles à l'accord apparurent toujours avec les
questions de revenu. D'ailleurs plus qu'un niveau de revenu, ce que
veulent défendre les médecins belges, est leur droit à la fraude
fiscale (certaines années le 'total des revenus déclarés par les méde-
cins était inférieur au total des remboursements effectués par la
sécurité sociale). Le système du conventionnement les obligeait à
déclarer au fisc la totalité des honoraires qui leurs seraient versés
par les assurés sociaux (1), tout comme un quelconque salarié, haut
fonctionnaire, ou dirigeant d'entreprise.
Le champ des privilèges qu'ils veulent défendre est toutefois
beaucoup plus large qu’un niveau de revenu ou même que l'inci-
dence sur ce revenu du régime fiscal. Ávec quelques rares autres
professions libérales, les médecins (ou du moins une grande partie
d'entr'eux) ont relativement bien échappé à la bureaucratisation de
la so té. Ils ont maintenu un rang social élevé ; ils ont gardé leur
prestige et surtout leur rapport autoritaire avec les malades. Mainte-
(1) C'est-à-dire la presque totalité de la clientèle, car en Belgique
les paysans et les indépendants, sont également «assujettis » à la
sécurité sociale.
76
beaucoup
nant c'est l'Etat qui veut s'emparer de ce rapport autoritaire. Quant
aux malades, bien entendu, personne ne songe à leur demander leur
avis. Lorsque la situation scandaleuse en matière de soins qui
résultait du caractère libéral de la médecine n'est plus apparue
compatible avec le réformisme économique, la sécurité sociale a été
introduite" comme remède. Il en est résulté depuis longtemps une
tendance à la bureaucratisation de la médecine. Comme celle-ci était
surtout gênante pour les malades, et comme d'autre part la sécurité
sociale avait pour effet de multiplier par deux ou par trois la
demande solvable de soins médicaux, les médecins n'ont guère
protesté. La loi Leburton est un nouveau pas en avant, bien modeste,
dans la voie de la bureaucratisation, c'est aussi un pas dans la
dépossession de l'autorité sur les malades au profit de l'Etat. Cette
fois la loi s'en prenait un peu plus explicitement aux privilèges
anachroniques de la médecine libérale. Ceci, joint à un climat
politique général favorable aux manipulations des groupes d'extrême
droite, a' entraîné cette réaction violente des médecins
plus violente qu'en France où, dans des circonstances analogues, les
médecins plus bureaucratisés et moins privélégiés, s'efforcent d'ajus-
ter le système et d'y aménager une hiérarchie (professeurs renom-
més, spécialistes, etc...).
Replacées dans le cadre général de l'évolution de la médecine,
les formes de lutte utilisées par les médecins belges ne manquent
pas d'intérêt. Tout d'abord il était admis tacitement que la grève
ne devait pas mettre sérieusement en danger la santé de la popu-
lation ; il fallait assurer un service de garde minimum (2).
Durant la première phase de la grève, ce service de garde mini-
mum était organisé par les médecins eux-mêmes. Il y avait pour
chaque ville ou chaque arrondissement un centre qui recevait tous
les appels des malades. Les médecins du centre décidaient du caractère
urgent ou non urgent de l'appel. Si celui-ci était reçu, un médecin
de l'équipe « visite à domicile » était désigné selon un tour de rôle
et allait visiter le malade. S'il estimait que l'état de celui-ci néces-
sitait des soins, il décidait l'hospitalisation, car il n'était pas question
de traitement à domicile, qui aurait pris trop de temps (cela entraîna
très rapidement un vaste engorgement des hôpitaux). Dans les hôpi-
taux, les malades étaient soignés par les services généraux de
l'hôpital. Pour ces prestations, les malades payaient des honoraires
(évidemment tout à fait en dehors du système de sécurité sociale).
Tous les honoraires perçus étaient versés à une caisse centrale dont
le contenu était réparti égalitairement entre tous les médecins, que
ceux-ci participent ou non au service de garde.
Il est amusant de noter que les défenseurs de la médecine libérale
ont ainsi mis sur pied un système qui dépasse de loin en bureaucra-
tisation tous les systèmes réalisés à ce jour, que ce soit en Angleterre
ou en U. R. S. S.
Encore :y avait-il là certains aspects que, de notre point de vue,
nous pourrions appeler positifs : la répartition égalitaire des revenus,
et surtout le fait que ce système était organisé et géré par les méde-
cins mêmes qui y participaient. Avec de l'optimisme, on peut même
(2) Toutefois les médecins belges ne considèrent pas que ce
principe est valable sous toutes les latitudes : lorsque l'indépen-
dance du Congo ex-Belge entraîna une sérieuse diminution des
avantages d'une « carrière coloniale » les médecins belges firent une
grève des soins totale et définitive. Ils abandonnèrent ce pays à son
sort ; le Congo souffre depuis lors d'un très grave sous-équipement
médical auquel les médecins de l'O. N. U., de 10. M. S., ne peuvent
guère apporter de remède en raison de leurs faibles moyens. Cet
abandon de la population par les médecins dure depuis quatre ans,
bien que l'« ordre » soit rétabli au Congo depuis longtemps.
77
entrevoir là des embryons d'une médecine collective dépassant le
conflit médecine libérale contre médecine bureaucratisée.
Mais aucun ridicule ne sera épargné à ces pauvres médecins.
Lorsque, sous la pression des groupes d'extrême-droite, et prenant
prétexte de la citation par le premier ministre d'un poète surréaliste,
les médecins décidèrent d'intensifier leur lutte, le seul résultat pra-
tique fut de bureaucratiser plus complètement le fonctionnement du
système.
Les médecins décidèrent d'abandonner le service de garde
d'urgence. En raison, du climat général d'hostilité à la grève et de
l'anxiété de la population, le gouvernement, qui jusqu'alors avait
tergiversé et traité avec une écœurante mansuétude cette révolte d'une
partie de la bourgeoisie contre un gouvernement bourgeois, dut
recourir à la mobilisation des médecins officiers de réserve (cas de
la majorité des moins de quarante ans) et à la réquisition des autres
Et les médecins, ni personne, ne pouvaient ignorer qu'à ce stade le
gouvernement serait forcé de recourir à la réquisition, Moyennant
quoi le système de garde reprit comme devant, sauf que cette fois il
était organisé dans le cadre militaire avec sa hiérarchie, que les
médecins étaient devenus des fonctionnaires en uniforme, payés par
l'Etat, tandis que les malades ne payaient plus rien du tout sauf la
fraction de leurs impôts destinée à ali enter le budget militaire
du pays.
Cette seconde phase foisonne d'incidents tragicomiques et cour-
telinesques, depuis les brimades contre les médecins (plus nombreux
qu'on ne l'a dit, surtout dans les régions industrielles) qui avaient
refusé la grève et accepté le régime de la convention, jusqu'à l'envoi
systématique des accouchements dans les hôpitaux militaires, où les
parturientes étaient soignées par des infirmiers séminaristés (3). La
lutte prenait parfois des tournures plus sérieuses : un médecin sabota
les installations de la salle de chirurgie d'un hôpital bruxellois,
puis s'en fut expliquer au micro d'un poste périphérique que l'orga-
nisation gouvernementale des services de garde dans cet hôpital
ne pourrait qu'entraîner des catastrophes. Il fut découvert et arrêté.
Il y eut aussi des décès imputés à la grève, déjà dans sa première
phase. Il y eut des formations ouvertes pour non-assistance à per-
sonne en danger. Des médecins furent arrêtés mais promptement relà-
chés. En présence de ces faitsi, les chambres syndicales des médecins
étaient dans une situation contradictoire : elles ne pouvaient recon-
naître que leur grève avait des effets nuisibles. (4) sur la santé de la
population ni encore moins assumer la responsabilité de ces décès
alors que leur cause était déjà très impopulaire. Mais l'attitude
inverse les amenait à une impasse : affirmer que la grève n'avait
pas d'effet sur la santé publique, c'était dire que les gens peuvent
se porter tout aussi bien avec un tiers des effectifs médicaux, fonc-
tionnant de façon bureaucratisée, qu'avec une médecine libérale
einployant trois fois plus de médecins.
Paul TIKAL.
(3) En Belgique, pendant leur service militaire les prêtres et
étudiants en prêtrise ne sont pas affectés aux unités combattantes ;
ils sont employés comme infirmiers dans les hôpitaux militaires.
Jusqu'il y a quelques jours, c'était là le seul statut d'objecteur de
conscience qui existait en Belgique.
(4) Quant aux effets non nuisibles, on peut méditer sur le fait
que les accidents d'autos furent beaucoup moins fréquents durant
la grève.
- 78
LIBERATION DES CONTRACEPTIFS
« Douze centres de « Planning - familial » ont déjà
été ouverts et d'autres le seront sous peu. Des camions
munis de haut-parleurs vont se rendre dans le moindre
village pour faire connaître les méthodes de contrôle des
naissances. Le ministère de la Santé envisage en outre,
la distribution gratuite de contraceptifs... »
17 février 1964. Cette nouvelle vient de Tunisie.
*
LE COUP D'ÉTAT BRÉSILIEN
Ce qui frappe dans les événements récents du Brésil, c'est la
facilité avec laquelle la gauche s'est écroulée devant le coup d'Etat
militaire-réactionnaire.
Depuis 10 ans, depuis le suicide de Vargas, le Brésil glissait vers
un libéralisme politique et connaissait, surtout au cours des dernières
années, une effervescence très grande tant dans les milieux ouvriers
que dans les milieux universitaires : d'une part grèves revendicatives
et expansion des syndicats ; d'autre part, radicalisation des étudiants,
manifestations de rue, propagande ouverte autour de l'idée, vague
malgré l'apparence, de « révolution socialiste brésilienne ».
Entre le mouvement étudiant et le mouvement ouvrier il y
avait alliance de fait. Ensemble on réclamait la Réforme Urbaine
comportant l'expropriation d'appartements riches en faveur des
miséreux des « favelas » (bidonvilles), ensemble on dénonçait l'im-
périalisme américain et on aidait le mouvement paysan du moins
posait-on le principe de cette aide (1).
Il faut savoir cependant que dans cette alliance les étudiants
formaient l'aile radicale et que les syndicats ouvriers étaient liés
de mille manières à la bureaucratie gouvernementale qui, elle-
même avait évolué.
Traditionnellement au Brésil, seule comptait la vie locale et
celle-ci avait toujours été dominée par les propriétaires terriens.
Le pouvoir central était une émanation du pouvoir des « Coronels »,
les seigneurs des provinces. Mais Vargas, au cours de sa dictature
le renforça considérablement et créa le noyau d'une bureaucratie
étatique moderne tout en favorisant l'industrialisation du pays.
Sous la présidence de Kubitchek cette industrialisation se poursuivit
de manière effrénée, déséquilibrée, spéculative. Le Brésil est alors
un paradis pour les capitalistes étrangers qui souvent réalisent des
bénéfices de 60-70 % par an. L'industrie est liée au capital étranger
et en même temps au capital foncier : les propriétaires n'investissent
pas dans l'agriculture, l'industrie rapportant beaucoup plus. C'est sous
la présidence de Kubitchek qu'une tendance déjà ancienne se précise
de manière inquiétante : la population s'accroît beaucoup plus vite
que ne s'accroît la production alimentaire et le prix des haricots,
du maïs, du riz, aliments de base des couches populaires, monte
de manière vertigineuse. Sous la présidence de Goulart, qui a partie
liée avec les syndicats, la bureaucratie centrale s'étend, les entre-
prises industrielles étatiques se développent, on s'oriente vers une
planification et on installe, à partir du centre, des Compagnies
régionales d'aménagement.
Telle est la situation au moment du coup d'Etat du 1er avril :
la prépondérance d'une technocratie de gauche, agitation
étudiante qui se lie au mécontentement des campagnes, une bureau-
cratie syndicale liée à la technocratie et au gouvernement. Mais il
une
(1) V. dans le n° 36 de S. ou B. l'article « Impressions du Brésil »
(p. 40 à 51).
79
faut de plus comprendre le rôle que tiennent le parlement et
l'armée. Le parlement est légaliste, respecte les règles du jeu démo-
cratique et est élu et réélu dans des élections-miracle où le grand
propriétaire désigne d'avance le candidat gagnant. Le corps des
officiers par contre, sauf pour la marine, est d'origine plébeienne.
Il dénonce l'hypocrisie parlementaire, est tenté de recourir à la
force et est en même temps plus proche des revendications populaires.
Le gouvernement Goulart était soutenu par cette coalition de
fait : technocratie, corps des officiers, syndicats et sur la gauche,
par le monde frondeur de l'université. Il était soutenu aussi par
le Parti Communiste, parent pauvre, jeté dans l'illégalité. La théorie
de Carlos Prestes, chef du P. C., héros d'une équipée courageuse au
début des années 1930 maintenant vieilli et assagi était qu'il
existe au Brésil une bourgeoisie progressiste anti-impérialiste et
anti-féodale. Or, en fait cette bourgeoisie est introuvable, l'industrie
étant, nous l'avons noté, aux mains des étrangers et des propriétaires
fonciers.
Goulart est tombé voulant timidement résoudre le problème
clef du Brésil : le problème agraire. La constitution prévoyait que
toute expropriation foncière doit être indemnisée comptant, au prix
du marché. C'était, dans l'état des finances brésiliennes, fermer la
voie à toute réforme agraire, même limitée. Or Goulart promulgue
un décret expropriant sans l'indemnité prévue les terres non culti-
vées situées le long des routes et des chemins de fer. Ces terres, en
effet, avaient acquis de la valeur du fait même de l'ouverture, sur
le budget fédéral, de ces voies de communication. Cette mesure
était-elle légale ou ne l'était-elle pas ? Problème impossible à résou-
dre et au demeurant oiseux. Mais formellement cette question de la
légalité départage les camps ennemis. Contre Goulart se sont retrou-
vés le Farlement, les partis et les propriétaires auxquels ils sont
liés. Le fait décisif cependant a été le changement de front de
l'armée. D'une part le corps des officiers n'était pas homogène : la
marine et une partie des officiers de l'armée de terre et de l'air
étaient conservateurs. D'autre part, l'indiscipline, « la subversion >>
propagée par les éléments révolutionnaires commençait à gagner
seulement les campagnes mais les rangs même de l'armée.
Devant cette situation les officiers ont opté pour l'ordre et se sont
ralliés aux conservateurs. Mais ceci ne veut pas dire et c'est
important
pour l'avenir
qu'ils ont abandonné toute idée
réformiste.
Le confusionnisme, l'absence de fronts tranchés était l'aspect
le plus frappant de la vie politique brésilienne sous le gouverne-
ment Goulart. Les étudiants proclamaient ouvertement la nécessité
d'une révolution violente au Brésil, Leurs réunions se propagande
à Rio de Janeiro étaient interdites par le gouvernement de l'Etat,
par Carlos Lacerda. Mais cette interdiction était annulée parce
qu’on obtenait la protection de la police militaire (dépendant du
Gouvernement fédéral), qui se tenait dans la salle même où l'on
proclamait des intentions révolutionnaires. Cela paraissait facile
un bon tour habile. Mais du même coup cette propagande glissait
vers le verbalisme. Les étudiants ont bien organisé dans les campa-
gnes des sections des Ligues Paysannes, mais jamais la question
de l'armement de ces Ligues ne s'est posée sérieusement. Certes, ce
n'était pas facile : sur ce point aussi, l'armée aurait été intraitable.
Mais le confusionnisme allait plus loin. Au congrès paysan de
Belo Horizonte, en novembre 1961, à la tribune d'une salle oit
3.000 paysans criaient «La terre ou la mort ! » on pouvait voir
aussi bien Francisco Juliao, leader des Ligues Paysannes que les
étudiants révolutionnaires, les chefs syndicaux et le gouverneur de
l'Etat de Minas Gerais, Magalhaes Pinto, le plus grand banquier du
non
80
Brésil flirtant avec la gauche à cette époque, dirigeant en mars
dernier, avec Lacerda, le coup d'Etat réactionnaire.
**
Il est difficile de tracer des perspectives politiques. Les officiers
tenteront-ils au cours d'une étape ultérieure d'imposer une réforme
agraire ? Pour le moment, ils sont prisonniers de leurs alliés.
Washington a pris fait et cause pour le nouveau régime droitier.
Mais il n'est pas exclu par la suite qu'il soutienne un régime
réformiste si celui-ci paraît susceptible de garantir l'ordre.
Les révolutionnaires d'autre part tireront-ils les leçons des
événements en se délimitant nettement des partis de gouvernement ?
Dans les campagnes, en tout cas, l'étape suivante semble devoir
être l'armement la lutte de guérillas.
Benno SAREL.
**
sur
UN ECHANTILLON DE LA NOUVELLE HUMANITE FORGEE
EN U. R. S. S.
Une jeune soviétique s'ouvre de ses problèmes à la « Komso-
molskaia Pravda s (avril "64) :
« Je travaillé dans un laboratoire pour ne pas suc-
comber à l'ennui. Le salaire est petit ; mais cela n'a
pas d'importance car mon père, comme on dit chez nous
appartient à la catégorie des gens très aisés... Le soir,
nous autres jeunes gens, nous nous réunissons souvent.
Nous écoutons des disques étrangers, nous chantons,
nous dansons. Ma vie coule ainsi d'une soirée à l'autre.
Notre petit groupe est composé de jeunes gens appar-
tenant au même milieu et nous ne voulons pas nous
mêler aux « plébeiens ».
« Mais un jeune savant formé dans les écoles de
l'Etat est venu se joindre à nous et sa rencontre a été
pour moi un choc. Il m'a invitée à danser puis il a
commencé à me parler des jeunes travailleurs qui peinent
un chantier quelque part dans la taïga. De tels
propos ne sont pas admis dans notre milieu. Nous consi-
dérons en général que tous ceux qui vont dans ces coins
perdus sont des fous où des hommes d’un rang inférieur.
« Une autre fois on en vint à parler de l'art abstrait.
Dans notre milieu il est de bon ton de défendre cet art
et je l'ai défendu. Mais il a riposté avec beaucoup
d'esprit et je me suis sentie désarçonnée.
« Cette brusque intimité s'est terminée par une
brouille et Oleg le jeune savant. a cessé de fréquen-
ter notre groupe. Que dois-je faire maintenant ? Le
travail au laboratoire m'ennuie à mourir. Reprendre des
études ? Rien ne m'intéresse dans aucun domaine et
d'ailleurs je ne serais plus capable de me soumettre à
une discipline scolaire. Partir quelque part ? J'avoue
que cela me ferait peur car je suis trop habituée à notre
ville et à l'appartement de papa. Me marier ? Mais Oleg
ne voudrait pas de moi ».
En adressant sa lettre au journal la jeune fille demande qu'on
lui réponde dans l'espoir qu'on aidera à résoudre ses problèmes.
Mais prudente autant qu'expansive, elle a fait poster sa lettre d'une
autre ville que la sienne par une amie hôtesse de l'air. La · « Komso-
molskaia Pravda » a publié cette lettre sans aucun commentaire.
Nous n'en ferons pas non plus.
81.
CAMARADE MAO, TU FERAIS BIEN DE PORTER UN CASQUE...
Khrouchtchev (15 avril 64), venant d'assimiler le maoïsme au
trotskisme : « C'est la vie qui décidera qui a raison des dirigeants
communistes chinois ou des marxistes-leninistes. En tout cas, Trotsky
est déjà mort... »
LES NOUVELLES FORMES « SOCIALISTES » DE CONSOMMATION.
Depuis quelque temps en U. R. S. S., les journaux mènent cam-
pagne sur le thëme : « logez-vous vous-mêmes », et encouragent les
épargnants à s'acheter un appartement neuf. Il paraît que cette for-
mule non seulement soulage les dépenses de l'Etat, mais encore
stimule efficacement les entreprises de construction... Le reporter de
« Moscou-soir » (15 mai) interroge un « épargnant » qui s'est inscrit
sur une liste d'attente pour acheter une voiture : « pourquoi voulez-
vous acheter une voiture alors que vous n'êtes pas propriétaire d'un
logement ? » Réponse : « parce que l'Etat me fournira un logement
mais pas une voiture ».
«LE XVII° CONGRES DU P. C. F. EST CELUI DU RAJEUNIS-
SEMENT » (les journaux).
Le P. C. F. décide de couper les vivres à la revue « Clarté »
organe de l'Union des Etudiants Communistes.
UN CHEF PERDU POUR TOUT LE MONDE.
Si l'on veut un moment s'abstraire de toute passion,
on se prend à imaginer quelle contribution il (Thorez)
aurait apportée à la politique française si le destin l'avait
conduit à la tête non du parti communiste mais d'un
autre parti, qui fut de gouvernement sans être tout à
fait comme les autres. Le schisme de la classe ouvrière
aucun doute appauvri le personnel dirigeant
français.
Le Monde, 19 mai 1964.
a
sans
LE DIFFEREND SINO-SOVIETIQUE
Il n'y a plus de « différend idéologique » entre la Chine et
l'U. R. S. S., il y a explicitement et publiquement un conflit poli-
tique entre deux bureaucraties rivales. Cela a été depuis le début la
réalité de la querelle, mais c'est seulement depuis cet hiver que la
polémique se déploie sur son vrai terrain. Du reste, personne n'est
plus dupe des arguties théoriques qu’échangent les deux prétendants
à la direction du mouvement révolutionnaire mondial, comme on a
pu le voir à la conférence de solidarité afro-asiatique qui s'est tenue
à Alger fin mars.
Au cours de l'année 63 le conflit a évolué sur deux plans : celui
de la polémique idéologique et celui des maneuvres menées par
chacun des deux adversaires afin d'isoler l'autre ou du moins de
l'affaiblir. La polémique a culminé dans la publication en juin des
« 25 points » de Mao et de la « lettre ouverte » de Khrouchtchev.
Depuis lors on peut dire que les positions des deux camps sont clai-
rement formulées et aucun élément vraiment nouveau n'est intervenu
sur le plan théorique.
Sur le plan des rapports entre les partis communistes de Chine
et d’U. R. S. S., le fait marquant en 63 a été l'échec de la conférence
bipartite de Moscou au mois de juillet. Cet échec est lui-même en
rapport avec la conclusion du traité américano-soviétique sur l'arrêt
des essais nucléaires, qui était négocié au même moment et qui mar-
quait la volonté de l'U. R. S. S. de poursuivre sa politique de
82
un
« détente » avec l'ouest, ouverte au moment de l'affaire cubaine. Pour
les Chinois c'était là la confirmation de la trahison des soviétiques.
Le traité de Moscou fut l'occasion pour les deux adversaires de
compter leurs partisans. La Chine apparut largement en minorité
mais elle s'efforça de se rattraper en manœuvrant à l'intérieur des
multiples instances communistes ou para-communistes sur le plan
international pour se faire une clientèle. Par exemple la bureaucratie
de Pékin faillit réussir à créer une organisation syndicale afro-
asiatique d'où les syndicats soviétiques et communistes européens
seraient exclus. Des fractions pro-chinoises se constituèrent dans
assez grand nombre de partis communistes (indien, cyngalais,
belge, espagnol, etc.).
En même temps les Chinois et les Russes rivalisaient d'argu-
ments et d'offres alléchantes pour rallier à leur camp les pays du
Tiers-Monde, et particulièrement leurs leaders les plus prestigieux,
comme Ben Bella et Castro.
Ce durcissement de la concurrence entre les deux bureaucraties
contribua fortement à décanter la phraséologie dans laquelle s'enve-
loppaient les polémiques. En effet, chacun des adversaires voulut
démasquer l'autre, montrer quels étaient les intérêts réels qui se
cachaient derrière l'affirmation des grands principes. . C'est
pourquoi l'accord sur l'arrêt des polémiques ne fut pas respecté.
C'est pourquoi aussi, on en vint à reprocher à l'adversaire son com-
portement réel et non plus seulement ses théories, et bientôt on fit
flèche de tout bois comme on le voit dans les éditoriaux-fleuves du
.« Drapeau Rouge » de Pékin ou la lettre du F: C. chinois du
29 février 64, d'un côté, et dans le rapport Souslov au comité central
du P. C. de l’U. R. S. S. (prononcé en février, publié en avril) ou
dans les discours de Khrouchtchev en Hongrie, de l'autre côté.
Les accusations que contiennent ces textes et qui sont souvent
étayées de preuves, constituent la plus impitoyable mise à nu des
rapports qui ont pu exister entre deux Etats bureaucratiques. Sur ce
chapitre, ce sont surtout les Russes qui sont en posture d'accusés.
Dans sa lettre du 29 février, le P. C. chinois reproche à l’U. R. S. S. :
d'avoir transformé le commerce avec la Chine en instrument
d'intervention politique dans les affaires chinoises ;
d'avoir introduit « la loi de la jungle du monde capitaliste »
dans les rapports entre pays socialistes. A cet égard la lettre affirme
que l'aide soviétique devait être consacrée à l'achat d'armes en
U. R. S. S., que même les armes fournies au moment de la guerre
de Corée pour résister aux Américains ont dû être payées, que l'aide
russe a toujours été établie sur une base strictement commerciale
et que le prix de nombreuses marchandises soviétiques était supé-
rieur au cours mondial. La lettre reproche également aux
d'utiliser le Comecon à leur profit, en retardant, pour satisfaire leurs
propres besoins, l'industrialisation des pays frères ;
d'avoir retiré les experts qui se trouvaient en Chine par une
décision unilatérale, en causant un grave préjudice à l'économie
chinoise ;
de mener des activités subversives le long de la frontière
commune et de refuser à réviser sur une base égalitaire les « traités
inégaux » imposés par la Russie à la Chine à l'époque coloniale.
Quand on se souvient de la façon dont l’U. R. S. S. a traité les
démocraties populaires du temps où elle pouvait se le permettre, les
accusations de Pékin se passent de commentaire. On se souvient
égalemen qu'il y a quelques années l’Egypte avait révélé que
l’U. R. S. S. lui troquait son coton contre diverses marchandises,
notamment des armes, pour le revendre sur le marché mondial avec
un large bénéfice.
Sur ce plan, de par la nature même des rapports entre la Chine
et l’U. R. S. S., celle-ci est mal placée pour répondre. Mais elle contre-
russes
83
« les
attaque sur le plan de la politique intérieure chinoise. Là, le P. C.
russe a une grande force : il se place dans la ligne de la déstalini-
sation ce qui lui donne d'emblée l'audience non seulement des
masses russes, mais aussi des clientèles des partis communistes occi-
dentaux. Pour Khrouchtchev et son équipe, les. Chinois ne sont rien
d'autre que le stalinisme vivant. Et il est vrai qu'il leur est encore
plus profitable de pouvoir se donner le mérite de combattre un
Staline réincarné en Mao que de s'acharner sur le cadavre du « petit
père des peuples » mort depuis onze ans. Les attaques que le P. C.
de l'U. R. S. S. lance contre le P. C. chinois sont toutes dans le
prolongement de celles qu'il lance contre Staline.
Ainsi lorsqu'il dénonce les entorses commises par Mao dans le
fonctionnement de son propre parti, par exemple le fait que le
ge congrès du P. C. chinois se soit tenu en deux sessions, en 56 et 58,
la première, selon la Pravda (29 avril) ayant servi de répétition
générale à la seconde qui s'est déroulée dans le plus grand secret ;
ou encore le fait qu'il n'y ait pas eu depuis d'autre congrès, au mépris
des règles internes du parti.
De même lorsque le P. C. russe critique impitoyablement et
là c'est beaucoup plus perfide la politique économique de Pékin.
Non sans cynisme, il accuse les dirigeants chinois de se préoccuper
principalement de « mettre la ceinture >> au peuple chinois. Selon
Khrouchtchev le fond de la politique chinoise est celui-ci :
dirigeants chinois veulent détourner l'attention de la population de
la question fondamentale : comment manger ».
A plusieurs reprises Khrouchtchev laisse clairement entendre que
l'ambition des communistes chinois est de construire le communisme
sur la misère, sur la famine même.
C'est le même problème qui est posé lorsque les Russes repro-
chent aux Chinois de préconiser une stratégie révolutionnaire qui
méconnait les problèmes économiques, et lorsque les Chinois jettent
à la figure des Russes qu'ils n'ont d'autre souci que de conserver
leurs avantages acquis, leur prospérité, aux dépens des «damnés de
la terre » et qu'ils se comportent comme des gens nantis, des capi-
talistes en somme le terme sans être directement appliqué aux
soviétiques émerge à plusieurs reprises dans les réquisitoires chinois.
Ainsi c'est le problème même des sociétés russe et chinoise qui est
posé explicitement. Une société dominée par le seul idéal de la
consommation, d'un côté, un régime d'arbitraire, de terreur et de
surexploitation aux mains d'un groupe de dirigeants assoiffés de
puissance, de l'autre côté, telle est, en forçant à peine, l'image que
chacun des deux plus grands pays socialistes donne de l'autre,
preuves à l'appui. Il est bien évident que chaque fois que l'un veut
démasquer l'autre il se démasque lui-même en même temps. D'au-
tant plus que bien souvent les accusations se prêtent parfaitement
à l'effet boomerang, par exemple lorsque les deux adversaires s'accu-
sent de vouloir dominer le mouvement communiste mondial ou de
chercher à provoquer un changement dans le personnel dirigeant
du pays rival. Certaines formules utilisées vont très loin, par exemple
celle-ci" relevée dans un article des Izvestia du 15 mai : « la dicta-
ture du prolétariat en Chine n'est pas autre chose aujourd'hui que
celle d'un groupe de dirigeants »....
Indirectement, les deux bureaucraties se dénoncent elles-mêmes
encore par la nature profondément réactionnaire des sentiments
qu'elles utilisent pour essayer de mobiliser les masses contre l'adver-
saire. Les Chinois ont donné maint exemple d'un racisme « anti-
blanc.» dépourvu de toute pudeur. Chez les Russes c'est plus subtil,
mais il y a bien un certain racisme dans la condescendance, par
exemple, avec laquelle ils parlent des erreurs grossières commises
par les techniciens chinois. Le chauvinisme éclate de toute part, bien
que d'un côté comme de l'autre on prétende s'inspirer de l'internatio-
84
nalisme. La vanité nationale des dirigeants Chinois s'étale en toute
occasion, tandis que les soviétiques ne manquent pas un prétexte
pour prendre la pose du sentiment national outragé, que ce soit à
propos des incidents de frontière, des insultes subies par leur repré-
sentant dans un organisme international ou du sort réservé en Chine
à leurs « experts ». Enfin, et c'est probablement ce qu'il y a de plus
répugnant, le sentiment que semble animer en profondeur toute la
polémique et que de part et d'autre on paraît chercher à susciter ou
à réveiller chez les masses, c'est du côté russe, la peur de « partager »
et du côté chinois la jalousie à l'égard du nanti.
La capacité de démystification du conflit -sino-soviétique s'est
ainsi considérablement élargie dans cette nouvelle phase ou, à la
fois, il pose crûment les problèmes et où les deux adversaires se
combattent publiquement en faisant appel sans détour aux masses
sous-développées et aux clientèles des organisations communistes ou
para-communistes dont le contrôle constitue pour une large part
l'enjeu de la querelle. Un premier résultat c'est que les pays sous-
développés ont refusé de s'engager derrière l'un ou l'autre des deux
adversaires et leur ont dénié à tous deux le droit de parler en leur
nom. C'est ce qui ressort très clairement de la conférence de solidarité
afro-asiatique qui s'est tenue à Alger fin mars. Les dirigeants du
Tiers-Monde présents à la conférence n'ont pas caché leur déception
de voir les représentants soviétiques et chinois s'adresser à eux beau-
coup moins pour les aider à résumer leurs problèmes propres que
pour tenter de les rallier à leur cause.
Le second résultat du conflit sino-soviétique c'est qu'il n'y a plus
de direction mondiale du mouvement communiste. Cette conséquence
était apparue dès la brouille entre Pékin et Moscou mais elle s'est
maintenant traduite de manière beaucoup plus nette dans les faits.
Dix ans après la mort de Staline, sept ans après la dissolution du
Kominform, treize ans après la conclusion du pacte sino-soviétique,
non seulement le monde communiste n'a plus de centre d'autorité et
de décision, non seulement il se trouve diyisé en trois courants
principaux : « léninisme » chinois, « révisionnisme » yougoslave,
« réformisme » krouchtchevien, mais même une multitude de cou-
rants secondaires sont apparus et ne cessent đe s'affirmer. Le castrisme
s'impose de plus en plus comme l' « idéologie » (si l'on peut dire) du
mouvement révolutionnaire en Amérique Latine. Les P. C. italien
et roumain, pour des raisons différentes, 'prennent leurs distances
vis-à-vis de Moscou. Le P. C. français abandonne la doctrine du
parti unique. Le parti indonésien affirme qu'il est avant tout indo-
nésien... Sans même parler des scissions. La Chine pour l'instant a
tout intérêt à ce que ce processus se poursuive puisqu'il s'effectue au
détriment de Moscou. C'est pourquoi elle s'oppose à la convocation à
court terme d'une conférence de tous les partis communistes réclamée
par Moscou. Elle considère que le temps travaille pour elle et se
réserve évidemment de provoquer la bataille rangée lorsque l'issue
de celle-ci lui paraîtra favorable. L'intérêt de l’U. R. S. S. au contraire
est de provoquer la scission le plus tôt possible car une condam-
nation des positions chinoises par la grande majorité des partis
communistes du monde lui permettrait de consolider son rôle de
leader auprès de ceux qui lui resteraient fidèles et d'arrêter l'atomi-
sation du monde communiste. Mais précisément, beaucoup, comme
les Italiens, ne sont pas pressés de faire à nouveau acte d'obédience
à Moscou.
Quoi qu'il en soit, au point qu'il a atteint, l'évolution du conflit
dépend beaucoup moins des maneuvres des uns et des autres que
de la dynamique même qui le porte et qui prend profondément sa
source dans les réalités sociales du monde moderne.
P. CANJUERS.
85
Les Films
LE JOURNAL D'UNE FEMME DE CHAMBRE
Ce film saisissant par son style sec et dur déconcerte par tout
ce qui contraste avec ce style : une étrange hésitation quant au prin-
cipal personnage, une incohérence, sans doute un manque d'audace.
Tout le début nous prépare à ce que quelque chose arrive. Une
jeune parisienne (Jeanne Moreau, fine et sensible), s'engage comme
femme de chambre dans une maison de maître à la campagne : belle
maison petit château de gentilhomme campagnard
vieux meu-
bles sombres et compliqués une jeune maîtresse de maison sèche,
frigide, chicanière, comptant les morceaux de sucre, grattant sur la
nourriture des domestiques le maître de maison, une brute,
« porté sur la chose » mais borné, oisif, incapable d'initiative, d'ima-
gination le vieux Monsieur enfin, père de Madame, ridicule d'élé-
gance affectée, dominé par cette perversion qui lui fait cirer les
bottines de ses servantes, carresser ces bottines, s'endormir les serrant
contre lui.
L'office est à l'avenant, et là le personnage principal est le valet,
Joseph, homme cruel, sadique, secret, s'adonnant avec délectation à
une politique d'antisémitisme féroce.
Ce milieu fermé, dominé par des haines recuites a deux sorties
sur le monde : le curé qui vient rendre visite à Madame, à qui elle
se confie, à qui elle confie ses peines d'alcôve et qui lui donne une
réplique à la fois pudibonde et adéquate ; un capitaine en retraite,
voisin les deux jardins se touchent homme ridicule, sifflant des
marches de guerre, occupé essentiellement par la haine de son voisin.
L'arrivée dans ce milieu d'une parisienne, piquante et parfumée,
jette un trouble compréhensible. Quelle chose doit se passer. Mais
c'est là que le film tourne court. Des événements importants se produi-
sent. Joseph assassine et viole du moins le suggère-t-on
petite fille, ce qui hante Célestine, la femme de chambre. Mais cet
événement n'est pas dans l'ordre de l'attente. Octave Mirbeau, dans
le livre dont le film s'est inspiré, avait pris le parti impitoyable de
montrer que Célestine s'adapte, qu'elle s'abrutit en épousant Joseph.
Mais le film hésite, l'attention se disperse, et la fin, le mariage de
Célestine avec le voisin, capitaine en retraite, laisse une impression
d'inachevé.
Bunuel, réalisateur du film, lie de manière saisissante le racisme
de Joseph à sa cruauté névrotique. (« Douze Juifs tués en Roumanie
toujours ça de moins ! »). Mirbeau, on le sait s'était attaqué à
l'antisémitisme en 1900, soulevé par l'affaire Dreyfus. Mais pourquoi
Bunuel s'arrête-t-il à mi-chemin de notre époque ? Pourquoi met-il
en scène d'une main ferme les racistes, les Camelots du Roi.
de 1934 ? Qui se souvient de ce que signifie le cri « Vive Chiappe » ?
une
Benno SAREL.
86
LE SILENCE
Dans un compartiment, deux femmes, un enfant.
Deux femmes jeunes, belles.
L’une, Esther, les cheveux tirési, un tailleur strict, semble tendue,
indifférente au monde extérieur,
En regardant l'autre, Anna, on sait qu'il fait chaud, sa robe est
légère, des bijoux soulignent le cou et le bras.
Flus tard on verra qu'elles ont trop de choses à se dire, alors
entre elles, là, c'est le silence.
L'enfant voudrait rompre ce silence, aussi il sort. Dans le long
couloir il regarde une plaque où sont inscrits des mots en langue
étrangère, il regarde, il ne comprend pas.
Le voyage est interrompu car Esther ne peut résister à un
malaise.
C'est dans une vaste chambre d'hôtel qu'elles se retrouvent et
qu'elles vont dénouer le lent et pesant ruban de leur passion.
Esther garde la chambre. Le lit où elle suffoque, la table de
travail, les cigarettes, l'alcool qu'elle boit goulûment, le plaisir qu'elle
prend solitaire ne la libèrent pas de l'attachement tyrannique qu'elle
a pour sa sæur, Anna. Celle-ci n'occupe la chambre que pour la
quitter ; elle dort, se baigne, se pare, puis sort. Anna va vers les
autres. En fait elle ne rencontre que le spectacle des autres, dans
la loge du théâtre, au café, dans la rue. Même lorsqu'elle rencontre
et désire un compagnon de passage, il est étranger. Ainsi elle reste
solitaire, aussi. Le seul dialogue est avec sa seur, mais elles se
heurtent sans se rencontrer jamais. Esther accuse, Anna se défend.
Le travail intellectuel est aussi étranger à l'une, que la maternité et
la recherche de l'homme l'est à l'autre.
L'enfant est un frêle garçonnet dont les longs cheveux lisses
tombent vers les yeux. Son regard suit ces deux femmes, observe
la douceur sensuelle de sa mère aussi bien que l'inquiétante agonie
de sa tante.
Il est le seul être de ce film à rechercher l'issue, la compré-
hension, mais les adultes ont leurs problèmes, leur prison et l'on
sent qu'il voit là se dérouler ce qu'il vivra plus tard, lui aussi.
Bergman, avec sobriété et gravité, entraîne implacablement le
spectateur vers un univers bien connu du cinéma moderne : la soli-
tude, l'impossibilité de communiquer. Il exprime une situation dans
laquelle, plus les moyens de communications sont savamment déve-
loppés, plus il est difficile aux individus de se rejoindre pour une
activité, un amour, un avenir. Mais aussi, moins que jamais les
rapports des hommes ne peuvent être enfermés dans cadre
rigide de lieu, de principes, de catégorie sociale.
Dans Le silence on peut considérer la passion amoureuse de ces
femmes comme essentielle, mais pourquoi ne pas imaginer qu'elles
sont étrangères ? Que Bergman ne les a réunies que pour mieux les
comparer ?
un
-- 87
Dans chacune des réalisations de Bergman, comme dans celles
d'Antonioni, de Resnais, le personnage féminin anime le film. Il
n'incarne pas tant un rôle, une action déterminée qu'il représente une
sorte d'axe autour duquel l'auteur développe son thème romanesque
ou philosophique.
Ces femmes hésitent, doutent, cherchent leur propre sens, regar-
dent vivre l'homme et dans ce même temps font des choix. Cette
lente quête paraît quelquefois dérisoire, ou empreinte d'un pessi-
misme facile, mais elle illustre une époque où les attitudes et les
rôles sont moins que jamais immuablement fixées.
Louise MAI.
88
Les Livres
" L'OEIL DE MOSCOU " A PARIS
ou les archives de Jules-Humbert DROZ
ancien secrétaire de l'Internationale communiste (1)
Lorsque les historiens ont voulu faire de l'histoire une science,
leur premier effort a porté sur les « sources ». Le travail en équipe
de divers spécialistes, l'utilisation de certaines techniques de la
science moderne ont permis une « critique » des documents en vue
d'établir l'authenticité et l'intégrité des vestiges, la véracité des
témoignages. Mais le problème de la « synthèse historique » n'a pas
été résolu pour autant ; aucune vérification des hypothèses n'est
possible, l'objet de l'histoire étant dissous dans le passé et inacces-
sible en tant que tel. On a montré que la perspective de l'historien
est étroitement conditionnée et qu'en un sens l'histoire du Moyen
Age, écrite par exemple au dix-neuvième siècle, nous renseigne plus
sur le dix-neuvième siècle que sur le Moyen Age et, enfin, que les
hommes qui « font l'histoire ne savent pas l'histoire qu'ils font »
pour la bonne raison que la signification du présent est relative à
un avenir qui exercera un effet rétroactif sur ce présent devenu
passé. Pour beaucoup de français d'Algérie, le 13 mai 58 a été vécu
comme un espoir et ne peut plus être pensé, que comme une illusion.
Il semble que ces considérations bien connues sur la « Révolu-
tion copernicienne en histoire » qui serait ainsi moins fondée
sur les événements passés que sur l'esprit de l'historien soient
maintenant, sinon comprises à un niveau théorique, du moins
« vécues » -au niveau des « consommateurs >> des livres d'histoire.
Avant de lire un ouvrage sur la Résistance, sur l’U. R. S. S. ou sur
les U. S. A., on tient à savoir « quelles sont les idées » de l'auteur,
à quel parti il appartient éventuellement, etc. C'est, sans doute, la
conscience de ce phénomène qui est à l'origine de nouvelles collec-
tions, par exemple Kiosque ou Archives, qui n'ont d'autre ambition
que de présenter le «document brut ». Ainsi l'historien n'est plus
celui qui a fait le livre mais celui qui le lit (2). Naturellement, les
choses ne
sont pas aussi nettes dans la pratique : le choix des
(1) Textes et notes établis par Annie Kriegel. Collection Archives,
Julliard, 1964, 265 p. Prix: 4,95 F.
(2) On a noté le même phénomène à propos de la nouvelle pein-
ture, du nouveau roman, du nouveau cinéma : le spectateur de
Marienbad doit composer son film, etc."
89
documents, les coupures et les juxtapositions (3) réintroduisent
l'optique de celui qui a composé le livre ; toutefois, le lecteur semble
voir, tout de même, dans la nouvelle formule, une diminution du
coefficient individuel si on s'en rapporte au succès des collections
de ce genre, compte tenu du fait que le prix de vente est calculé
en fonction d'une large diffusion.
Certes, dira-t-on, chacun effectue une lecture qui réintroduit le
coefficient personnel. Mais il reste que la liberté qui est volontai-
rement laissée au lecteur le provoque à la réflexion ; comme on ne
lui impose rien il n'a l'occasion ni d'adhérer avec une foi passionnée
ni, en sens inverse, de regimber ; il est sur le chemin de cette « libre
et scientifique recherche » préconisée par Marx, dans la préface du
Capital. La nouveauté de cette méthode apparaît particulièrement à
la lecture du second numéro de la collection Archives qui a précisé-
ment pour but de nous mettre en présence de l'attitude radicalement
contraire : en l'espèce l'interventionnisme incessant du Komintern
dans le parti communiste français, vers 1922-24.
On sait que la scission de Tours (à laquelle un autre volume
de la collection Archives est consacré) s'était faite dans une certaine
confusion. Il en avait résulté que la majorité « communiste » était
relativement hétérogène et comprenait une droite, un centre et une
gauche. Cette dernière, seule, s'était réellement alignée sur les
positions de la III° Internationale, d'où divers tiraillements. Si, en
effet, la Seconde Internationale n'était qu'une sorte de fédération
de partis nationaux pleinement autonomes, le texte des 21 conditions
pour l'admission de la IIIe Internationale précisait bien que les
partis nationaux n'étaient que les bataillons disciplinés de l'état-
major du Komintern. Mais les majoritaires de Tours n'avaient pas
tous pris au sérieux le texte des 21 conditions, ce qui tendrait à
montrer que ce n'est pas seulement dans les minorités qu'il y a une
« majorité d'imbéciles ». Quoi qu'il en soit, le Comité exécutif de
l'Internationale communiste (I. C.) ne voulait pas d'une nouvelle
scission, comme celle de Livourne, en Italie, qui, en isolant la petite
gauche du centre et de la droite, aurait abouti à un minuscule P. C. F.
C'est pourquoi le Comité exécutif de l’I. C. envoya à Paris le cama-
rade Jules-Humbert Droz avec le mandat suivant, signé de Zinovieff :
« Le camarade Jules-Humbert Droz, est envoyé en France par le
« Comité Exécutif de l'Internationale Communiste, dans le but de
« s'informer de la vie du Parti Communiste français et pour inter-
« venir avec pleins pouvoirs dans le sens des décisions du Comité
« Exécutif concernant la France ».
Moscou, 27/IX.21.
N° 2433.
(ce document est reproduit par photocopie sur la couverture
du livre).
ne
(3) Le rôle du « metteur en scène » se borne naturellement
pas là : il choisit des photos, met au point un « petit appareil »
(chronologie, biographies, bibliographie), destiné à faciliter la lecture.
En effet, comme on dit, un amas de documents ne constitue - pas
plus un livre qu'un tas de pierres une maison.
90
Jules-Humbert Droz est un citoyen suisse, né en 1891, actuel-
lement secrétaire du Parti socialiste pour le canton de Neuchâtel.
En 1941, il avait perdu la direction du Parti communiste suisse, sur
ordre de Staline et avait été exclu en 1943. En effet, en 1928, il
avait fait partie du groupe Boukharine. Il avait été l'artisan de la
scission qui avait été à l'origine de la fondation du P. C. suisse
et, sur proposition de Lénine, avait été élu secrétaire de l'I. C. au
Troisième congrès mondial (1921). Il était particulièrement chargé
des « pays latins » dont la France.
Pendant au moins deux ans, Droz assista aux réunions des diver-
ses instances du P. C. F., envoyant régulièrement des « rapports »
(dont il a gardé les doubles) à Zinoviev avec, souvent, une copie
pour Trotsky. On se trouve ainsi en présence d'archives de premier
ordre qui contiennent, avec les rapports de Droz, le texte des
« instructions » du Komintern et de nombreuses lettres des dirigeants
du communisme mondial.
par le
Il n'est pas question de résumer ici ces textes et c'est, je crois,
rester dans l'esprit de la collection que de donner quelques extraits
bruts qui, dans Socialisme ou Barbarie, « parlent d'eux-mêmes ».
Alors que le P. C. F. était en train d'étudier le dossier de Fabre
en vue de son exclusion, la nouvelle de son « exécution »
Komintern parvint aŭ congrès par télégramme. Aussitôt «la com-
mission des conflits qui allait statuer suspendit ses travaux jugeant
inutile de prononcer une sanction si le cas était jugé d'en haut ».
(p. 66)
En conséquence, dans son rapport n° 3, Droz fait la propo-
sition suivante :
« Il serait peut-être bon que l'exécutif lui-même propose au
quatrième congrès (mondial de l’I. C.) de préciser le sens de l'arti-
cle 9 pour donner à l'exécutif le droit non pas seulement d'exiger
l'exclusion mais de la prononcer. » (p. 87).
Dans un rapport précédent, Droz ayant signalé, entre autres signes
d'irritation du P. C. F., que « Cachin avait fait de violents discours
contre les interventions continuelles de l'Exécutif, contre le discrédit
qu'elles jettent sur le parti » (p. 67), Zinoviev répondit : « Tous les
longuettistes latents ou demi-latents se trouvant encore dans les
rangs du P. C. ont beau faire autant de tapage hystérique qu'ils
désirent à propos des exclusions automatiques », l'Internationale
« devra toujours insister sur sa décision. Celle-ci a été parfaitement
bien et mûrement pesée et une fois prise elle doit être exécutée coûte
que coûte. Il faut que les ennemis de l'Internationale en France appren-
nent enfin que l'Internationale communiste ne plaisante pas. »
(p. 99). Dans le post-scriptum de cette même lettre, Zinoviev ajoutait :
« Quant à votre rencontre et votre conversation avec Verfeuil après
qu'ait paru son article ...elles étaient superflues. C'était trop montrer
d'égards à ce monsieur. On ne doit «converser » avec de tels person-
nages qu'avec l'aide d'une cravache. » (p. 104).
La conséquence de cet autoritarisme ne se fait pas attendre :
« les votes qui ont eu lieu sous mes yeux dans certaines sections
sur les nouveaux statuts me laissent pessimiste sur le redressement
91
du parti, écrit Droz à Zinoviev. On a voté sans lire les textes, sans
donner un mot d'explication, à l'unanimité, parce que le Comité
directeur les propose... » (p. 127).
Le comité exécutif de l'I. C. n’est sans doute pas très ému par
cette remarque puisque, dans l'instruction suivante, il précise :
« Un parti communiste n'est pas une arène de discussions oiseuses,
mais l'Union combative de l'avant-garde du prolétariat, défendant
un programme et une tactique déterminée. » (p. 131).
Déterminée par qui ? On le sait à la fin de l' « instruction » :
« Le comité exécutif de l'Internationale communiste charge sa délé-
gation de veiller à ce que soient envoyés en temps utile à Moscou
tous les projets de résolutions qui seront soumis à l'examen du
Congrès de Paris, ainsi que les listes des candidats au nouveau
Comité directeur du parti afin que le Comité exécutif de l’I. C. puisse
se prononcer en temps utile sur toutes ces questions. » (p. 135).
Et voilà !
A lire l'ensemble des textes, on se persuade que Trotsky a joué
un rôle de premier plan dans cette mise au pas (militaire) des
partis nationaux. Le nom de Lénine n'apparaît presque pas.
De telles méthodes avaient sans doute pour but de réaliser, à
brève échéance la révolution prolétarienne dans l'Europe entière. En
fait leur résultat le plus remarquable a été de présenter sur
plateau, à Staline, un instrument pour soumettre les divers partis
nationaux au Parti russe et bientôt au « chef génial » des peuples.
un
Yvon BOURDET.
92
Réunion publique à Clichy
Le 29 avril, deux camarades se sont rendus à Clichy, invités à
exposer les idées du groupe Socialisme ou Barbarie sur les problèmes
du mouvement révolutionnaire sous le capitalisme moderne, devant
une assistance composée de membres du P. S. U., de jeunes et de
plusieurs militants syndicalistes.
P. Cardan exposa rapidement l'historique de nos positions actuel-
les, en reliant notre analyse de la société moderne et de sa contra-
diction fondamentale avec la critique de la bureaucratie de
l’U. R. S. S., et de la place de l'économie dans l'évolution de la
société, il montra ensuite comment la réalisation par le capitalisme
bureaucratique de revendications formulées autrefois par le mouve-
ment ouvrier et l'expérience même des ouvriers (dégénérescence de
la révolution russe, conseils ouvriers, etc....), obligeaient à définir
une nouvelle conception du socialisme et les conséquences qui s'en-
suivaient pour la théorie révolutionnaire et, pour la conception d'une
organisation militante.
Au cours de la discussion qui suivit, plusieurs assistants firent
des interventions centrées autour du problème des revendications
ouvrières et des possibilités d'action syndicale. Le camarade Mattei,
du P. S. U., fit une critique plus longue défendant en gros le travail
qu'il est probable d'accomplir dans une organisation telle que le
P. S. U. Sans contester formellement le besoin d'un renouvellement
idéologique ni la constatation de la dépolitisation actuelle, il affirma
qu'il fallait travailler avec ce qu'on avait, que la seule position
politique efficace était de prendre les gens tels qu'ils étaient, les
organisations si imparfaites qu'elles soient telles qu'elles
existaient.
Au total, la discussion fit apparaître des points d'accord et
quelques divergences : en accord, la volonté de poser la question
du socialisme sous l'angle de la gestion ouvrière, la nécessité d'un
réexamen des objectifs socialistes du point de vue de la vie et des
besoins concrets des hommes, la nécessité de prendre en considé-
ration tous les problèmes de la société et d'abandonner le privilège
absolu accordé à l'économique.
En divergence, l'appréciation du rôle des syndicats et, semble-
t-il, du rapport du militantisme révolutionnaire et de la vie sociale.
A la fin, tout le monde se trouva d'accord pour donner une suite
à cet échange d'idées et d'expériences. Après cette première discus-
sion, volontairement placée sur un plan général, il fut décidé
d'aborder des problèmes concrets susceptibles d'intéresser davan-
tage les militants et notamment les jeunes ouvriers de Clichy. La
prochaine réunion, prévue pour juin, sera introduite par un exposé
de D. Mothé concernant le syndicalisme et le militantisme révolu-
tionnaire dans l'usine.
93 -